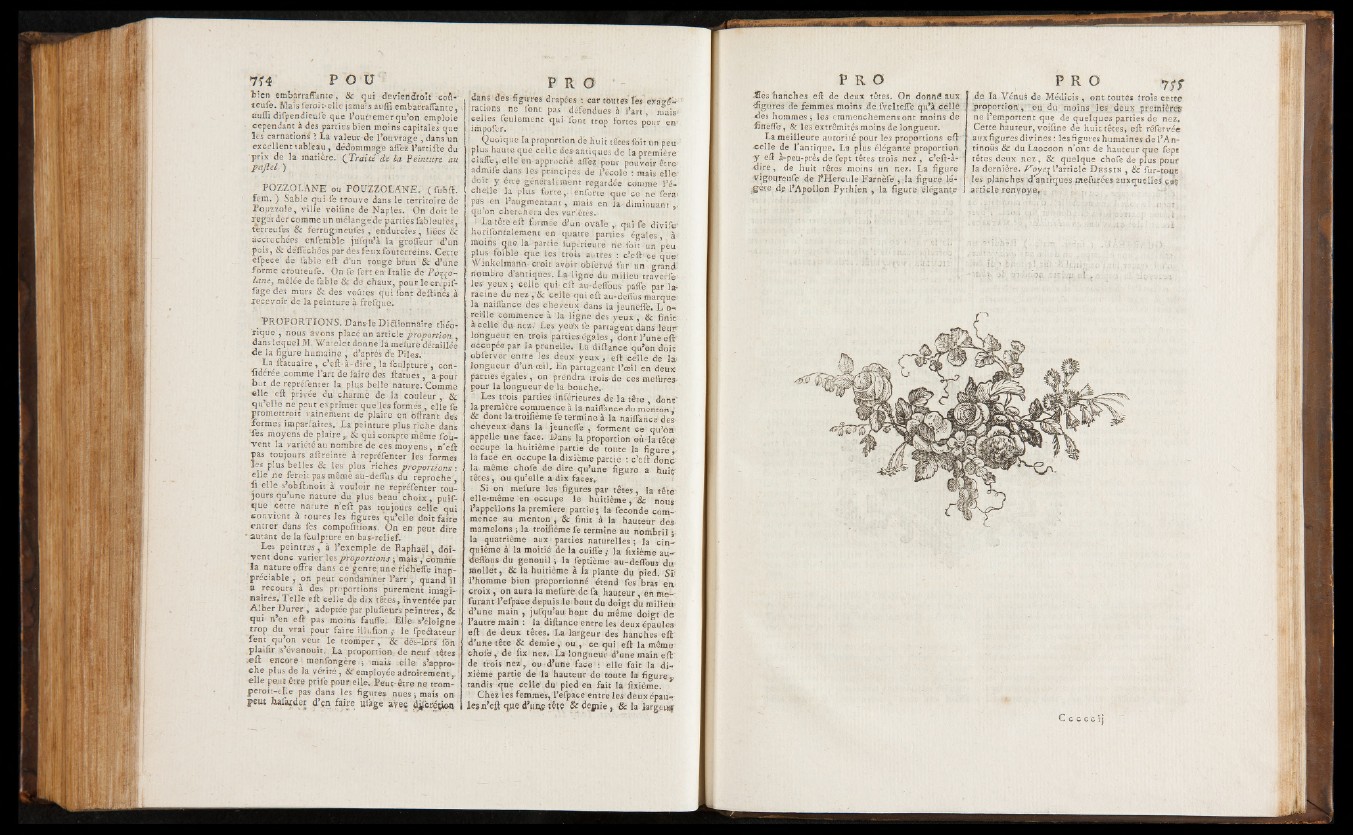
bien embarraffante, & qui devîendroît coft--
teufe. Mais feroit-elle jamais auïfi embarraflante , •.
aufîi difpendieufé que l’outremer qu’on emploie
cependant à des parties bien moins capitales que
les carnations’ ? La valeur de l ’ouvrage , dans un
excellent tableau , dédommage aflez l’ artifte du
prix de la matière. (Traité de la Peinture au
pafiel- )
POZZOLANE ou POUZZOLANE. ( fiibft.
fem. ) Sable qui fe trouve dans le territoire de
Pouzzole, v ille vôifine dé Naples. On doit le
regarder comme un mélange de parties fableufes,
terreufes 8c ferrugjneüfes , endurcies ; liées &
accrochées enfemble jüfqu’à la groffeur d’un
pois, & defféchêes par des feux fouterrêins. Cette
éfpece de iable eft d’un rouge brun & 'd’üne
forme crouteufe. On fe fert en Italie de P 6m o ~
Zane, mêlée de fable & de chaux, pour le crépif-
fage des murs & des voûtes qui font deftines.à
Recevoir de la peinture à. frefque.
^ PROPORTIONS. Dansîe P légionnaire fHéôrique
, nous avons placé un article proportion,
dans lequel M. W at elet donne là mefuredétaillée
de la figure humaine , d’après de Piles. ‘
Laftatuaire, c’eft-à-dire, la fculpturê , con-
fidérée comme l’art de faire dés fiat u e s , a pour
but de repréfenter la plus belle nature. Comme
«lie eft privée du- charmé de la couleur &
qu’elle ne peut; exprimer quelles formés,, elle fe
promettroit vainement de plaire en offrant des
formes imparfaites. La peinture plus riche dans '
Tes moyens de plaire y 8c qui compte même foule
n t la variété au nombre de ces moyens, n’eft
pas toujours aftreinte à repréfenter les formes
les plus belles & les plus riches proportions :
elle ne fëVok pas même au-deffus du reproche" ■
Pi elle s’obftinoit à vouloir ne repréfenter toujours
qu’ une nature du plus beau ch o ix , puif-
que cette nature n’eft pas toujours celle qui
convient à toutes les figures qii’ éile doit faire
entrer dans fes compofitions. On en peut dire
* autant de la fculpturê en bas-relief.
Les peintres, à l’exemple de Raphaël, doivent
donc varier les proportions ; mais ,5cbmme
la nature offre dans ce genre, unê fiçhéffe inappréciable
, on peut condamner l’a r r , quand il
a recours à des proportions purement imagr-i
«aires. T elle eft celle dé dix têtes, inventée par
Alber Durer, adoptée jiar plufiéurs peintres, &
qui n’ en eft pas moins faufle.. Elle s’éloigne -
trop du vrai pour faire illufion ; le fpe&ateur ?
fent qu’on veut le tromper", &"aës-Tpfs" fôh ^
plaifir s’évanouit. La proportion de neuf t^tes-j'
.eft encore menfongère. ; -mais -elle s’appro- m
che plus de la vérité , employée adroitement,,
elle peut .être prife pouf?elle., Peut-être ne trom-
peroit-elie pas dans les figures nues i mais on-
pettt Hafarder d’en faire ulàge avec dÿcréj^on
dans" dés figures drapées : car toutes Tes eya'géi*
: rations ne font pas défendues à l’art, mais“
Icelles feulement qui- font trop fortes pour en'
impofer. > r *
1 Quoique la proportion dé Huit têtes foit un
i plus haute que celle des>antiques de la première
•clàffe ,. elle-ën-approche afié? pour pouvoir 'être-'
admife dans les principes de l’école : mais e lle -
! doit y être génétalèment regardée comme l’échelle
la plus forte ,• -enforte que ce ne fera»
pas en l’augmentant, mais en la diminuant
q.u on cherchera des variétés.-
» La-têtëéft formée d’ un o v a l e q u i fe divîfe*
horilbntalement en quatre parties égales , à
moins qùe la -'partie fupérieure rie.foit’un peu
; plus foiblè que les trois autres : c-’eft ce que*
f Winkelman'n- croit avèir obfervé fur un grand-
nombre d antiques. La-ligne du milieu traverfe-
les y eu x; celle qui> e'ft au-deffous paffe paria-
racine du nez , 8c celle qui eft au-deffus marque-
la naiffance des cheveux dans la jeuneffe. D o -
; refile commence à-la ligne des yeux , & finit
â celle du; nezV Les yeux te partagent dans leurf
longueur en trois parties égales, dont l’une eft
occupée par la prunelle. La diftance qu’ on doit
obier ver entre les deux y e u x , eft celle de la
longueur d’un-oeil. En partageant l’oeil en deux
, parties égales,, on prendra trois-de ces mefures’
pour la longueur de la bouche.-
{ ' Les trois parties -inférieures de la tête dont"
la-première commence à la naiffance du menton '
& dont la troifième fe termine à la naiffaiiee des
cheveux dans la- jeuneffe , forment ce qu’on
appelle une face. JJans la proportion où-la-tête-
occupe- la huitième partie de toute la figure r
la face en occupe la dixième partie : c’eft dont
la même chofe de dire qu’ une figure a huit
têtes, ou qu’ elle a dix faces.-
Si on mefure les figures par têtes, la tète-
elle-même en occupe le huitième , & nous
l’appelions la première partie ; la fécondé commence
au menton , & finit à la hauteur desmamelons
; la troifième fe termine au nombril ;
la quatrième aux parties naturelles ; la cinquième
ài la moitié de la cuiffe ,- la fixième au-
deffous du genouil; la feptième au-deffous du
mollet, & la huitième à la plante du pied. Si'
l ’homme bien proportionné étend fes bras en-
croix , on aura la mefure de fa hauteur , en tne
rurânt l’efpace depuis le bout du doigt du milieu-
d’une main , jufquau bout du même doigt de
l’autre main : la diftance entre les deux épaules-
eft de deux têtes. La largeur des hanches eft
d’une-tête & demie , ou , ce. qui èft là même -
chofe , de ftx nez. La longueur d’ une main eft
de trois nez,, ou-d’ une face : elle fait la di- ’
xième partie de la hauteur de toute la figure y
tandis que celle du pied en fait là fixième.
: Chez les femmes, l’elÿace entre les deux épaur
les n’eft que d’un£ tête & dejnie, & la largci«f
Æès hatichès eft de deux têtes. On donné aux
^figures de femmes moins de fveltefle qu’ à cellê ;
des hommes; les emmenchemensont moins de
finéfte, & les extrémités moins de longueur.
La meilleure autorité pour les proportions eft ‘‘
celle de l’antique. La plus élégante proportion
y eft à-peu-près de fept têtes trois nez , c’eft-à- ■
d ire , de huit têtes moins un nez. La figure
de Î’H erc u le Earnèfe> ÿ -1a. ftgu;Ee:, tq-
îgère .dp l’Apollon PytHIen , la figuré "élégante i
de la Vénus de Médicis, ont toutes trois cette
.proportion', ' oii du moins les deux premières
ne l’emportent que de quelques parties de nez.
Cette hauteur, voifine de huit têtes, eft réfervée
aux figures divines : les figures humaines d e l’An-
tinoüs & du Laocoon n’ont de hauteur que fept
têtes deux n e z , & quelque chofe de plus pour
la dernière. Voye^ l’ article Dessin , & fur-tout
les planches d’antfques mefurées auxquelles çeç
article renvoyé,: .
P
C c c c c ij