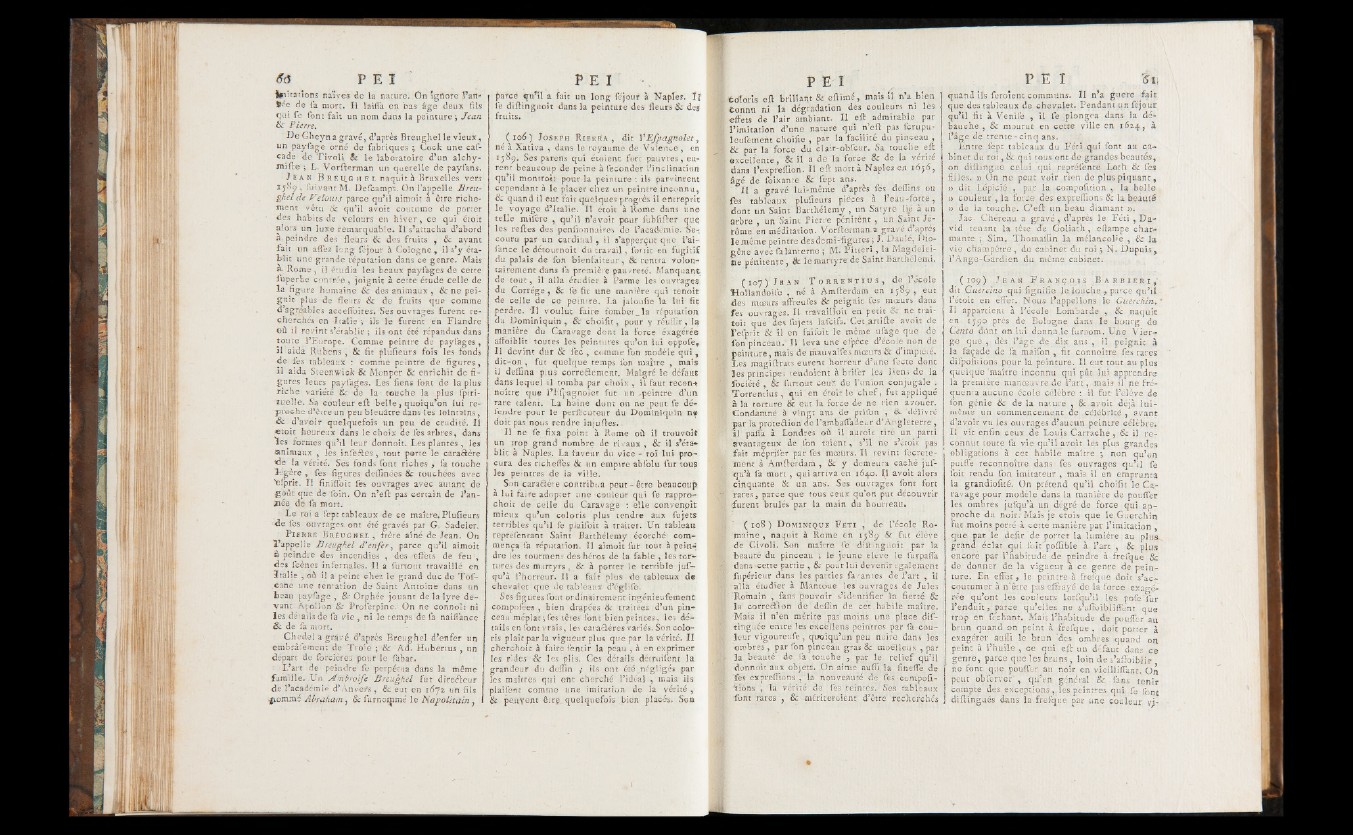
imitations naïves -de la nature. On ïgttore l ’art-
Itfe de fa mort. I l laiffa en bas âge deux fils
qui fe font fait un nom dans la peinture ; Jean
8c Pierre.
De Gheyn a gravé, d’après Breughel le vieux ,
un payfage orné de fabriques ; Cock une caf-
cade de Tiv o li & le laboratoire d’ un alchy-
niifte -, L. Vorfterman un querelle de payfans.
J ea n B rk u.g h e l naquit à Bruxelles vers
15S9, fuivantM. Defcamps. On l’appelle Breughel
de Velouts parce qu’ il aimoit a être richement
vêtu 6c qu’il avoit coutume de porter
des habits de velours en h iv e r , ce qui étoit
alors un luxe remarquable. Il s’attacha d’abord
à peindre des fleurs & des fruits , & ayant
fait un affez long féjour à Cologne , il s’y établit
une grande réputation dans ce genre. Mais
a. Rome , il étudia les beaux payfages de cette
fuperbe contrée, joignit à cette étude celle de
la figure humaine & des animaux , & ne peignit
plus de fleurs & de fruits que comme
d agréables acceffoires. Ses ouvrages furent recherchés
en Italie ', ils le furent en Flandre
où il revint s’établir ; ils ont été répandus dans
toute l ’Europe. Comme peintre de payfages,
il aida Rubens , & fit plufieurs fois les fonds
de Tes tableaux : comme peintre de figures,
i l aida Sreenwick & Monper 6c enrichit de figures
leurs payfages. Les Tiens font de la plus
riche variété 6c de la touche la plus fpiri-
tuelle. Sa couleur eft belle , quoiqu’on lui reproche
d’être un peu bleuâtre dans les lointains,
& d’avoir quelquefois un peu de crudité. Il
«toit heureux dans le choix de les arbres, dans
le s formes qu’ il leur donnoit. Les plantes, les
animaux , les infectes, tout porte le caraâère
’de la vérité. Ses fonds font riches y fa touche
légère , fes figures defîinées & touchées avec
’elprit. Il finiffoit fes ouvrages avec autant de
goût que de loin. On n’efr pas certain de l’an-
3née de fa mort.
Le roi a fept tableaux de ce maître; Plufieurs
de fes ouvrages, ont été gravés par G. Sadeler,
P ierre Breughel , frère aîné de Jean. On
l ’appelle Breughel d’enfer, parce qu’ il aimoit
â peindre des incendies , des .effets de feu ',
des fcènos infernales. I l a furtout travaillé en
Italie , où il a peint chez le grand duc de Tof-
cane une tentation de Saint Antoine dans un
beau payfage , & Orphée jouant de la lyre devant
Apollon 6c Proférpine. On ne connoît ni
les détails de fa vie , ni le temps de fa naiffance
& de fa mort. -
Chedel a gravé d’ après Breughel d’ enfer un
embrâfemcnt de Troie y 8c Ad. Hubercus, un
départ de Torcières pour le fabat.
L’ art de peindre fe perpétua dans la même
famille.- Un Anibroife Breughel fut direéleur
de l’académie d’ Anvers , & eut en 1672 un fils
■ pommé Abraham, 8c furnoipmé le Napolitain ,
^>ârcë qu’ il a fait un long féjour à Naples. I|
fe diffinguoit dans la peinture des fleurs 8c des
fruits;
( 106 ) Joseph Ribeüa , dit VEfpagnolet,
né à Xatlva , dans le royaume de Valence , en
158p. Ses parens qui étoient fort pauvres, eurent
beaucoup de peine à féconder l’inclination
qu’ il montroit pour la peinture : ils parvinrent
cependant à le placer chez un peintre inconnu,
8c quand il eut fait quelques progrès il entreprit
le voyage d’Italie. Il étoit à Rome dans une
telle mil’ère , qu’ il n’avoit pour fubfifter quç
les reftes des penfionnaires de l’académie. Se-,
couru par un cardinal , il s’apperçut que rai-
fan ce le détournoit du travail, forcit en fugitif
du palais de fon bienfaiteur, & rentra volontairement
dans fa première pauvreté. Manquant
de tout, il alla étudier à Parme les ouvrages,
du Corrége , & fe fit une manière qui tenoic
de celle de ce peintre. La jaloufie la lui fie
perdre. '11 voulut faire fomber_la réputation
du Dominiquin , 8c choifit, pour y réulfir, la
manière du Caravage dont la force exagérée
affoiblit toutes les peintures qu’on lui oppofe,
Il devint dur 8c fec , comme fon modèle qui ,
dit-on , fut quelque temps fon maître , mais
- il deffina plus correélement. Malgré le défaut
dans lequel il tomba par choix , il faut reeon-t
noître que l’Efpagnolet fut un -peintre d’un
rare talent. La haine dont on ne peut fe défendre
pour le perfécuteur du Dominiquin n^
doit pas nous rendre injuftes.
Il ne Te fixa point à Rome où il trouvoit
un trop grand nombre de rivaux , & il s’éta»
blit a Naples. La faveur du vice - roi lui pro-
; cura des richefles 8c un empire abfolu furtou$
les peintres de la ville.
> Son caraéière contribua peut-être beaucoup
a lui faire adopter une couleur qui fe rappro-
choic de celle du Caravage : elle convenait
mieux qu’ un coloris plus tendre aux fujets
terribles qu’ il fe plaifoit à traiter. Un tableau
repréfentant Saint Barthélemy écorché- commença
fa réputation. Il aimoit fur tout à.pein«
dre les tourmens des héros de la fable , les tortures
des martyrs , 8c à porter le terrible ju f-
qu’ à l’ horreur. J1 a fait plus -de tableaux de
chevalet que de tableaux d’ cglife.
Ses figures font ordinairement ingénieufement
compofées-, bien drapées 6c traitées d’un pinceau
méplat •, fes têtes' font bien peintes, les détails
en font vrais, les caractères variés. Son coloris
plaît par la vigueur plus que par la vérité. II
cherchoit à faire fentir la peau , à en exprimer
les rides & les plis. Ces détails décruifent la
grandeur du deffin ; ils ont été.négligés par
les maîtres qui ont cherché l’ idéal , mais. ils
plaifenc comme une imitation de la vérité ,
& peuvent ê.tre_ quelquefois bien placés. Son
td o r is eft brillant & eftimé, mais il n’ a bien
Connu ni la dégradation des couleurs m les
effets de l’air ambiant. I l eft admirable par
l ’ imitation d’une nature qui n’eft pas ferupu-
leufement choifie , par la facilite du pinceau ,
& par la force du clair-obfcur. Sa touche, eft
excellente, & il a dé la force 8c de la vérité
dans l’expreflion. I l eft mort a Naples en 1656,
âgé de fôixante 8c lept ans.
I l a gravé lui-même d’après fés deffins ou
fes tableaux plufieurs pièces à l’eau-forte,
dont un Saint Barthélemy , un Satyre lié à un
arbre , un Saint Pierre pénitént , un Saint Jérôme
en méditation. Vorfterman a grave d apres
le même peintre des demi-figures-, J. Dame, Diogène
avec fa lanterne j M. Pitpèri, la Magdeleine
pénitente, 8c le martyre de Saint Barthélemi.
( 107 ) J a A N T o R R e N T i u s , de l’école
Hollandoiie , né à Amfterdam en 1589 , ;eut
des moeurs affreuies & peignit fes moeurs dans
fes ouvrages. Il travailloit en petit & ne trai-
toit que dés fujets lalcifs. Cet^rtifte avoit de
Tefprit 8c il en faifoit le même ufage que dp
fon pinceau.' I l leva une efp.èce d’école non de
' peinture, mais de mauvaifesmoeurs & d’ impiéré.
.. Les magiftrats eurent horreur d’une fecte dont
les principes tendoient à brifer les liens de la
■ fociété , oc furtout ceu?. de l ’union conjugale ;
. Torrentius, qui en étoit le c h e f , fut appliqué
à la torture & eut la force de ne rien avouer.
Condamné à vingt ans de prifon , 8c délivré
par la prôte&ion de Tambafladeur d’Angleterre ,
il paffa à Londres où il au roi t tiré un parti
avantageux de l'on talent, s’ il ne s’étoit pas
Tait meprifer par fes moeiirs. Il revint fecrete-
ment à Amfterdam , & y demeura caché juf-
erù’à fa mort, qui arriva en 1640. I^l avoit alors
cinquante & un ans. Ses ouvrages font fort
rares, parce que tous ceux qu’on pue découvrir
Turent brûlés par la main du bourreau.
( 10 8 ) D ominique F eti , de l’école Romaine,
naquit à Rome en 1589 8c fut élève
de Civoli. Son maître Te diltingiioïc par la
beauté du pinceau -, le jeune elève le furpaffa
dans cette partie , & pour lui devenir egalement
fupérieur dans les parties fa van tes de l ’art , il
alla étudier à Mantoue les ouvragés de Jules
Romain , fans pouvoir S'identifier la fierté &
la corredion de deffin de cet habile maître.
Mais il n’en mérite pas moins une place dif-
tingaée entre les eXcellens peintres par fa couleur
vigoureufe, quoiqu’ un peu noire dans les
ombres , par fon pinceau gras & moelleux , par
la beauté de fa touche , par le relief qu’ il
donnoit aux objets. .On aime âufii la fineffe de
Tes expreffions , 1a nouveauté de fes ccmpofi-
‘tions , la vérité" de fes Feintes. Ses tableaux
font rares , 8c mériteraient d’être recherchés
quand ils feroient commüns. I l n’ a guère fait
que des tableaux de chevalet. Pendant un féjour
qu’ il fit à Venife , il fe plongea dans la débauche.,
& mourut en cette ville en 1624, à
l’âge dë trente-cinq ans.
Entre fept tableaux du Féti -qui font au cabinet
du roi , 8c qui tous ont de grandes beautés,
on diftingue celui qui repréfente Lot h 8c fes
filles. » On ne peut voir rien de plus piquant,
» dit Lépiciq , par la compofidon , la belle
» couleur , la force des expreffions 8c la beauté
» de la touche. C’ eft un beau diamant »;
Jac. Chéreau a gravé, d’après le Féti , David
tenant la tête de Goliath , e Hampe charmante
y Sim. Thomaffin la mélancolie , & la
vie champêtre, du cabinet du r o i -, N. Dupuis,
l’Ange-Gardien du même cabinet.
(10 9 ) J e a n F r a n ç o i s B a r b i é r i ,-
dit Guercino qui fignifie le,.louche , parce qu’ il
l’étoic .en effet. Nous l’appelions le Guerchin*'
Il appartient à l ’école Lombarde , & naquit
en 1590 près de Bologne dans le bourg de
Cento dont on lui donna le furnom. Une Vierge
que , dès, l’âge .de dix ans , il peignit à
la façade de fa maifon , fit connoître fes rares
difpofitions pour la peinture. Il eut tout au plus
quelque 'maître inconnu qui pût lui apprendre
la première manoeuvre de l’a r t , mais il pe fréquenta
aucune école célèbre : il fut l’élève de
fon génie 8c de la nature , 8c avoit déjà'lui-
même un commencement de célébrité , avant
d’avoir vu les ouvrages d’aucun peintre célèbre*
Il vit enfin ceux de Louis Carrache , & il reconnut
toute fa vie qu’ il avoit lès plus grandes
obligations à cet habile maître -, non qu’on
puiffe reconnoître dans fes ouvrages qu’ il fe
l'oit rendu fon imitateur , mais il en emprunta
la grandiofité. On prétend qu’ il choifit le Caravage
pour modèle dans la manière de pouffer
les ombres jufqu’ à un degré de force qui approche
du noir; Mais je crois que le Guerchin
rue moins porré à cette manière par l’ imitation ,
que par le defir de porter la lumière au plus.,
grand éclat qui foît poffible à l’art , 8c plus
encore par l’ habitude de geindre à frefque 8c
de donner de la vigueur a ce genre de peinture.
En effet, le peintre à frefque doit s’accoutumer
à n'être pas effrayé de la force exagérée
qu’ont les couleurs lorfqu’il les pofe'fur
l’enduit, parce qu’elles ne s’afFcibliflUnt que
trop en féchant. Mais l’habitude de pouffer au
brun quand on peint à frefque , doit porter à
: exagérer auffi le brun 'des ombres quand on
peint à l’ huile , ce qui eft un défaut dans ce
genre, parce que les bruns, loin de s’affoibiir
ne font que pouffer au noir en vieilïiffant. On
peut obferver' , qii’en général & fans tenir
compte des exceptions, les peintres qui fe font
diftingués dans la frefque par une couleur