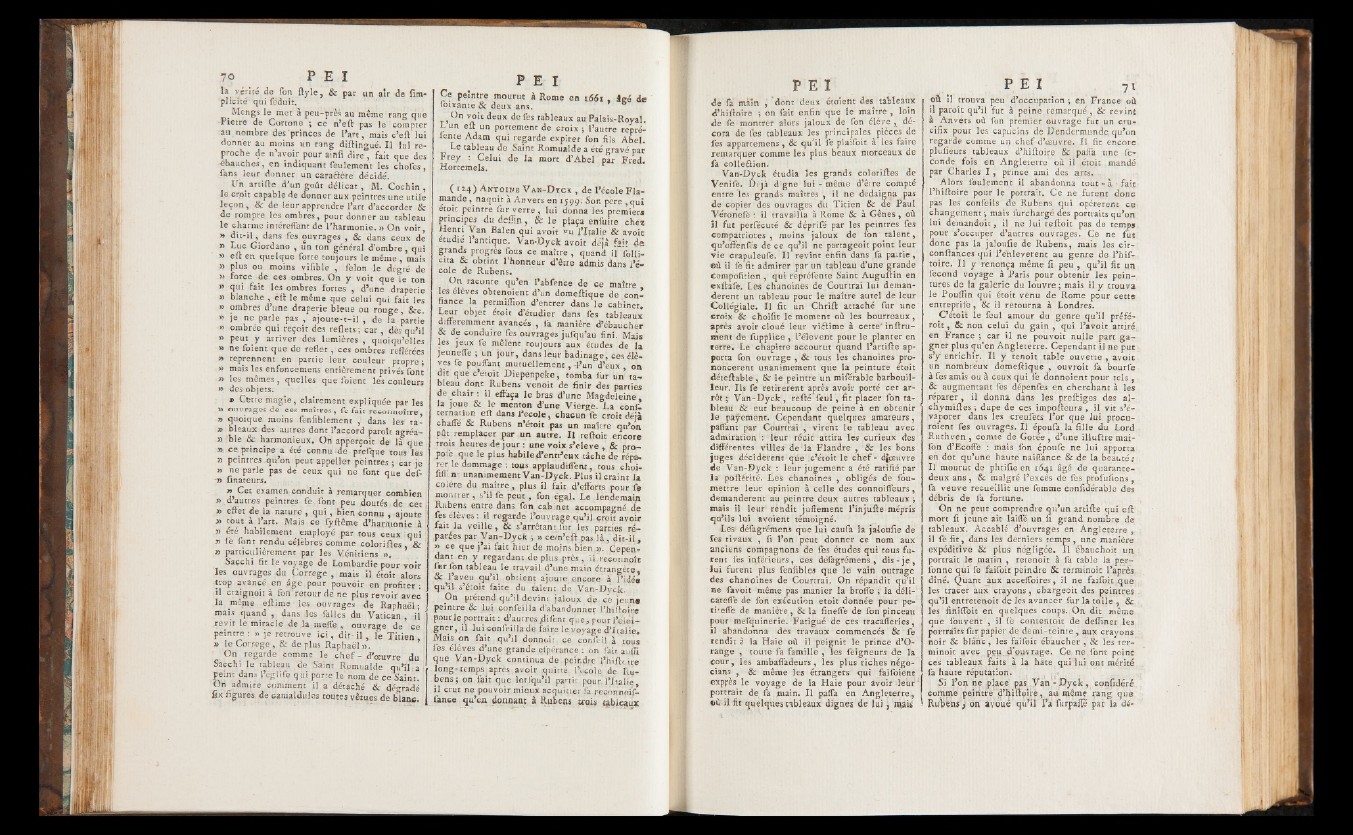
“ vérité de fon fty le , & par un air de fim-
p]icité ■ qui Téduit.
Mengs le met a peu-près au même rang que
-Pietre de Cortonè ; ce n’eft pas le compter
au nombre des princes de l’ar t, mais c’eft'lui
donner au moins un rang diftjngué. Il lui reproche
de n’avoir pour ainfi dire, fait que des
-ébauches , en indiquant feulement les chofes,
fans leur donner un caraflère décidé.
Un artifte d’un goût d é lic a t, M. Cochin ,
le croit capabie de donner aux peintres une utile
le çon , & de leur apprendre l’art d’accorder &
de rompre les ombres, pour donner au tableau
le charme intéreffant de l’harmonie. » On voit,
» d it - il, dans fes ouvrages , & dans ceux de
» Luc Giordano , un ton général d’ombre, qui
» eft en quelque forte toujours le même , mais
» plus ou moins vifible , félon le degré de
» force de ces ombres. On y voit que le ton
» qui fait les ombres fortes , d’une draperie
» blanche , élb le même que celui qui fait les
» ombres d’une draperie bleue ou rouge, &c.
o je ne parle pas , ajoute-t-il , de la partie
» ombrée qui reçoit des reflets; car , dès qu’ il
» peut y arriver des lumières, quoiqu’elles
» ne foient que de re fle t, ces ombres reflétées
y> reprennent en partie leur couleur propre;
» mais les enfoncemens entièrement privés font
» les mêmes, quelles que foient les couleurs
» des objets;
» Cette magie, clairement expliquée par les
» ouvrages de ces maîtres, fe fait reconnoîrre
» quoique moins fenfiblement , dans les ta xi
bleaux des .autres dont l’accord paroît agréa- i
» ble & harmonieux. On apperçoit de la q u e
». ce. principe a été connu de prefque tous les
» peintres .qu’on peut appeller peintres ; car ie
» ne parle pas de ceux qui ne font que def-
-» finateurs.
x Cet examen conduit à remarquer combien
» d’autres peintres f e . font peu doutés de cet j
» effet de la. nature , q u i, bien connu , -ajoute 1
» tout à l ’art. Mais ce fyftême d’harmonie à
» été habilement employé par tous ceux qui
» le font rendu célèbres comme colorifles &
» particulièrement par les Vénitiens ». ’
Saçchi fit le voyage de Lombardie pour voir
les ouvrages du Çorrege , mais il étoit alors
trop avancé en âge.pour pouvoir en profiter ;
il craignoit à fon' retour de ne plus revoir avec
la même.r eftime les ouvrages de Raphaël;
mais quand , dans les falles du Vatican il
revit le miracle de la meffe , ouvrage d e ' ce
peintre : » je retrouve i c i , dit- i l , le Titien :
» le Cortège , & de plus Raphaël ».
On regarde comme le c h e f - d ’oeuvre du
Sacchi le tableau de'Saint Romualde qu’il a
peint dans l’églife qui porte le nom de ce Saint.
Oh admiré comment il a détaché & dégradé
fix figures de eamaldules toutes vêtues de blanc.
Ce peintre mourut à Rome en 1661 , i e ê de
lotxante & deux ans.
On voit deux de l’es tableaux au Palais-Royal.
L un eft un portement de croix ; l’autre repréfente
Adam qui regarde expirer fon fils Abel.
Le tableau ae Saint Romualde a été gravé par
Frey ; Celui de la mort d’Abel par Fred.
Hortemels.
( 114) Antoine V an-Dtck , de l’école Flamande
, naquit à Anvers en 1599: Sor. père , qui
étoit peintre fur verre , lui donna les premier»
principes du delfin, & le plaça enfuite chez
Henri Van Balen qui avoit v u l’Italie & avoit
étudié l’antitjue. Van-Dyck avoit déjà f t iî de
grands progrès fous ce maître , quand il folli-
cita & obtint l ’honneur d’être admis dans l’école
de Rubens.
On raconte qu’en i’abfence de ce maître
les élèves obtenoient d’un domeftique de confiance
la permiflïon d’ entrer dans le cabinet.
Leur objet étoit d’étudier dans fes tableaux
différemment avancés , fa manière d’ébaucher
& de conduire, fes ouvrages jufqu’au fini. Mais
les jeux fe mêlent toujours aux études de la
Jeuneffe ; un jour, dans leur badinage; ces élèves
fe pouffant mutuellement, -l’ un d’eux , on
dit que c’ étoit Diepenpeke, tomba l'ur itn tableau
dont Rubens venoit de finit des parties
de chair ; il effaça le bras d’une Magdeleine ,
la joue & le menton d’une Vierge. La conft
ternation eft dans l’ecole, chacun fe croit déjà
chaffé & Rubens n’étoit pas un maître qu’on
p(jt remplacer par un autre. II reftoit encore
trois heurcs-de jour : une voix s’élevé , & pro-
pofé que le plus habile d’ entPeux tâche de répa,
rer le dommage ; tous applaudiffent, tous choi.
fiilin- unanimement Van-Dyck. Plus il craint Ia
colère du maître , plus il fait d’ efforts pour fe
montrer , s’il fe peut, fon égal. Le 1 en demain
Rubens entre dans fon cabinet accompagné de
fes élèves : il regarde l’ouvragejqù’ il croit avoir
fa i t la v e ille , & s’arrêtant lut les parties réparées
par Van-Dyck ; » ce/n’e jl pas.là., d it- il,
» ce que j’ai fait hier de moins bien ». ,Cependant
en y regardant de plus.près , .it.reconnoîc
fer fon tableau le travail d’ une main étrangère,
& l’aveu qu’ il obtient ajoute, .encore à l ’idée
qu’-il s’étoit faite du talent-dé Van-Dyck.
_0n prétend qu’ il devint jaloux de ce jeune
peintre & lui confeilla d’abandonner l’hîftoice
pour le portrait ; d’autres filen t qu e , pour l’éloigner,
il lui confeilla de faire levpyage d’ Italie.
Mais on fait qu’il donnoit ce confeil à .tous
fes. élèves d’ une grande eipérance'; on fait aufli
que Van-Dyck continua de pcir.dpe i’ hiftcire
long-temps après-avoir quitté. l'école de Rubens;
on fait que lorsqu'il partit poup i’Italie
il crut ne pouvoir mieux acquitter fa reconnpif-
fance qu'en donnant à Rubens trois tableaux
de fa main , dont deux étaient des tableaux
d’h iftoire -, on fait enfin que le maître , loin
de fe montrer alors jaloux de fon éléve , décora
de fes tableaux les principales pièces de
fes appartemens, & qu’ il fe plaifoit à les faire
remarquer comme les plus beaux morceaux de
fa colledion.
Van-Dyck étudia les grands coloriftes de
Venife. Déjà digne lui - même d’être compté
entre lés grands maîtres , il ne dédaigna pas
de copier des ouvrages du Titien & ae Paul
Véronefè : il travailla à Rome & à Gènes, où
il fut perfécuté & déprifé par les peintres fes
compatriotes, moins jaloux de fon talent,
qu’offenfés de ce qu’ il ne partageoit point leur
vie crapuleufe. I l revint ehfin dans fa pairie,
où il fe fit admirer par un tableau d’une grande
compofition , qui repréfente Saint Augulrin en
exftafe, Les chanoines de Courtrai lui demandèrent
un tableau pour le maître autel de leur
Collégiale. Il fit un Chrift attaché fur une
croix & choifit le moment où les bourreaux,
après avoir cloué leur viélime à cette'' infiniment
de fiipplice , l’élevent pour le planter en
terre, Le chapitre accourut quand l’artifte apporta
fon ouvrage , & tous les chanoines prononcèrent
unanimement que la peinture étoit
déteftable, & le peintre un miférable barbouilleur.
Ils fe retirèrent après avoir porté cet arrêt
^ Van-Dyck:, refté fieul, fit placer fon ta-
bleau & eut beaucoup de peine à en obtenir
le payement. Cependant quelques amateurs,
paflant par Courtrai ,' virent le.tableau avec,
admiration : leur rédit attira les .cürieux des
différentes villes dejla Flandre , & les bons
juges décidèrent qüe c’étoit le chef - d|peuvre
de Van-Dyck : leur jugement a été ratifié par
la poftérité. Les chanoines , obligés de fou-
metrre leur opinion à celle des connoiffeurs,
demandèrent au peintre deux autres tableaux •,
mais il leur rendit juftement l ’injufte mépris
qu’ ils lui avoient témoigné.
Les1 défagrémens que lui caufa la jaloufie de
fes rivaux , fi l’on peut donner ce nom aux
anciens compagnons de fes études qui tous furent
fes inférieurs, ces défagrémens , dis - j e ,
lui furent plus fenfibles que le vain outrage
des chanoines de Courtrai. On répandit qu’il
ne favoit même pas manier la broffe ; la déli-
cateffe de fon exécution etoit donnée pour pe-
tLefle de manière, & la fineffe de fon pinceau
pour mefquinerie. Fatigué de ces tracaffèries,
il abandonna dès travaux commencés & fe
rendit à la Haie où il peignit le prince d’O-
range , toute fa famille , les feigneurs de la
cour, lès ambaffadeurs, les plus riches négoc
i a i , & même les étrangers qui faifoient
exprès le voyage de la Haie pour avoir deùr ’
portrait de fa.main. .11 paffa en Angleterre.,
©ù il fit quelques tableaux dignes de lui $ mais
où il trouva peu d’occupation ; en France où
il paroît qu’ il fut à peine remarqué, & revint
a Anvers où fon premier ouvrage fut un crucifix
pour les capucins de Dendermunde qu’on
regarde comme un chef-d’oeuvre. Il fit encore
plufieurs tableaux d’hiftoire & paffa une féconde
fois en Angleterre où il étoit mandé
par Charles I , prince ami des arts.
Alors feulement il abandonna t o u t - à - fa i t
l ’hiftoire pour le portrait. Ce ne furent donc
pas les confeils de Rubens qui opérèrent ce
changement-, mais furchargé des portraits qu’on
lui demandoit, il ne lui reftoit pas de temps
pour s’occuper d’autres ouvrages. Ce ne fut
donc pas la jaloufie de Rubens, mais les cir-
conftances qui l’ enleverent au genre de l’hifr
toire. I l y renonça même fi peu , qu’ il fit un
fécond voyage à Paris pour obtenir les peintures
de la galerie du louvre; mais il y trouva
le Pouflin qui étoit venu de Rome pour cette
entreprife, 8c il retourna à Londres.
C’étoit le foui amour du genre qu’il préfé-
ro it, & non celui du gain , qui l’avoit attiré,
en France j car il ne pouvoit nulle part gagner
plus qu’en Angleterre. Cependant il ne put
s’y enrichir. I l y tenoit table ouverte , avoit
un nombreux domeftique , ouvroit fa bourfe
à fes amis ou à ceux qui fe donnoient pour tels ,
8c augmentant fes dépenfes en cherchant à les
réparer , il donna dans les preftiges des al-
chymiftes ; dupe de ces impofteurs , il vit s’évaporer
dans les creufets l’or que lui procu-
roient fes ouvrages. I l époufa la fille du Lord
Ruthven , comte de Corée , d’une illuftre mai-
fon d’Ecoffe : mais fon époufe ne lui apporta
en dot qu’ une haute naiffance & de la beauté ;
I l mourut de phtifie en 1641 âgé de quarante-
deux ans , & malgré l’excès de fes profufions ,
fa veuve recueillit une fomme eonfiaérable des
débris de fa fortune.
On ne peut comprendre qu’un artifte qui eft
mort fi jeune ait- laiffé un fi grand nombre de
tableaux. Accablé d’ouvrages en Angleterre ,
il fe f it , dans les derniers temps, une manière
expéditive & plus négligée. I l ébauchoit un
portrait le matin , recenoit à fa table la per-
fonne qui fe faifoit peindre 8c terminoit l’après
dîné. Quant jmx acceffoires, il ne faifoit, que
les tracer aux crayons, chargeoit des peintres
qu’il entretenoit de les avancer fur la toile , &
les finifïoit en quelques coups. On dit même
que fouvent', il fe contentoit de defïiner.les
portraits fur papier de demi-teinte , aux crayons
noir & blanc, les faifoit ébaucher , 8c les ter-
minoit avec peu, d’puvrage. Ce ne font point
ces tableaux faits à la hâte qui lui ont mérité
fa haute réputation.
Si l’on ne placé pas .y an ’-D y c k , confidéré.
comme peintrè d’hiftoiré, au rang que
- Rumens ; on ayôué qu’ il f a furpaffé par la dé