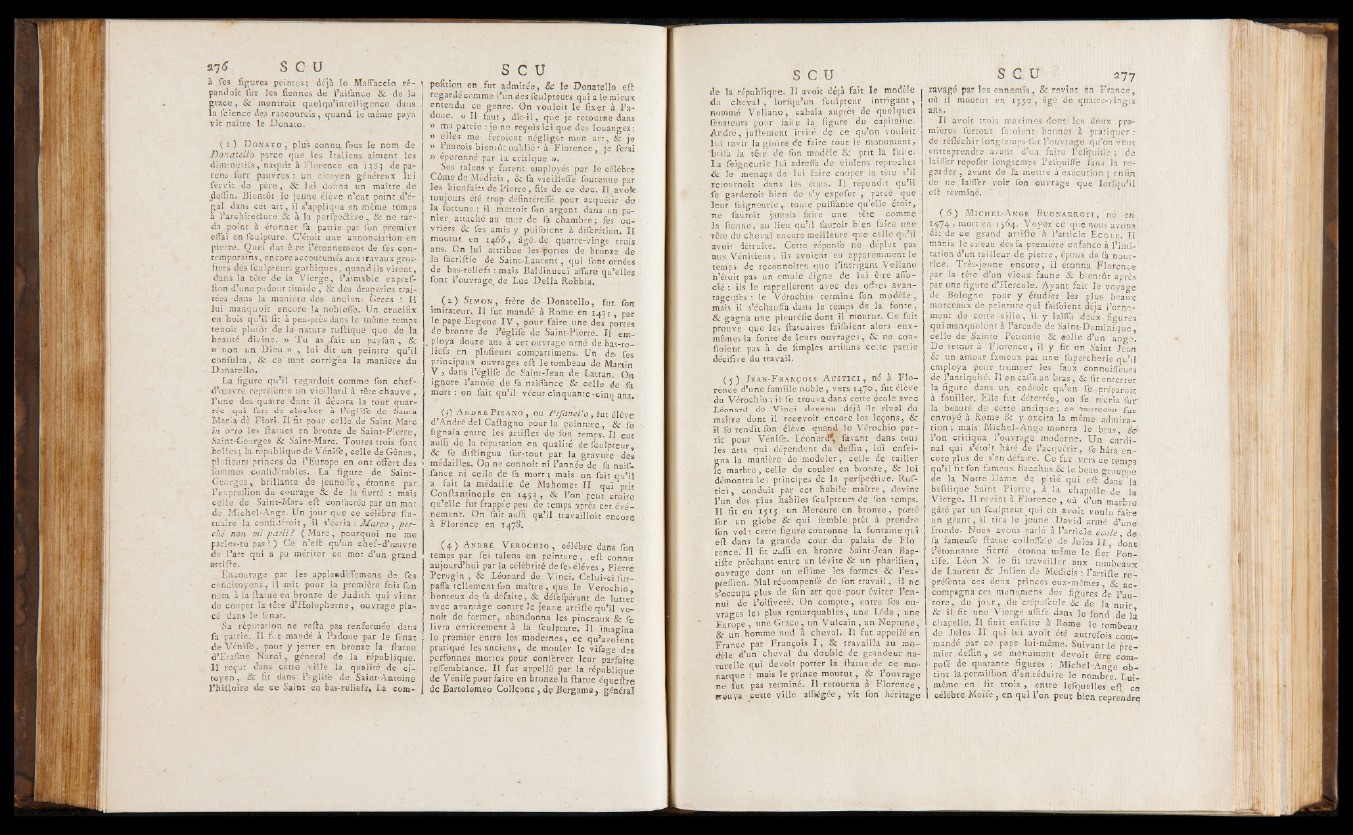
2 7 < î S C U
à Tes figures peintes; déjà le Maffaceîo ré-
pandoit fur les Tiennes de l’aifance & de la
g râ ce , & montroit quelqu’ intelîigcnce dans
la icien.ce des raccourcis , quand le même pays
v it naître le Donato.
( O D o n a to , plus connu fous le nom de
Donatello parce que les Italiens aiment les
diminutifs $ naquit à Florence en 1383 de pa-
rens- fort pauvres: un citoyen généreux lui
fervit de père, & lui donna un maître de
deflin. Bientôt le jeune élève n’ eut point ^d’égal
dans cet art, il s’ appliqua en même temps
à l’architeêture & à la perfpectiye, & ne tarda
point à étonner fa patrie par Ton premier
eifai en iculpture. C’étoit une annonciarion-en
pierre. Quel dut être l’étonnement de fes contemporains,
encore accoutumés aux travaux gros-
lie rs dés lculptears gothiques, quand ils virent, -
dans la tête de la V ierge, l’aimable expref-
lion d’ une pudeur timide , & des draoeries traitées
dans la manière des anciens Grecs ! H
lui manquoit encore la noblefle. Un crucifix
en bois qu’ il fit à pen-près dans le même temps
tenoit plutôt de la'nature ruftique que de la
beauté divine. » Tu as „fait un payfan , &
» non un Dieu » , lui ait un peintre qu’il
confulta, & -ce mot corrigea la manière du
Donatello.
La figure qu’ il regardoit comme fon chef-
d’oeuvre repréfente un vieillard à tête chauve ,
'l’une des quatre dont il décora la tour quar-
rée qui- fert de clocher à l’églife de Santa
Maria dè Fiori. Il fit pour celle de Saint Marc
in orto les fiâmes en bronze de Saint-Pierre,
Saint-Georges & Saint-Marc. Toutes trois font
belles -, la république de Vénife, celle de Gênes,
plufieurs princes de l’ Europe en ont offert des s
Tommes confidérâbles. La figure de Saint-
Géorges y, brillante de jeunefTe, étonne par.
l’expreflion du courage & de la fierté : mais
celle de Saint-Marc efi confacrée par un mot
de Michel-Ange. Un jour que ce célèbre fia-
tuaire la c-onfitiéroic, il s’écria : Marco , perché
non mi parti? (M a r c , pourquoi ne me
parles-tu pas ? ) Ce n’eft qu’ un chef-d’oeuvre
de l’art qui a pu mériter ce mot d’ un grand
a-rtifie.
Encouragé par les appIaBdiffemens, de Tes
concitoyens, il mit pour la première fois fon
nom à la ftatue en bronze de Judith qui vient ’
de couper la tête' d’Hoîopîierne, ouvrage placé
dans le Icnar.
Sa réputarion ne refia pas renferm ée dans
fa patrie. I l f i t m andé à P adou e par le fénat
d e V é n ife , pour y jetter en b ronze la ftatu e
d’Erafm e N a r n i, gen eral de la rép ub liq ue.
I l reçut dans cette ville la qualité de citoyen
, & fit dans l ’eglife de Saint-Antoine
l ’hifioire de ce Saint en bas-reliefs. La corn-
S C U
I pofitlon en fu t a d m irée, & le D o n a tello e fi
regardé com m e l’un d es Icu lp teu rs q u i a le m ieu x
en ten d u c e g en re. O n v o u lo it le fix er à P ad
ou e. « Il fa u t, d it -il, q u e je retou rn e dans
» rtia p a trie : je n e reçois ic i q u e des lo u a n g es:
» e lle s m e feroien t n é g lig e r mon a rt, & je
» l’aurois b ien tô t o u b lié • à F lo r e n c e , je ferai
» éperon né par la critiq u e » .
Ses; talen s y fu ren t em p loyés par le célèbre
Corne d e M éd icis , 8c fa v ie ille ffe fou ten u e par
le s b ien fa its d e P ie r r e , fils d e ce d u c. I! avofc
tou jours été trop- défintéreüfé pour acquérir d e
la fortun e : il m etta it fon a rg en t dans un pan
ier. attach é au mur de là cham bre ; fes o u vriers
8c fes am is y p u ifo ien t à difcrétion . I l
m ourut en 1 4 6 6 , â gé^ d e q u a tre-v in gt trois
ans. O n lu i attrib u e les portes d e bronze d e
la facrifiie d e S a in t-L a u ren t, q ui fon t ornées
d e b a s-reliefs : m a is B a ld in u cci allure qu’e lle s
fon t l’ouvrage^ d e L u c D é lia R ob b ia.
( z ) Si m o n , frère d e D o n a te llo , fu t fon
im itateu r. I l fu t m andé à R om e en 1431 , par
le pape E u g en e I V , pour faire u n e d es portes
de bronze d e l’é g life d e Saint-P ierre. Il em p
loya douze ans à c e t ou vra ge orné d e bas-relie
fs en plufieurs com partim ens. U n de- Tes
principaux ou vrages e fi le tom beau de M artin
V f dans l’é g life d e Saint-Jean d e Latran. O n
ig n o re l’année àe fa n ai (lance & c e lle de fa
m ort : on fait q u ’il v écu t c in q u a n te -c in q an s,
? (3) A ndr é P isano , ou Pifanello > fu t élè v e
d’A ndré d el C aftagn o pour la p e in tu r e , & Te
fig n a la en tre les artiftes d e fon tem ps. Il eu t
auffi de la réputation en q u a lité de fculpreur
fe d iftin g u a fu r-tou t par la gravu re d e s
m éd a illes. On n e co n n a ît n i l’an n ée d e fa n a if-
,la n ce ni c e ile d e fa m ort ; m ais on fait q u ’il
a fa it la m éd a ille de M ah om et I I q u i prit
C o n fia n tin o p le en 1 4 5 3 , & l’on .peut croire
qu ’e lle fu t frappée peu de tem ps après cet é v é n
em en t. O n fait auffi qu’il tra v a illo it en core
à F lo r e n c e en 1478.
( 4 ) A ndré V erochio , céléb ré dans fon
tem ps par fes talen s en p ein tu re, e fi con n u
aujourd’h ui par la céléb rité d e fe s é lé v e s , P ierre
P cru g in , & Léonard de V in c i. C e lu i-c i fu r-
pafla te llem e n t fon m a îtr e , q u e le V ero ch io
h o n teu x de fa d é fa ite , & défefpérant d e lu tter
a vec ava n tag e con tre le jeu n e a rtifie q u ’il v e -
n o ît de form er, abandonna les p in ceau x & Te
liv ra en tièrem en t à la fcu lp tu re. I l im agin a
le prem ier en tre le s m o d ern es, ce qu’a v o ien t
pratiqué le s a n c ie n s, d e m o u ler le v ifa g e des
p erfon nes m ortes pour co n ferv er leu r parfaite
reffëm b lân ce. I l fu t ap p elle par la rép u b liq u e
de V én ife pour faire en bronze la ftatu e éq u eftre
d e B a rtolom eo C o lle o n e , d ç B erg am e, gén éral
S C U
de la république. Il avoit déjà fait le modèle 1
du cheval , lorsqu’ un fculpteur intrigant,
nommé V ellano, cabala auprès de quelques
fénareurs pour faire la figure du capitaine.
André, juftement irrité de ce qu’on vouloit
lui ravir la gloire de faire tout le monument,
'briià la tête de fon modèle & prit ta fuite.
Là feigneurie lui adreffa de violens reproches ■
8c le menaça de lui faire couper la tête s’ il
retournoit dans les états. Il répondit qu’ il
fe garderoit bien de s’y expofer , parce que
leur feigneurie, toute puilfante qu’elle étoit,
né fauroit jamais faire une tête comme
la fienne, au lieu qu’il fauroit b:en faire une
tête de cheval encore meilleure que celle qu’ il
avoit détruite. Cette réponfe né déplut pas
aux Vénitiens-, ils avoient eu apparemment le
temps de reconnoître que l ’intrigant V ellano
n’étoit pas un émule digne de lui être alïb-
clé : ils le rappellèrent avec des o rires avantage
u.lës : le Verochio termina fon modèle,
mais il s’échauffa.dans le temps de la fonte ,
& gagna une pleu.réfie dont il mourut. Ce fait
prouve que les ftatuaires faifoient alors eux-
mêmes la fonte de leurs ouvrages, Sc né con-
fioient pas à de fimplës artilàns cette partie.
décifive du travail.
( 5 ) Jean-François A ust ic i , né ,à F lo rence
d’une famille noble, vers 1470, fut élève
du Verochio -, il fe trouva dans cette école avec
Léonard de Vinci devenu déjà 4 e rivâl du
maître dont il recevoit encore les leçons, &
il fe rendit Ton élève quand le Vérochio partit
pour Vénife.- Léonard*,* fayant dans tous
lés arts qui dépendent du delfin , ldi enfei-
gna la manière de modeler, celle de tailler
le marbre, celle de couler en bronze, & lui
démontra les principes de la perfpe&ive. Ruf-
t i c i , conduit par cet habile maître, devint
l ’un des plus haoiles fculpteurs de Ton temps.
I l fit en 1515 un Mercure en bronze, porté-
fur un globe & qui femble prêt à prendre
fon vol : cette figure couronne la fontaine qui
efi dans la grande cour du palais de Florence.'
U fit auffi en bronze Saint-Jean Bap-
trfte prêchant entre un lévite & un pharifien,
ouvrage dont on eftime les formes & l ’ex-
prelïïcn. Mal récompenfé de fon travail, il ne
s’occupa plus de fon art que pour éviter l’ennui
de l ’oifiveté. On compte, entre fes ouvrages
les plus remarquables, une Léda , une'
Europe , une Grâce, un Vulcain , un Neptune,
& un homme nud à cheval. Il fut appelle en
France par François I , & travailla au modèle
d’ un cheval du double de grandeur naturelle
qui dévoit porter là ftatue de ce monarque
: mais le prince mourut, & l’ouvrage
ne fut pas terminé. Il retourna à Florence,
«rouYa cette v ille alfiégée, vît fon héritage
S C U 277
ravagé par les ennemis, & revînt en France,
où il mourut en 1550, âgé de quatre-vingts
ans.
I l avoit trois maximes dont les deux premières
furtout feroient bonnes à pratiquer :
de réfléchir longtemps fur l’ouvrage qu’on veut
entreprendre avant d’en faire refquifiè ; de
laiffer repofer longtemps l’elquiffe Tans la ré-/
garder , avant de la mettre à exécution ; enfin
de n e . laiffer Voir fon ouvrage que lorlqu’ il
efi termine.
( 6 ) Mi ch e l -A nge B u o n a r r o t i , né en
H 74 3 morc en 15Ô4. Voyez ce que nous avons
dit de ce grand artifie à l’article É cole . Ii
mania le cil eau dès Ta première enfance à l’ imi-'
tation d’un railleur de pierre, époux delà nourrice.
Très-jeune encore, il étonna Florence
par la tête d’un vieux faune 8c bientôt après
par une figure d’Hercule. Ayant fait le voyage
de Bologne pour y étudier les plus beaux
morceaux de peinture qui faifoient déjà l ’ornement
de cette v i lle , il ÿ laiffa deux figures
qui manquoient à l’arcade de Saint-Dominique
celle de Sainte Péttoniê .& ©elle d’un ange.
De retour à Florence, il y fit un Saint Jean
& un amour fameux par une fupercherie qu’il
employa pour tromper les faux connoiffeurs
de l’antiquité. Il encaffaun bras , & fit enterrer
la figure dans un endroit qu’on fe .préparait
à fouiller. Elle fut déterrée, on fe, récria fur
la beauté de cette antique; ce 'morceau fut
envoyé à Rome & y excita la même admiration
; mais Michel-Ange montra le bras 8é
l’on critiqua l’ouvragé moderne. Un cardinal
qui s’étoit hâté de l’acquérir, Te hâta encore
plus de s’en défaire. Ce fut vers ce temps
qu’ il fit fon fameux Bacchus..&: le beau «rouppe
de la Notre Dame de pitié qui efi dans la
bafiiique Saint Pierre, à la chapelle de la
Vie'rge. I l revint à Florence , où d’ un marbre
gâté par un fculpteur qui en avoit voulu faire
un géant, il tira le jeune David armé d’une
fronde. Nous avons parlé à l’article école de
fa fameufe fiatue coiloffale de Jules I I , dont
l’étonnante fierté étonna même le fier Pontife.,
Léon X le fit travailler aux tombeaux
de Laurent 8c Julien de Médicis : Tartifie représenta
ces deux princes eux-mêmes, 8c accompagna
ces montimens des figures de l’aurore,
du jour, ,du crépu feu le 8c de la nuit
& il fit une Vierge aflifë dans le fond de la
chapelle. I l finit enfuite à Rome le tombeau
de Jules II qui lui avoit été autrefois commandé^
par ce pape lui-même. Suivant le premier
.deffin, ce monument devoit être com-
pofé de quarante figures : Michel- Ange obtint
la permifiion d’ en.’réduire le nombre. Lui-
même en fit trois , entre lefquelles efi ce
célébré Moïfe, en qiu l’on peut bien reprendre?