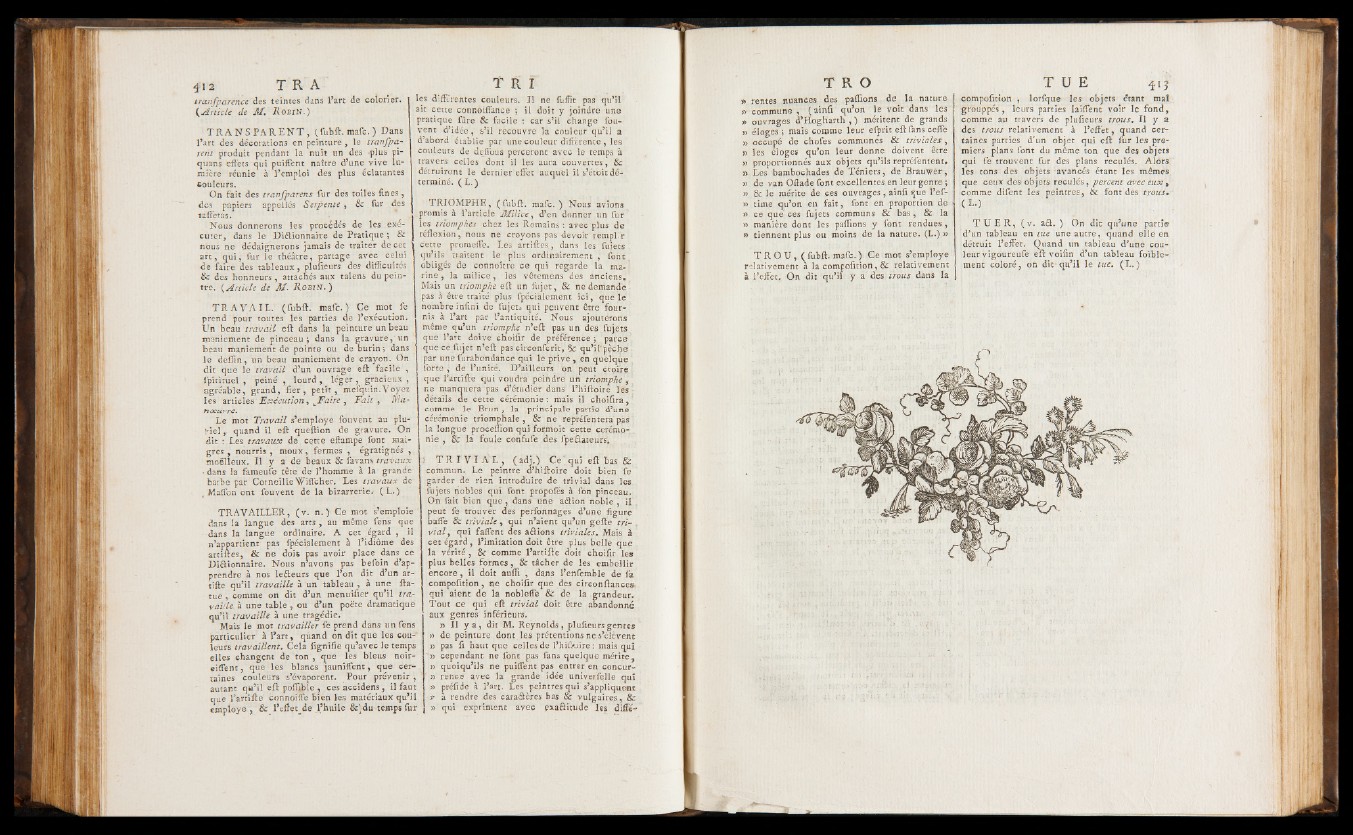
tranfparen.ee des teintes dans l’art de colorier.
( A rticle de M . R o b in .)
T R A N S P A R E N T , (fubft. mafe. ) Dans
l’art des décorations en peinture, le tranfpa-
rent produit pendant la nuit un des plus pi-
quans effets qui puiffent naître d’ une vive lumière
réunie à l ’ emploi des plus éclatantes
Couleurs.
On fait des tranfparens fur des toiles fines,
des papiers appellés Serpente, & fur des
taffetas. • '
Nous donnerons les procédés de les exécuter,
dans le Di&ionnaire de Pratique ; &
nous ne dédaignerons jamais de traiter de cet
a r t, q u i, fur le théâtre, partage avec celui
de faire des tableaux, plufieurs des difficultés
& des honneurs, attachés aux talens du peintre.
( A rticle de M • R o b in . )
T R A V A I L , (fubft. mafe. ) Ce mot fe
prend pour toutes les parties de l’exécution.
IJn beau travail eft dans la peinture un beau
maniement de pinceau; dans la gravure,"un
beau maniement de pointe ou de burin; dans
le deflïn, un beau maniement de crayon. On
dit que le travail d’un ouvrage eft facile ,
fpiritucl , peiné , lourd , léger , gracieux ,
agréable, grand, fie r, p e tit, mefquin. Voye2
les articles Exécution y ^Faire , Fait , Manoeuvre.
Le mot T ra va il s’employe fouvent au pluriel
quand il eft queftion de gravure. On
dit : Les tra va u x d e.cçtte eftampe font maigres
, nourris , moux, fermes , égratignés ,
moelleux. Il y a de beaux & lavans tra va u x
• dans la fameufe tête de l’homme à la grande
barbe par Corneille Wiffcher. Les tra va ux de
, Mafion ont fouvent de la bizarrerie.' (L .)
les différentes couleurs. I l ne fuffit pas qu’ il
ait cette connoiffance ; il doit y joindre une
pratique fure & facile : car s’ il change fouvent
TRA VA IL LER, (v . n. ) Ce mot s’ emploie
dans la langue des arts , au même fens que
dans la langue ordinaire. A cet égard , il
n’appartient pas fpécialement à l ’ idiome des
artiftes, & ne dois pas avoir place dans ce
Diélionnaire. Nous n’avons pas befoin d’apprendre
à nos leéleurs que l’on dit d’ un ar-
tifte qu’ il tra va ille à un tableau ; à une fta-
tue , comme on dit d’ un menuiiier qu’ il tra vaille
à une table , ou d’un poète dramatique
qu’ il travaille à une tragédie.
Mais le mot travailler fe prend dans un fens
particulier à l’art » quand on dit que les cou-*
leurs travaillent. Cela fignifie qu’avec le temps
elles changent de ton , que les bleus noir-
eiffent, que les blancs jauniffent, que certaines
couleurs s’ évaporent. Pour prévenir ;
autant qu’ il eft poflij>le , cesaccidens, il faut
que fartifte connoiffe bien les matériaux qu’ il
employé, & l’ effeqde j ’huile & ’ du temps fur
d’ idée, s’ il récouvre la couleur qu’ il a
d’abord établie par une couleur différente , les
couleurs de deffous perceront avec le temps à
travers celles dont il les aura couvertes, &
détruiront le dernier effet auquel il s’étoit déterminé.
( L. )
TRIOMPHE, (fubft. mafe. ) Nous avions
promis à l ’article M ilic e , d’en donner un fur
les triomphes chez les Romains : avec plus de
: réflexion, nous ne croyons pas devoir remplir
dette promeffe. Les artiftes., dans les fujets
qu’ ils traitent le plus ordinairement , font
obligés de connoître ce qui regarde la ma. '
r in e , la m ilice, les vêtemens des anciens.'
Mais un triomphe eft un lujet, & ne demande
pas à être traité plus fpécialement i c i , que le
nombre infini de lu jeta qui peuvent être fournis
à l’ art par l’antiquité. Nous ajouterons
même qu’un triomphe n’eft pas un des fujets
que l’ art doive choifir de préférence ; parce
quecé.fujet n’eft pas çirconfcrit, & qu’ il’ pèche
par une furabondance qui le prive , en quelque
forte , de l’ unité. D’ailleurs on peut croire
que l ’artifte qui voudra peindre un triomphe f
ne manquera pas d’étudier dans l’hiftoire les
détails de cette cérémonie: mais il choifira,
comme le Brun , la principale partie d’une
cérémonie triomphale, & ne représentera pas
la longue proceflion qui forrnoic cette cerémo-,
nie , & la foule confufe des fpeûateufs.
î T R I V I A L , ( adj.) Cejjjj qui eft bas &
commun. Le peintre d’hiftoire doit bien fe
garder de rien introduire de trivial dans les
fujets nobles qui font propofés à fon pinceau.
On fait bien q ue , dans une aétion npble , il
peut fe trouver des perfonnagès d’une figure
baffe & triviale , qui n’aient qu’ un gefte tri- ,
vialy qui faffent des aélions triviales. Mais à
cet égard, l ’imitation doit être plus belle que
la vérité , & comme l ’artifte doit choifir le*
plus belles formes, & tâcher de les embellir
encore, il doit aufii , dans l’enfemble de fa
compofition, ne choifir que des circonftances
qui aient de la nobleffe & de la grandeur.
Tout ce qui eft trivial doit être abandonne
aux genres inférieurs.
» I l y a , dit M. Reynolds, plufieurs genres
» de peinture dont les prétentions ne s’élèvent
» pas fi haut que celles de l’hiffoire : mais qui
'» cependant ne font pas fans quelque mérite,
» quoiqu’ ils ne puiffent pas entrer en concur-
» rence avec la grande idée universelle qui
» préfide à l’art. Les peintres qui s’appliquent
5? à rendre des câra&ères bas & vulgaires &
» qui expriment avec pxaélitude les difféy
» rentes nuances des pallions de la nature
» commun® , (ainfi qu’on le voit dans les
» ouvrages d’Hogharth, ) méritent de grands
» éloges; mais comme leur efprit eft fans ceffe
>5 occupé de chofes communes & triviales,
» les eloges qu’on leur donne doivent être
» proportionnés aux objets qu’ ils repréfentent.
» Les bambochades de Téniers, de Brauwer ,
» de van Oftade font excellentes en leur genre ;
» & le mérite de ces ouvrages , ainfi que l’ ef-
» time qu’on en fa it, font en proportion de
» ce que ces fujets communs & bas , & la
» manière dont les pallions y font rendues,
» tiennent plus ou moins de la nature. (L.) »
T R O U , ( fubft. mafe. ) Ce mot s’employe
relativement à la compofition, & relativement
à l’ effet,. On dit qu’ il y a'des trous dans la
compofition , lorfque les objets étant mal
grouppés , leurs parties laiffent voir le fond,
comme au travers de plufieurs trous. Il y a
des trous relativement à l’effet, quand certaines
parties d’ un objet qui eft fur les premiers
plans font du même ton que des objets
qui fe trouvent fur des plans reculés. Alors
les tons des objets avances étant les mêmes
que ceux dés objets reculés, percent avec eux ,
•comme difent les peintres, éc font des trous•
( L . )
T U E R , ( v. a â . ) C)n dit qu’ une partie
d’ un tableau en tue une autre, quand elle en
détruit l’ effet. Quand un tableau d’une couleur
vigdureufe eft voifin d’un tableau foible-
ment coloré, on dit qu’ il le tue. (L .)