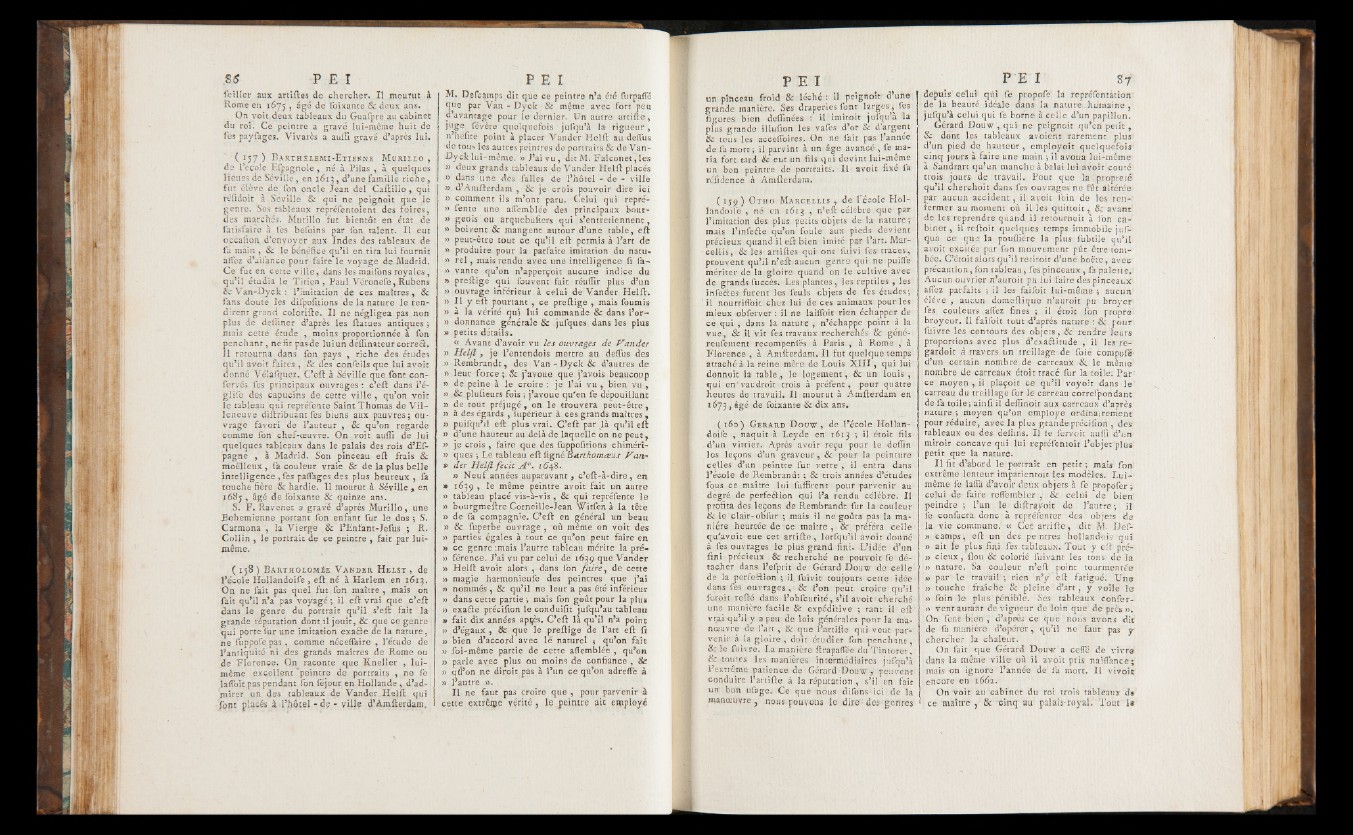
.8 S
P E I
le iller aux artiftes de chercher. Il mourut à
Rome en 1675 , âgé de foixante & deux ans.
On voit: deux tableaux du Gu afp re au cabinet
du roi. Ce peintre a gravé lui-même huit de
les payfages. Vivarès a aufli gravé d’après lui.
( 157 ) Barthélemi-Etienne Mürilzo ,
de l’école Efpagnoîe , né à Pilas , à quelques
lieues de Séville, en 1613, d’ une famille riche ,
fut élève de fon oncle Jean del Caftillo , qui
réfidoit à Seville & qui ne peignoit que le
genre. Ses tableaux repréfentoient des foires,
des marchés. Murillo fut bientôt en état de
iatisfaire à les beloins par fon talent. Il eut
oçcafion, d’enyoyer aux Indes des tableaux de
fa main , & le bénéfice qu’il en tira lui fournit
à fiez d’aifance pour faire le voyage de Madrid.
Ce fut en cette v ille , dans les maifons royales,
qu’ il étudia le Titien , Paul Veronefe, Rubens
& Van-Dyck : l ’ imitation de ces maîtres, &
fans doute les difpofitions de la nature le rendirent
grand çolorifte. Il ne négligea pas non
plus de defliner d’après les ftatues antiques ;
mais cette étude , moins proportionnée à fon
penchant, nefit pasde luiun deflinateur correéi.
I l retourna dans fon pays , riche des études
qu’ il avoît faites , & des confeils que lui avoir
donné Vélafquez. C’ eft à Séville que.font con-
fervés fes ' principaux ouvrages : c’eft dans i’é-
glife des capucins de cette v ille , qu’on voit
le tableau qui repréfente Saint Thomas de V i lleneuve
diftribuant fes biens aux pauvres; ouvrage
favori de l’auteur , & qu’on regarde
comme fon chef-oeuvre. On voit aufli de lui
quelques tableaux dans le palais des rois d’Ef-
pagne , à Madrid. Son pinceau eft frais &
moelleux , fa couleur vraie & de la plus belle
in telligence, fes pafiages des plus heureux , fa
touche fière & hardie. Il mourut à Séville , en
1685 , âgé de foixante & quinze ans.
S. F. Ravenet a gravé d’après Murillo, une
jBehemïenne portant fon enfant fur le dos ; S.
Carmona , la Vierge & l’Enfant-Jefus ; R.
C o ll in , le portrait de çe peintre , fait par lui-
jnême.
( 1 5 8 ) Bartholomée Vander Helst , de
l ’école Hollandoife , eft né à Harlem en 1613.
On ne fait pas quel fut fon maître , mais on
fait qu’ il n’ a pas voyagé ; il eft vrai que c’eft
dans le genre du portrait qu’ il s’eft fait la
grande réputation dont il jouit, & que ce.genre ■
qui porte fur une imitation exaôe de la nature, ;
ne fuppofe pas , comme néçeffaire , l ’étude de
l ’antiquité ni des grands maîtres de Rome ou
de Florence. On raconte que Kneller , lui-
même excellent peintre de portraits , ne fe
lafibit pas pendant fon féjour en Hollande , d’ad- j
mirer un des tableaux de Vander Helft qui j
font placés à l’hôtel - de - v ille d’Amfterdam,, 1
P E I
M, Defcamps dit que ce peintre n’a été furpafle
que par Van - Dy ck & mçme avec fort peu
d’avantage pour le dernier. Un autre artifte,
jUge févère quelquefois jufqu’à la rigueur,
n’héfite point à placer Vander Helft au deflus
de tous les autres peintres de portraits & de Van-
Dyck lui-même. » J’ai vu , ait M. Falconet,les
» deux grands tableaux de Vander Helft placés
» dans une des falles de l’hôtel - de - ville
» d Amfterdam , & je crois pouvoir dire ici
» comment ils m’ont paru. Celui qui repré-
» fente une affemblée des principaux bour-
» geois ou arquebufiers qui s’entretiennent,
» boivent & mangent autour d’une table, eft
» peut-être tout ce qu’il eft permis à l’art de
» produire pour la parfaite imitation du natu-
» r e l , mais rendu avec une intelligence II fa-
» vante qu’on n’apperçoit aucune indice du
» preftige qui fouvent fait réuflir plus d’un
» ouvrage inférieur à celui de Vander Helft.
» I l y eft pourtant , ce preftige , mais fournis
» à la vérité qui lui commande & dans l’or-
» donnance générale & jufques. dans les plus
» petits détails.
« Avant d’avoir vu les ouvrages de Vander
» Helft , je l’entendois mettre au deflus des
» Rembrandt, des Van - D y ck & d’autres de
» leur force ; & j’avoue que j’avois beaucoup
» de peine à le croire: je l ’ai v u , bien vu ,
». & plufieurs fois ; j’avoue qu'en fe dépouillant
» de tout préjugé, on le trouvera peut-être,
» à des égards , iupérieur à ces grands maîtres ,
» puifqu’ il eft plus vrai. C ’eft par là qu’ il eft
» d’ une hauteur au delà de laquelle on ne peut,
» je crois , faire que des fuppofitions chiméri-
» ques ; Le tableau eft figné Barthomceus Vank
» der Helft fecit A a. 16*48.
» Neuf .années auparavant , c’ eft-à-dire, en
» 1639 , le même peintre avoït fait un autre
» tableau placé vis-à-vis, & qui repréfente le
» bourgmeftre Corneille-Jean Witfen à la tête
» de la compagnie. C’eft en général un beau
» & fuperbe ouvrage , où même on voit des
» parties égales à tout ce qu’on peut faire en
» ce genre -.mais l’autre tableau mérite la pré-
» férence. J’ai vu par celui de 1639 que Vander
» Helft avoit alors , dans l’on faire, de cette
» magie harmonieufe des peintres que j’ai
» nommés , & qu’ il ne leur a pas été inférieur
» dans cette partie ; mais fon geùt pour la plus
» exaéle précifion le conduifit jufqu’au tableau
9 fait dix années apçès. C’ eft la qu’il n’a point:
» d’égaux , & que le preftige de l’art eft 11
» bien d’accord avec lé naturel ; qu’on fait
» foi-même partie de cette aflemblée , qu’on
» parle avec plus ou moins de confiance , &
» qd’on ne diroit pas à l’un çe qu’on adreffe à
» l ’autre ».
Il ne faut pas croire que , pour parvenir à
cette extrême vérité , le peintre jtit employé
p e 1
tm pinceau froid & léché : il peignoit d’ une
grande manière. Ses draperies font larges, fes
figures bien deflinées : il imitoit jufqu’a la
plus grande illufion les vafes d’or Sc d argent
& tous les accefloires. On ne fait pas l’année
de fa mort- ; il parvint à un âge avancé , fe maria
fort tard & eut un fils qui devint lui-même
un bon peintre de portraits. I l avoit fixé la
rcfidence à Amfterdam.
( 159 ) Otho Marcellis , de l’école Hol-
làndoife , né en 1613 , n’e ft célèbre que par
l’imitation des plus petits objets de la nature ;
mais l’ infefte qu’on foule* aux pieds devient
précieux quand il eft bien imité par l’ârt. Marcellis.,
& les artiftes qui ont fuivi fes traces ,
prouvent qu’ il n’eft aucun genre qui ne puifle
mériter de.la gloire quand on le cultive avec
de. grands fuccès. Les plantes , les reptiles , les
inPeéles furent'les.feuls objets de fes études-,
il nourrifloit chez lui de ces animaux pour les
mieux obferver : il ne laîffoit rien échapper de:
cè qui , dans la nature , n’échappe point à la
vue, & il vit fes travaux recherchés & géné--
reufement: recompenl’és à Paris , à Rome , à
Florence , à Amfterdam. Il fut quelque temps-
attaché à la reine mère de Louis X I I I , qui lui
donnoit la table., le logement, & un louis ,
qui en'vau droit trois à préfent, pour quatre
heures de travail. Il mourut à Amfterdam en
1673 , âgé de foixante & dix ans.
(160 ) Gérard Douw , de l’école Hollandoife
, naquit à Leyde en' 1613 ; il étoit fils
d’ un vitrier. Après avoir reçu pour le deflin
les leçons d’un graveur, & pour la peinture
celles d’un peintre fur verre , il entra dans
l ’école de Rembrandt ; & trois années d’études
fous ce maître lui fuffirent pour parvenir au
degré, de perfe&ion qùi l’a rendu célèbre. Il
profita des leçons de Rembrandt fur la couleur
tk le clair-obfur; mais il ne goûta pas la manière
heurtée de ce maître , préféra celle
qu’avoit eue cet artifte, lorfqu’ il avoit donné
à fes ouvrages le plus grand fini. L’ idée d’ un
fini précieux & recherché ne pouvoir fe détacher
dans l’efprit de Gérard Douw de celle
de la perfe&ion ; il_ fuivit toujours cette idée
dans fes ouvrages , • & l’on peut croire qu’ il
fer-oit refté dans l’obfcurité, s’ il avoit cherché
une manière facile & expéditive ; tant il eft
vrai qu’il y a peu de lois générales pour la manoeuvre
de l’a r t, & que l ’arcifte qui veut parvenir
a la gloire , doit étudier fon penchant,
& le fuivre. La manière ftrapaflee du Tintoret,
& toutes les manières intermédiaires jufqu’à-'
l’extrême patience de Gérard Douw , peuvent
conduire l’artifte à la réputation , s’ il en fait
un' bon ufage. Ce que nous difons*ici de la
manoeuvre | nous pouvons le dire-des genres
P E I 87
depuis'celui qui fe propofe la repréfentàtion'
de la beauté, idéale dans la nature humaine ,
jufqu’à celui qui fe borne à celle d’un papillon.
> Gérard Doüw , qui ne peignoit qu’eri petit ,
& dont les tableaux av’oient rarement plus
d’un pied de. hauteur, employoit quelquefois
cinq jours à faire une main -, il avoua lui-même
à Sandrarc qu’ un manche à balai lui avoit coure
trois jours de travail. Pour que la propreté
qu’il cherchoit dans fes ouvrages ne fût altérée
par aucun accident, il avoit foin de les renfermer
au moment où il les quittoit, &: avant
de^ les'reprendre quand il retournoit à l'on cab
inet, il reftoit quelques temps immobile juf-
quà ce que la poufilère la plus lubtile qu’ il
avoit excitée' par fon mouvement pût être tombée.
C’étoit alors qu’il retiroit d’unë boè'te, avec
précaution, fon tableau, fes pinceaux , fa palette.'
Aucun ouvrier n’auroit pu lui faire des pinceaux
afiez parfaits -, il les faifoit lui-même; aucun
éléve , aucun domeftique n’auroit pu broyer
fes couleurs afiez fines ; il étoit fon propre
broyeur. Il faifoit tout d’après nature : & pour
fuivre les contours des objets, & ’ rendre leurs
proportions avec plus d’ëxàftirude , il les regardât
à travers un treillage de foie compofé-
d’ un certain nombre de carreaux & le même
nombre de carreaux étoit tracé fur la toile; Par
ce moyen , il plaçoit ce qu’ il voyolt dans le
carreau du treillage fur le carreau correfpondant
de fa toile; ainfi il deflinoit aux carreaux d’après
nature ; moyen qu’on employé ordinairement
pour réduire, avec la plus grande précifion , des
tableaux ou des definis. Il le fervoit aufli d’ un
miroir concave qui lui repréfentoir l’objet plus
petit que la nature.
I l fit d’abord le portrait en petit; mais fon'
extrême lenteur impatientoit les modèles. Lui-
même fe lafia d’ avoir deux objets à fe propôfer ;
celui de faire reflembler , & celui de bien
peindre ; l’ un le diftrayoit de l’autre ; il
fe confacra donc à repréfenter des objets de
la vie commune. « Cet artifte , dit M. Déf-
» camps, eft un des pe ntres hollandais qui
» ait le plus fini fes tableaux. Tout y eft pré-
» c ieu x , flou & colorié fuivant les tons de la
» nature. Sa couleur n’eft point tourmentée
» par' le travail ; rien n’y èft fatigué. Une
» touche ' fraîche & pleine d’a r t, y voile le
» foin le plus péniblé. Ses tableaux confer-
» vent autant de vigueur de loin que de près ».
On fent bien , ' d’après ce que nous avons dit
de fa maniéré d’ojjéïet, qu’il ne faut pas y
chercher la chaleur.
On fait que Gérard Douw a cefle de vivre
dans la même v ille où il avoit pris naifiance;
mais on ignore l’année de fa mort. Il vivoit
encore en 1662.
On voit au cabinet du roi trois tableaux d»
‘ ce maître , & cinq au palais-royal. Tout U