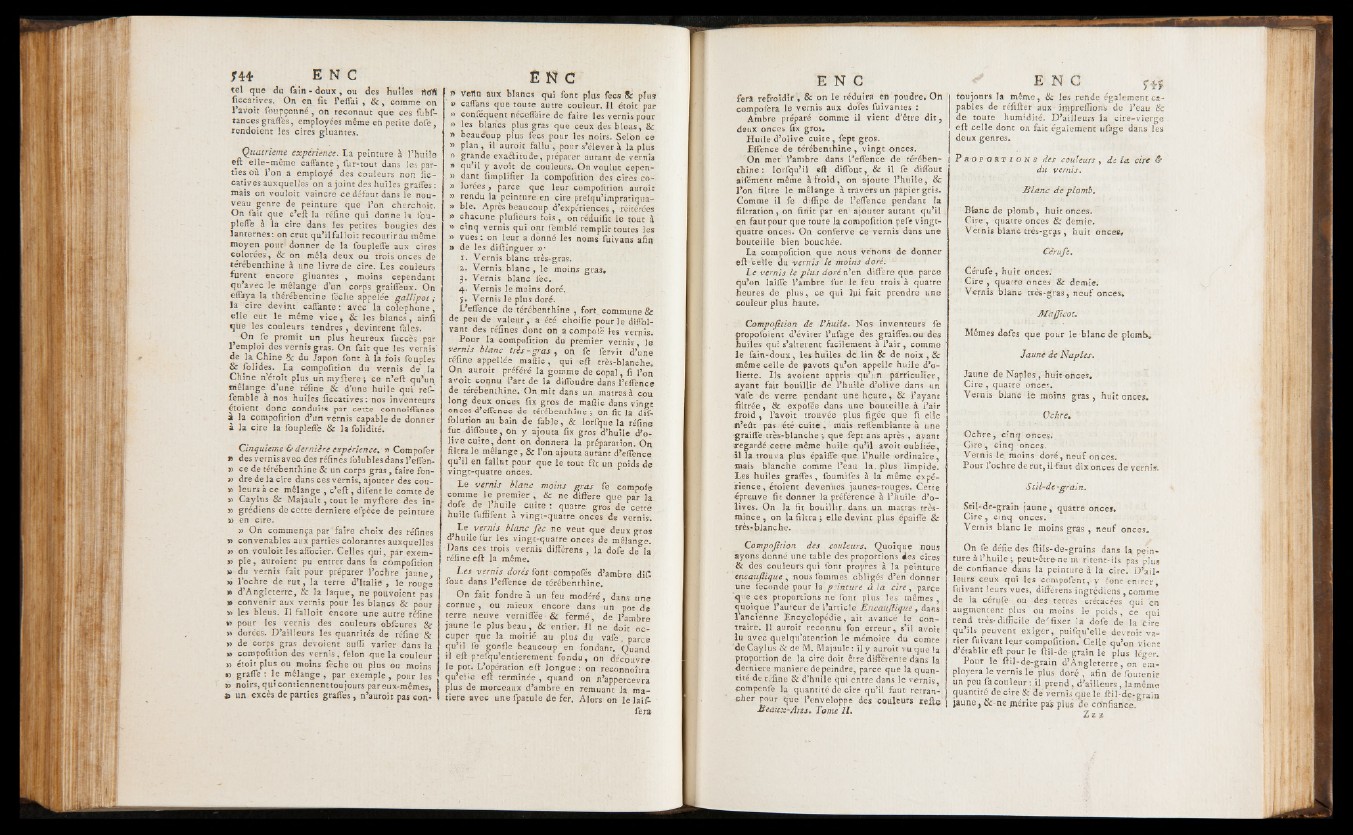
tel que du fain - d ou x , ou des huiles rttffli
ficcatives. On en fit l’ eflai , comme on
l ’avoit foupçonné, on reconnut que ces fubf-
tances grafles, employées même eh petite dofé .
rendoient les cires gluantes.
Quatrième expérience. La peinture à l’huile
eft elle-même caflante, fur-tout dans les parties
où l ’on a employé des couleurs non ficcatives
auxquelles on a joint des huiles grafles:
mais on vouloit vaincre ce défaut dans le nouveau
genre de peinture que l’on cherchoit.
On fait que c’eft la réfine qui donne la fou-
plefle à la cire dans les petites bougies des
lanternes: on crut qu’ il falloir recourir au même
moyen pour donner de la fouplefle aux cires
colorées, & on mêla deux ou trois onces de
térébenthine à une livre de cire. Les couleurs
furent encore gluantes , moins cependant
qu’avec le mélange d’un corps graifleux. On
elfaya la thérébentine lèche appelée gallipot ;
la cire devint caflante : avec la colophone,
e lle eut le même v ic e , & les blancs, ainfi
«jüe les couleurs tendres , devinrent fales.
On fe promit un plus heureux fuccès par
l ’emploi des vernis gras. On fait que les vernis
de la Chine 8c du Japon font à la fois fouples
& folides. La compofition du vernis de la
Chine n’éroît plus un myftere ; ce n’eft qu’ un
mélange d’une réfine & d’une huile qui ref-
femble à nos huiles ficcatives: nos inventeurs
étoient donc conduirs par cette connoiflance
à la compofition d’ un vernis capable de donner
à la cire la fouplefle & la folidité.
Cinquième & dernière expérience. » Compofer
y> des vernis avec des réfines folublesdans l’ eflen-
» ce de térébenthine & un corps gras, faire fbn-
» dre de la cire dans ces vernis, ajouter des cou-
» leurs à ce mélange , c’ e f t , difent le comte de
» Caylus & Majault, tout le myftere des in-
» grédiens de cette derniere efpèce de peinture
» en cire.
» On commença par faire choix des réfines
s> convenables aux parties colorantes auxquelles
» on vouloit les affocier. Celles qui, par exem-
yy pie, auraient pu entrer dans la compofition
» du vernis fait pour préparer l’ochre jaune
» l’ochre de ru t, la terre d’Italié , le rouge
» d’Angleterre, & la laque, ne pouvoient pas
» convenir aux vernis pour les blancs & pour
» les bleus. Il falloir encore une autre réfine
» pour les vernis des couleurs obfcures 8c
» doréës. D’ailleurs les quantités de réfine &
» de corps^ gras dévoient auffi varier dans la
» compofition des vernis, félon que la couleur
» étoit plus ou moins féche ou plus ou moins
n grafle : le mélange , par exemple, pour les
» noirs, qui contiennent toujours par eux-mêmes,
t> un excès de parties grafles, n’auroit pas con- I
» Vertu aux blancs qui font plus fecs & plus
» caflans que toute autre couleur. I l étoit par
» conféquent neceflaire de faire les vernis pour
» les blancs plus gras que ceux des bleus, &
» beaucoup plus fecs pour les noirs. Selon ce
» plan , il aurait fa llu , pour s?élever à la plus
» grande exaélitude, préparer autant de vernis
» qu’il y avoit de couleurs. On voulut cepen-
» dant Amplifier la compofition des cires co-
» lorées 9 parce que leur compofition aurait
» rendu la peinture en cire prelqu’ impratiqua-
» ble. Après beaucoup d’expériences , réitérées
» chacune plufieurs fois , on réduifit le tout à
*> cinq vernis qui ont femblé remplir toutes les
» vues : on leur a donne les noms fuivans afin
» de les diftinguer »•
1. Vernis blanc très-gras.
2. Vern is_blanc, le moins gras*
3. Vernis blanc iec.
4. Vernis le moins doré.
5. Vernis le plus doré.
L’ effence de térébenthine , fort, commune &
de peu de valeur, a été choifie pour le difîol-
vant des réfines dont on a compote les vernis.
Pour la compofition du premier vernis le
vernis blanc très-gras, on fe fervit d’une
réfine appeliée mafiic, qui eft très-blanche.
On aurait préféré la gomme de copal, fi l’on
avoit connu l’art de la difloudre dans l’eflence
de terebenthine. On mit dans un matras à cou
long deux onces fix gros de mafiic dans vingt
onces d’ effence de térébenthine ; ôn fit la dif-
folution au bain de fable, & lorfque la réfine
fut difloute, on y ajouta fix gros d’huile d’olive
cuite, dont on donnera la préparation. On
filtra le mélange, & l’ôn ajouta autant d’effence
qu’ il en fallut pour que le tour fît un poids de
vingt-quatre onces.
Le vernis blanc moins gras fe compofè
comme le premier , 8c ne différé que par la
dofe de l’huile cuite : quatre gras de cette
huile fuffifent à vingt-quatre onces de vernis.
Le vernis blanc f i e ne veut que deux gros
d’huile fur les vingt-quatre onces de mélange.
Dans ces trois vernis différens , la dofe de la
réfine eft la même.
Les vernis dorés font compofés d’ambre diC
fout dans l’eflence de térébenthine.
On fait fondre à un feu modéré, dans une
cornue , ou mieux encore dans un pot d©
terre neuve verniflee & fermé, de l’ambre
jaune le plus beau, & entier. I l ne doit occuper
que la moitié au plus du v afe , parce
qu’ il fe gonfle beaucoup en fondaht. Quand
il eft prefqu’entierement fondu, on découvre
le pot, L’opération eft longue: on reconnoîtra
qu’eiîe eft terminée , quand on n’appercevra
plus de morceaux d’ambre en remuant la matière
avec une fpatule de fer. Alors on le lai£
fera
fera refroidir, & on le réduira en poudre* Oh
compofera le vernis aux dofes fuivantes :
Ambre préparé comme il vient d’être d it,
deux onces fix gros*
Huile d’olive cuite, fept gros.
Eflence de térébenthine, vingt onces.
On met l’ ambre dans l’ eflence de térébenthine
: lorfqu’ il eft diflout, & il fe diflout
aifément même à froid, on ajoute l’huile, &
l ’on filtre le mélange à travers un papier gris.
Comme il fe diffipe de l’eflence .pendant la
filtration, on finit par en ajouter autant qu’ il
en faut pour que toute la compofition pefe vingt-
quatre onces. On conferve ce vernis dans une
bouteille bien bouchée.
La compofition que nous venons de donner
eft celle du vernis le moins doré.
Le vernis le plus doré n’ en différé que parce
qu’on laifle l’ambre fur le feu trois à quatre
heures de plus, ce qui îjii fait prendre une
couleur plus haute.
Compofition de Vhuile. Nos inventeurs fe
propofoient d’éviter l’ufage des graiffes.ou des
huiles qui s’altèrent facilement à l’a i r , comme
le fain-doux, les huiles de lin & de noix , &
même celle de pavots qu’on appelle huile d’o-
liette. Ils avoient appris qu’ un pârriculier,
ayant fait bouillir de l’huile d’olive dans un
vafe de verre pendant une heure, & l’ayant
filtrée, & expofée dans une bouteille, à l’air
froid , l’avoit trouvée plus figée que fi elle
n ’eût pas été cu ite , mais reffemblante à une
graiffe très-blanche •, que fept ans après , ayant
•regardé cette même huile qu’ il avoit oubliée,
il la trouva plus épaifle que l’huile ordinaire ,
mais blanche comme l’eau la. plus limpide.
Les huiles grafles, foumifes à la même expérience
, étoient devenues jaunes-rouges. Cette
•épreuve fie donner la préférence à l ’huile d’olives.
On la fit bouillir, dans, un matras très-
mince , on la filtra j elle devint plus épaifle &
trèsrblanche.
Compofition des couleurs. Quoique nous
ayons donné une table des proportions des cires
& des couleurs qui font propres à la peinture
cncaufiique , nous fommes obligés d’ en donner
une fécondé pour la peinture à la cire, parce
que ces proportions ne font plus les mêmes
quoique l’auteur de l’article Encaufiique , dans
l ’ancienne Encyclopédie, ait avancé le con-
trairè. 11 aurait reconnu fon erreur, s’ il avoit
lu avec quelqu’atention le mémoire du comte
de Caylus 8c. de M. Majault : il y aurait vu que la
proportion de la cire doit être différente dans la
derniere maniéré dépeindre, parce que la quantité
de r.-fine & d’hnile qui entre dans le vernis,
compenfe la quantité de cire qu’ il faut retrancher
pour que l’ enveloj?pe des couleurs refte
Beaux-Arts, Tome IL
toujours la même, & les rende également capables
de réfifter aux impreflions de l ’eau 8c
de toute humidité. D’ailleurs la cire-vierge
e ft celle donc on fait également ufage dans les
deux genres.
I P r o p o r t i o n s des couleurs,du vernis. de la cire &
Blanc de plomb.
Blanc de plomb, huit onces.
Cire’, quatre onces 8c demie.
Vernis blanc très-grjs , huit onces*
Cérufe.
Cérufe, huit onces.'
Cire , quatre onces & demie.
Vernis blanc crès-grasj neuf onces.
JM à flic ou
Mêmes dofes que pour l e ’blanc de plomb.
Jaune de Naples.
Jaune de Naples , -huit-onces.
C i r e , quatre onces.
Vernis blanc le moins gras , huit onces.
Ochre*
Ochre , cinq onces.
C ir e , cinq onces.
Vernis le moins doré, neuf onces.
Pour 1 ochre de rut, il faut dix onces de vernis*.
Stil-de 'grain.
Stil-de-grain jaune, quatre onces.
C ir e , cinq onces.
Vernis blanc le moins gras , neuf onces.
On fe défie des ftils-de-grains dans la peinture
à l’huile -, peut-être-ne m ritent-ils pas plus
de confiance dans la peinture a la cire. D’ailleurs
ceux qui les compofent,-y font entrer
fuivant leurs vues, différens ingrédient , comme
de la cérufe ou des terres crétacées qui en
augmentent plus ou moins le poids, ce qui
rend très-difficile de/fixer la dofe de la cire
qu’ ils peuvent ex iger, puifqu’elie devrait varier
fuivant le.ur compofition. Celle qu’on vient
d’érablir eft pour le ftil-de-grain le plus léger.
Pour le ftil-de-grain d’ Angleterre , on emplo
yer le vernis le plus doré, afin de fouten ir
un peu fa couleur : il prend, d'ailleurs, la même
quantité de cire & de vernis que le ftil-de-grain
jaune, èc ne jnérite pas plus 3e confiance.
Z a z