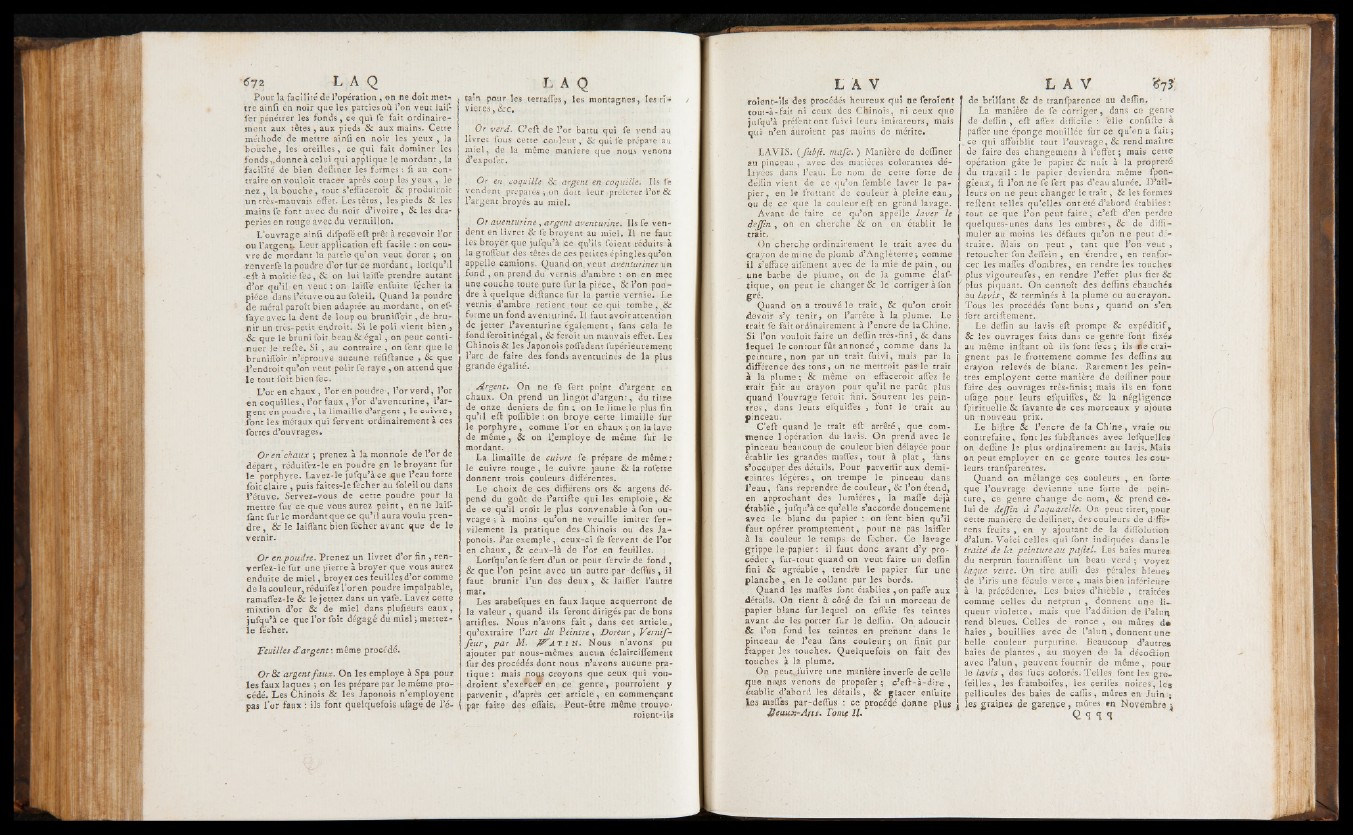
Pour la facilité de l’opération , on ne doit met- v
tre ainfi en noir que les parties où l’on veut laiP-
fer pénétrer les fonds , ce qui fe fait ordinairement
aux têtes, aux pieds & aux mains. Cette
méthode de mettre ainfi en noir les yeux , la
'bouche, les oreilles, ce qui fait dominer lés
fondsdonne à celui qui applique le mordant, la
facilité de bien defliner les formes : fi au contraire
on vouloit tracer après' coup les yeux , lé
nez , la bouche, tout s’effaceroit & produiroit
un très-mauvais effet. Les têtes, les pieds 8c les
mains fe font avec du noir d’ ivoire , & les draperies
en rouge av-ec du vermillon.
L’ouvrage ainfi difpofé eft prêt à recevoir l’or
ou l’argent. Leur application eft facile : on couvre
de mordant la partie qu’on veut dorer ; on
renverfe la poudre d'or lur ce mordant, lorlqu’ il
eft à moitié ie c , & on lui laiffe prendre autant
d’or qu’ il en veut : on laiffe enfuite fécher la
pièce dans l’étuve ou au foleil. Quand la poudre
de métal parole bien adaptée au mordant, on ef-
laye avec la dent de loup ou bruniffoir , de brunir
un très-petit endroit. Si le poli vient bien >
& que le bruni foit beau & é g a l, on peut continuer
le reftê. S i , au contraire , on lent que le
bruniffoir n’éprouve aucune réfiftance , 8c que
l ’endroit qu’on veut polir fe raye , on attend que
le tout foit bien fee.
L’or en chaux , l’or en poudre , l’or verd, l’or
en coquilles , l’or fau x , l’or d’avencurine, l’argent
en poudre, la limaille d’argent, le cuivre,
font les métaux qui fervent ordinairement à ces
fortes d’ouvrages.
Or en chaux ; prenez à la monnoîe de l’or de
départ, réduifez-le en poudre gn le broyant fur
le porphyre. Lavez-le jufqu’ à ce que l’eau forte
foit claire , puis faites-le fecher ’au foleil ou dans
l ’étuve. Servez-vous de cette poudre pour la
mettre fur ce que vous aurez peint, en ne laif-
fànt furie mordant que ce qu’ il aura voulu prend
re , & le laiffanr bien fécher avant que de le
vernir.
Or en poudre. Prenez un livret d’or fin , ren-
rerfez-le fur une pierre à broyer que vous aurez
enduite de m ie l, broyez ces feuilles d’or comme
de la couleur, réduifez l’or en poudre impalpable,
ramaffez-le & le jettez dans un vafe. Lavez cette
mixtion d’or & de miel dans plufieurs eaux,
jufqu’à ce que l ’or foit dégagé du miel -, mettez-
le fécher.
feuilles (Cargent', même procédé.
Or & argent faux . On les employé à Spa pour
les faux laques ; on les prépare par le même procédé.
Les Chinois & les Japonois n’employent
pas l ’or faux : ils font quelquefois ufagè de le -
tain pour les terraffes, les montagnes , les rî*
vieres, & ç .
Or verd. C’eft de l ’or battu qui fe vend au
livrer, fous cette couleur , & qui fe prépare au
miel, de la même maniéré que nous venons
d’expolèr.
Or en coquille 6c argent en coquille. Ils fe
vendent préparés -, on doit leur préférer l’ or &
l ’argent broyés au miel.
Or aventurine , argent aventurine. Ils fe. vendent
en livret & le broyent au miel. Il ne faut
les broyer que jufqu’à ce qu’ ils Ibient réduits-à
la groffeur des têtes de ces petites épingles qu’on
appelle camions. Quand on, veut aventuriner un
fond , on prend du vernis d’ambre : on en met
une couche toute pure fur la pièce, & l’on poudre
à quelque diftance fur la partie vernie* Le
vernis d’ambre retient tout ce qui tombe,fk .
forme un fond aventurine. Il faut avoir attention
de jetter l’ aventurine également, fans cela le
fond feroit inégal, & feroit un mauvais effet. Les
Chinois & les Japonois poffedent lupérieurement
l’art de faire des fonds aventurinés de la plus
grande égalité.
Argent. On ne fe fert poijit d’argent en
chaux. On prend un lingot d’argent, du titre
de onze deniers de fin ; on le lime le plus fin
qu’ il eft pofiible : on broyé cette limaille fur
le porphyre , comme l’or en chaux ; on la lave
de même, & on l’employe de même lur le
mordant.
La limaille de cuivre fe prépare de même:
le cuivre rouge , le cuivre jaune & la rofette
donnent trois couleurs différentes.
Le choix de ces diftèrens ors 6c argens dépend
du goût de l’artifte qui les emploie, &
de ce qu’il croit le plus convenable a fon ouvrage
; à moins qu’on ne veuille imiter fer-
vilement la pratique des Chinois ou des Japonois.
Par exemple, ceux-ci fe fervent de l’or
en chaux, & ceux-là de l’or en feuilles.
Lorfqu’onfefert d’un or pour fervir de fond,
& que l’on peint avec un autre par-deffus, il
faut brunir l’un des deux , & laiffer l’autre
mat.
Les arabefques en faux .laque acquerront de
la valeur , quand ils feront dirigés par de bons
artiftes. Nous n’avons fait , dans cet article.,
qu’extraire Vart du Peintre, Doreur, Vernif-
feu r , par M. JP'AT-i N. Nous n’avons pu
ajouter par nous-mêmes aucun éclairciflement
fur des procédés dont nous n’ avons aucune pratique:
mais noitè croyons que ceux qui vou-
droient s’exercer en ce genre, pourroient y
parvenir, d’après cet article, en commençant
par faire des effais, Peut-être même trouve*
roiçnt-ils
roîent-îls des procédés heureux qui tie feroîeflt |
tou!-à-fait ni ceux des Chinois, ni ceux que
jufqu’à préfentont fuivi leurs imitateurs, mais J
qui n’en aiiroienc pas1 moins de mérite.
LAVIS. ( fuhfl. mafe. ) Manière de defliner
au pinceau , avec des matières colorantes délayées
dans l’eau. Le nom de cette forte de
deffin vient de ce qu’on.femble laver le papier,
en 1* frottant de couleur à pleine eau,
qu de ce que la couleur eft en grand lavage.
Avant de faire ce qu’on appelle laver le
deffin , on en cherche & on en établit le
trait.
On cherche ordinairement le trait avec du
Crayon déminé de plomb d’Angleterre; comme
i l s’eff’acç aifément avec de la mie de pain, ou
une barbe, de plume, ou de la gomme élaf-
tique, on peut le changer & le corriger à fon ' mQ
uand on a trouvé le trait, & qu’on croit
devoir s?y tenir, on l’ arrête, à la plume. Le
trait fe fait ordinairement à l’ encre de la Chine.
Si l’on vouloit faire un deflin très-fini, & dans
lequel le contour fût annoncé, comme dans la
ceinture, non par un trait ftiivi, mais pat la
différence des tons, on ne mettroit pàsle trait
à la plume ; & même on effaceroit alfez le ,
trait fait au crayon pour qu’ il ne parûc. plus
quand Pouvragè feroit fini. Souvent les peintre
s , dans leuts eiquiffès , font le trait au
pinceau.
C’eft quand le trait eft arrêté, que commence
1 opération du lavis. On prend avec le
pinceau beaucoup de couleur bien délayée pour
établir les grandes maffes, tour à plat , fans
s’ occuper des détails. Pour parvertir aux demi-
teintes légères, on trempe le pinceau dans
l ’eau, fans reprendre de couleur, & l’on étend,
en approchant des lumières, la malfe déjà
é tablie, jufqu’ à ce qu’elle s’accorde doucement
avec le bianc du papier : on fent bien qu’ il
faut opérer promptement, pour ne pas laiffer
à la couleur le temps de fécher. Ce lavage
grippe le 'papier •: il faut donc avant d’y procéder
, fur-tout quand on veut faire un deffin
fini & agréable , tendre le papier fur une
planche, en le collant pur les bords.
Quand lgs maffes font établies , on paffe aux
détails. On tient à côté de foi un morceau de
papier blanc fur lequel on effaie fes teintes
avant de les porter fur le deffin. On adoucit
& l’on fond les teintes en prenant dans le
pinceau de l’eau fans couleur; on finit par
îtapper Jes touches. Quelquéfois on fait des
touches à la plume.
On peuç^Çuivre une manière inverfe de celle
que nous venons de propofer ; c’eft-à-dire ,
établir d’abord les détails, & glacer enfuite
\es maffes par-deffus : ce propéçlé donne plys
^ eaux-Art s. Tonif H.
de brillant & de tranfparence âû deffin.
La manière de fe corriger, dans ce genre
de deflin , eft affez difficile : elle confifte à
paffer une éponge mouillée fur ce qu’on a fait;
ce qui affoiblic tout l ’ouvrage , & rend maître
de faire des changemens à l’effet ; mais cette
opération gâte le papier 8c nuit à la propreté
du travail: le papier deviendra même lpon-
gieux, fi l’on ne fe fert pas d’eau alunéè. D’ailleurs
on ne peut changer le trait, 8c les formes
reftciit telles qu’elles ont été d’abord établies:
tout ce que l’on peut faire ; c’eft d’en perdre
quelques-unes dans les ombres, & de difïi—
muler au moins les défauts qu’ on ne peut détruire.
Mais on peut , tant que l’on veut ,
retoucher fon deffein , en étendre, en renforcer
les maffes d’ombres, en rendre les touches
plus yigoureufes, en rendre l’effet plus fier &
plus piquant. On connoît des deflins ébauchés
au la v is , & terminés à la plume ou au crayon.
Tous les procédés font bons , quand on s’ea
fert artiftement.
Le deflin au lavis eft prompt & expéditif,
8c les ouvrages faits dans ce genre font fixés
au même inftant où ils font fecs ; ils tie craignent
pas.le frottement comme les deflins au
crayon relevés de blanc. Rarement les peintres
employent cette manière de delîiner pour
faire des ouvrages très-finis; mais ils en font
ulage pour leurs efquiffes, & la négligence
fpirituelle & favante de ces morceaux y ajoute
un nouveau prix.
Le biftre & l’encre de la Chine, vraie ou
contrefaite, font les fubftances avec lcfquelles
on defline le plus ordinairement au lavis.. Mais
©n peut employer en ce genre toutes, les couleurs
tranfparenres.
Quand on mélange ces couleurs , en forte
que l’ouvrage devienne une forte de peim*
ture, ce genre change de nom, & prend celui
de deffin à Vaquarelle. On peut tirer, pour
cette manière de delîiner, des couleurs de diffe-
rens fruits , en y ajoutant de la diffolurion
d’alun. Voici celles qui font indiquées dans le
traité de la peinture au pajlel. Les baies mures
du nerprun fourniffènt un beau verd ; voyez
laque verte. On tire, aufli des pétales bleues
de l’ iris une fécule verte , mais bien inférieure
à la, précédente. Les baies d’hièble , traitées
comme celles du nerprun , donnent une li-,
queur violette, mais que l’addition de l’alun
rend bleues. Celles de ronce , ou mûres dm
haies , bouillies avec de l’alun , donnent une
belle couleur purpurine. Beaucoup d’autres
baies de plantes , au moyen de la décoélion
avec l’alun, peuvent fournir de même,. pour
le lavis , des lues colorés. Telles font les gro-
feilles , les framboifes, les çerifes noires, le s
pellicules des baies de caflis, mûres en Juin ;
les graijies 4e garence, mûres »n Novembre t
Q ‘i ‘l ' 1