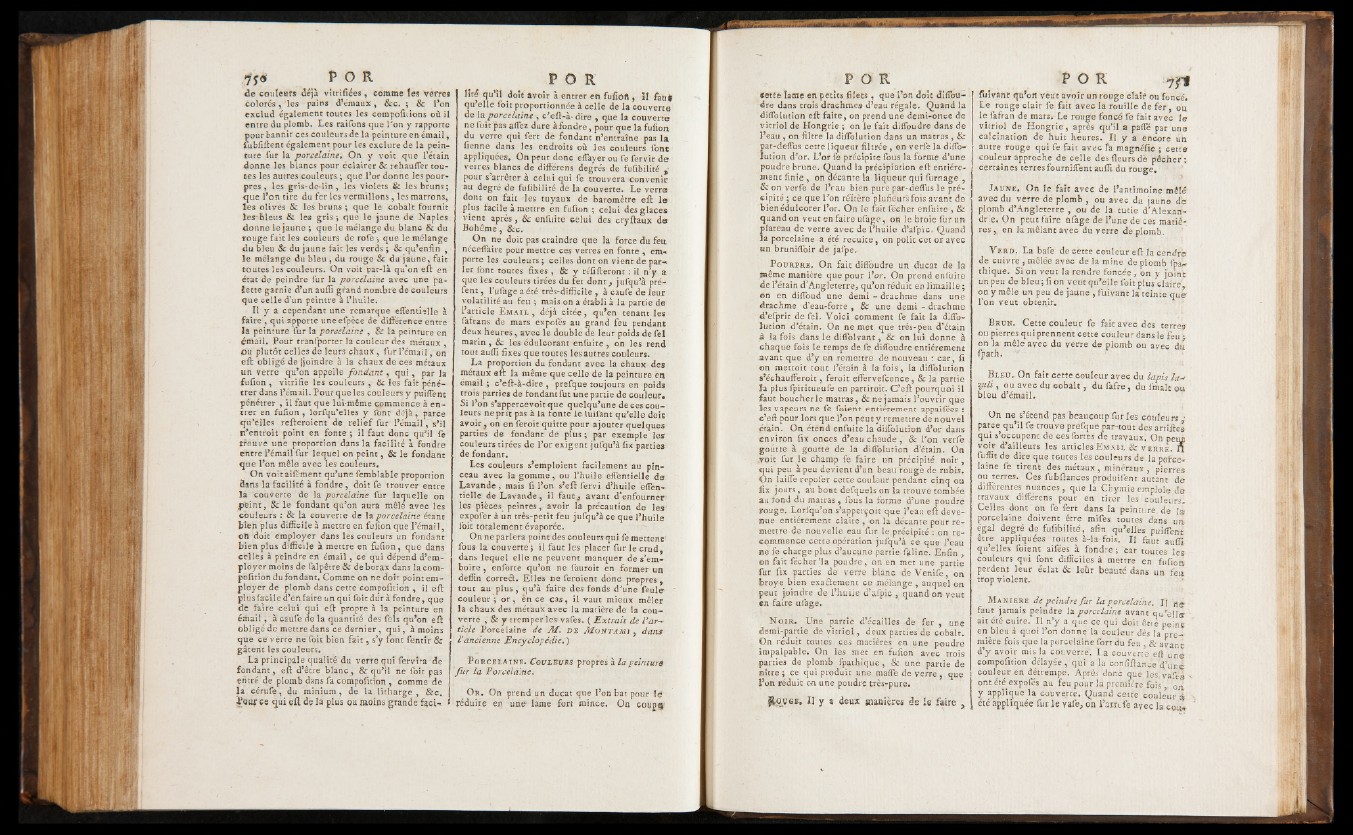
'ÿjat P O R
de couleurs déjà vitrifiées, comme les verres
colorés, les pains d’émaux, & c . ; & l’on
exclud également toutes les compofiiions où il
entre du plomb. Les raifons que l'on y rapporte
pour bannir ces couleurs de la peinture en émail.,
fubfiftent également pour les exclure de la peinture
fur la porcelaine, On y voit que l’étain
donne les blancs pour éclairer 8c rehauffer toutes
les autres couleurs ; que l ’or donne les pourpres
, les gris-de-lin , les violets 8c les bruns;
<jue l’on tire du fer les vermillons, les marrons,
le s olives & les bruns ; que le cobalt fournit
te$~bleus & les gris -, que le jaune de Naples
donne le jaune ; que le mélange du blanc & du
rouge fait les couleurs de rofe -, que le mélange
du bleu & du jaune fait les verds ; & qu’ enfin ,
le mélange du bleu , du rouge & du jaune, fait
routes les couleurs. On voit par-là qu’on eft en
état de peindre fur la porcelaine avec une palette
garnie d’ un aufli gtand nombre de couleurs
que celle d’un peintre à l’ huile.
Il y a cependant une remarque effentielle à
faire , qui apporte uneefpèce de différence entre
la peinture fur la porcelaine , & la peinture en
émail. Pour tranfporter la couleur des métaux ,
Ou plutôt celles de leurs chaux, fur l’émail, on
eft obligé de {joindre à la chaux de ces métaux
un verre qu’on appelle fon d a n t, q u i, par la
fufion , vitrifie les couleurs , & les fait pénétrer
dans l’émail. Pour que les couleurs y puiffent
pénétrer , il faut que luî-même commence à entrer
en fufion, lorfqu’elles y font déjà, parce
qu’ëlles refteroient de relief fur l’émail, s’ il
n’ entroit point en fonte ; il faut donc qu’il fe
trouve une proportion dans la facilité à fondre
entre l’émail fur lequel on peint, & le fondant
que l ’on mêle avec les couleurs.
On voitaifement qu’une femblable proportion
dans la facilité à fondre, doit fe trouver entre
la couverte de la porcelaine fur laquelle on
p eint, & le fondant qu’on aura mêlé avec les
couleurs : & la couverte de la porcelaine étant
bien plus difficile à mettre en fufion que l ’émail,
on doit employer dans les couleurs un fondant
bien plus difficile à mettre en fufion, que dans
celles à peindre en émail, ce qui dépend d’employer
moins de falpêtre 8c de borax dans la com-
pofition du fondant. Comme on ne doit point employer
de plomb dans cette compofition , il eft
plus facile d’enfaire un qui foit dur à fondre, que
de faire celui qui eft propre à la peinture en
értiail, à c au fed e la quantité des fêls qu’on eft
obligé de mettre dans ce dernier, q u i, à moins
que ce verre ne foit bien f a i t , s’y font fentir &
gâtent les couleurs.
La principale qualité du verre qui fervirad e
fondant, eft d’être blanc, & qu’ il ne foit pas
entré de plomb dans fa compofition , comme de
la cérufe, du minium, de la .lith a rg e , & c .
Jouf çe qui eft de la glus ou moins grande faci-
P o R
lité qu’ïl doit avoir à entrer en fufîôfl , 31 fàu|
qu elle foit proportionnée à celle de la couverte
de la, porcelaine , c’ eft-à-dire , que la couverte
ne foit pas alfez dure afondre, pour que la fufion
du verre qui fert de fondant n’entraîne pas la
fienne dans les endroits où les couleurs fonc
appliquées. On peut donc effayer ou fe fervir de
verres blancs de différens degrés de fufibilité j
pour s’arrêter à celui qui fe trouvera convenir
au degre de fufibilité de la couverte. Le verre
dont on fait les tuyaux de baromètre eft le
plus facile a mettre en fufion ; celui des glaces
vient après, & enfuite celui des cryftaux de
Bohême, &c.
On ne doit pas craindre que la force du feu
néceffaire pour mettre ces verres en fonte , em*
porte les couleurs ; celles dont on vient de par-*
1er, font toutes fixes , & y réfifteront : il n y a
que les couleurs tirées du fer dont, jufqu’à pré-
fen t, l ’ufage a été très-difficile , à caufe de leur
volatilité au feu ; mais on a établi à la partie de
l’article Ema.i l , déjà citée, qu’en tenant les
fafrans de mars expofés au grand feu pendant
deux heures, avec le double de leur poids de fel
marin , & les édulcorant enfuite , on les rend
tout aufli fixes que routes les autres couleurs.
La proportion du fondant avec la chaux des
métaux eft la même que celle de la peinture ën
émail ; c*eft-à-dire , prefque toujours en poids
trois parties de tondant fut une partie de couleur,
Si l’on s’ appercevoitque quelqu’une de ces couleurs
ne prît pas à la fonte le luifant qu’elle doit
avoir} on en feroit quitte pour ajouter quelques
parties de fondant de plus; par exemple les
couleurs tirées de l ’or exigent jufqu’à fix parties
de fondanr.
Les couleurs s’emploient facilement au pinceau
avec la gomme, ou l’huile eflentielle de
Lavande, mais fi l’on s’eft fervi d’huile effen-
tieîle de Lavande, il faut,, avant d’enfourner
les pièces peintes, avoir la précaution de les
expofer à un très-petit feu jufqu’à ce que l’huile
foit totalement évaporée.
On ne parlera point des couleurs qui fe mettent
fous la couverte; il faut les placer fu r le c ru d ,
dans lequel elle ne peuvent manquer de s’em-
boire, enforte qu’on ne fauroit en former un
deffin correét. Elles ne feroient donc propres ,
tout au plus, qu’à faire des fends d’une feule
cohleur ; o r , en ce cas , il vaut mieux mêler
la chaux des métaux avec la matière de la couverte
, & y trempeflesivafes. ( Extrait de Varticle
Porcelaine de M . de M on t ami , dans,
l ’ancienne Encyclopédie. )
Porcelaine. Couleurs propres à la peinturé
fu r la Porcelaine.
Or. On prend un ducat que l’on bat pour le
réduire en une- lame fort mince. On coup®
P O R
cette lame en petits file ts , que l’on doit dîffou-
dre dans trois drachmes d’eau régale. Quand la
diffolution eft faite, on prend une demi-once de
vitriol de Hongrie ; on le fait difïbudre dans de
l ’eau , on filtre la diffolution dans un matras , 8c
par-deffus cetté liqueur filtrée , on verfe la diffolution
d’or. L’or fe précipite fous la forme d’une
poudre brune. Quand la précipiation eft entièrement
finie , on décante la liqueur qui fumage ,
& on verfe de l’eau bien pure par-deffus le précipité
; ce que l'on réitère plusieurs fois avant de
bien édulcorer l’or. On le fait fécher enfuite , &
quand on veut en faire ufage, on le broie fur un
plateau de verre avec de l’huile d’afpic, Quand
la porcelaine a été recuite, on polit cet or avec
un bruniffoir de jafpe.-
Pourpre, On fait diffoudre un ducat de la
même manière que pour l’or. On prend enfuite
de l’étain d’Angleterre, qii’on réduit en limaille ;
on en diffoud une demi - drachme dans une
drachme d'eau-forte , & une demi - drachme
d’efprit de fel. Voici comment fe fait la diffolution
d’étain. On ne met que très-peu d’étain
à la fois dans le diffolvant, & on lui donne à
chaque fois le temps de fe diffoudre entièrement
avant que d’y en remettre de nouveau r car, fi
on mettoit tout Pétain à la fois, la diffolution
s’échauffèroit, feroit effervefcence, & la partie
la plus Ipiritueufe en partiroit. C ’eft pourquoi il
faut boucherie matras, & ne jamais l’ouvrir que
les vapeurs ne fe foient entièrement appaifées :
e’eft pour lors que l’on peut y remettre de nouvel
étain. On étend enfuite la diffolution d’or dans
environ fix onces d’eau chaude, 8c l’on verfe ,
goutte à goutte de la diffolution d’étain. On
vo it fur le champ fe faire un précipité noir,,
qui peu apeu devient d’ un beau rouge de rubis.
On la-iffe repofer cette couleur pendant cinq ou
fix jours, au bout defquels on'la trouve tombée
au fond du matras , fous la forme d’ une poudre
rouge. Lorfqu’on s’apperçoit que l’eau eft devenue
entièrement claire , on la décante pour remettre
de nouvelle eau fur le précipité : on recommence
cette opération jufqu’ à ce que l’ eau
né fe charge plus d’aucune partie faline. Enfin ,
©n fait fécher Ma poudre, on en met une partie
fur fix parties de verre blanc d eV en ife , on
broyé bien ex a élément ce mélange , auquel on
peut joindre de l’huile d’afpic , quand on veut
en faire ufage.
Noir. Une partie d’écailles de fer , une
demi-partie de v it r io l, deux parties de cobalt.
On réduit toutes ces matières en une poudre
impalpable. On les met en fufion avec trois
parties de plomb fpathique, & une partie de
nître; ce qui produit une maffe de verre, que I
l’on réduit en une poudre très-pure.
jkoyGE. I l y a deux »amères de le faire *
fOR
ruîyant qufon veut avoir un rouge claî? ou foncé*
Le ronge clair fe fait avec la rouille de fe r , ou
le fafran de mars. Le rouge foncé fe fait avec le
vitriol de Hongrie , après qu’il a paffé par une
calcination de huit heures. Il y a encore un
autre rouge qui fe fait avec fa magnéfie ; cetté
couleur approche de celle des fleurs de pêcher:
certaines terres fourniffent aufli du rouge.
Jaune. On le fart avec de l ’antimoine mêlé
avec du verre de plomb , ou avec, da jaune de
plomb d’Angleterre , ou de la tutie d’Alexandrie.
On peut faire ûfage de l’ une de ces matières
y en la mêlant avec du verre de plomb.
Verd. La bafe de cette couleur eft la cendré
de cuivre , mêlée avec de la mine de plomb fpâ^
thique. Si on veut la rendre foncée, on y joint
un peu de bleu ; fi on veut qu’ elle foit plus claire'
ou y mêle un peu de jaune , fui van t la teinte que
l ’on veut obtenir..
Brun. Cette couleur fe fait avec des terres
ou pierres qui prennent cette couleur dans le feu •
on la mêle avec du verre de plomb ou avec du
Ipath.
Ble^ , On fait cette couleur avec du lapis la-*
\ ïili, ou avec du co b a lt, du fafre, du fmalt ou
bleu d’émail.
On ne s’étend pas beaucoup furies couleurs -
parce qu’ il fe trouve prefque par-tout des artiftes
qui s’occupent de ces fortes de travaux. On peim
voir d’ailleurs les articles Email & verre, u
fuffit de dire que toutes les couleurs de la porce--
laine fe tirent des métaux, minéraux, pierres
ou terres. Ces fubftances produifent autant de
différentes nuances , que la Cbymie emploie de
travaux différens pour en tirer les couleurs;
Celles dont on fe fert dans la peinture de la
porcelaine doivent être mifes, toutes dans un
égal degré de fufibilité, afin qu’ elles puiffent
être appliquées toutes à-la-fois. I l faut aufli-
qu’elles foient aifées à fondre ; car toutes les
couleurs qui font difficiles à mettre en fufion
perdent leur éclat & leür- beauté dans un feu
trop violent.
Maniéré de peindre fur la porcelaine. Il ne
faut jamais peindre la porcelaine avant qu'ell«
ait été cuite. I l n’y a que ce qui doit être peint
en bleu à quoi l’on donne la couleur dès la première
fois que la porcelaine fort du feu & avant
d’y avoir mis la couverte. La couverte efl une
compofition délayée, qui a la confiftance 4’u rc
couleur en détrempe. Après donc que les, vafes '■
ont été expofés au feu pour la première fois T on
y applique la couverte. Quand cette couleur à
été appliquée fur le yafe, on l’arrcfe avec la cou*