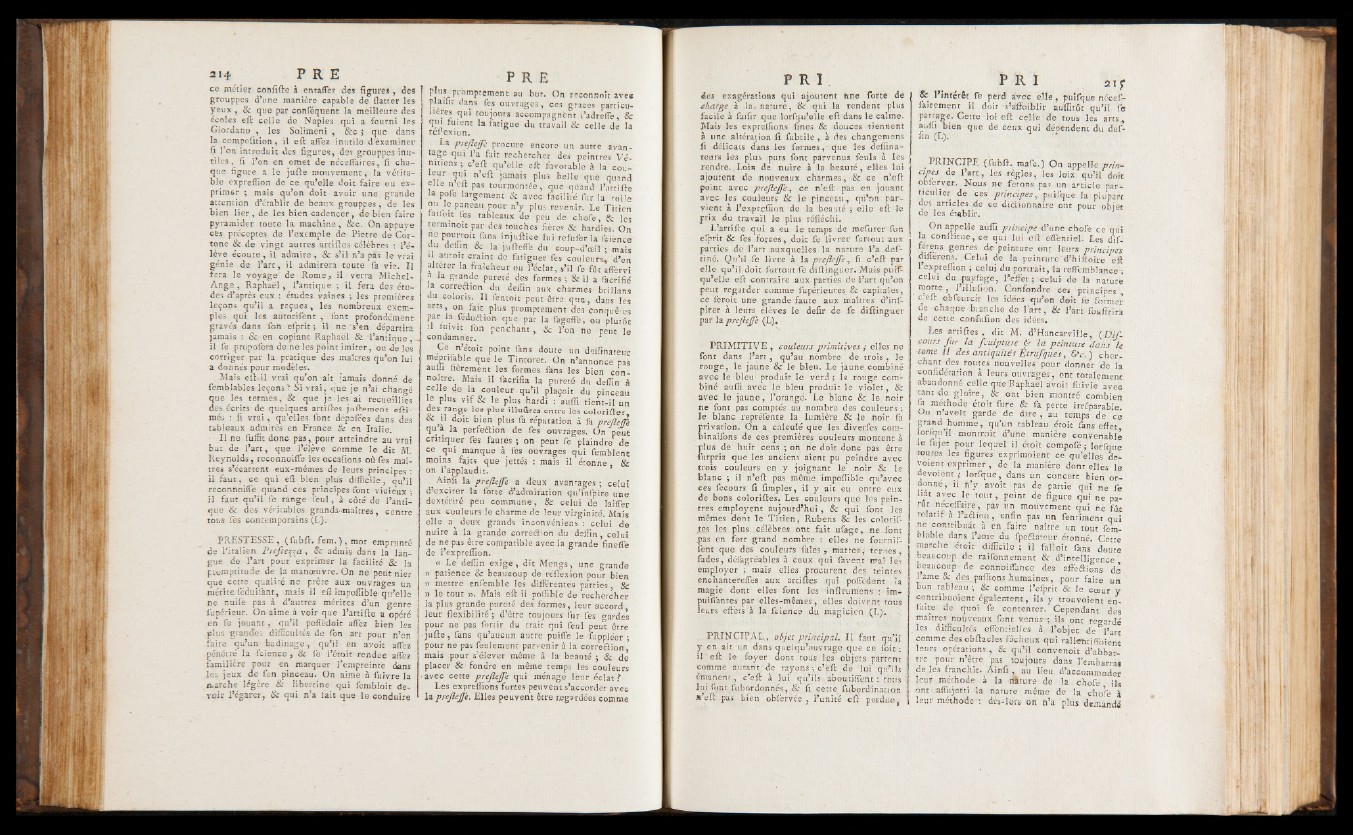
ce métier confifte à entaffer des figures , des
grouppes d’une manière capable de flatter les
yeux , & que par conféquent la meilleure des
écoles eft celle de Naples qui a fourni les
Giordano , les Solimeni , & c j que dans
la compofition, il eft affez inutile d’examiner
fi l’on introduit des figures, des grouppes inutile
s , fi l’on en omet de ncceffaires, fi chaque
figure a le jufte mouvement j la véritable
expreffion de ce qu’elle doit faire ou exprimer
; mais qu’on doit avoir une grande
attention d’établir de beaux grouppes, de les
bien lie r , de les bien cadencér, de bien faire
pyramider toute la machine, & c. On appuyé
ces préceptes de l’exemple de Pietre de Cor-
tone & de vingt autres arciftes célèbres : l’élève
écoute, il admire , & s’ il n’a pas le vrai
génie de l’ar t, il admirera toute fa vie. I l
fera le voyage' de Rome, il verra Michel-
A n g e , Raphaël, l’antique -, il fera des études
d’après eux : études vaines ; les premières
leçons qu’ il a reçues, les nombreux exemples
qui les autorifent , font profondément
gravés dans fon efprit ; il ne s’en départira
jamais : & en copiant Raphaël & l’antique -
il fe propofera de ne les point imiter, ou de les
corriger par la pratique des maîtres qu’on lui
a donnés pour modèles.
Mais eft-iî vrai qu’ on ait jamais donné de
femblables leçons? Si vrai, que je n’ai changé
que les termes, & que je les ai recueillies
des. écrits de quelques artiftes juftement efti-
més : fi vrai , qu’elles font dépofées dans des
tableaux admirés en France & en Italie.
I l ne fuffit donc pas, pour atteindre au vrai
but de l’ar t, que l’élève comme le dit M.
Reynolds, reconnoiffe les occafions où fes maîtres
s’écartent eux-mêmes de leurs principes:
il faut, ce qui eft bien plus difficile, qu’ il
reconnoiffe quand ces principes font vicieux-,
il faut qu’il fe range fe u l, à côté de l’antique
& des véritables grands-maîtres, contre
tous fes contemporains (L).
PRESTESSE, ( fubft. fem.) , mot emprunté
de l’italien P r e f e r a , & admis dans la langue
de l’art pour exprimer la facilité & la
promptitude de la manoeuvre. On ne peut nier
que cette qualité ne prête aux ouvrages un
mérite féduilant, mais il eft impoffible qu’elle
ne nuife pas à d’autres mérites d’un genre
fupérieur. On aime à voir que l ’artifte a opéré
en fe jouant, qu’ il poffédoit affez bien les
plus grandes difficultés de fon art pour n’en
faire qu’un badinage, qu’ il en avoit affez
pénétré la fcience , & fe l’étoit rendue affez
familière pour en marquer l ’empreinte dans
les jeux de fon pinceau. On aime à fuivre la
r-arche légère & libertine qui fembloit de- I
voir l’égarer, &: qui n’ a fait que le conduire 1
plus promptement au but. On reconnoït ave«
plaifir dans fes ouvrages, ces grâces particu-
lieres qui toujours accompagnent l’adrefTe, &
qui fuient la fatigue du travail & celle de la
rerexion.
La preflejfe procure encore un autre ayants
® qui l’a fait rechercher des peintres Vé-
nitiens ; c’eft qu’elle eft favorable à la cou-
leur ijuj n’ cft jamais plus belle que quand
elle n eft pas tourmentée , que quand l’artifte
la pôle largement & avec facilité fur la toile
ou le paneau pour n’y plus revenir. Le Titien
falloir les tableaux de peu de chofe, & les
terminoit par des touches fières & hardies. On
ne pourroit fans injuftice lui te fit fer la fcience
du deffin & la juftefle du coup-d’oeil ; -mais
il auroit craint de fatiguer fes couleurs, d’en
älterer la fraîcheur ou l’éclat, s’il fc fflt aflervi
a la grande pureté des formes ; & il a lacrifié
a correction du dellin aux charmes brillans
du coloris. Il femoit peut-être qua, dans les
arts, on fait plus promptement des conquêtes
pat la féduflion que par la fagefle, ou plutôt
il iuivit fon penchant, & l’on ne peut le
condamner. r
Çe .n’étoit point fans doute un doffinateur
mepriftble que le Tintoret. On n’annonce pas
aulli herement les formes fans les bien con-
noître. Mais il facrifia la pureté du deffin à
celle de la couleur qu’il plaçoit du pinceau
le plus v if & le plus hardi : auffi tient-il un
des rangs les plus illuftres entre ies coloriftes,
doit bien plus fa réputation à fa preßelß
qu a la perfection de fes ouvrages. On peut
critiquer fes fautes ; on peut fe plaindra de
ce qui manque à fes ouvrages qui femblent
moins fajts que jettés : mais il étonne &
on l’applaudit.
Aiiifi la preßeße a deux avantages ; celui
d’ exciter la forte d’admiration qu’infpire une
dextérité peu commune, & celui de laiffer
aux couleurs le charme de leur virginité. Mais
elle a deux grands inconvéniens : celui de
nuire à la grande correction du deffin, celui
de ne pas être compatible avec la grande fineffe
de l’expreffion.
J Le deffin e x ig e , dit Mengs, une grande
» patience & beaucoup de réflexion pour bien
» mettre enfemble les différentes parties &
» le tout ». Mais eft-ii poffible de rechercher
la plus grande pureté des formes, leur accord
leur flexibilité ; d’ être toujours fur fes gardes
pour ne pas fortir du trait qui feul peut être
ju fte , fans qu’aucun autre puiffe le fuppléer ;
pour ne pas feulement parvenir à la correétion
mais pour s’élever même à la beauté ; & de
placer & fondre en même temps les couleurs
avec cette preßeße qui ménage leur éclat ?
Les expreffions fortes peuvent s’accorder avec
\ i preßeße. Elles peuvent être regardées comme
des exagérations qui ajoutent fine forte de
charge à la. nature, & qui la rendent plus
facile à fai fit* que lorfqu’elle eft dans le calme.
Mais les expreffions fines & douces tiennent
à une altération fi fubtile , à des changemens
fi délicats dans les formes.,- que les deffina-
teurs les plus purs font parvenus feuls à les
rendre. Loin de nuire à la beauté, elles lui
ajoutent de nouveaux charmes, & ce n’eft
point avec prejlejfe., ce n’eft pas en jouant
avec les couleurs & le pinceau, qu’ on parvient
à l’expreffion de la beauté ; elle eft le
prix du travail le plus réfléchi.
L’artifte qui a eu le temps de mefurer fon
efprit & fes forces, doit fe livrer furtout aux
parties de l’art auxquelles la nature l ’a def-
tiné. Qu’il ie livre à la p te fte jfe , fi e’eft par
elle qu’il doit furtout fe diftinguer. Mais puif-
qu’elle eft contraire aux parties de l’art qu’on
peut regarder comme fupérieures & capitales,
ce feroit une grande faute aux maîtres d’ inl-
pirer à leurs élèves le defir de fe diftinguer
par la prejlejfe (L).
PRIMITIVE , couleurs primitives ,* elles ne
font dans l ’a r t , qu’au nombre de trois, le
rouge, le jaune & le bleu. Le jaune combine
avec le bleu produit le verd ; le rouge combiné
aufii avec le bleu produit le v iolet, &
avec le jaune , l’orangé. Le blanc & le. noir
ne font pas comptés au nombre des couleurs ;
le blanc repréfente la lumière & le noir fa
privation. On a calculé que les diverses com-
binaifons de ces premières couleurs montent à
plus de. huit cens ; on ne doit donc pas être
furpris que les anciens aient pu peindre avec
trois couleurs en y joignant le noir & le
blanc ; il n’eft pas même impoffible qu’avec
ces fecours fi fimples, il y ait eu entre eux
de bons coloriftes. Les couleurs que les peintres
employent aujourd’h u i, & qui font les
mêmes dont le T itien , Rubens & les coloriftes
les plus célèbres ont fait ufage., ne font
pas en fort grand nombre : elles ne fournif-
fent que des couleurs fales , martes^ ternes
fades, défagréables à ceux qui favent mal les
employer -, mais elles procurent des teintes
enchantereffes aux artiftes qui poffèdent la
magie dont elles font les inftrumens : im-
puiffantes par elles-mêmes, elles doivent tous
leurs effets à la fcience du magicien (L). \
PRINCIPAL,, objet principal. Il faut qu’il
y en ait un dans quelqu’ouvrage que ce foie :
il 'e f t le foyer dont tous les objets partent
comme autant de rayons-, c’eft de lui qu’ ils
émanent, c’eft à lui qu’ ils aboutiffent : tous '
lui font lu b or don nés., & fi cette fubordination
n’eft pas bien obferrée , l’ unité eft perdue ^
& l’ intérêt fe perd avec e l le , pnifque nécef-
fairement il doit s’affbiblir auffitôt qu’ il fe
partage. Cette loi eft celle de tous les arts*
au-ffi" bien que de ceux qui déoendent du deffin
(L). ^
J PRINCIPE {fubft. mafe.) On appelle prin-
cipes de l ’ar t, les règles, les loix qu’ il doit
obferver. Nous ne ferons pas un article pàrj-
ticulier de ces principes, puifque la plupart
des articles.de ce diéiionnaire ont pour objet
de les établir.
On appelle auffi principe d’ une choie ce qui
la constitue, ce qui lui eft effentiel. Les dif-
ferens genres de peinture ont leurs principes
.différent. Celui de la -peinturé d’hiftôire eft
1 expreffion ; cejui du portrait, la raffembîance ;
celui du .payfage, Eëffét; -celui de la nature
n>°/L6 ’ Confondre ces principes *
c éft obfcurcir les idées qu’on doit fe former
de chaque-branche de l ’a r t, & l ’art fouffrira
de cette confufion des idées.
Les artiftes , dit M. d’Hancarville, (D if-
cours fu r la fculpture & la peinture dans /<?
-tome i l des antiquités Étrufques y & c .) cherchant
des routes nouvelles pour donner de la
confidération à leurs ouvragés, ont totalement
abandonné celle que Raphaël avoit fuivié avec
tant de gloire, & ont bien montré combien
fa méthode étoit fure & fa perte irréparable.
On n’a voit garde de dire , au temps de ce
grand homme, qu’un tableau étoit fans effet
lorfqu’il montrait d’une manièfe convenable
le fujet pour lequel il étoit compofé j lorfque
routes les figures exprimoient ce qu’elles dévoient
exprimer, de la manière dont elles le
dévoient,* lorfque, dans un concert bien ordonné,
il n’y avoit pas de partie qui ne fe
liât avec le tout, point de figure qui ne parue
neceffaire, pas un mouvement qui ne fôc
relatif à j ’a&ion, enfin pas un fentiraent qui
ne contribuât à en faire naître un tout fem-
blable dans l’ame du fpeélateur étonné. Cette
marche étoit difficile ; il falloir fans doute
beaucoup de raifonnement & d’ intelligence
beaucoup de connoiffance des affrétions de
l’ame & des paffions humaines, pour faire un
bon tableau -, & comme î’efprit & le coeur y
contribùoient' également , ils y trouvoient en-
fuite de quoi fe contenter. Cependant des
maîtres nouveaux font venus-; ils ont regardé
les difficultés effentielJes à l’objet d e r i’art
comme des obftacles fâcheux qui rallchtiffoient
leurs opérations , & qu’il convenoit d’abbatv
tre pour n’êtré pas toujours dans l’embarras
de les franchir. Ainfi , au lieu d’accommoder
leur méthode à la nature de la chofe ils
ont affujetti la nature même de la chofe à
leur méthode': dès-lors on n’a plus demande