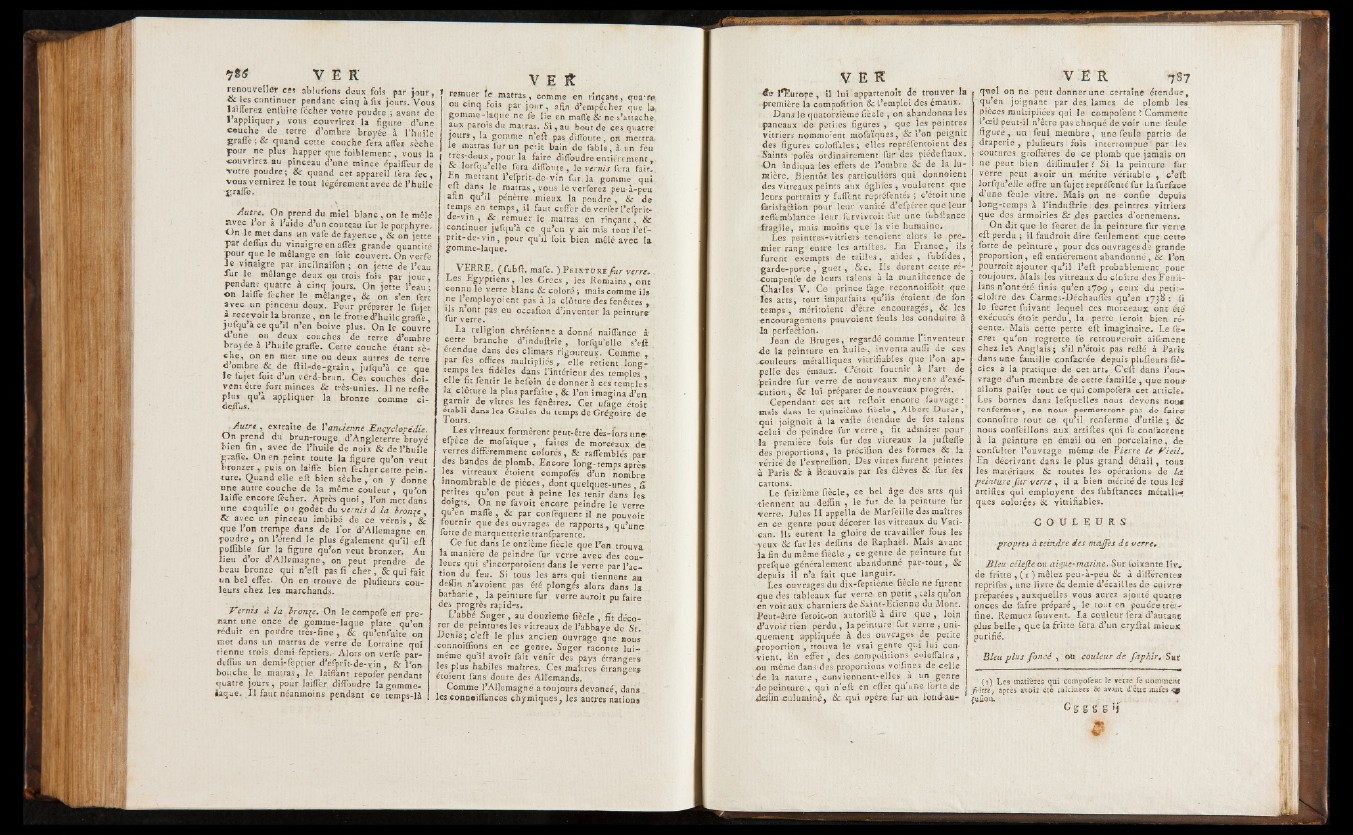
renouvellôr ces ablurions deux fois par jou r,
& les continuer pendant cinq à fix jours. Vous
lai (ferez enfuite lécher votre poudre ;, avant de
l ’appliquer, vous couvrirez la figure d’une
c«uche de terre d’ombre broyée à l’huile
grafTe ; & quand cette couche fera affez sèche
pour ne plus happer que foiblement, vous la
-couvrirez au pinceau d’ une mince épaifleur de
votre poudre ; & quand cet appareil l’era f e c ,
vous vernirez le tout légèrement avec de l’huile
griffe.
Autre. On prend du miel blanc , on le mêle
avec 1 or à l'aide d’un couteau fur le porphyre,
■ On le met dans un vafe de fayence , & on jette
par deffus du vinaigre en affez grande quantité
pour que le mélange en foit couvert. On verfe
le vinaigre par inctlnaifon ; on jette de l’eau
dur le mélangé deux qu trois fois par jour.
pendant quatre à cinq jours. On jette l’ eau ;
on laiffe fecher le mélange, & on s’ en lert
avec un pinceau doux. Pour préparer le fujet
à recevoir la brome , bn le frotte d’huile graffe
jufqu’à ce qu'il n’ en boive plus. On le couvre
d’une on deux couches de terre d’ombre
broyée à l’huile graffe. Cette couche étant sèch
e , on en met une ou deux autres de terre
d ’ombre & de ftiL-de-grain, jufqu’ à ce que
îe lujet (bit d’un vérd-brun. Ces couches doivent
être fort minces & très-unies. Il ne refte
plus qu’a appliquer la bronze comme ci-
dejfus.
.Au tr e , extraite de Ÿancienne Encyclopédie.
On prend du brun-rouge, d’Angleterre broyé
bien fin , av e c 'd e 'l’huile de noix & de l’huile
grade. On en peint toute la figure qu’on veut
bronzer, puis on laiffe bien fecher cette pein*
ture. Quand elle eft bien sèche ,Jon y donne
une autre couche de la même couleur, qu’on
laiffe encore lecher. Apres quoi, l’on met dans
une coquille 01 godet du vr ais J la ironie,
& avec un pinceau imbibé de ce vernis , &
que l’on trempe dans de l'or d’Allemagne en
poudre, on l’etend îe plus également qu'il elt
poffible fur la figure qu’on veut bronzer. Au
lieu d’or d’Allemagne, on peut prendre de
beau bronze qui n’elt pas fi ch e r , & qui fait
un bel effet. On en -trouve de plufieurs couleurs
chez les marchands.
Vernis à la ironie. On le compofe en prenant
une once de gomme-laque plate qu’on
réduit en poudre très-fine, & qu’enfuite on
met dans un matras de verre de Lorraine qui
tienne trois demifepders.- Alors on verfe par-
deffus un demi-feptier d’efprit-de-ïîn , & l ’on
bouche le matras, le laiffant repofer pendant
quatre jours, pour Jaiffer, diflôudre la gomme-
laque. I l faut néanmoins pendant ce,temps-là
remuer le matras, comme en rinçant, qua*f©
ou cinq fois par jou r, afin d’empêcher que la-
gomme-laque ne fe lie en mafle &r ne s’attache-,
aux parois du matras. S i , au bout de ces quatre
jours, la gomme n’eft pas difloute, on mettra,
le matras lur un petit bain de fable, à un feu
j très-doux, pour la faire diflbudre entièrement y
& lorfqu’elle fera difloute, le vernis fera fait,.
En mettant l’elprit-de-vîn fur. la gomme qui
eft dans le matras, vous le verferez peu-à-peu
afin qu’ il pénètre, mieux la poudre, & de
temps en temps, il faut ceffcr de verfer l’ efpric-
de-vin , & remuer le matras en rinçant, &
continuer jufqu’à ce qu’on y ait mis tout l’ef-
■ prit-de-vin, pour qu’il foit bien mêlé avec la
gomme-laque.
VERRE. (fubft. mafe. ) Peinture fur verre- .
Les Egyptiens, -les Grecs , les Romains, ont
connu le verre blanc & coloré ; mais comme ils
,ne 1 employaient pas à la clôture des fenêtres 'r
‘ils n ont pas eu occafion d’inventer la peinture
fur verre.
La religion chrétienne a donné naîflance à!
cette branche d’ induftrie , lorfqu’elle s’ eft
ecendue dans des. climats rigoureux. Comme
par (es offices multipliés y , elle retient long-
rempsles fideles dans l’intérieur des temples .
a ^-nt*r befoin de donner à ces temples-
la clôture la plus parfaite , & l’on imagina d’en
garnir de vitres les fenêtres. Cet ufage étok .
établi dans les Gaiil.es du temps de Grégoire de
Tours. ' °
Les vitreaux formèrent peut-être dès-fors une
efpèce de mofaïque , faites de morceaux de
verres différemment colorés, & raflemblés par
des bandes de plomb. Encore long-temps après
les vitreaux étoient compofés d’ un nombre
innombrable de pièces , dont quelques-unes fi
petites qu’on peut à peine les tenir dans les
doigts. On ne favoit encore peindre le verre
qu’en^ maffe , & par conféquent il ne pouvoit
fournir que des ouvrages de rapports, qu’une
lotte de marquetterie traniparente.
Ce fup dans le onzième fiècle que l’on trouva
la manière de peindre fur verre avec des couleurs
qui s’ incorporoient dans le verre par l ’action
du feu. Si tous les arts qui tiennent au
deffin n’avoient pas été plongés alors dans la
barbarie la peinture fur verre auroit pu faire
des progrès rapides.
L’abbé Suger , au douzième fiècle , fit décorer
de peintures les vitreaux de l’abbaye de St.
Denis ; c’eft le plus ancien ouvrage que nous
-connoiffrons en^ ce genre. Suger raconte lu i-
même qu’il avoit fait venir dès pays étrangers
les plus habiles maîtres, Ces, maîtres étrangers
étoient fans doute des Allemands.
Comme l’Allemagne a toujours devancé, dans
les connziffances chymiques, les autres nations
&& PEurope , il lui appartenoit de trouver la
première la compofition 8c l’ emploi des émaux.
Dans1 le quatorzième fiècle , on abandonna lés
paneaux de petites figures , que les peintres
vitriers nommoient mofaïques, ;& l’on peignit
des figures coloflales ; elles repréfentoient des
-Saints pôles ordinairement fur des piédeftaux.
O n indiqua les effets de l’ombre 8c de la lumière.
Bientôt les particuliers qui donnoient
des vitreaux peints aux églifes , voulurent que
leurs portraits y fuflent repréfentés ; c’étoit une
fttisfa&ion pour leur vanité d’ efpérer que leur
leflèmblance leur furvivroit fur une fubllance
.fragile, mais moins que la vie humaine.
Les peintres-vitriers tenoient alors le premier
rang entre les artiftes. En France, ils
furent exempts de tailles, aides , fubfides,
garde-porte , g u e t , & c . Ils durent cette ré-
compenfe de leurs talens a la munificence de
Charles V . Ce . prince fage reconnoifloit que
les arts, tout imparfaits qu’ ils étoient d.e fon
temps, méritoient d’être encouragés, 8c les
cncouragemens pouvoient feuls les conduire à
la perfection.
Jean de Bruges, regardé comme linventeur
.de la peinture en huile», inventa aufll de ces
-couleurs métalliques vitrifiables que 1 on appelle
des émaux. C’étoit fournir à l’art do
peindre fur verre de nouveaux moyens d exécution,
& lui préparer de nouveaux progrès.
Cependant cet art refloit encore fauvage:
mais dans le quinzième ficelé, Albert Durer,
qui joignoit à la vafte étendue de les talens
Celui de peindre fur verre , fit admirer pour
la première fois fur des vitreaux la jufteffe
des proportions, la precifion des formes & la
vérité de l’expreffion. Des virr.es furent peintes
à Paris & à Beauvais par fes. élèves 8c fur fes
cartons.
Le feizième fiècle, ce bel âge dés arts qui
tiennent au deffin , le fut de la peinture fur
verre. Jules I I ap.pella de Marfeille des maîtres
en ce genre pour décorer les vitreaux du Vatican.
Ils eurent la gloire de travailler fous les
yeux & furies deffms de Raphaël. Mais avant ;
la fin du même fiècle , ce genre de peinture fut
prefque généralement abandonné par-tout, &
depuis il n’a fait que languir.
Les ouvrages du dix-feptième fiècle ne furent .
que des tableaux fur v.erre en p e t it , tels qu’on (
en voit aux charniers de SaintrEcienne du Mont.
Peut-être feroit-on autorife a dire que , loin
d’ avoir rien perdu , la peinture fur verre , uniquement
appliquée à des ouvrages de petite
proportion , trouva le vrai genre qui lui convient.
En effet , .des compofition s poloflalrs ,
.ou même dans des proportions voifipes de celle ,
de la nature , conviennent-elles à un genre
de peinture , qui n’eft en effet qu une forte de
defiin enluminé, 8c qui opère fur un foiid.auquel
on ne peut donner une certaine étendue,
qu’en joignant par des lames de plomb les
pièces multipliées qui le compofent ? Comment
l’ceil peut-il n’être pas choqué de voir une feule
figuré, un feul membre, une feule partie de
draperië , plufieurs fois interrompue; par les.
coutures grofliètes de ce plomb que jamais on
ne peut bien diffimuler ? Si la peinture fur
verre peut avoir un mérite véritable , c’ eft
lorfqu’elle offre un fujet repréfenté fur la furface
d’une feule vitre. Mais on ne confie depuis
long-temps à l ’induftrie des. peintres vitriers
que des armoiries & des parties d’ornemens.
On dit que le fecret de la peinture fur verre
eft perdu ; il faudroit dire feulement que cetto
forte de peinturé, pour des ouvrages de grande
proportion, efl: entièrement abandonné, & l ’on
pourroit ajouter qu’il l’eft probablement^ pour
toujours. Mais les vitreaux du cloître desFeuii-
lans n’ont été finis qu’en 1709 , ceux du petit-
cloître des Carmes-Déchaufles qu’en 173$ : fi
le fecret fuivant lequel ces morceaux ont été
exécutés étoit perdu, la perte feroit bien récente.
Mais cette perte eft imaginaire. Le fe-<
cret qu’on regrette fe retroüveroit aifemenc
chez les Anglais; s’il n’étoit pas refté à Paris
dans une famille confacrée depuis plufieurs fié-
d e s à la pratique de cet art* C’eft dans l’ou-«
vrage d’un membre de cette famille, que nous-
alions paifer tout ce qui compofèra cet article.
Les bornes dans lefquelles nous devons noue
renfermer , ne nous permettront pas de faire
connoître tout ce qu’ il renferme d’utile ; &
nous confeillons aux ardftes qui feconfacrene
à la peinture en émail ou en porcelaine, de
confulter l’ouvrage même de Pierre le Vieil*
En décrivant dans le plus grand détail , tous
les matériaux & toutes les opérations de Ici
peinture fu r verre , il a bien mérité de tous lesv
ar.tiftes qui employent des fubftances métallw
ques colorées & vitrifiables.
C O U L E U R S
propres à teindre des tnajjes de verre.
Bleu célejle ou aigue-marine. Sur loixante liv*
de fritte , ( i ) mêlez peu-à-peu 8c à différente*
reprifes , une livre 8c demie d’écailles de cuivr®
préparées , auxquelles vous aurez ajouté quatre
onces de fafre préparé, le tout en poudretrèt-r
fine. Remuez fouvent. La couleur fera d’autanc
plus belle , que la fritte fera d’un ctyftal mieux
purifié.
Bleu plus foncé , oh couleur de faphir. Sut
(1) Les matières qui cômpofeat le verre fe nommait
■ fritte> après avoir été calcinées Ôc avant d’être miles ■ qp
faûon. • : - ^ ^.i f i - . la
G g g 'S 6 >J