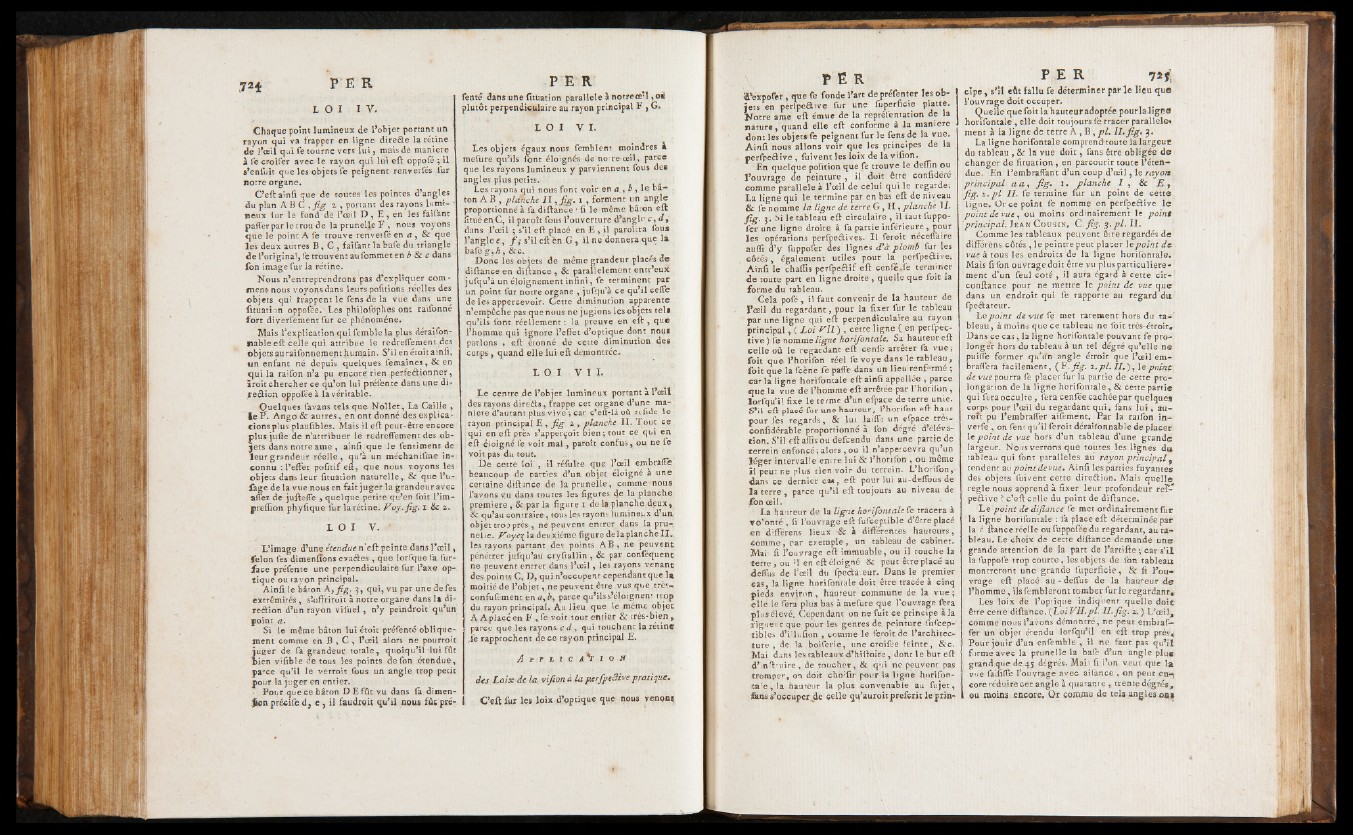
P E R
L O I I V .
Chaque point lumineux de l’objet portant un
rayon qui va frapper en ligne dire&e la rétine
de l’oeil qui fe tourne vers lui , mais de maniéré
à le croifer avec le rayon qui lui eft oppofé ; il
s’enfuit que les objets fe peignent renverfés lur
notre organe.
C ’eft ainfi que de toutes les pointes d’angles
du plan A B C y f ig 2 , portant des rayons lum<- *
Beux fur le fond de l’oeil D , E , en les faifant
pafferpar le trou de la prunelle F , nous voyons
que le point A fe trouve renverfé en û , & que
les deux autres B , G , faifant la bafe du triangle
de l’original, retrouvent au fommet en b & c dans
Ion image fur la rétine.
Nous n’ entreprendrons pas d’expliquer comment*
nous voyons dans leurs pofitions réelles des
objets qui frappent le fens de la vue dans une
fituation oppofée^Les philofdphes ont raifonné
fort diverfeinent fur ce phénomène.
Mais l’explication qui femble la plus déraifon-
tiable eft celle qui attribue le redreffement des
objets au raifonnement humain. S’ il en étoit ainfi,
un enfant né depuis quelques femaines, & en
qui la raifon n’a pu encore rien perfeélionner,
iroit chercher ce qu’on lui préfente dans une direction
oppoféeà la véritable.
Quelques favans tels que N o lle t, La Caille , le P. Ango & autres, en ont donné des explications
pi us plaufibles. Mais il eft peut-être encore
plus jufle de n’attribuer le redreffement des objets
dans notre ame , ainfi que le fentiment de
leur grandeur réelle , qu’a un méchaniline inconnu
-.l’ effet pofitif eft, que nous voyons les
objets dans leur fituation naturelle, & que l’u-
fage de la vue nous en fait juger la grandeur avec
affez de jufteffe , quelque petite qu’en foit l ’im-
prefiion phyfique fur la rétine. Voy. fig. I & 2.
L O I V .
L’ image d’une étendue n’eft peinte dans l’oe il,
félon fes dimenlîons exaéles , que lorfque fa fur-
face préfente une perpendiculaire fur l’axe optique
ou rayon principal.
Ainfi le bâton A,f ig . 3, qui, vu par une de fes
extrémités, sïoffriroit à notre organe dans la direction
d’ un rayon v îfu e l, n’y peindroit qu’ un
point a.
Si le même bâton lui étoit préfenté obliquement
comme en B , C , l’oeil alors ne pourrait
juger de fa grandeur totale, quoiqu’ il lui fût
bien vifible de tous les points de fon étendue,
parce qu’il le verrait (bus un angle trop petit
pour la juger en entier.
■ Pour que ce bâton D Efût vu dans là dimension
précife d , e , i l faudrait qu’il nous fût pré- I
P E R
fente dans une fituation parallèle à notreoe*l , ok
plutôt perpendiculaire au rayon principal F , G.
L O I V I .
Les objets égaux nous femblent moindres a
mefure qu’ ils font éloignés deno^reoeil, parce
que les rayons lumineux y parviennent fous de*
angles plus petits.
Les rayons qui nous font voir en a , b , le bâton
A B , plahche I I y fig . 1 , forment un angle
proportionné à la diftance: fi le même bâton eft
fitué en C, il paroît fous l’ouverture d’angle c , d t
dans l’oeil ; s’il eft placé en E , il paraîtra fou*
l’angle e, f ; s’ il eft en G , il ne donnera que la
bafe g r h , &c.
Donc les objets de même grandeur placés de
diftance en diftance , & parallèlement entr’ eux
jufqu’à un éloignement infini, fe terminent par
un point fur notre organe , jufqu’à ce qu il ceffe
de les appercevoir. Cette diminution apparente
n’empêche pas que nous ne jugions les objets tel*
qu’ ils font réellement : la preuve en eft , que
l’homme qui ignore l’ effet d’optique dont nous
parlons , eft étonné dé cette diminution des
corps , quand elle lui eft démontrée.
L O I V I I .
Le centre de l’objet lumineux portant à l’oeil
des rayons directs, frappe cet organe d’une maniéré
d’autant plus^vive -, car c’ eft-là où refide le
rayon principal' E , f ig 1 , planche II. Tout ce
qui en eft près s’apperçoit bien; tout ce qui en
^ eft éloigné fe voit m a l, paraît confus, ou: ne fe
voit pas du tout.
De cette loi , il réfulte que l’oeil embrafle
beaucoup de parties d’un objet éloigné a une
certaine diftance de la prunelle, comme nous
l’avons vu dans toutes les figures 4e la planche
première, & par la figure 1 de là planchedpux,
& qu’au contraire, tous les rayons lumineux d un;
objet trao près;, nèpeuvent entrer dans la pru-,
nelie. Voye\1 la deuxième figure delà planche I I .
les rayons partant des points A B , ne peuvent
pénétrer jufqu’jau cryftallin , & par conféquent
ne peuvent entrer dans l’oe il, les rayons venant
des points C, D, qui n’occupent cependant que la
moitié de l’objet , ne peuvent être vus que très-.
: confufément en a,ù, parce qu’ ils s’éloignenr trop
du rayon principal. Au lieu que le même objet
A A placé en F , fe-voit tou t entier & très-bien ,
parce que les rayons- c d , qui touchent la retin*
4'e rapprochent de ce rayon principal E.
A e r l 1 c 1 o tr
des L o ix de la vifion à la perfpeclive pratique.
C’eft fur les loix d’optique que nous venons
P E R
a ’expofef, que fe fonde l’art de préfenter les objets
en pérljpe&ive fur une fuperficie platte.
Notre ame eft émue de la rèpréfentation de la
nature, quand elle eft conforme à la maniéré
dont les objet* fe peignent fur le fens de la vue.
Ainfi nous allons voir que les principes de la
perfpeâive , fuivent les loix de la vifion.
En quelque pofition que fe trouve le defïin ou
l ’ouvrage de peinture , il doit être confidére .
comme parallèle à l’oeil de celui qui le regarde:
La ligne qui le termine par en bas eft de niveau
& fe nomme la ligne de terre G , H , planche II.
fig , 3. Si le tableau eft circulaire , il faut luppo-
fer une ligne droite à fa partie inférieure, pour
les opérations perfpeélives. Il ferait neceffaire
aufli d’y fuppofer des lignes cPà plomb fur les
côté.s, également utiles pour la perfpeétive.
Ainfi le chaffis perfpe&if eft cenfé.lé terminer
de toute part en ligne droite, quelle que foit la
forme du tableau.
Cela pofé, il faut convenir de la hauteur de
l ’oeil du regardant, pour la fixer fur le tableau
par une ligne qui eft perpendiculaire au rayon
principal, ( Loi P I I } , cette ligne ( en perfpec-
tive ) fe nomme ligne horifontale. Sa hauteur eft
celle où le regardant eft cenfé arrêter (a vue j
foit que J’ horifbn réel fe voye dans le tableau ,
foit que la feene fe pafft dans un lieu renferme ;
car la ligne horifontale eft ainfi appellee -, parce
que la vue de l’homme eft arrêtée par l’horifon ,
iorfqu’i! fixe le terme d’ un efpace de terre unie.
S’ il eft placé fur une hauteur, l’horifon eft haut
pour fes regards, & lui laiffb un efpace tres -.
confidérable proportionné a fon degré d’élévation,
S’il eft aflis ou defeendu dans une partie de
terrein enfoncé; alors , ou il n’appercevra qu’ un
léger intervalle entre lui & l’horilon , ou meme
Il peut ne plus rien voir du terrein. L’horifon,
dans ce dernier cas, eft pour lui au-deffousde
la terre , parce qu’ il eft toujours au niveau de
Ion oeil.
La hauteur de la ligne horifontale fe tracera à
v o ’onté , fi l’ouvrage eft fufceptible d’être placé
en dlfférens lieux & à différentes hauteurs,
Comme, par exemple, un tableau de cabinet.
Mai- fi l’ouvrage eft immuable, ou il touche la
terre, ou J en eft éloigné & peut être placé au
deffus de l’oeil du fpe&a.eur. Dans le premier
. ©as, la ligne horifontale doit être tracée à cinq
pieds environ, hauteur commune de la vue ;
elle le fora plus bas à mefure que l’ouvrage fera
plus élevé. Cependant on ne fuit ce principe à la
rigueur que pour les genres de_ peinture fufeep-
tibles d’ i ’ lufion , comme le feroit de l’architecture
, de la boiferie, une croifée feinte, & c.
Mai dans les tableauxd’ hiftoiré , donc le but eft
d’ inft'uire, de toucher, & qui ne peuvent pas
trompe«*, on doit cho:fir pour la ligne horifbn-
t a 'e , la hauteur la plus convenable au fujet,
&ns s’ occuper .de ©elle (^’aurait preferit le prin-
P E R 7 * j |
cîpe, s’il eût fallu fe déterminer par le lieu que
l’ouvrage doit occuper.
Quelle que foit la hauteur adoptée pourlaJigne
horifontale, elle doit toujours fe tracer parallèle^
ment à la ligne de terre A , B , pl. II. fig. 3.
La ligne horifontale comprend toute la largeur
du tableau, & la vue d o it, fans être obligée de
changer de fituation, en parcourir toute l’étendue.
En Tembraffant d’un coup d’oe il, le rayon
principal a a, fig. 1. planche 1 , & E , fig. 1. pl II. fe termine fur un point de cette
ligne. Or ce point fe nomme en perfpe&ive le
i point de vue y ou moins ordinairement principal. le point Jean C ousin. C.fig. 3.pl. H.
Comme les-tableaux peuvent êire regardés de
différèns côtés, le peintre peut placer 1 e point de
vue à tous les endroits de la ligne horilonrale.
Mais fi fon ouvrage doit être vu plus particulièrement
d’un feul coté , il aura égard à cette cir-
conftance pour ne mettre le point de vue.que
dans un endroit qui fe rapporte au regard du
fpeftateur.
Le point de vue fe met rarement hors du tableau,
à moins que ce tableau ne foit très-étroit.
Dans ce cas, la ligne horifontale pouvant fe prolonger
hors du tableau à un tel degré qu’elle ne
puiffe former qu’ ifn angle étroit que l’oeil em-
dbrtavfufeeryao ufaxcxiblement, ( F -fig. 2. pl. I I . ) , le point fe placer fur la partie de cette prolongation
de la ligne horifontale, & cette partie
qui fera occulte, fera cenfée cachée par quelques
corps pour l’oeil du regardant qui, fans lui y au-
roft pu l’embraffer aifement. Par la raifon in-
verfe , on fent qu’ il feroit dérailônnable de placer
le point de vue hors d’un tableau d’une grande
largeur. Nous verront que toutes les lignes du
tableau qui font parallèles au rayon principal y
tendent au point de vue. Ainfi les parties fuyantes
des objets fuivent cette direélion. Mais quelle
réglé nous apprend à fixer leur profondeur rer»
peélive ? c’eft celle du point de diftance.
L e point de diflànce fe met ordinairement fur
la ligne horifontale : fa place eft déterminée par
la ci ftance réelle ou fuppofée du regardant, au tableau.
Le choix dé cette diftance demandé une
grande attention de la part de l’artifte ;• car s’i l
la fuppofe trop courte , les objets de Ion tableau
montreront une grande fuperficie, & fi l ’ouvrage
eft placé au - deffus de la hauteur de
l’ homme, ils fembleront tomber furie regardant.
Les loix de l’optique indiquent quelle doit
être cette diftance. (Loi VII.pl- II. fig . z. ) L’oeil,
comme nous l’avons démontré, ne peut embiaf—
fer un objet étendu lorfqu’ il en eft trop près*
Pour jouir d’un enfemble , il ne faut pas qu’ il
forme avec la prunelle la bafe d’ un angle plu*
grand.que de 45 degrés. Mai> fi l’on veut que la
vue faififfe l’ouvrage avec aifance , on peut en-q
core réduire cet angle à quarante , trente degrés,
ou moins encore. Or comme de tels angles 03*