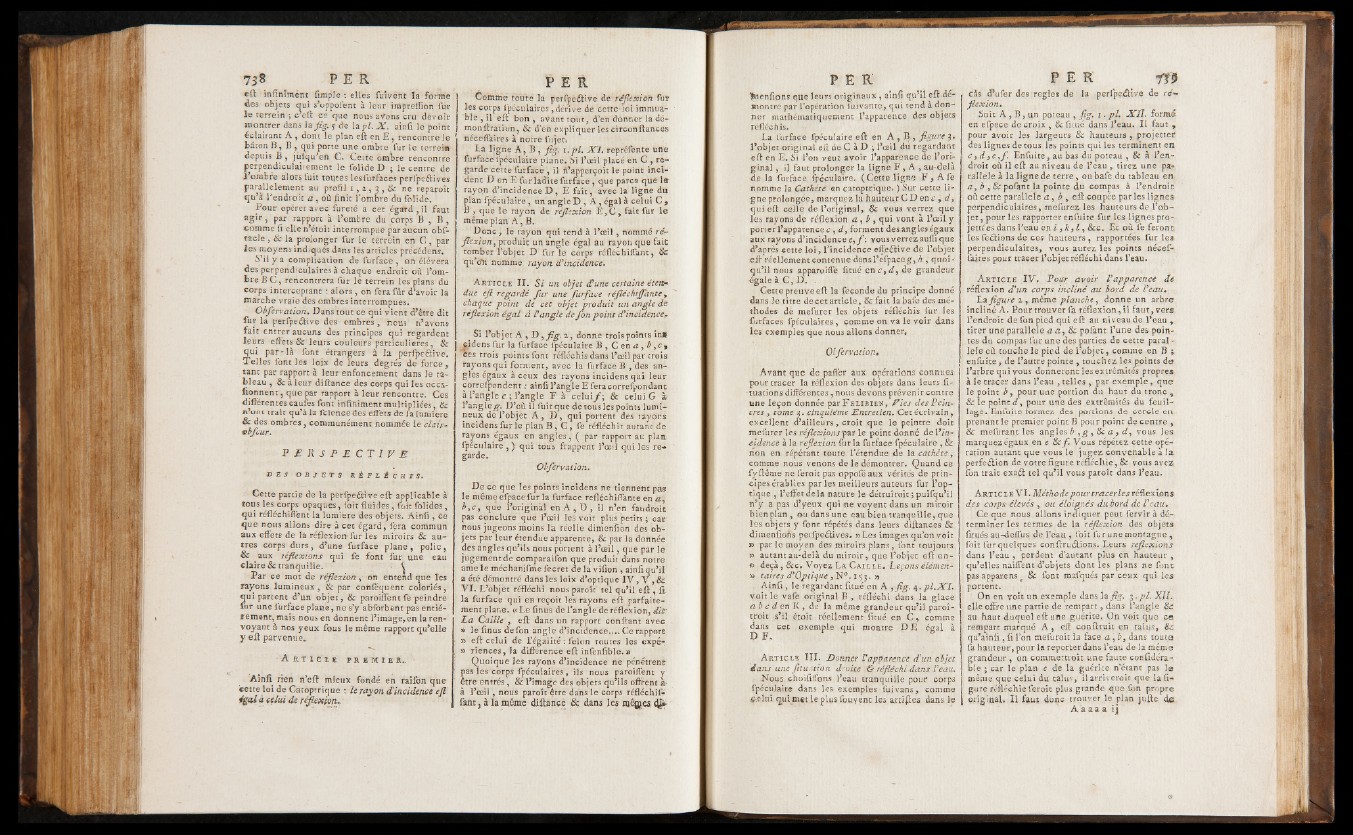
eft infiniment fimple : elles fuîvént la forme |
^es objets qui s’oppofent à leur imprefîïon fur J
le terrein -, c’eft ce que nous avons cru deyoîr f
montrer dans Ja^g. 5 de la p l X . ainfi le point !
éclairant A , dont le plan eft en E , rencontre le '
bâton B, B , qui porte une ombre fur le terrein
depuis B , jiifqu’ en C. Cette ombre rencontre
perpendiculaitement le folide D ; le centre de
l ’ombre alors fuit toutes lesfurfaees perfpeélives
parallèlement au profil 1 , z , 3 , & ne reparoît
cju’a l'endroit d\ où finit l’ombre du folide.
Pour opérer avec' fureté à cet égaPtrd , il faut
a g i r , par rapport à l’ombre du corps B , B ,
comme fi elle n’étoit interrompue par aucun obf-
ta c le , & la prolonger fur le terrein en C , par
les moyens indiqués dans les articles précédons.
S’ il y a complication de furface , on élévera
des perpendiculaires à chaque endroit où l’ombre
B C , rencontrera fur le terrein les plans du
corps interceptant : alors , on ferafûr d’avoir la
marche vraie des ombres interrompues.
Obfervation. Dans tout ce qui vient d’ être dit
fur la perfpeétive des ombres, nous n’ avons .
fait entrer aucuns des principes qui regardent
leurs effets & leurs couleurs particulières, &
qui par- là font étrangers à la. perfpe&rve.
•Telles font les loix de leurs degrés de force y
tant par rapport à leur enfoncement dans le tableau
, & a leur diftance des corps qui les occa-
fionnent, que par rapport à leur rencontre. Ces
différentes caufes font infiniment multipliées, &
ïi’ont trait qu’ à la fciencedes effets de la lumière
& des ombres, communément nommée le clair-
ebfcur.
P E R S P E C T I V E
& E S O B J E T S RÈF L ÉCHT S .
Cette partie de la perfpeéfcive eft applicable à
tous les corps opaques, foit fluides, foit folides,
qui réfléchiffent la lumière des objets. Ainfi , ce
que nous allons dire à cet égard, fera commun
aux effets de la réflexion! fur les miroirs & autres
corps durs, d’une furface plane, polie,
& aux réflexions qui fe font fur une eau I
claire & tranquille. V
Par ce mot de réflexion, on entend que les
rayons lumineux, & par cohfequent coloriés,
qui partent d’un ob jet, & paroifïènt fe peindre
fur une furface plane, ne s’y abforbent pas entièrement,
mais nous en donnent limage, en la renvoyant
à nos yeux fous le même rapport qu’elle
y eft parvenue..
A r t i c l e p r e m i e r ..
Ainfi rien n’eft mieux fondé en raifon que
cette loi de Catoptrique : le rayon d'incidence eft
égal à celui de réflexion*
Comme toute la perfpeétive de réflexion fui
les corps fpéculaires, dérive de cetté loi immuable
, il eft bon , avant tout, d’en donner la dé-
monftration, & d’en expliquer les circonftances
néceffaires à notre fujet.
Là ligne A , B , fig. i .p l, X I . repréfènte une
furface fpéculaire plane, bi l’oeil placé en C , regarde
cette furface , il ft’apperçoit le point incident
D en E fur ladite furface , que parce que 1®
rayon d’incidence D , E fait, avec la ligne du
plan fpéculaire , un angle D , A , égal à celui C ,
B , que le rayon de réflexion E ,C , fait fur le
même plan A , B.
Donc, le rayon qui tend à l ’oe il, nommé réflex
ion, produit un angle égal au rayon que faic
tomber l’objet D fur le corps réfléchiflant, &
“qu’dti nomme rayon d*incidence.
Article II. S i un objet dune certaine éten*
due eft regardé fur une furface réfléchijflante,
chaque point de cet objet produit un angle de
réflexion égal à Vangle de fon point d'incidencer
* Si l’objet A , D yfig. z , donne trois points in*
jjd en s fur la furface fpéculaire B , C e n û ,^ ,c »
ces trois points font réfléchis dans l’oeil par trois
rayons qui forment, avec la furface B , des angles
égaux à ceux des rayons incidensqui leur
correfpondent : ainfi l’angle E feracorrefpondant
à l’angle e ; l’angle F à celui f ; & celui G à
l’angle g. D’oftil fuit que de tous les points lumineux
de l ’objet A , D , qui portent des rayons
incidens fur le plan B , C , fe réfléchit autant de
rayons égaux en angles , ( par rapport ai; plan
fpéculaire , ) qui tous frappent l’oeil qui les regarde*
Obfervation.
De ce que les points incidens ne tiennent pas
le même efpacefur la furface refléchiffante en a y
b9c 9 que l’original en A , D , il n’ en faudroit
pas conclure que l’oeil les voit plus petits; car
nous jugeons moins la réelle dimenfion des objets
par leur étendue apparente, & par la donnée
des angles qu’ ils nous portent à l’oe il, que par le
jugement de comparaison que produit dans notre
ame le méchanifme fecret de la vifion , ainfi qu’ il
a été démontré dans les loix d’optique I V , V , &
V I . L’objet réfléchi nous parolé tel qu’ il eft , fl
la furface qui en reçoit les rayons eft parfaitement
plane. « Le finus de l’angle de réflexion, d it
L a Caille , eft dans un rapport confiant avec
» le fious de fon angle d’ incidence.... Ce rapport
>5 eft celui de L’égalité ; félon toutes les expér
» riences, la différence eft infenfible.»
Quoique les rayons d’incidence ne pénétrent
pas les corps fpéculaires , ils nous paroiffent y
être entrés, & l’image des objets qu’ils offrent a
à l ’oe il, nous paroît être dans le corps réfléchif-
fant, à la même diftance & dans les raêjges
ïwenîions que leurs originaux, ainfi qu’ il eft-de-
siontré par l’opération i'uivante, qui tend a donner
mathématiquement l’apparence des objets
réfléchis.
La furface fpéculaire eft en A , B., figure 3.
l ’objet original eft d eÇ à D ; l’oeil du regardant
eft en E. Si l’on veut avoir l’apparence de l’original
, il faut prolonger la ligne F , A , au-delà
de la furface fpéculaire. (Cette ligne F y A fe
npmme la Çathéte en çatoptriquei ) Sur cette ligne
prolongée, marquez la hauteur C D en c y d ,
qui eft celle de l’original, & vous verrez que
les rayons de réflexion a , b , qui vont à l’oeil y
porter l’apparence c , </, forment des angles égaux
aux rayons d’incidence e, f : yous verrez aufli que
d’aprps cette lo i , l’ incidence effective de l’objet
eft réellement contenue dansl’efpaceg, h , quoiqu’
il nous apparoiffe fitué en c , d y de grandeur
é g a le à .C ,D . .
Cette preuve eft la fécondé du principe donné
dans le titre de cet article, & fait labafe des méthodes
dè mefurer les objets réfléchis fur les
furfaces fpéculaires , çomme on va le voir dans
les exemples que nous allons donner,
Obfervation•
Avant que de pafl’er aux opérations connues
pour tracer la réflexion des objets dans leurs fl-;
tuations différentes, nous devons prévenir contre
une lëçon donnée par F elibien , Vies des Peintres
, tome 3. cinquième Entretien. Cet écrivain,
excellent d’ailleurs, croit que le peintre doit
mefurer les réflexions par le point donné de l'incidence
à la reflexion fur la furface fpéculaire , &
non en repérant toute, l ’étendue de la cathète,
comme nous venons de le démontrer. Quand ce
fyftême ne feroit pas oppoféaux vérités de principes
établies par les meilleurs auteurs fur l’optique
, l ’effet de là nature le détruiroit ; puifqu’ il
n’y a pas d’yeux qui ne voyent dans un miroir
bien plan, ou dans une eau bien tranquille, que
les objers y font répétés dans-leurs diftances &
dimenfioùs pevfpeélives. »Les images qu’on voit
» par le moyen des miroirs plans, font toujours
» autant au-delà du miroir, que l’objet eft en-
« deçà, & c . Voyez La Caille, Leçonsélémen-
» taires d'Optique y N°. 153. »
Ainfi , le regardant fitué en A yfig. 4. p l.X I .
voit le valé original B , réfléchi dans la glace
a b c d e n K , de la même grandeur qu’il paroi-
troit s’ il étoit réellement fitué en C , comme
dans cet exemple qui montre D E égal à
D F , b
Article III. Donner Vapparence d'un objet
dans une fituation droite <& réfléchi dans Veau.
Nous ehoififTons l’eau tranquille pour corps
fpéculaire dans les exemples fuivans, comme
£elui qui met le plus louyent les artiftes dans le
Càs d’ufer des réglés de la perfpeftive de ré*
flex ion.
Soit A , B , un poteau , fig. 1 . p l. X I I . formé
en efpece de croix , & fitué dans l’eau. I l faut ,
pour avoir les largeurs & hauteurs , projetter
des lignes de tous les points qui les terminent en
c , d , e , f i En fuite, au bas du poteau , & à l’endroit
où il eft au niveau de l’ eau , tirez une parallèle
à la ligne de terre , oubafe du tableau en
ay b 9 8c pofant la pointe du compas à l’endroit
où cettè parallèle a , b , eft coupée parles lignes
perpendiculaires, mefurez les hauteurs de l’obje
t , pour les rapporter en fuite fur les lignes projetée
s dans l’eau en i ykyl y & c . Et où 1e feront
les feéfcions de ces hauteurs , rapportées fur le*
perpendiculaires, vous aurez les points nécel-
faires pour tracer l’objet réfléchi dans l’eau.
Article IV . Pour avoir Vapparence dè
réflexion d'un corps incliné au bord de l'eau,
La figure z , même planche, donne un arbre
incliné A. Pour trouver fa réflexion, il faut, vers
l ’endroit de fon pied qui eft au niveau de l ’eau ,
tirer une parallèle a a 9 & pofant l’ une des pointe
s du compas fur une des parties de cette parallèle
où touche le pied de l ’ob je t, comme en B ;
enfuite , de l’autre pointe , touchez les points de
l’arbre qui vous donneront les extrémités propres
à le tracer dans l’eau , telles , par exemple, que
le point b y pour une portion du haut du tronc ,
& le pointé , pour une des extrémités du feuillage.
Enfuite formez des portions de cercle en
prenant le premier point B pour point de centre ,
& mefurant les angles b 9g , & a y d 9 vous les
marquez égaux en e 8c f . Vous répétez cette opération
autant que vous le jugez convenable à la
perfection de votre figure réfléchie, & vous avez
fon trait exaét tel qu’ il vous parole dans l’eau.
A rticleVI. Métho de pour tracer les réflex ions
des corps élevés , ou éloignés du bord de Veau.
Ce que nous allons indiquer peut fervir à déterminer
les termes de la réflexion des objets
finies au-deffus de,l’ea u , foit fur une montagne ,
foit fur quelques conftruétions. Leurs réflexions
dans l’eau , perdent d’autant plus en hauteur,
qu’elles naiffent d’objets dont les plans ne font
pas apparens e & font mafqués par ceux qui les
portent.
On en voit un exemple dans la fig. 3. pl. XII.
elle offre une partie de rempart, cfims l’angle &
au haut duquel eft une guérite. On voit que ce
rempart marqué A , eft conftruit en talus, <£d
qu’ ainii, fi l’on mefuroit la face a , by dans tout©
fa hauteur, pour la reporter dans l’eau de la même
grandeur , on commettroit une faute confidéra-
ble ; car le plan e de la guérite n’étant pas le
même que celui du talus, ilarriveroit que la fi-
gure réfléchie feroit plus grande que fon propre
original. I l faut donc trouver le plan jufte 4e
A a a a a ij