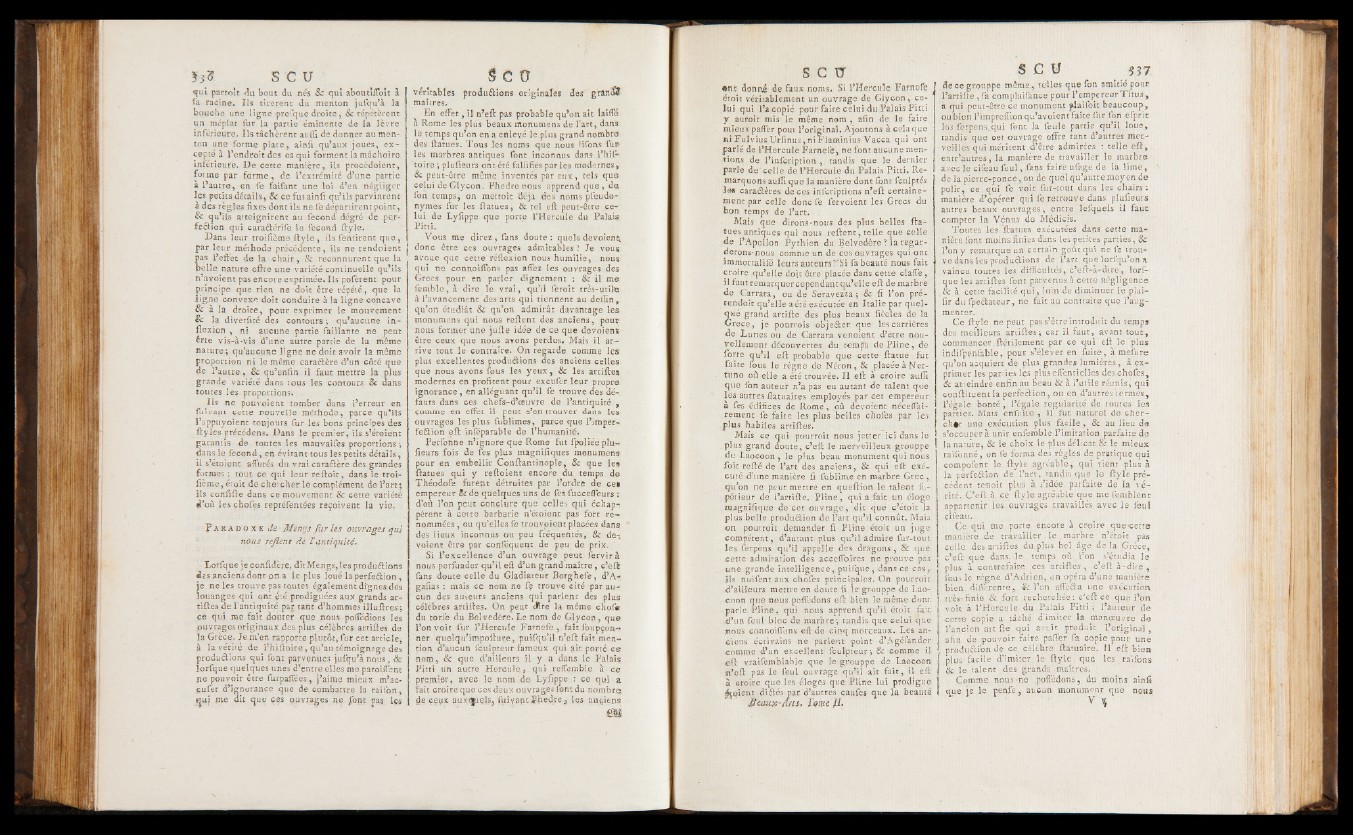
qu'l partoit du bout du nés 8c qui aboutîffoît â
fa racine. Ils tirèrent du menton jufqu’à la
bouche une ligne prefque droite, & répétèrent
un méplat fur la partie éminente de la lèvre
inférieure. Ils tâchèrent aufti de donner au menton
une forme plate, ainfi qu’aux joues, excepté
à l ’endroit des es qui forment la mâchoire,
intérieure. De cette manière, ils procédoient,
forme par forme , de l’extrémité d’une partie
a l’autre, en fe faifant une loi d’en négliger
les petits détails, & ce fui ainfi qu’ ils parvinrent
à des règles fixes dont ils ne le départirent point,
& qu’ils atteignirent au fécond dégré de pe.r-
feélion qui caraélérife le fécond ftyle.
Dans leur troifième ftyle , ils fentirent q u e ,
par leur méthode précédente, ils ne rendoient
pas l’eftet de la chair, & reconnurent que la
belle nature offre une variété continuelle qu’ils
n avoient pas encore exprimée. Us pofèrent pour
principe que rien ne doit être répété, que la
ligne convexe doit conduire à la ligne concave
& à la droite, pour exprimer le mouvement
& la diverfité des contours ; qu’aucune inflexion
, ni aucune partie faillante ne peut
êrte vis-à-vis d’ une autre partie de la même
nature; qu’aucune ligne ne doit avoir la même
proportion ni le même eara&ère d’ un côté que
de l’autre-, & qu’enfin il faut mettre la plus
grande variété dans tous les contours & dans
toutes les proportions. -
Us ne pouvoient tomber dans l’ erreur en
fuivant cette nouvelle méthode, parce qu’ ils
l ’appuyoient toujours fur les bons principes des
ftyles précédens. Dans le premier, ils s’ éroient
garantis de toutes les mauvaifes proportions ;
dans le fécond, en évitant tous les petits détails,
il s’étoient affurés du vrai caraélère des grandes
formes : tout ce qui leur réffoit, dans le troifième,
éroit de chercher le complément de l’arc;
ils confifte dans ce mouvement & cette variété
d’où les chofes repréfentées reçoivent la vie.
P a r a d o x e de Jffengs fu r les ouvrages qui
nous refient de Vantiquité,
. Lorfque je confidère, ditMengs,les productions
«Us anciens dont pn a le plus loué la perfeélion ,
je ne les trouve pas toutes également dignes des
louanges qui ont été prodiguées aux grands artiftes
de l'antiquité par tant d’hommes illuftres ;
ce qui me fait douter que nous poffédions les
.ouvrages originaux des plus célèbres artiftes de
la Grèce. Je m’en rapporte plutôt, fur cet article,
à la vérité de l ’hiftoire, qu’ au témoignage des
produélions qui font parvenues jufqu’à nous, &
lorfque quelques unes d’entre elles me paroiffent
pe pouvoir être furpaffées, j’aime mieux m’ ac-
çufer d’ignorance que de combattre la raifort ;
qui me dit que ççs ouvrages ne |ont pas les
véritables produélions originales des grân<£?
maîtres.
En effet, il n’eft pas probable qu’on ait laiffe
a Rome les plus beaux monumens de l ’art, dans
le temps qu’on en a enlevé le plus grand nombre
des ftatues. Tous les noms que nous lifons fu&
les marbres antiques font inconnus dans l’hif*
‘taire; plusieurs ont été fallifiés parles modernes >
& peut-être même inventés par eu x , tels que
celui de Glycon. Phedre nous apprend que, de
fon temps; on mettoit déjà des noms pfeudo-
nymes fur les ftatues, & tel eft peut-être celui
de Lyfippe que porte l’Hercule du Palais
Pitti.
Vous me direz , fans doute : quels dévoient;
donc être ces ouvrages admirables’ Je vous
avoue que cette réflexion nous humilie, nous
qui ne connoiffons pas allez les ouvrages des
Grecs pour en parler dignement : & il me
femble, à dire le vrai, qu’il feroit très-ytite
à l’avancement des arts qui tiennent au deffin ,
qu’on étudiât & qu’on admirât davantage les
monumens qui nous refient des anciens, pour-
no us former une jufle idée de ce que devoiens
être ceux que nous avons perdus. Mais il arrive
tout le contraire. On regarde comme les
plus excellentes prodüétions des anciens celles
que nous avons fous les yeux , & les artifles
modernes en profitent pour exeufer leur propre
ignorance, en alléguant qu’ il fe trouve des dé-,
fauts dans ces chefs-d’oeuvre de l’antiquité ,
comme en effet il peut s’en trpuver dans les
ouvrages les plus fublimes, parce que l’imper-
feétion eft in réparable de l ’humanité,
Perfonne n’ ignore que Rome fut fpoliéeplu-
fieurs fois de Ces plus magnifiques monumens
pour en embellir Conftantinople, 8c que les
ftatues qui y reftoient encore du temps de
Théodofe furent détruites par Pordre de ce«
empereur êc de quelques uns de fes fuccefleurs ;
d’où Pon peut conclure que celles qui échappèrent
à cette barbarie n’étoient pas fort renommées
, ou qu’elles fe trou vpient placées dans
des lieux inconnus ou peu fréquentés, & dé-,
voient être par conféquent de peu de prix.
Si l’excellence d’un ouvrage peut fervirà
nous perfuader qu’ il eft d’un grand maître, c’eft
fans doute celle du Gladiateur Borghefe, d’A-
gafia? : niais ce nom ne fp trouve cité par aucun
des auteurs anciens qui parlent des plus
célèbres artiftes. On peut dire la même chofe
du torfe du Belvedère. Le nom de Glycon, que
l ’on voit fur l’Hercule Farnefe, fait foupçorainer
quelqu’ impofture, puifqu’il n’eft fait mention
d’aucun feu lpteur fameux qui ait porté ce
nom, & que d’ailleurs il y a dans le Palais
Pitti un autre Hercule,, . qui reffemble à ce
premier, avec le nom de Lyfippe ; ce qui a
fait croire que ces deux ouvrages font du nombre»
de ceux auxijuçls, ftiiyant Phedre3 les anciens
m
•n t donné de faux noms. Si l’Hercule Farnefe
étoit véritablement un ouvrage de Glycon, celui
qui l’a copié pour faire celui du Palais Pitti
y auroit mis le même nom, afin de le faire
mieux paffer pout l’original. Ajoutons à cela que
ni Fulvius Urfinus; niFlaminius Vacca qui ont
parlé de l’Hercule Farnefe, ne font aucune mentions
de l ’ infeription , tandis que le dernier
parle de'celle de l ’Hercule du Palais Pitti. Remarquons
aufti que la manière dont font fculptés
Je« caraélères de ces inferiptions n’eft certainement
par celle donc fe fervoient les Grecs du
bon temps de l’ art.
Mais que dirons-nous des plus belles ftatues
antiques qui nous reftent, telle que celle
de l’Apollon Pythien du Belvedère Ma regarderons
nous comme un de ces ouvrages qui ont
immortalife leurs auteurs fa beauté nous fait
croire qu’elle doit être placée dans cette claffe,
il faut remarquer cependant qu’elle eft de marbré
de Carrara, ou de Seravezza ; & fi l’on pré -
tendoit qu’elle a été exécutée en Italie par quelque
grand artifte des plus beaux fiècles de la
Grece, je pourrois objeéter que les carrières
de Lunes ou de Carrara venoient d’ ètre nouvellement
découvertes du temps de P lin e , de
Porte qu’ il eft probable que cette ftatue fut
faite fous le règne de Néron, & placée à Net-
tuno où elle a été trouvée. Il eft à croire aufti
que fon auteur n’a pas eu autant de talent que
les autres ftatuaires employés par cet empereur
a fes édifices de Rome, où dévoient néceflài-
rement fe faite les plus belles chofes par les
plus habiles artiftes.
Mais ce qui pourroit nous jetter ici dans le
plus grand doute, c’ eft le merveilleux grouppe
de Laocoon , le plus beau monument qui nous
foit refté de l’art des anciens, & q ui eft exécuté
d’une manière fi fublime en marbre Grec ,
qu’on ne peut mettre en queftion le talent lu-
périeur de l’artille. Pline, qui a fait un éloge-
magnifique de cet ouvrage, dit que c’étoit la
plus.belle produétion de l’ art qu’ il connut. Mais
on pourroit demander fi P lin e é to it un juge,
compétent, d’autant plus qu’ il admire fur-tout
les ferpèns qu’ il appelle des dragons , & que
cette admiration des acceffoires ne prouve pas
une grande intelligence, puifque, dans ce cas,
ils nuifent aux chofes principales. On pourroit
d’ailleurs mettre en doute fi l e grouppe de Laocoon
que nous poffédons eft bien le même dont
pa-rle Pline, qui nous apprend qu’ il étoit fait
d’ un feul bloc de marbre; tandis que celui «que
nous connoiffons eft de cinq morceaux. Lès anciens
écrivains ne parlent point d’Agéfander
comme d’ un excellent feu lpteur ; & comme il
«ft vraifemblabié que le grouppe de Laocoon
n’eft pas le feul ouvrage qu’ il ait fait, il eft
à croire que les éloges que Pline lui prodigue
étoient diètes par d’autres caufes que la beauté
Xi eaux-Arts, Tqihc IL
de ce grouppe même, telles que fon amitié pour
l ’artifte , fa complaifance pour l’empereur T itu s,
a qui peut-être ce monument plaifoit beaucoup,
ou bien l’ imprefllonqu’avoient faite fur fon efpric
las ferpens.qui font la feule partie qu’ il loue,
tandis que oet ouvrage offre tant d’autres merveilles
qui méritent d’être admirées : telle e ft,
entr’autres, la manière de travailler le marbre
avec le cifeau fe u l, fans faire ufage de la lime,
de la pierre-ponce, ou de quel qu’autre moy en de
polir, ce qui fe voit lur-tout dans les chairs :
manière d’opérer qui fe retrouve dans plufieurs
autres beaux ouvrages, entre lefquels il faut
compter la Vénus de Médicis.
Toutes les ftatues exécutées dans cette manière
font moins finies dans les petites parties', 8c
l’on y remarque un certain goût qui ne fe trouve
dans les productions de l’art que lorfqu’ on a
vaincu toutes les difficultés, c’eft-a-dire, lorfque
les artiftes font parvenus à cette négligence
& à cette facilité q u i, loin de diminuer le plai-
fir du fipeélàteur, ne fait au contraire que l’augmenter.
Ce ftvle ne peut pas s’être introduit du temps
des meilleurs artiftes; car il faut, ayant tout,
commencer .ftérilement par ce qui eft le plus
indifpenfable, pour s’élever en fuite, à mefure
qu’ on acquiert de plus grandes lumières, à exprimer
les parties les plus effentielles des chofes,
& atteindre enfin au beau & à l’ utile réunis, qui
coj,îftituentla perfection, ou en d’autres termes,
l’éàale bonté, l’égale régularité de toutes les
parties. Mais enfuite , il fut naturel de cherchée
une exécution plus fa c ile , & au lieu de
s’occupera unir enfemble l’imitation parfaite de
la nature, & le choix le plus délicat & le mieux
raifonné, on ie forma des règles de pratique qui
compofent le ftyîe agréable, qui tient plus à
la perfeélion de l’art, tandis que le ftyle précédent
tenoit plus à l’idée parfaite de la vérité.
C’ eft à ce ftyle agréable que me femblent
appartenir les ouvrages travaillés avec le feul
cifeau.
Ce qui me porte encore à croire que «cette
manière de travailler le marbre n’etoit pas
celle des artiftes du plus bel âge de la Grèce,
c’ eft que dans, le temps où l’on s’étudia le
plus à contrefaire ces artiftes, c’eft à-d ire ,
fous le règne d’Adrien, on opéra d’ une manière
bien differente, . & l’on affecta une exécution
très-finie & fort recherchée: e7eft ce que l’on
voit à l’Hercule du Palais Pitti ; l’auteur de
cette copie a tâché d'imiter la manoeuvre de
l’ancien art fte qui aveit produit l’ original,
afin de pouvoir faire paffer fa copie pour une
produéli’on de ce célèbre ftatuaire. Il eft bien
plus facile d’imiter le ftyle que les raifons
8c le talent des grands maîtres.
Comme nous-ne poffédons, du moins ainfi
que je le penfe, aucun monument que nous
V ^