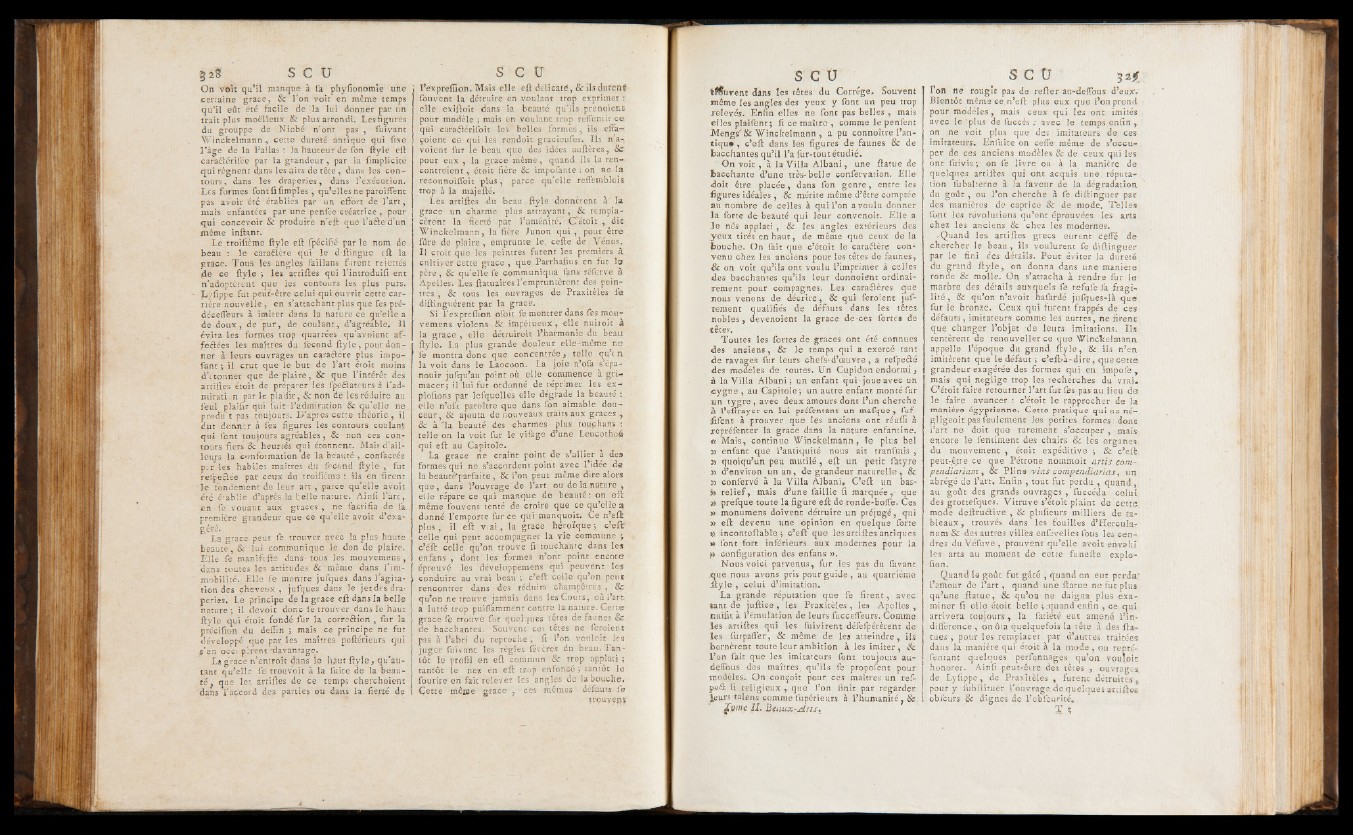
On voit qu’ il manque à la phyfionomîe une
.certaine grâce, & Ton voit en même temps
qu’il eût été facile de la lui donner par un
trait plus moelleux & plus arrondi. Les figures
du grouppe de Niobé n’ont pas , fuivant
Winckelmann , cette dureté antique qui fixe
l ’âge de la Pallas : la hauteur de Ton ftyle eft
caraclérilee par la grandeur, par la fimplicité
qui régnent qans les airs de tête , dans les contours,
dans les draperies, dans l’exécution.
Les formes fontfifimples , qu’elles ne paroiffent
pas avoir été établies par un effort de l ’art,
mais enfantées par une penfée créatrice, pour
,qui concevoir Sc produire n’eft que l’aéle d’un
même inftant.
Le troifième ftyle eft fpécifié par le nom de
beau : le caraélère qui le d ftingue eft la
grâce. Tous les angles faillans furent rejettes
de ce ftyle ; les artiftes qui l’introduifr ent
n’adoptèrent que les contours les plus purs.
L/fiope fut peut-être celui qui ouvrit cette carrière
nouvelle , en s’attachant plus que fes pré-
déceffeurs à imiter dans la nature ce qu’elle a
de doux, de pur, de coulant, d’agréable. Il
évita les formes trop quarrées qu’avoient af-
feélées les maîtres du fécond fty le , pour donner
à leurs ouvrages un caractère plus impo-
fant ; il crut que le but de l’art étoit moins
d’ttonner que de plaire, & que l’ intérêt des
artiftes étoit de préparer les fpeéiatèurs à l’admiration
par le plaifir, & non dé les réduire au
feuï plaifir qui luit l’admiration & qu’elle ne
produ't pas toujours. D’apres cette théorie , il
dut donner à fes figures les contours coulant
qui font toujours agréables, & non ces contours
fiers & heurtés qui étonnent. Mais d’ailleurs
la conformation de la beauté , confacrée
p:r les habiles maîtres du fécond ftyle , fut
relpeclée par ceux du troifième : ils en firent
le fondement de leur art , parce qu’elle avoit
' été établie d’après la te lle nature. Ainfi l’art,
en fe vouant aux grâ ce s, ne facrifia.de fa
première grandeur que ce qu’elle avoit d’exa-
gérc.
La grâce peut fe trouver avec la plus haute
beauté, & lui communique le don de plaire.
Elle fe manifefte dans-tous les. mouvemens ,
'dans toutes les attitudes & 'même dans l'immobilité.
Elle fe montre jufqùes dans l’agitation
des cheveux , jufques dans le jet des draperies.
Le principe de la grâce eft dans la belle
nature-, il devoir donc le trouver dans le haut
ftyle qui étoit fondé fur la correâion , fur la
précifion du defïin ; mais ce principe ne fut
développé que par les maîtres- poftérieurs qui
s’en oce. plrent "davantage.
La grâce n?entroit dans le haut ftyle , qu’au-
tant qu’elle fe trouvoit à la fuite de la beaut
é . que lès artiftes de ce temps cherchoient
dans l'accord dps parties ou dans la . fierté de
l ’expreftion. Mais elle eft délicaté, & ils durent
fouvent la détruire en voulant trop exprimer r
e l le . exiftoit dans la beauté qu’ils prenoier.t
pour modèle ; mais en voulant trop reffentir ce>
qui caraélérifoit les belles formes , ils effa-
çoient ce qui lès rendoit gracieufes. Ils na^
voient fur le beau que des idées auftères, &
pour eux , la grâce même, quand ils la ren-
controient, étoit fièrè & impofante : on ne- la
reconnoiffoit plus, parce qu’elle reffembloit
trop à la majefté.
Les artiftes du beau ftyle donnèrent à la
{ grâce un charme plus attrayant, & remplacèrent
la fierté par l’aménité. C ’étoit., dit
Winckelmann, la fière Junon qui , pour être
fûre de plaire, emprunte le, cefte de Vénus.
Il croit que les peintres furent les premiers à
cultiver cette grâce , que Parrhafius en fut la
père, & qu’elle fë communiqua fans réferve à
Apelles. Les ftatuaires l’empruntèrent des peintres
, & tous les ouvrages de Praxitèles le
diftinguèrent par la grâce.
Si l ’expreftion ofoit fe montrer dans fes mont
vemens violens & impétueux , elle nuiioit à
la grâce , elle détruiroit l’harmonie du beau
ftyle. La plus grande douleur elle-même ne
fe montra donc que concentrée , telle qu’c ri
la voit dans le Laocoon. La joie n’ofa s'épanouir
jufqu’au point où elle commence à gri-
macer j îi lai fut ordonné de réprimer les èx -
plofions par lefquelles elle dégrade la beauté
elle n’ofa paroître que dans fon aimable douceur,
& ajouta de nouveaux traits aux grâces ,
& à Ta beauté des charmes plus totiphans :
telle on la voit fur le vifage d’une Leucothoé
qui eft au Capitole.
La grâce ne craint point de s’allier a des
formes qui ne s’accordent point avec l ’ idée da
la beauté*parfaite, & l’on peut même dire alors
que, dans l’ouvrage de l’ art ou de la nature,
elle répare ce qui manque de beauté: on eft
même fouvent tenté de croire que ce qu’elle a
donné l’emporte fur ce qui manquoit. Ce n’eft
plus, il eft v ia i , la grâce héroïque; c’eft
celle qui peut accompagner la vie commune 9
c’e ft celle qu’on trouve fi touchante dans les
en fans ,. dont les formes n’ont point encore
éprouvé les développemens qui peuvent les
conduire au vrai beau ; c’eft celle qu’on petit
rencontrer dans des réduits champêtres , &
qu’on ne trouve jamais dans les Cours, où l’art
a lutté trop puiffamment contre la nature. Cette
grâce fe trouve fur quelques têtes de faunes &
de bacchantes. Souvent ces, têtes ne feroient
pas à l’abri du reproche', fi l’on vouloir les
juger fuivant lès règles févères du beau. Tantôt
lp profil en eft commun & trop applati;
tantôt le nez en eft trop enfoncé ; tantôt le
fourire en fait rélever les angles de la bouche.
Cette même grâce , ces mê-fîies1 défauts le
trouyéi^
ttôuvent dans les têtes du Corrége. Souvent
même les angles des yeux y font un peu trop
relevés. Enfin elles ne font pas belles , mais
elles plaifent; fi ce maître , comme le penfent
Mengs' & Winckelmann , a pü connoître l’antique
, c’ eft dans les figures de faunes & de
bacchantes qu’il l ’a fur-tout étudié.
On v o it , à la Villa Alb ani, une ftatue de
bacchante d’une très-belle confervation. Elle
doit être placée, dans fon genre, entre les
figures idéales , & mérite même d’être comptée
au nombre de celles à qui l’on a voulu donner
la forte de beauté qui leur convenoit. Elle a
le nés applati , & les angles extérieurs des
y eu x tirés en haut, de même que ceux de la
bouche. On fait que c’étoit le caraétère convenu
chez les anciens pour les têtes de faunes,
& on voit qu’ ils ont voulu l’imprimer à celles
des bacchantes qu’ ils leur donnoient ordinairement
pour compagnes. Les caraélères que
nous venons de décrire, & qui feroient juf-
tement qualifiés de défauts dans les têtes
nobles, devenoient la grâce de^ces fortes de
têtes*
Toutes les fortes de grâces ont été connues
des anciens, & le temps qui a exercé tant
de ravages fur leurs chefs-d’oeuvre, a refpè&é
des modèles de toutes. Un Cupidon endormi,
à la V illa Albani; un enfant q u ijo u e a v e c un
.cygne , au Capitole; un autre enfant monté fur
un tygre , avec deux amours dont l’un cherche
à l’effrayer en lui préfentant un mafque, fuf-
d&feiit à prouver que les anciens ont réufti à
répréfenter la grâce dans la nature enfantine.
« Mais, continue Winckelmann, le plus bel
» enfant que l’antiquité nous ait tranfmis ,
» quoiqu’ un peu mutilé , eft un petit fatyre
» d’ environ un an, de grandeur naturelle, &
.» confervé à la Villa Albani. C’eft un bas-
j» r e lie f, mais d’ une faillie fi marquée,- que
» prefque toute la figure eft de ronde-bofte. Ces
»-monumens doivent détruire un préjugé, qui
» eft devenu une opinion en quelque forte
p .inconteftable,; c’ eft que les artiftes antiques
» font fort inférieurs aux modernes pour la
>> configuration des enfans ».
Nous voici parvenus, fur les pas du favant
.que nous avons pris pour guide, au quatrième
fty le , celui d’ imitation.
La grande réputation que fe firent, avec
tant de juftice , les Praxitèles , les Apelles ,
nuifit à l’émulation de leurs fucceffeurs. Comme
les artiftes qui les fuivirent défelpérèrent de
les furpaffer, & même de les atteindre, ils
bornèrent toute leur ambition à les imiter, &
l ’ on fait que les imitateurs font toujours au-
deffous des maîtres, qu’ ils fepropofent pour
modèles. On conçoit pour ces maîtres un ref-
peft fi religieux , que l’on finit par regarder
|eu,rs talens comme fupérieurs à l’humanité, &.
ffiffli JL Beaux-Arts»
l’on ne rougît pas de refter au-deffotis d’eux.
Bientôt même ce n’eft plus eux que l’on prend
pour modèles, mais ceux qui les ont imités
avec le 'plus de fuccès : avec le temps enfin ,
on ne voit plus que des imitateurs de ces
imitateurs. Enfuite on ceffe même de s’occuper
de ces anciens modèles & de ceux qui les
ont fuivis ; on fe livre ou à la manière de?
quelques artiftes qui ont acquis une, réputation
fubalterne à la faveur de la dégradation
du goût , ou l’on cherche à fe diftînguer par
des manières de. caprice & de mode. Telles
font les révolutions qu’ont éprouvées les arts
chez les anciens & chez les modernes.
.Quand les artiftes grecs eurent ceffé de
chercher le beau , ils voulurent fe diftînguer
par le fini ces détails. Pour éviter la dureté
du grand fty le , on donna dans une manière;
ronde & molle. On s’attacha à rendre fur le
marbre des détails auxquels fe refufe là fragilité
, & qu’on n’avoit hafardé jufques-là que
fur le bronze. Ceux qui furent frappés de ces
défauts, imitateurs comme les autres, ne firent
que changer l’objet de leurs imitations. Us
tentèrent de renouveller ce que Wmcltelmann.
appelle l’époque du grand f ty le , & ils n’en
imitèrent que le défaut ; c’eft-à-dire, que cette
grandeur exagérée des formes qui en impofe ,
mais qui négligé trop les recherches du vrai.
C’étoit faire retourner l’art fur fes pas au lieu de
le faire avancer : c’étoit le rapprocher de la
manière égyptienne. Cette pratique qui ne né-
gligeoit pas feulement les petites formes donc
l’arc ne doit que rarement s’occuper , -mais;
encore le fentiment des chairs & les organes;
du mouvement , étoit expéditive ; & c’eft
peut-être ce que Pétrone nommoit artis çom-
pendiariam , & Pline vias competidiarias, un
abrégé de l’art. Enfin , tout fut perdu , quand,
au goût des grands ouvrages , fuccéda celui
des grottefques. Vitruve s’étoit plaint de cette
mode deftruélive , & plufieurs milliers de tableaux,
trouvés dans les fouilles d’Hercular
num & des autres villes enfévelies fous les cendres
du Véfuve , prouvent qu’elle avoit envahi
les arts au moment de eétte funefte explo-
fion.
Quand 1© goût fut gâté \ quand on eut perdu'
l’amour de l ’a r t , quand une ftatue ne fut plus
qu’ une ftatue, & qu’on ne daigna plus examiner
fi elle étoit belle ;:quand enfin , ce qui
arrivera toujours, la fattété .eut amené l’indifférence
, on ôta quelquefois la tête à des fta-
tues , pour les remplacer par d’ autres traitées
dans la manière qui étoit à la mode, ou reprç-
fenrant quelques perfonnages qu’on voulpit
honorer. Ainfi peut-être des têtes , ouvrages,
de Lyfippe, de Praxitèles , furent détruites,
pour y lubftituer l’ouvrage de quelques artiftes
obfcurs & dignes de l’ cbfcurité. i l