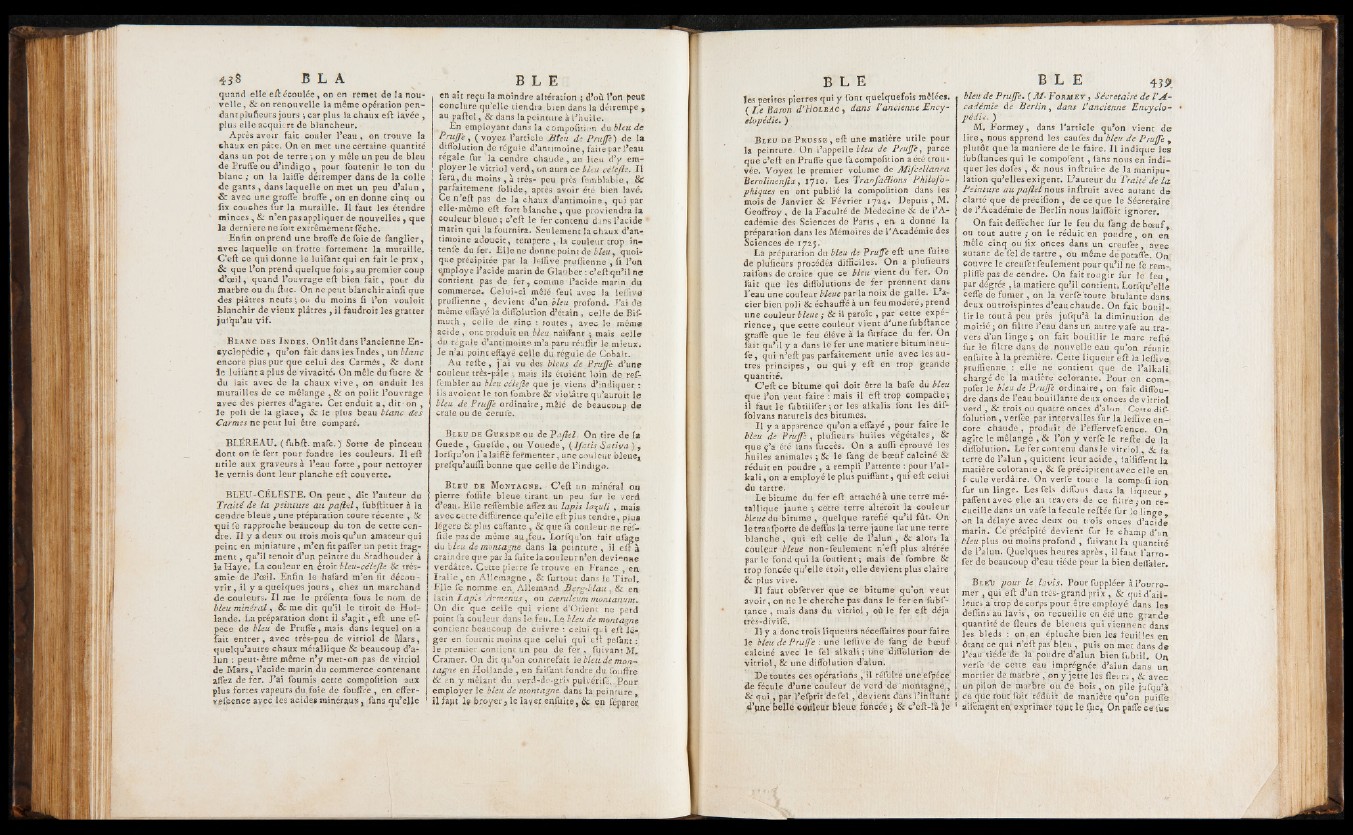
quand elle eft écoulée, on en remet de la nouv
e lle , & on renouvelle la même opération pendant
plufieurs jours -, car plus la chaux eft lavée ,
plus elle acquiert de blancheur.
Après avoir fait couler l’e a u , on trouve la
chaux en pâte. On en met unecèrtaine quantité
dans un pot de terre ; on y mêle un peu de bleu
de Pruffe ou d’ indigo , pour ioutenir Je ton du
blanc ,* on la laifle détremper dans de la colle
de gants , dans laquelle on met un peu d’alun ,
& avec une grofle brofle , on en donne cinq ou
fix couches fur la muraille. I l faut les étendre
minces , 8c n’en pas appliquer de nouvelles , que
la d erniere ne foit extrêmement féche.
En tin on prend une brofle de foie de fanglier,
avec laquelle on frotte fortement la muraille.
C ’eft ce qui donne le luifant qui en fait le prix ,
& que l ’on prend quelque fois , au premier coup
d ’oe il, quand l ’ouvrage eft bien fa it , pour du
marbre ou du ftuc. On ne peut blanchir ainfi que
des plâtres neufs ou du moins fi l ’on vouloit
blanchir de vieux plâtres , il faudroit les gratter
julqu’au v if.
Blanc des Indes. Onlitdans l’ancienne Encyclopédie
, qu’on fait dans les Indes, un blanc
encore plus pur que celui des Carmès , & dont
le luifant a plus de vivacité. On mêle du fucre &
du lait avec de la chaux v i v e , on enduit les
murailles de ce mélange , & on polit l’ouvrage
avec des pierres d’agare. Cet enduit a , dit-on , !
le poli de la gla ce, & le plus beau blanc des
Carmes ne peut lui être comparé.
BLÉREAU. ( fubft. mafe. ) Sorte de pinceau
dont on fe fert pour fondre les couleurs. I l eft
utile aux graveurs à l ’ eau forte , pour nettoyer
le vernis dont leur planche eft couverte.
BLEU-CÉLESTE. On peut, dit l’ auteur du
Traité de la peinture ait paftel, fubftituer à la
cendre bleue, une préparation toure récente , 8c
qui fé rapproche beaucoup du ton de cette cendre.
I l y a deux ou trois mois qu’ un amateur qui
peint en miniature, m’en fit pafler un petit fragment
, qu’ il tenoit d’ un peintre du Stadhouder à
la Haye. La couleur en étoit bleu-célejle 8c très-
amie de l’oeil. Enfin le hafard m’en fit découv
r ir , .il y a quelques jours , chez un marchand
de couleurs. I l me le préfenta fous le nom de
bleu minéral, & me dit qu’il le tiroit de Hollande.
La préparation dont il s’agit ', eft une eff-
pece de bleu de Pruffe , mais dans lequel on a
Fait entrer, avec très-peu de vitriol de Mars,
quelqu’autre chaux métallique & beaucoup d’alun
; peut-être même n’y met-on pas de vitriol
de Mars, l’acide marin du commerce contenant
aflez de fer. J’ai fournis cette compofition aux
plus fortes vapeurs du. foie de fouffre , en effer-
vetcence avec les acides minéraux, fans qu’elle 1
en ait reçu la moindre altération ; d’ où l’on peut
conclure qu’elle tiendra bien dans la détrempe ,
au paftel, 8c dans la peinture à l’ huile.
En employant dans la compofition du bleu de
P ruße, (voy ez l’article Bteu de Pruffe) de la
diffolution de régule d’antimoine, faite par l’eau
régale fur la cendre chaude, au lieu d’y employer
le vitriol verd, on aura ce bleu célefte. I l
fera, du moins , à très- peu près femblabie , &
parfaitement lolide, après avoir été bien lavé.
Pas c^aaix d’antimoine, qui par
elle-meme eft fort blanche , que proviendra la
couleur bleue ; c’ eft le fer contenu dans l’acide I
marin qui la fournira. Seulement la chaux d’an-:
timoine adoucit, tempere , la couleur trop intente
du fer. Elle ne donne point de bleu, quoique
précipitée par la leflive pruflienne , fi l’on
einploye l’acide marin de Glauber : c’eft qu’ il ne
contient pas de fe r , comme l’acide marin du
commerce. Celui-*ci mêlé feul avec la leflive
pruflienne , devient d’ un bleu profond. J’ai de
meme eflayé la diffpiution d’étain , celle de Bifc »
muth , celle de zinç : routes, avec le même
acide, ont produit un bleu naiflÜant ; mais celle
du régulé d’antimoine-m’a paru réuffir le mieux.
Je n’ai point eflayé celle du régule de Cobalt.
Au re fte , j'ai vu des bleus de Pruffe d’une
couleur très-pâle ; mais ils étaient loin de refi-
fembler au bleu célefie que je viens d’ indiquer :
ils avoient le ton fombre & violâtre qu’auroit le
bleu de Pruffe ordinaire, mêié de beaucoup de
craie ou de cérufe.
Bleu de Guesde ou de Paftel. On tire de la
Guede , Guefde, ou Vouede, ( Ifatis Sativa ) ,
lorfqu’on l’a laifle fermenter, une couleur bleue,
prefqu’aufli bonne que celle de l’ indigo.
Bleu de Montagne. C ’ eft un minéral ou
pierre foflile bleue tirant un peu fur le verd
d’eau. Elle reflemble aflez au lapis la^uli , mais
avec cette différence qu’elle eft plus tendre, plus
légère & plus caflante , & que fa couleur ne réf-
fiiiepasde même au/eu. Lorfqu’on fait ufage
du b leu de montagne dans la peinture , il eft à
craindre que par la fuite la couleur n’en devienne
verdâtre. Cette pierre fe trouve en France , en
I ta lie , en Allemagne, & furtout dans le Tirol.
Elle fe nomme en Allemand Beng-blau, & en
latin Lapis Armenus, ou cceruleum montanum.
On dit que celle qui vient d’Orient ne perd
point fa couleur dans le feu. Le bleu de montagne
contient beaucoup de cuivre : celui qui eft léger
en fournit moins que celui qui eft pefant :
le premier contient un peu de fer , fuivant M.
Cramer. On dit qu’on contrefait le bleu de montagne
en Hollande , en faifant fondre du {buff're
& e n y mêlant du verd-de-gris pulvérifè. Pour
employer le bleu de montagne, dans la: peinture ,
il faut 1$ broyer> le layer enfuite, 8c en féparer
les petites pierres qui y font quelquefois mêlees.
( Le Baron d ’HoLBAc , dans Vancienne Encyclopédie.
)
Bleu de Prusse, eft une matière utile pour
la peinture. On l’appelle bleu de Pruffe, parce
que c’eft en Pruffe que fa compofition a été trouvée.
Voyez le premier volume de Mifcellanea
Berolinenfia, 1710. Les Tranfaclions Philofo-
phiques en ont publié la compofition dans les
mois de Janvier 8c Février 1724* Depuis , M.
Geoffroy , de la Faculté de Médecine 8c de l’Académie
dés Sciences de Paris , en. a donné la
préparation dans les Mémoires de TAcadémie des
Sciences de 172$^ ' .
La préparation du bleu de Pruffe eft une fuite
de plufieurs procédés difficiles. On a plufieurs
railons de croire que ce bleu Vient du fer. On
Tait que lés diflolutions de fer prennent dans
l ’eau une couleur bleue par la noix de galle. L’acier
bien poli & échauffé à un feu modéré, prend
une couleur bleue ,* & il paroît , par cette expérience,
que cette couleur vient d’une fubftance
grafle que le feu éléve à la fupface du fer. On
lait qu’ il y a dans lé fer une matière bitumineu-
f e , qui n’eftpas parfaitement unie avec les autres
principes, ou qui y eft en trop grande
quantité.
C ’eft ce bitume qui doit être la bafe du bleu
que l’on veut faire : mais il eft trop compacte;
il faut le fubtiiifer ; or les alkalis font les dif-
folvans naturels des bitumés. .
I l y a apparence qu’on a eflayé , pour faire le
bleu de Pruffe , plufieurs huiles végétales, &
que ç’a été-iàns fuccès. On a auffi éprouvé les
Éuiles animales ; & le fang de boeuf calciné &
réduit en poudre , a rempli l’attente : pour l ’al-
Jcali, on a employé le plus puiflant, qui eft celui
du tartre.
Le bitume du fer eft attaché à une terre métallique
jaune ; cette terre altéroit la couleur
bleue du bitume , quelque raréfié qu’ il fût. On
letranfporte de deffus la terre jaune fur une terre
blanche, qui eft.celle de l’alun, & alors la
couleur bleue non-feulement n’eftjffus altérée
par le fond qui la foutient ; mais de fombre 8c
trop foncée qu’elle étoit, elle devient plus claire
8c plus vive.
Il faut obferver que ce bitume qu’on veut
avoir, on ne le cherche pas dans le fer en fubftance
, mais dans du v itriol, où le fer eft déjà
très-divife. 1
Il y a donc trois liqueurs néceflaires pour faire
le bleu de Pruffe : une leflive de fang de boeuf
calciné avec le fel alkali ; une 'diflblùtion de
v itr io l, 8c une diffolution d’alun.
De toutes ces opérations , il rerafte une efpéce
de fécule d’une couleur de verd de montagne^,
& qui , par l’ efprit de f e l , devient dans Pihftàiit’
d’pnebelle couleur bleue foncée j & c’eft-l’à te *
bleu de Pruffe. (M • F o r m e y , Secrétaire de l 'A cadémie
de Berlin, dans l ’ancienne Encyclo-
péd ü. )
M. Formey, dans l’article qu’on vient de
li r e , nous apprend les caufes du bleu de Pruffe ,
plutôt que la maniéré de le faire. I l indique les
îubftances qui le compofent, fans nous en indiquer
les doles , & nous inftruire de Ja manipulation
qu’elles exigent. L’auteur du Traité de la
Peinture au paftel nous inftruit avec autant da
clarté que de précifion , de ce que le Secrétaire,
de l’Académie de Berlin nous laiffoit ignorer.
On fait deffécher fur le feu du fang de boeuf %
ou tout autre ,• on le réduit en poudre, on en
mêle cinq ou lix onces dans un creufet, avec
autant de fel de tartre , ou même dé potaffe. On
couvre le creufet feulement pour qu’ il ne fe rem-,
plifle pas de cendre. On fait rougir fur Je feu
par degrés , 1a matière qu’ il contient* Lorfqu’elle
ceffe de fumer , on la verfe toute brûlante dans
deux outroispintes d’eauchaude. On fait bouillir
le tout à peu près jufqu’ à la diminution de
moitié j on filtre l’eau dans un autre vafe au travers
d’un lin g e ; on fart bouillir le marc refté
fur le filtre dans de nouvelle eau qu’on réunie
enfuite à la première. Cette liqueur eft la leflive
pruflienne : elle ne contient que de l’alkalL
chargé’de la matière colorante. Pour en com-
poler le bleu de Pruffe ordinaire, on fait diffou-
dre dans de Teau bouillante deux onces de vitriol
verd , & trois ou quatre onces d’alun. Certe d iffolution
, verfée par intervalles fur la leflive en-'
coré chaude , produit de l’èffervefcence. On
agite le mélange , & l’on y verfe le refte de la
diffolution. Le fer contenu dans le v itr io l, 8c la
terre de l’alun , quittent leur acide , faififlent la
matière colorante , 8c fe précipitent avec elle en
f eule verdâtre. On verfe toute la compofi ion
: fur un linge. Les fels diflbus dans la liqueur
paffentavec elle au travers de ce filtre,-on recueille
dans un vafe la fecule reftée fur îe linge ,
on la délaye avec deux ou trois onces d’acide
marin. Ce précipité devient fur le champ d’un
bleu plus ou moins profond , fuirant la quantité
de l’alun. Quelques heures après, il faut l’arro-
« fer de beaucoup d’eau tiède pour la bien deffaler.
BleIj pour le lavis. Pour fuppléer à l’outremer
, qui eft d’ un très-grand prix , & qui d’ailleurs
a trop de corps pour être employé dans le*
déffiris au lavis, on recueille en été une grarde
quantité de fleurs de bleuets qui viennent dans
les bleds : on en épluche bien les feuilles en
ôtant ce qui n’eft pas bleu , puis on mec dans de
l ’éau tîédè de la'poudre d’alun bien fubtil. On
verfe de cette eau imprégnée d’alun dans un
mortier de marbre , pn y jette les flei rs , & avec
: un pilon de marbre ou de bois , on pile jufqu’à
I ce que tout (oit réduit de manière qu’ on puiffe.
‘ aiféiiiefft en: exprimer tout le ûic. On paffe cefue