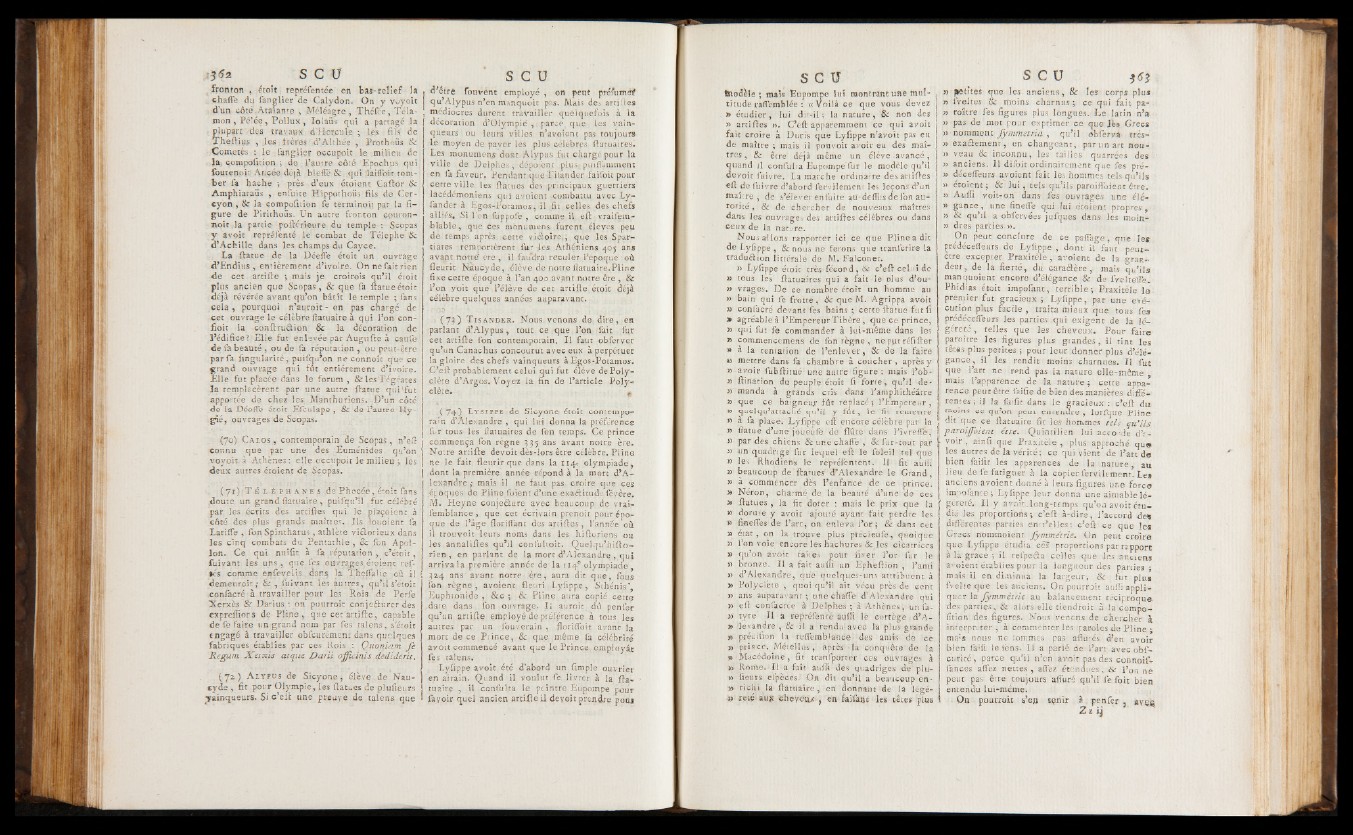
i3 $ 2 S C Ü
fronton , étoit repréfentée en bas-relief la
chafle du fanglier de Calydon. On y voyoit
d’un côté. Atalante , Méléagre , Théfce, Téla-
mon , Pé’ée , P ollu x , Iolaüs qui a partagé la
plupart des travaux d'Hercule ; lès fils de
Theftiug , J es . frères d’Alt hée , Prothoüs 8c
Cometès le fanglier occupoit le milieu de
la compofirion -, de l’autre côté EdocIius qui
foutenoit Armée déjà blefle & qui'laifToit tomber
fa hache -, près d’eux étoient Caftor 8c
Amphiaraiis , enfuite Hippothoiis fils de Cer-
cyon , & la compoficion fe terminoit par la figure
de Pirithoüs. Un autre fronton epivron-
n o it.la partie- poftérieure du temple : Sçppas
y a voit repréfenté le combat de Télephe &
d’Achille dans les champs du Cayce.
La ftatue de la Déefle étoit un ouvrage
d ’Endius , entièrement d’ ivoire. On ne fait rien
de cet artifte ; mais je croirois qu’ il étoit
plus ancien que Seopas, & que fa ftatue étoit
déjà révérée avant qu’on bâtît le temple ; fans
c e la , pourquoi n’au ro it-o n pas chargé de
cet ouvrage le célèbre ftatuaire à qui l’on con-
fioit la conftruction & la décoration de
l ’édifice? Elle fut enlevée par Augufte à caufe'
de fa beauté , ou de fa réputation , ou peut-être
par fa fingularité, puifqu’on ne connoîc que ce
grand ouvrage qui fût entièrement d’ ivoire.
E lle fut placée dans le forum, & les Tegéates
la remplacèrent par une autre ftatue qui'fut
apportée de chez les Manthutiens. D’un côté
de la Déeffe étoit E-fculape , & de l’autre Hy-
g îé , ouvrages dè Seopas.
(70) C a lo s , contemporain de Seopas, n’ eft
connu que par une des Euménides qu’on
voyait.à Athènes: elle occupoit le milieu ; les
deux autres étoient de Seopas.
(7 1 ) T e l é ph ane s .de Phocée, étoit fans
doute un grand flatuaire, puifqu’il fut célébré
par les écrits dès artiftes qui le plaçaient à
côté des plus grands maîtres. Us louoient fa
Lariffe , fan Spintharus, athlète vi&orieux dans
les cinq combats du Pentathle , & fon Apollon.
Ce qui nuifit à fa réputation , c’étoit,
fuivant les uns , que fes ouvrages étoient ref-
tés comme enfevelis . dans la ,THçfialie où il
demeur.oit; 8c , fuivant les autres, qu’ il s’etoit
confacré à travailler pour les Rois de Perfe
Xerxès & Darius : on pourroit conje&urer des
exprefîiors de Pline , que ceta rtifte, capable
de fe faite un grand nom par fes talens, s'éroit
engagé à travailler obfcurément dans quelques
fabriques établies par ces Rois : Quoniam f e
Regurn X e ix is atqite Darii officinis de dï de rit.
(72.) A lypus de Sicyone, élève de Nau-
e y d e , fit pour Olympie, les ftatucs de plufieurs
vainqueurs. Si c ’eft une preuve de taie ns que
s c u d’être fo u v én t em p lo yé , on p eu t préfum èf
qu A lyp u s n’en m a n q u o it pas. M ais des artiftes
m éd iocres durent trav ailler q u elq u efo is à la
décoration d’O lym p ië , parce, qii.e les v a in q
ueurs ou leu rs v ille s n ’avoionc pas tou jou rs
le m o yen de paver les plus célèb res ftactuaires.
L es m o n um en t don t A lyp u s fu t ch a rg é pour la
v ille d e D e lp h e s , dépobent plus, puiflàm m ent
en fa faveu r. P en d an t q u e Tftander, faifoit pour
c e tte v ille les ftatu es d es principaux guerriers
lacéd ém on ien s q u i a v o ien t -com battu a v ec L y -
fan der à E g o s-P o tam o s, il fit c e lle s d es ch efs
a llié s. S i l ’on fuppofe , com m e il e ft v ra ifem -
b la b le , que ces m onum ens fu ren t élev és peu
de tem ps après, c ette viélp irej; q u e les Spartiates
rem portèrent fur le s A th én ien s 405 ans
avan t n otre ère , il faudra recu ler l’époque où
fleu rit N à u c y d e , .élèv e d e notre ftatu a ire.P lin e
fix e c e tte ép oq u e à l ’an 4 00 avan t n o tre ère , &
l’on y o it q u e l’élè v e d e c e t a rtifte étoit déjà
célèb re q u elq u es années auparavant.
ï (73 ) T is a n d e r . N o u s, v en on s de, d ir e , en
parlant d’A ly p u s, tou t c e ,q u e l’o n fait fur
c e t a rtifte fon con tem p orain . I l fau t obferver
qu ’un C anachus con cou ru t a v ec eu x à perpétuer
la g lo ire d es ch efs vain q u eu rs à E g o s-P o tam o s.
C ’e ft prob ab lem en t c e lu i q u i fu t élèv e d eP o ly '-
c lè te d’A rgos. V o y e z la fin d e l’a rticle P o ly -
c lè te . #
. ,( 7 4 ) Ly s ip p e d e S ic y o n e éto it con tem p orain
d’A le x a n d r e , q u i lu i donna la p référence
fur tous le s ftatuaires d e fon tem ps. Ç e p rin ce
com m en ça fon règn e 335 ans avant n otre ere.
N o tre a rtifte d ev oir dès-lors être célèb re. P lin e
n e le fait fleu rir q u e dans la 114e o ly m p ia d e ,
d on t la prem ière an n ée répond à la m ort d’A lexan
dre,* m ais il ne fau t pas croire q u e ces
ép oq u es de P lin e fo ien t d’u n e exa ftitu d e févère.
M . H e y n e con je& ure a v ec b eaucoup d e vrai-
fem b la n ce , que c e t écrivain p renoit pour ép o q
u e de l’â ge floriftànt des a rtifte s, l’année où
il tro u v o it leu rs nom s dans les h ifto rien s ou
le s a n n a liftes q u ’il c o n fu lto it. Q u elq u ’h ifto -
rien , en parlant d e la m ort d’A lex a n d re , q u i
arriva la prem ière an n ée de la 114e o lym p iad e ,
-324 ans a va n t n otre è r e , aura d it q u e , fous
fon règ n e , a v o ien t fle u r i, Lyfippe , S th én is*,
E u p h ion id e , & c ; 8c P lin e aura cop ié c e tte
.date d a n s, fon ou vra ge. Il auroit dû penfer
qu ’un a rtifte em p lo yé de-préférence à tous le s
autres par un fou verain , florifloit avan t la
m ort d e c e .P r in c e , & q u e m êm e (à célébrité
a v o it com m en cé avant q u e le P rin ce em p lo y â t
fes talen s.
Lyfippe a v o it été d ’abord un Ample ou vrier
en airain. Q uand il v ou lu t fe liv rer à la fta tuaire
, il con fu lta le p ein tre Eupoinpe pour
fay oir q u el a n cien a rtifte il de y o it prendre p on t
s c u fïiodèle • mais 'Eupompe lui montrant use multitude
raftemblée : «Voilà ce que vous devez
» étudier, lui dit-il ; la nature, non des
» artiftes ». C’ eft apparemment ce qui avoit
fait croire à Duris que Lyfippe n’avoit pas eu
de maître ; mais il pouvoit avoir eu des maîtres
, & être déjà même un élève .avancé,
quand il confulta Eu pompe fur le modèle qu’ il
devoit fuivre. Lamarche ordinaire des artiftes
eft de fuivre d’abord fervilemenr les leçonsiRun
maître , de s’élever enfuite aiî-deftus de fon autorité
, 8c de chercher de nouveaux maîtres:
dans les ouvrages des artiftes célèbres ou dans
ceux de la nature.
Nous allons rapporter ici ce que Plinead it
de Lyfippe , & nous n,e ferons que tranlcrire la
traduélion littérale de M. Falconer.
» Lyfippe étoit très-fécond , 8c c’eft celu i de
» tous les ftatuaires qui a fait le plus d’ou-
» vrages. De ce nombre étoit un Homme au
» bain qui fe frotte, 8c que M. Agrippa avoit
» confacré devant fes bains ; cette ftatue fut fi
» agréable à l ’Empereur Tibère, que ce prince,
» qui fut fe commander à lui-même dans les
» commencemens de fon règne , ne put réfifter
» à la tentation de l’enlever, & de la faire
u mettre dans fa chambre à coucher , après y
» avoir fubftitué une autre figure : mais l ’ob-
» ftination du peuple, étoit fi forte , qu’ il de-
» manda à grands cris . dans l'amphithéâtre
» que ce baigneur fût replacé 5 l’Empereur ,
» quel qu’attaché qu’ il y fû t, le fit remettre,
w a fa placé. Lyfippe eft encore célèbre par la
» ftatue d’une'joueufë de flûte dans l'ivrefle,
» par des chiens & une chafle , 8c fur-tout par
» un quadrige fu r lequel eft le foleil tel que
» les Rhodiens le rëpréfentent. 11 fit auftî
» beaucoup de ftatues d“Alexandre le Grand ,
» a commencer dès l’ enfance de ce prince.
» Néron, charmé de la beauté d’une "d e ces
» ftatues , la fit dorer : mais le prix que la
» dorure y avoit ajouré ayant fait perdre les
p finefles de l’ artj on enleva l’or ; oc dans cet
» état, on la trouve plus pfécieufe, quoique
» l’on voie encore les hachures & les cicatrices
» qu’on avoit faiies pour fixer l’or- fur le
» bronze. Il a fait aufti un Epheftion , l’ami
» d’Alexandre, que quelques-uns attribuent à
» Polyclète , quoi qu’il ait vécu près de cent
» ans auparavant ; une c baffe d’Alexandre qui
» eft confacrée à Delphes ; à Athènes1, un fa-
,» tyre :I1 a repréfenté auflî le cortège d’A-
» ‘1 ex an dre , & il a rendu! avec la plus grande
» précifion la rëfTemblande des amis dé ce
» prince. MéteHus, après la 'conquête'de la
» Macédoiné, fit1 tranfporter ces ouvrages à
» Rome. l i a fait■ auffi des quadriges de plu-
» fie-ùrs efpèces. On dit qu’ il a beaucoup en-
» riclii la ftatuaire, en oonnant de la légé-
» reté au je cheveux , en foifauc les têtes plus
S C U
» p etites q u e le s a n c ie n s , & le s corp s plus
» lv e lte s 8c m oin s ch arn u s ; c e q u i fa it pa- .
» roître fes fig u res plus lo n g u e s. L e la tin n ’a
» pas d e m o t pour exp rim er c e q u e jfes G recs
» n om m en t Jytnmetria , q u ’il ob ferva très-
» exactement^:, en c h a n g e a n t, par un art n o u -
» veau 8c in c o n n u , lps ta ille s quarrées d es
» a n cien s. I l d ifoit o rd in a irem en t q u e fes pré-
» décefteurs a v o ie n t fa it les hom m es te ls q u ’ils
» é to ie n t; & lui , tels q u ’ils p aroiffu ient être.
>5 A u fïï v o it-o n dans fe s o u vra ges u n e é lé -
» g a n c e , u n e fin efle q u i lu i étoien t propres
» & qu’il a ob fervées ju fq u es dans le s m o in -
» dres parties ».
O n peut co n clu re d e ce p a fia g e, q u e le s
çrédécefteurs d e L yfippe , d o n t il fau t p e u t-
être ex cep ter P r a x itè le , a v o ien t d e la gran d
eu r, d e la fie r té , du c a r a â è r e , m ais q u ’ils
m a n q u o ien t en core d’élég a n ce & d e fV eîteïîe.
P h id ias éto it im p o fa n t, te r r ib le ; P ra xitèle le
prem ier fu t g ra cieu x ; L y fip p e, par u n e e x é c
u tio n plus fa c ile , traita m ieu x q u e tou s fes
prédécefleurs les parties q u i e x ig e n t de la lé -
g ér e ti , te lle s q u e le s c h e v e u x . P o u r faire
paroître le s fig u res p lu s g r a n d e s, il tin t le s
têtes plus p etites ; pour leu r d o n n er plus d’élé g
a n c e , il les ren d it m o in s ch a rn u es. I l fu t
q u e l’art n e . -.rend pas la nature e lle -m êm e ,
mais l’apparence d e la nature ; c e tte apparen
ce p eu t être faifie d e b ien d es m an ières difFé-
. rentes ; il la faifit dans le g ra cieu x : c ’e ft du
m o in s c e qu ’on p eu t en ten d re , lorfq u e P lin e
d it q u e c e ftatuaire fit les h om m es tels qu’ ils
paroijfoient être. Q u in tilie n lu i a cco 'de d ’r-
r voir , ainfi q u e P r a x itè le , plus approché qu®
les autres d e k v érité : c e q u i v ie n t d e l’art d e
b ien faifir les apparences d e la n a tu r e , au
lie u de fe fatigu er à la cop ier fervilem en r. L es
a n cien s a v o ie n t d onné à leu rs fig u res u n e fo r c e
im pofante ; Lyfippe leu r donna u n e aim ab le lé g
èreté. I l y a v o it.lo n g -tem p s q u ’on a v o it étud
ié le s proportions ; c ’e ft à -d ir e , l ’accord de«
diftèren'tes parties e n a ’e lje s : c’e ft c e q u e le s
G recs n om m oien t fymtnêtrie. G n peut croire
q u e L yfippe étu d ia ce? proportions par rapport
I à là g râ ce ; il refpeéla c e lle s que' le s an ci e ns
a v o ien t éta b lies pour la lo n g u eu r des parties ;
mais il en dim in u a la la rg eu r, & fu t plus
fv e lte q u e les a n cien s. O n pourroit aufti a p p liq
u er la fymmètrie au b a la n cem en t récip ro q u e
des p a rties, & a lo rs.elle tien d ra it à la c om p o -
fîtion d es figu res. N o u s v en o n s d e ch erch er à
interp réter ; à com m en ter le s p aroles d e P lin e ;
m ais nous n e îom m es pas aflurés d’en avo ir
b ien faifi le fens. Il a parlé de l’art a v ec o b f-
cu rité , parce qu’il n ’en a v o it pas d es c o n n o if-
fan ces affez n ettes , afiez éte n d u e s, 8c l ’on n e
p eu t pas être tou jours affuré q u ’il .fe fo it b ien
en ten d u lu i-m êm e.
O a pourvoit sJe a te n ir à . p en fer , a y ç ç
Z z sj