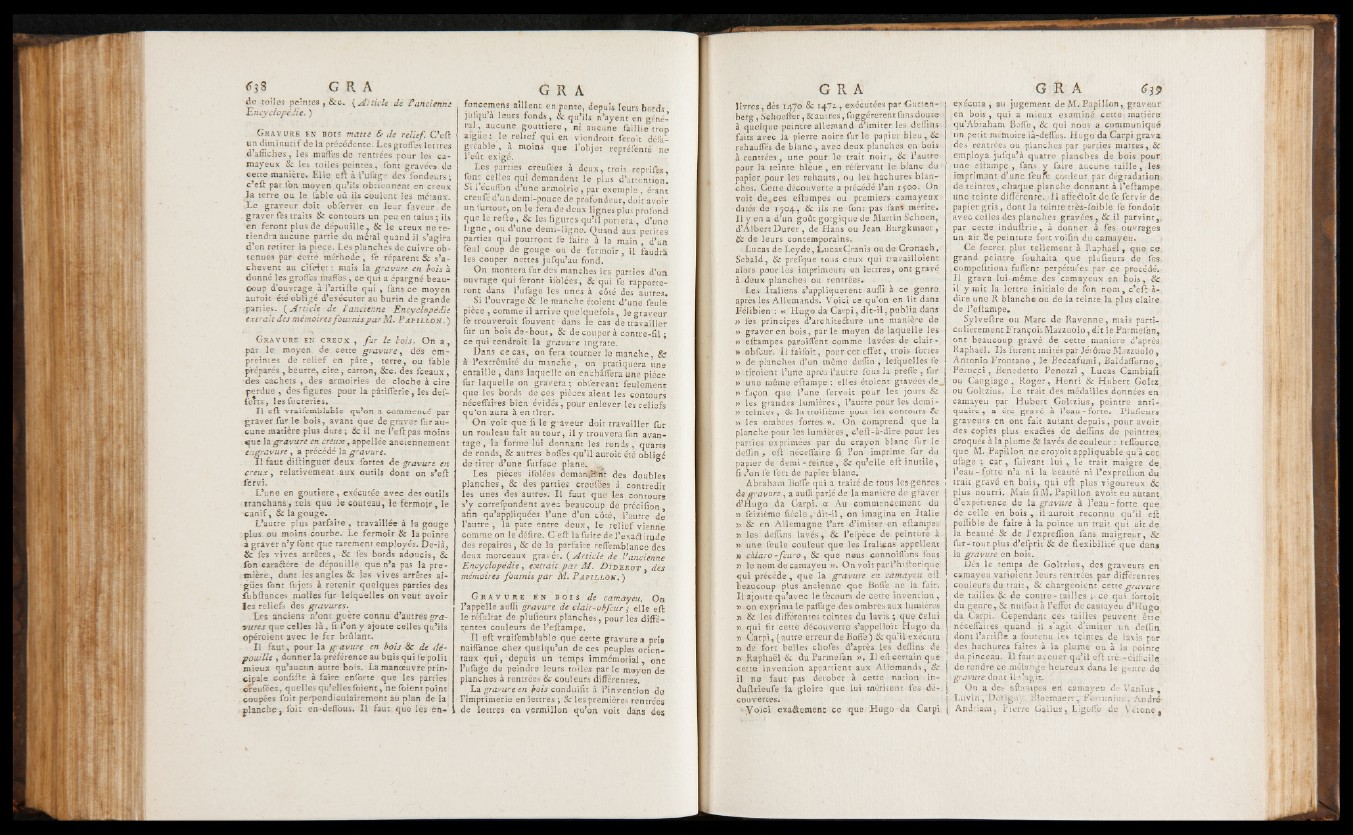
de toiles peintes , & c. ( Article Encyclopédie. de Vancienne )
, Gravure en b o is matte & de relief. C’eft
un diminutif de la précédente. Les grofles lettres
d’affiches, les mafTes de rentrées pour les ca-
mayeux & les toiles peintes, font gravées, de
cette manière. Elle eft à l’ufage des fondeurs ;
c’eft par fon moyen qu’ ils obtiennent en creux 3a terre ou le fable où ils coulent les métaux.
X e graveur doit obferver en leur faveur de
graver (es traits & contours un peu en talus ; ils
en feront plus de dépou ille , & le creux ne retiendra
aucune partie du métal quand il s’agira
d’en retirer la pièce. Les planches de cuivre obtenues
par cette méthode, fe réparent & s’achèvent
au cifeiet : mais la gravure en bois à
donné les grofles mafles , ce qui a épargné beaucoup
d’ouvrage à l’artifte qui , fans ce moyen
auroit été obligé d’exécuter au burin de grande
parties. ( Article de l'ancienne Encyclopédie
extrait des mémoiresfournis par M. Papillon. )
Gravure en creux , fur le lois. On a ,
par le moyen de cette gravure, des empreintes
de relief en pâte, terre, ou fable
préparés , beurre, c ire , carton, & c . des fceaux,
-des cachets , des armoiries de cloche à cire
perdue , des figures pour la pâtiflerie, les déficits
, les fucreries.
I l eft vrailémblable qu’on a commencé par
graver fur le bois, avant que de graver fur aucune
matière plus dure; & il ne l’eftpas moins
que la gravure en creux, appellée anciennement engravure , a précédé la gravure.
I l faut diftinguer deux fortes de gravure en
creux, relativement aux outils dont on s’eft
fervi.
L’ une en goutiere, exécutée avec des outils
tranchans, tels que le couteau, le fermoir, le
can if, & la gouge.
L’autre plus parfaite, travaillée à la gouge
plus ou moins courbe. Le fermoir & la pointe
à graver n’y font que rarement employés. De-là,
& fes vives arrêtes, & fes bords adoucis, &
lbn caraâère de dépouille que n’a pas la première,
dont les angles & les vives arrêtes ai*-
■ giies (ont fujets à retenir quelques parties des
iubftances molles fur lefquelles on veut avoir
le s reliefs des gravures.
Les anciens n’ont guère connu d’autres gravures
que celles là , fi l’on y ajoute celles qu’il s .
opéroient avec le fer brûlant.
poIuli llfeaut, pour la gravure en bois-& de dé
, donner la préférence au buis qui fe polit
mieux qu’aucun autre bois. La manoeuvre principale.
confifte à faire enforte que les parties
creufées, quelles qu’ellesfoient, ne (oient point
coupées foit perpendiculairement au plan de la
planche, foit en-defl'ous. I l faut que les en -’
foncemens aillent en pente, depuis leurs bords
J jufqu’à leurs fonds, & qu’ils n’ayent en génér
a l, aucune gouttière, ni aucune faillie trop
aigue: le relief qui en viendroit feroit défa-
gréable, a moins que l’objet repréfenté ne
l’eût exigé.
Les parties creufées à deux, trois reprifes,
font celles qui demandent le plus d’attention.
Si 1 écuflon d’une armoirié, par exemple , érant
creufé d’un demi-pouce de profondeur, doit avoir
un furtout, on le fera de deux lignes plus profond
que le refte, & les figures qu’il portera , d’une
lign e , ou d’une demi-ligne. Quand aux petites
parties qui pourront fe faire à la main , d’ un
feul coup de gouge ou de fermoir, il faudrâ
les couper nettes jufqu’au fond.
On montera fur des manches les parties d’un
ouvrage qui feront ifolées, & qui fe rapporteront
dans l ’ufage les unes à côté des autres.
Si l ’ouvrage & le manche croient d’ une feule
pièce , comme il arrive quelquefois, le graveur
fe trouveroit fouvent dans le cas de travailler
fur un bois de-bout, & de couper à contre-fil •
ce qui rendroit la gravure ingrate.
Dans ce cas, on fera tourner le manche, &
à l’ extrémité du manche , ori pratiquera une
entaille , dans laquelle on enchâflera une pièce
fur laquelle on gravera ; observant feulement
que les bords de ces pièces aient les contours
néceflaires bien évidés, pour enlever lés reliefs
qu’on aura à en tirer.
On voit que fi le g-aveur doit travailler fur
un rouleau fait au tour, il y trouvera fon avantage
, la forme lui donnant les ronds, quarts
de ronds, & autres bofles qu’ il auroït été obligé
de tirer d’une „furface plane. w|
Les pièces ifolées demarv$tïîfc des doubles
planches, & des parties creufées à contredit
les unes des autres. Il faut que les contours
s’y correfpondent avec beaucoup de précifion
afin qu’appliquées l’ une d’ un côté, l’autre de
l’autre, la pâte entre deux, le relief vienne
comme on le délire. C eft la fuite de l’exa&itude
des repaires, & de la parfaire reflembîance des
deux morceaux graves. ( Article de P ancienne
Encyclopédie, extrait par M. D id e r o t , dés
mémoires fournis par M. Papillon. )
G ravure en bois de camayeu. On
l’appelle auffi gravure de çlair-obfcur ; elle eft
leréfultat de plufieurs planches, pour les différentes
couleurs de l’ eftampe.
Il eft vraifemblable que cette gravure a pris
naiflance chez quelqu’ un de ces peuples orientaux
q u i, depuis un temps immémorial, ont
l’ufage de peindre leurs toiles par le meyen de
planches à rentrées & couleurs différentes.
La gravure en bois conduific à l’ invention de
l’imprimerie en lettres ; & les premières rentrées
4e lettres en vermillon qu’on voit dans des
livres, dès 1470 & 1472,, exécutées par Gtittcn- |
berg, Schoeffer, & autres, fuggérerent fans doute <1
à quelque peintre allemand d’ imiter les de (Tins J
faits avec la pierre noire fur le papier bleu, & I
rehaufles de blanc-, avec deux planches en bois
à rentrées, une pour le trait noir , 8c l’autre- j
pour la teinte bleue, en réfervant le blanc du ■
papier pour les rehauts, ou les hachures.blanches.
Cette découverte a précédé l’an 1500. On
voit de*ces eftampes ou premiers camayeux
datés de 1)04, 8c ils ne font pas fans mérite.
Il y en a d’un goût gorgique de Martin Schoen,
d’Albert Durer , de Hans ou Jean Burgkmaer,
8c de leurs contemporains.
Lucas deLeyde, LucasÇranis ou de Cronach,
Sebald, 8c prefque tous ceux qui travailloient
alors pour les imprimeurs en lettres, ont gravé
à deux planches ou rentrées. ...
Les Italiens s’appliquèrent auffi.' à ce genre
après les Allemands. Voici ce qu’on en lit dans
Félibien : « Hugo da Carpi, dit-il, publia dans
» fes principes d’arcliiteéiure une maniéré de
».graveren bois, parle moyen de laquelle les
» eftampes paroiflent comme lavées de cla ir-
» obfcur. l i fa ifo it , pour cet effet, crois fortes
» de planches d’ un même deffin , lefquelles fe
». tirotent l’une après l’autre fous la prefle , fur
» une même eftampe : elles étoient gravées de_
» façon que l’ une fer voit pour les jours &
» les grandes' lumières , l’autre pour les deini-
» teintes , & la troifième pour les contours 5c
» les ombres- fortes ». On comprend que la
planche pour les lumières, c’eft-à-dire pour les
parties'exprimées par du crayon blanc fur le
deffin >- eft nécèflaire fi, l’on imprime fur du
papier de demi-fe inte, & qu’elle eft inutile,
fi i’on fe fett de papier blanc.
Abraham Bofle qui a traité de tous les-genres •
degravure , a auffi parié de la manière de gfaver
d’Hugo da Carpi. « Au commencement du
» feizième fiécle, dit-il, on imagina en Italie
» & en Allemagne l’art d’ imiter en eftanrpes
» les deflins lavés , & l’efpèce de- peinture à
» une feule couleur que les Italiens appellent
» chiaro -feuro, & que nous connoiflbns fous
» le nom de camayeu ». On voit par l’hiftorique
qui précédé, que la gravure en camayeu eft
beaucoup plus ancienne que Bofle ne la fait.
Il ajoute qu’avec le fecours de cette invention ,
» on exprima le paflage des ombres aux lumières
» & les différentes teintes du lavis. ; que Celui
» qui fit cette découverte s’ appelloit Hugo da
» Carpi, (autre erreur de Bofle) 8c qu’il exécuta
» de fort belles chofes d’après les deflins de
» Raphaël & du Parme fan ». Il eft certain que
cette invention appartient aux Allemands, &
il ne faut pas dérober à cette nation in- 1
duftrieufe la gloire que lui méritent les dé- j
couvertes.
, [Voici eXa&ement ce que Hugo da Carpi (
exécuta , au jugement de M. Papillon, graveur
,en bois, qui a mieux examiné cette matière
qu’Abraham Bofle, 8c qui nous a communiqué
un petit mémoire là-deffus. Hugo da Carpi grava
des rentrées ou planches par parties martes, &
employa julqu’ à quatre planches de bois pour
une eftampe, fans y faire aucune ta ille , les
imprimant d’une feure couleur par dégradation
de teintes, chaque planche donnant à l’eftampe
une teinte différente. Il affeéloit de fe fervir de
papier g r is , dont la teinte très-foiblé fe fondoit
avec celles des planches. gravées , & il parvint,
par cette induftrie, à donner à fes ouvrages
un air 8e peinture fort voifin du camayeu.
Ce fecret plut tellement à Raphaël, que ce,
grand peintre fouhaita que plufieurs de fes,
, compofitions fuflent perpétuées par ce procédé.:
I l grava lui même des camayeux en bois, &
il y mit la lettre initiale de fon nom, c’eft-à-
dire une R blanche ou de la teinte la plus claire
de l’eftampe.
Sylveftre ou Marc de Ravenne, mais particulièrement
François Mazzuolo, dit le Parmefan,
ont beaucoup gravé de cette manière d’après
Raphaël. Ils furent imités par Jérôme Mazzuolo,
Antonio Frontano , le Beccafumi, Baldaflorno,
Perucci, Benedetto Penozzi , Lucas Cambiafi,
ou Cangiage, Roger, Henri & Hubert Goltz.
ou Goltzius. Le trait des médailles données en
camayeu par Hubert Goltzius, peintre antiquaire,
a été gravé à l’eau-forte. Plufieurs
graveurs en ont fait autant depuis, pour avoir,
des copies plus exa&es de deflins de peintres,
croqués à la plume & lavés de couleur : reflburce
que M. Papillon ne cr-oyoit appliquable qu’à cet
ufage ; car , fuivant lui , le trait maigre dev
l’eau-forte n’ a ni la beauté ni l’expremon du
trait gravé en bois, qui eft plus vigoureux &
plus nourri. Mais fi M. Papillon avoit eu autant
d’expérience de la gravure à l’eau-forte que
de celle en bois , il auroit reconnu qu’ il eft
poffible de faire à la pointe un trait qui aie de
la beauté & de l’expreffion fans maigreur, &
fur-tout plus d’efprit & de flexibilité que dans
la gravure en bois.
Dès le temps de Goltzius, des graveurs en
camayeu varioient leurs rentrées par différentes
couleurs du trait, 8c chargeoienc cette gravure
de tailles 8c de contre-tailles -, ce qui lbrtoic
du genre, & nuifoità l’effet de camayeu d’Hugo
da Carpi. Cependant ces tailles peuvent êtie
néceflaires quand il s’agit d’imiter un deffin
dont l’artifte a foutenu les teintes de lavis par
des hachures faites à la plume ou à la pointe
du.pinceau. Il faut avouer qu’ il eft trè-difficile
de rendre ce mélange heureux dans le gtnre de
gravure donc il s’agit.
On a des eftampes en camayeu de Vanius ,
Luvîn, Dct Jgny“: Bîoemaert ", Fouunius, André
Andriam, Pierre Galius, Ligofle de Vérone,