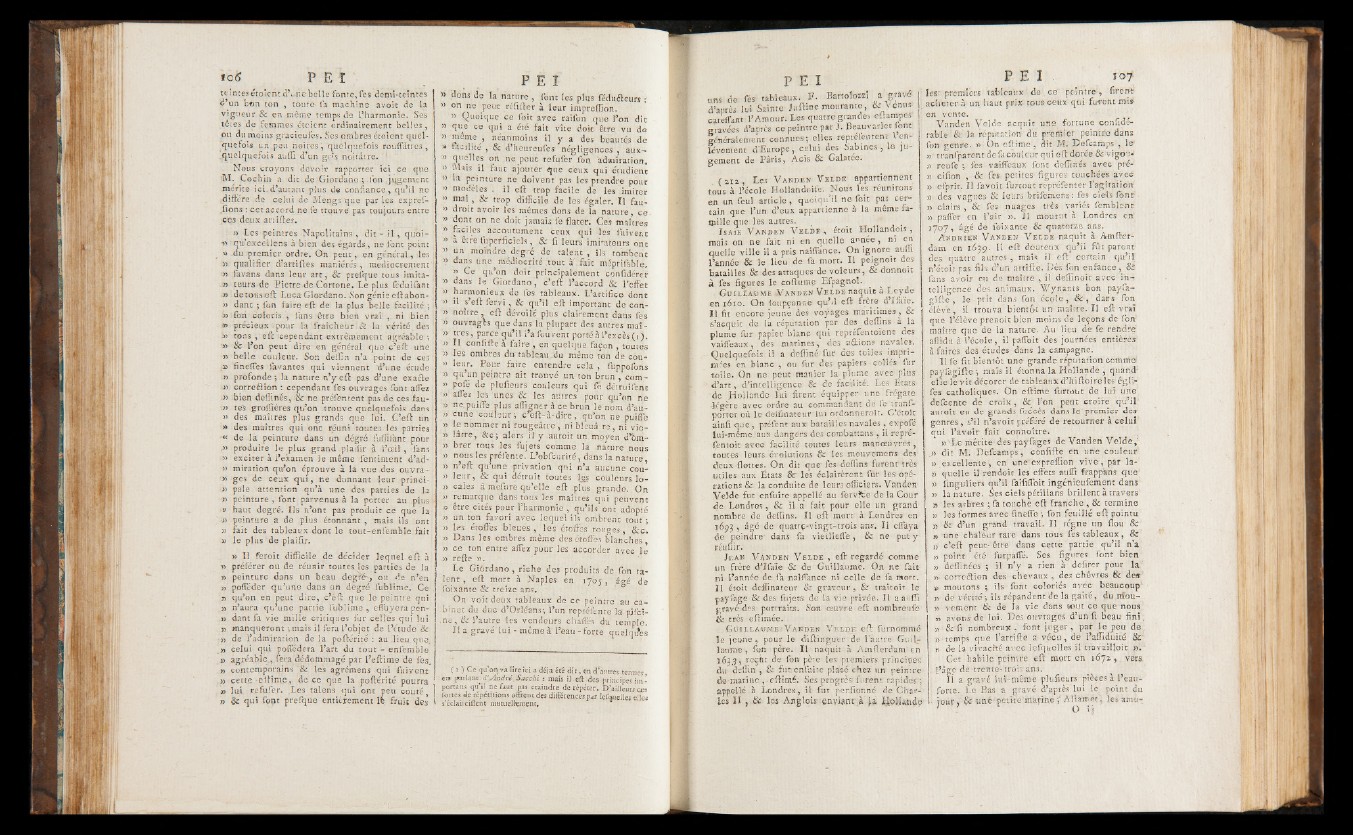
teintesétoient d’ une belle fonte, fes demi-teintes
ç ’ un bon ton , toute' la machine a voit de la
vigueur & en même temps de l ’harmonie. Ses
têtes de femmes etcicm ordinairement b e lle s ,
pu du moins gracieules. Ses ombres étoient quelquefois
un „peu noires, quelquefois rouffàtres ,
‘quelquefois au fil d’ un gris noirâtre. '
Nous croyons de'voiv rapporter ici ce que.
fM. Çoçhin- a dit de Giordano ; l’on .jugement
mérite ic i.d ’autant plus de confiance, qu’ il ne
.-différé de celui de Mengs que par Les expref-
.fions : cet accord ne fe trouve" pas toujours entre
ces deux arttff.es.
» Les peintres Napolitains , dit - il , quoi-
■ » ' qiiîaxcellens à bien des égards , ne font point
» du premier ordre. Gn peut, en généraL, J es
» qualifier d’artiftes maniérés , médiocrement
» favâns dans leur art, & prefque tous imita-
» tetirs de Pierre de Cortorie. Le plus féduifant
>» detous.eft Luca Giordano. Son génie eftabon-
» dant ; fon faire eft de la plus belle facilité -,
;» fon coloris., lans être bien vrai , ni bien
» précieux .-.pour la fraîcheur. & la vérité des
I» tons , eft cependant extrêmement agréable -,
» & l’ on peut dire'en général que c’eft une
■ » belle couleur. Son delîin n’a point de ces
» fineffes lavantes qui viennent d’ une étude
» profonde ; la nature n’ y eft pas d’une exacte
correétion : cependant fes ouvrages font affez
-» bien delîin es, & ne préfëntent pas de ces fau-
-» tes groflières qu’on .trouve quelquefois dans
» des maîtres plus grands que lui. C’eft un
» des maîtres qui ont réuni toutes, les parties
-« de la peinture dans un degré fuffîfant pour
,» produire le plus grand plaiîir à l’oeil , :lâns
» exciter à i’ examen le même fentiment d’ ad-
» miration qu’on éprouve à la vue des ouvra-
» ges de ceux qui , ne donnant leur princi-
» pale attention qu’ à une des parties de la
» peinture, font parvenus à la porter au plus
» haut degré. Ils n’ont pas produit ce que la. 3» peinture a de plus étonnant , mais ils ont
» fait des tableaux dont le tout-enfembîe fait
» le plus de plaiîir.
» Il feroit difficile de décider lequel eft à
« préférer ou de réunir'toutes les parties de la
» peinture dans un beau degrés ou de n’en
» pofféder qu’ une dans un degré fublime. Ce
» qu’on en peut dire, c’èft que le peintre qui
» n’aura qu’ une partie fublime, effuyerapen-
» dant fa vie mille critiques fur celles qui lui
» manqueront •, mais il fera l’objet de l’étude &
•» de l’admiration de la poftérité : au 'lieu.que.
» celui qui pofféder a l’art du tout - enfemble
» agréable., fera dédommagé par l’eftime de fes.
» contemporains & les agrémens qui ftiiyenc
.» cette -eftime, de ce que la poftérité pourra
» lui refufer. Les talens qui ont peu coûté,
» & qui font prefque entièrement 1% fruit des
» Hons de la nature , font les plus féduéleurs ;
» on ne peut réfifter à leur impreffion.
» Quoique^ ce foit avec railon que l’on dit
» que ce qui a été fait vîte doit être vu de
» même , néanmoins il y a des beautés de
* facilité d’heureufes négligences , aqx-
» quelles on .ne peut refufer fon admiration.
» Mais il faut ajoutèr que ceux qui étudient
» la peinture ne doivent pas les prendre pour
» modèles . il eft trop facile de les imiter
» mal , & trop difficile de les égaler. Il fan-
» droit avoir les mêmes dons de la nature, ce-
» dont on ne doit jamais fe flater. Ces maîtres
» faciles accoutument ceux qui les fuiver.c
» à être luperficiels, & fi leurs imitateurs ont
” un moindre degré de talent , ils tombent
» dans une médiocrité tout à''fait méprifable,
» Ce qu’on doit principalement confidérer
»5 dans le Giordano, c’ eft l’accord & reffet
» harmonieux de les tableaux. L’artifice- dont
» il s’eft fe rv i, & qu’ il eft important de con-
» noître, eft dévoile plus clairement dans fes
M ouvrages que dans la plupart des autres maî-
» très, parce qu’ il l’ a fou vent porté à l’ excès ( i) .
» U. confifte à faire , en quelque, façon , toutes
)} l gs ombres du tableau-du même ton de cou-
» leur. Pour faire entendre cela , luppofons
f qu’un peintre ait trouvé un ton brun , corn-
» pofé de plufieurs couleurs qui fn détruifenc
» affez 1rs unes 8c les autres pour qu’on ne
»: ne.puiffe plus affigner à ce brun le nom d’au-
» cune couleur •, c*eft-à-dire, qu’on ne puiffe
» le nommer ni rougeâtre , ni bleuâ r e , ni vic-
» litre , &c; alors il y auroit un moyen d’bm-
» brer tous les fujers comme la nature nous
» nous les préfente. L’obfcurité, dans la nature
» n’eft qu’une privation qui n’ a aucune cou-
» leur , & qui détruit toutes des couleurs lo-
» cales à mefnre qu’elle eft plus grande. On
» remarque dans tous les .maîtres qui peuvent
» être cités pour l’harmonie , qu’ ils ont adopté
» un ton favori avec lequel ils ombrent tout •
» les étoffes bleues, les éroffes rouges, & c .
» Dans les ombres même des étoffes blanches
» ce ton entre affez pour les accorder avec le
refte .
Le Giérdano , riche des produits de fon talent
, eft mort à Naples en 1705 , âgé de
foixànte & treize ans.
On voit deux tableaux de ce peintre au cabinet
du duc d’Orléans -, l’un’représen te la pifei-
>n e , & l’autre les vendeurs chaffés du temple.
I l a gravé lui - même à l’eau - forte quelques
| | ) Ce qu’on va lire ici a déjà été d it , en d’autres termes,
ci» parlant^ d’André. Sacchi : mais il eft des principes iin-
portans qù*il ne Faut pas craindre de répéter. D ’ailleurs qw
fortes de répétitions offrent des différences pur lefouelles elle«
s’éclairciflent mutuellement.
uns de fés tableâux. F. Banoloiri a gm #
d’après lui Sainte Juftine mourante, & Venus'
careffant l’Amour, te s quatre grandes eltampes
gravées d’après ce peintre par J. Beauvarlet font!
généralement connues; elles reprelentenr 1 en-
lévement d'Europe, celui des babines , le jugement
de Pâris, Acis & Galatée.
(2,12, Les V AND EN Velde appartiennent
tous à l’école Hollandoife. Nous les réunirons
en un leul article , quoiqu il ne foit pas certain
que l’un d’eux appartienne a la meme famille
que les autres.
Isaïe V anben V ei.d e , étoit Hollandais,
mais on ne fait ni en quelle année, ni en
quelle ville il a pris.naiffance. On ignore aulli
l’année & le lieu dé fa mort. I l peignost des
batailles & des attaques-de voleurs, & donnoit
à fes figures le coftume Efpagnol.
Guillaume ^ anden Velde naquit à Leyde
en 1610. On (bupçonnè qu’ il eft frere d’Ifaïe.
I l fit encore jeune des voyages maritimes , 8c
s’acquit de la réputation par des deflins à la
plume fur papier blanc qui reprefentoient des
vaiffeaux, des marines, des a étions navales.
Quelquefois il a deffir.é fur des toiles imprimées
en blanc , ou fur des papiers collés fur
toile. On ne. peut manier la plume avec plus
d’art, dIntelligence & de facilité. Les Etats
de Hollande lui firent équipper une frégate
-Légère avec ordre au commandant de fe tranf-
porter où le deffinateur lui ordonneroit. C’étoit
ainfi qùê j préfent aux batailles navales , expofé
iui-meme 'aux dangers des combattans , il repré-
(entoit avec facilité toutes leurs manoeuvres ,
toutes leurs évolutions & les méiivemens des
deux flottes. On dit que' fes deflins furent' très
utiles aux États & les éclairèrent fur les opérations
& la conduite de leurs officiers. Vanden
Velde fut enfuite appellé au fervfce de la Cour
de Londres , & il a fait pour elle un grand
nombre de deflins. I l eft mort à Londïes en
3 , âgé de quattç-vingt-trois ans. I l effàya
de peindre' dans fa v ieilleffe, & ne put y
réuuir.-
Jean V anden Velde , eft regardé comme
un frère d’Ifaïe & de Guillaume. On ne fait
ni l’année de fa naiffance ni ce lle de fa mort.
I l étoit deflinateur & graveur, & traitoit le
payfàge & des fujets de la vie privée. Il a aufîi
gravé des portraits.1 Son oeuvre eft nombreafé
8c très.-eftîmée.':
GûillaujvlecV anden V elde eft furnommé
le jeune, pour le diftinguer de l ’autre Guil^
laume , fon père. Il naquit à- Amfterdam: en
Ï633, reçût de fbn père les premiers principes
du deffm , .& fut:enfuite placé chez un peintre
de marine-,-eftimé. Ses progrès! furent rapides:-,
appelle à Londres, il fut penfionné de Charles
II , & les Anglois-;enviônr.à hollande
lesr premiers- tableaux de , ce peintre , firent
acheter à un haut prix tous ceux-qui furent mis-
en vente.
Vanden Velde acquit une fortune confide-
rable & la réputation du premier peintife dans
fon trente. » On eftime, dit M. Defcamps , le*
»' trahfparent de fa couleur qui eft dorée 8é vigo’.)-
» reûfe ; fes vaiffeaux font deffinés avec pré-
» cifion , 8c fes petites figures touchées avec
» efDrir. Il fa voit furtout rc-préfenter I’agitatioff
» des vagues & leurs brifemens: fës cieLs font-'.
» clairs, 8c fes nuages très variés femblent
» paffer en l’air ». I l mourut à Londres en
1707, âgé de foixante & quatorze ans.
A nd rien Vanden V elde naquit à Amftër-
dam -en 1639. Il eft douteux qu’ il fût parent-
des quatre autres , mais il eft certain qu’ il:
n’étoit pas fils d’ un artifte. Dès fon enfance, 8t
: fans avoir eu de maître , il deflinoit avec in-
■ tclligence des. animaux. Wynar.ts bon payfa-
i g i f le , le prit dans fon école , & , dans fon
élève, il trouva bientôt un maître. Il eft vrai
que l ’élève prenoit bien moins de leçons de fon-
maître que de la naturé. Au lieu de fe rendre
aflïdu à l’école, il paffoit des journées entières-
àfaires des études, dans la campagne.
Il fe fit bientôt une grande réputation comme1
payfagifte mais il étonna la Hollande , quand-
elle le v it décorer de tableaux d’hiftoire les égli-
fes catholiques. On eftime furtout de lui une
defeente de croix , & l’on peut croire qu’ il
auroit eu de grands fuccès dans le premier des
genres , s’ il n’avoit préféré de retourner à celui
qui l’avoir fait connoître.
» 'L e mérite des payfages de Vanden Velde,"
.» dit M. Defcamps , confifte en une couleur
» excellente:, en uneexpreflion v iv e , par la-
» quelle il rendoit les effets aufll frappans que
» fmguliers qu’ il faififfoit ingénieufement dans
» la nature. Ses ciels pétillans brillent à travers
» les arbres ; fa touche eft franche , & termine
» les formes avec fineffe -, fon feuillé eft pointu
» & d’un grand travail. Il régne un flou 8c
y» une chaleur rare dans tous les tableaux, &
» c’eft peut: être dans cette partie qu’ il n’a
» point été furpaffé. Ses figures font bien
» deffmées ; il n’ y a rien à defirer pour la
n correélion des chevaux , des chèvres 6c de«
» moutons ; ils font coloriés avec beaucoup'
» dé vérité ; ils répandent de la gaité, du nfou-
» vement & dé la vie dans tout ce que nous
s, avons de lui. Des ouvrages d’ un fi beau fini,
„ & fi nombreux, font ju g e r , par le jie u de
» -temps que l’artifte a v é cu , de l’ afliduité 8c
» de la vivacité avec lefcjuelles il travaiftoit ». '
Cet habile peintre eft mort en 1672-,. vers,
ftâge dé trent-eT trois ans.
Il a gravé lui-même plufieurs pièces à l’eau-
forte. Le Bas a gravé d’après .lui le. point du
i o ù r 8c uné-petlte'iiiàrme f Aîiamet, le i amu-
J ’ O ij