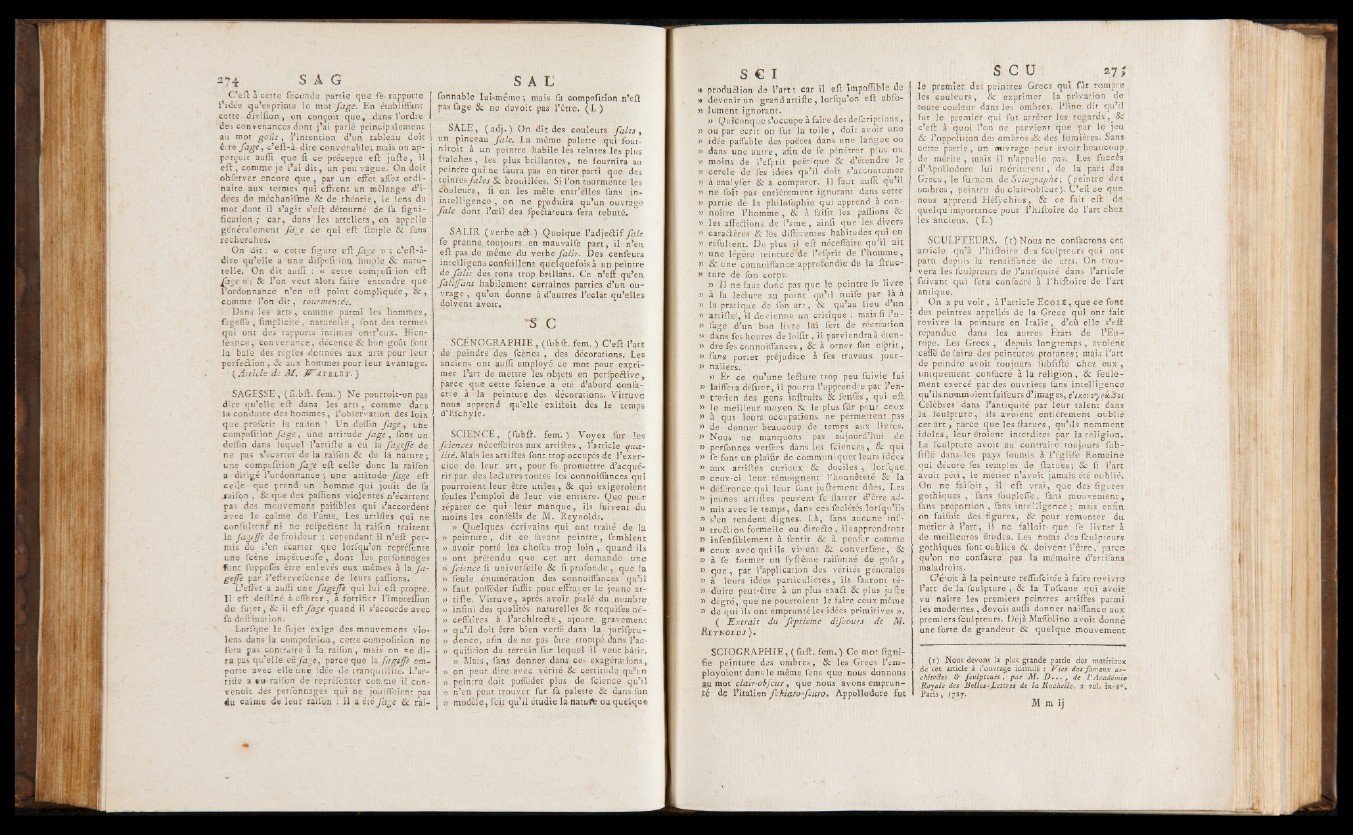
*74 SA G
C ’eft à cette fécondé partie que fe' rapporte
l’ idée qu’exprime le mot fa g e . En établiffant
cette divifion, on conçoit que, dans l’ordre
des convenances dont j’ai parlé principalement
au mot g o û t , l’ intention d’ un tableau doit
être fage ^ c’eft-à- dire convënable*, mais on ap-
perçoic aufii que fi ce précepte eft ju fte , il
eft , comme je l’ai d it, un peu vague. On doit
obferver encore que , par un effet affez. ordinaire
aux termes qui offrent un mélange d’ idées
de méçhanifme & de .théorie, le lens du
mot dont il s’agit s’eft détourné de fa lignification;
car, dans les atteliers, on appelle
généralement fage ce qui eft fimple & fans
recherches.
On dit : « cette figure eft fage » •, c’eft-à-
dire qu’ elle a une difpofirion fimple & naturelle.
On dit aulfi : « cette compofi'ion eft
fage-n\ & l’on veut alors faire entendre que
l’ordonnance n’en eft point compliquée, & ,
comme l’on d i t , tourmentée. '
Dans les arts, comme parmi les hommes,-;
fig e fle , {implicite, naturelle, font des termes
qui ont des rapports intimes entr’eux. Bien-
feance, converance, décence & bon goût font
la bafe des régies données aux arts pour leur
perfection , & aux hommes pour leur avantage.
{Article dz M . ^ a t e l e t . )
SAGESSE, (fubft. fem7) Ne pourroit-on pas
dire qu’elle eft dans les arts , comme dans
la conduite des hommes, l’obfervation des loix
que prefcrit la railbn? Un deflin fa g e , uhe
coinpofition fa g e , une attitude fa g e , font un
deffin dans lequel l’artifte a eu la fagejje de
ne pas s’écarter de la raifon & de la nature ;
une compofition fage eft celle dont la raifon
a dirigé l’ordonnance -, une attitude fage eft
celle que prend un homme qui jouit de fa
«aifon , & que des pallions violentes n’écartent
pas des mouvemens paifibles qui s’accordent
avec le calme de l’ame. Les artiftes qui ne
confièrent ni ne refpeélent la raifon traitent
la fagejje de froideur : cependant il n’ eft permis
de s’ en écarter que lorfqu’on repréfente
une fcène impétueufe, dont les perfonnages
font fuppofés être enlevés eux mêmes à la fa -
geffe par l ’effervefcence de leurs pallions.
L’effet a aulfi une fagtffe qui lui eft propre.
11 eft deftiné à affûter, a fortifier l’imprelfion
du fujet, & il eft fage quand il s’accorde avec
fa deftination.
Lorfque le fujet exige des mouvemens v io -
lens dans la compofition, cette compofition ne
fera pas contraire à la raifon , mais on ne dira
pas qu’elle e&fage, parce que la fagejfe emporte
avec elle une idée de tranquillité. L’ar-
tiile a eu- raifon de repréfenter cor. me .11. con-
venoit des perfonnages qui ne jouiffoient pas
éu calme de leur railbn : il a été fage & rai-
S A L
fonnable lui-même ; mais fa compofition n’eft
pas fage & ne devoit pas l’ être. (L )
SALE, ( adj. ) On dit des couleurs fa le s ,
un pinceau f i le . La même palette qui fournirent
à un peintre habile les teintes les plus
fraîches, les plus brillantes, ne fournira au
peintre qui ne laura pas en tirer parti que des
teintes fales & brouillées. Si l’on tourmente l.es
couleurs, fi on les mêle entr’èlles fans inintelligence
, on ne produira qu’un ouvrage
fa le dont l’oeil des fpectâteurs fera rebuté.
SALIR (verbe aft.) Quoique l’adjeéiiffale
fe prenne toujours en mauvaife part, il n’en
eft pas de même du verbe falir. Des cenfeurs
intelligens conieillent quelquefois à un peintre
de fa lir dès tons trop brillans. Ce n’eft qu’ en
falijfant habilement certaines parties d’ un ouvrage
, qu’on donne à d’autres l ’éclat qu’elles
doivent avoir.
*s c
SCÉNOGRAPHIE, (fubft. fem. ) C’eft l’ art
de peindre des fcènes , des décorations. Les
I anciens ont aulfi employé ce mot pour expri-
; mer l’art de mettre les objets en perfpe&ive,
I parce que cette feienoe a été d’abord -çonfa-
crée à la peinture des décorations. Vitruve
noua apprend qu’elle ‘ exiftoit dès le temps
d’Efchyle.
SCIENCE, (fubft. fern'.) Voyez fur les
fciences néceffaires aux artilies , l’ar.fîcle qualité.
Mais les artiftes font trop occupés de l’exercice
de leur art, pour fe promettre d’acquérir
par des lectures toutes les connoiffances qui
pourroient leur être utiles, & qui exigeroient
feules l’ emploi de leur vie entière. Que pour
réparer ce qui leur manque, ils fui vent du
moins les conféils de M. Reynolds. .
» Quelques écrivains qui ont traité de la
» peinture, dit ce lavant peintre-, femblent
» .avoir porté les chofes trop loin , quand ils
,» ont prétendu que cet art demande une
» feience fi univerfelle & fi profonde , que la
» feule énumération des connoiffances qu’ il
» faut pofféder fuffit pour effrayer le jeune ar-
» tifte. Vitruve , après avoir parlé du nombre
» infini des qualités naturelles & requifes né-
» ceffaires à l’architeête, ajoute gravement
» qu’il doit être bien verl’é dans la jurifpru-
» dence, afin de ne pas être trompé dans l’ac-
» quifirion du terrein fur lequel il veut bâtir,
» Mais, fans donner dans ces exagérations,
» on peut dire avec vérité & certitude qu’ un
» peintre doit pofféder plus de fcience qu’ il
>v n’eft peut trouver fur fa palette & dans.fon
» modèle, fo.it qu’ il étudie la nature ou quelque
» production de l’art: car il eft ïmpofiibîe de
» devenir un grand artifte , lorfqu’on eft abfo-
» Jument ignorant.
» Quiconque s’occupe à faire des deferiptions,
» ou par écrit ou fur la to ile , doit avoir une
» idée paffable des poètes dans une langue ou
» dans une autre, afin de fe pénétrer plus ou
» moins de l’ efprit poétique & d’étendre le
» cercle de fes idées qu’ il doit s’accoutumer
» à analyfer & à comparer. I l faut aulfi qu’ il
» ne foit pas entièrement ignorant dans cette
» partie de la philolophie qui apprend à con-
» noître l’ homme , & à faïfir les pallions &
» les affeéfions de l’ame, ainfi que les divers
» caractères & les différentes habitudes qui en
» réfultent. De plus il eft néceffaire qu’ il ait
» une légère teinture^de l’efprit de l’ homme,
» & une connoiffance approfondie de la ftruc-
» ture de fon corps;
» Il ne faut donc pas que le peintre fe livre
» à la leêlure au point qu’ il nuife par la a
». la pratique de fon art, & qu’au lieu d’un
» artifte), il devienne un critique -, mais fi i’ u-
» fage d’un bon livre lui fert de récréation
». dans fes heures de loifir , il parviendra à éten-
» dre fes connoiffances, & a orner for. efprit,
» fans* porter préjudice à fes travaux jour-
» n ali ers. ~
» Er ce qu’ une leêture trop peu fuivie lui
» laiffera délirer, il pourra l’apprendre par l’ en-
» tretien des gens inftruits ' & lenfés, qui eft
» le meilleur moyen & le plus fûr pour ceux
» à qui leurs occupations ne permettent pas
» de donner beaucoup de temps aux livres.
» Nous ne manquons pas aujourd’hui de
» perfonnes verfées dans les fciences, & qui
» fe font un plaifir de communiquer leurs idées
» aux artiftes curieux & dociles , lorfque_
» ceux-ci leur témoignent l’honnêteté & la
» déférence qui leur l’ont juftement dû es. Les
» jeunes artiftes peuvent fe flatter d’ être ad^
» mis avec le temps, dans ces fociétés lorfqu’ils
» s’en rendent dignes. Là, fans àucune irif-
» truêlion formelle ou direde , ils apprendront
» infenfiblement à fentir & à penfer comme
» ceux avec qui ils virent & converfent, &
» à Te former un fyftême raifonné de goû t,
-» q u e , par l’application des vérités générales
» à leurs idées particulières, ils fauront ré-
» du ire peut-être à un plus exà£t & plus jufte
» degré, que ne pourroient le faire ceux même
» de qui ils ont emprunté les-idées primitives ».
( Extrait du feptieme difeours de M.
R e y n o l d s ),
SCIOGRAPHIE, ( fuft. fem.) Ce mot figni-
fie peinture des ombres, & les Grecs l’em-
ployoîent dans le même fens que nous donnons
au jnaot clair-obfcur, que nous avons emprunté
de l’ italien fcftio.ro feuro, Appollodore fut
le premier, des peintres Grecs qui fût rompre
les couleurs, & exprimer la privation de
toute couleur dans les ombres. Pline dit qu’ il
fut le premier qui fut arrêter les regards, ^
c’eft à quoi l’on ne parvient que par le jeu
& l ’oppofition des ombres .& des lumières. Sans
cette partie, un ouvrage peut avoir beaucoup
de mérite , mais il n’appelle pas. Les fuccès
d’ Apollodore lui méritèrent, de la part des
Grecs, le fürftom de Sciogmphe; (peintre des
ombres , peintre du clair-obfcur). C ’ eff ce que
nous apprend Héfychius, & ce fait eft de
quelqu importance pour l’hiftoire de l’arc chez
les anciens. (L )
SCULPTEURS, ( i) Nous ne confacrons cet
arricle qu’à l’hiftoire des fculpteurs qui ont
paru depuis la renaiffance de arts. On trouvera
les fculpteurs de l’antiquité dans l’article
fuivant qui fera confacré à l ’ iiiftoire de l’art
antique.
On a pu v oir , à l’article Ë c o tÉ , que ce font
des peintres appelles de la Grece qui ont fait
revivre la peinture en Italie , d’ où elle s’eft
répandue dans les autres Etats de l’Europe.
Les Grecs , depuis longtemps , avoient
ceffé de faire des peintures profanes; mais l ’art
de peindre avoit toujours lubfifté chez eux ,
uniquement confacré à la religion, & feulement
exercé par des ouvriers fans intelligence
qu’ ils nommoierit faifeurs d’images, e utovcyç&Sroi
Célèbres dans l’antiquité par leur talent dans
la fculpture, ils avoient entièrement oublié
cet art , parce que les ftatues , qu’ils nomment
idoles, leur étoienc interdites par la religion.
La fculpture avoit au contraire toujours fub-
fifté dansées pays fournis- à l ’églife Romaine
qui décore fes temples, de ftatues ; & fi l’art
avoit péri, le métier n’avoit jamais été oublié.
On ne fai foit , il eft vrai, que des' figures
gothiques , fans foupleffe, fans mouvement,
fans proportion, fans intelligence ; mais enfin
on faifoit des figures, & pour remonter du
métier à l’art, il ne falloir- que fe livret à
de meilleures études. Les noms des fculpteurs
gothiques font oubliés & doivent l’être ,* parce
qu’on ne confacré pas la mémoire d’artifans
maladroits.
C’étoit à la peinture reffufeitée à faire revivre
l’art de la fculpture , & la Tofcane qui avoit
vu naître les premiers peintres artiftes parmi
les modernes , devoit aulfi donner naiffance aux
premiers fculpteurs. Déjà Maffolino avoit donné
une forte de grandeur, & quelque mouvement
(i) Nous devons la plus grande partie des matériaux
de cet article à l’ouvrage intitulé : Vies des fameux architectes
& fculpteurs, par M. D ... , de VAcadémie
Royale des Belles-f.ettr.es de la Rochelle. 2 vol. in* s®,
Paris, 1787.
M m ij