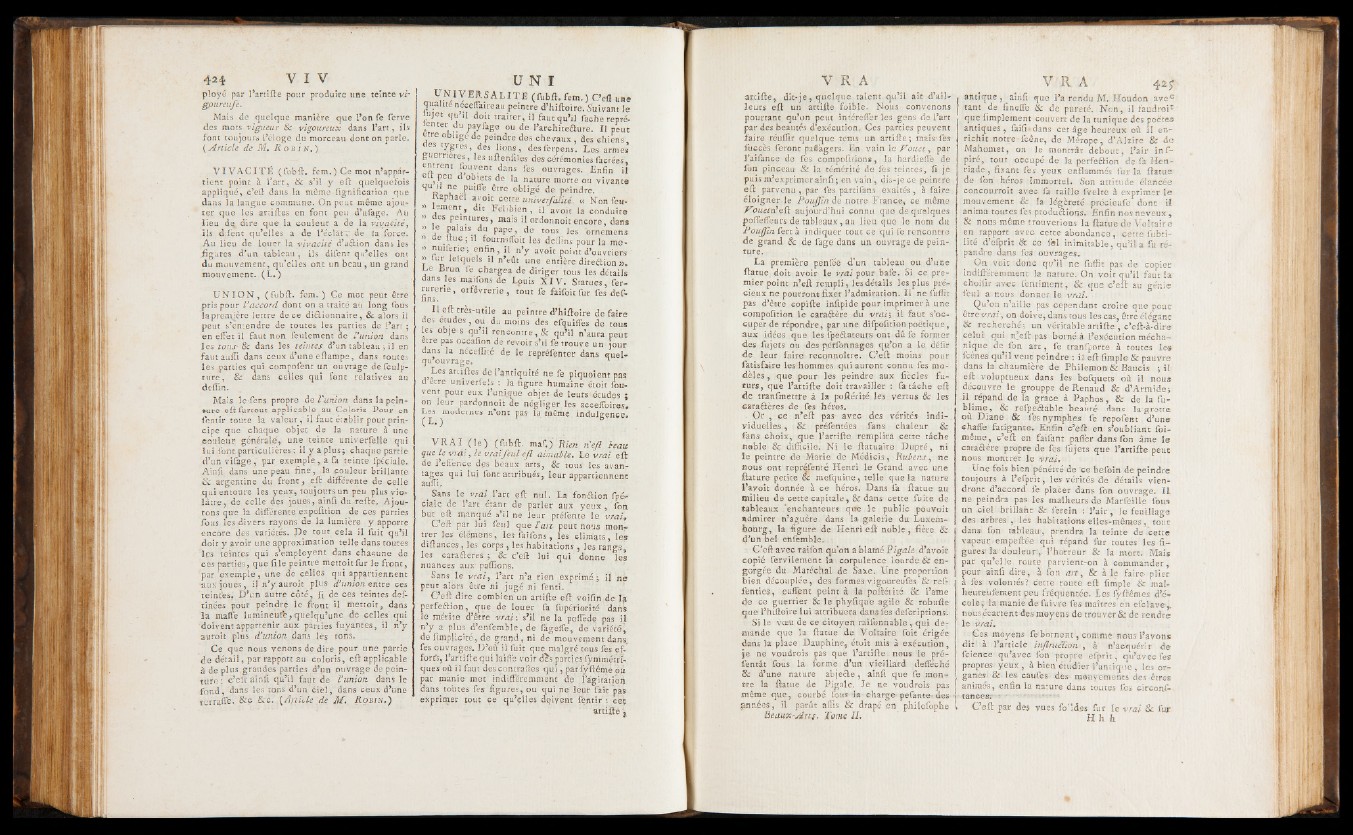
ployé par l ’artifte pour produire une teinte vi- gpureuje.
Mais de quelque manière que l’on fe ferve
des mots vigueur & vigoureux dans l’ar t, ils
font toujours l’éloge du morceau dont on parle.
( Article de M. R obi n. )
V I V A C I T É (fubft. fem.) Ce mot ^appartient
point à l’art, & s’ il y eft quelquefois
appliqué, c’eft dans la même lignification que
dans la langue commune. On peut même ajouter
que les arriftes en font peu d’ ufage. Au
lieu de, dire que la couleur a de la vivacité,
ils d:fent qu’elles a de ré c îa r r de la force.
Au lieu de louer la vivacité d’aélion dans les
.figures d’ un tableau, ils difenr qu’elles ont
du mouvement, qu’ elles ont un beau, un grand
mouvement. ( L. )
U N IO N , ( fubft. fem .) Ce mot peut être
pris pour Vaccord dont on a traité au long fous
la première lettre de ce diélionriaire, & alors il
peut s’entendre de toutes les parties de l’ art •
en effet il faut non feulement de l’union dans
les tons- & dans les teintes d’ un tableau -, il en
faut aufîi dans ceux d’ une eftampe, dans toutes
les parties qui compofent un ouvrage de fculp-
tiire , & dans celles qui font relatives au
deflin.
Mais ledens propre de Vunion dans la peinture
e II fur tout applicable au Coloris Pour en
feniir toute la valeur, il faut établir pour principe
que chaque objet de la nature à une
couleur générale, une ’teinte univerfelle qui
lui font particulières-: il y a plus; chaque partie
d’ un v ifa g e , par exemple, a fa teinte fpéeiale.
Ain fi. dans une peau fine, la couleur brillante
& argentine du front y ,eft différente de celle
qui entoure les yeux, toujours un peu plus violâtre,
de celle des joues, ainfi. du refte. Ajoutons
que la différente expofition de ces parties
fous les divers rayons de la lumière y apporte
encore des variétés. De tout c.ela il fuit qu’il
jdoit y avoir une approximation telle dans toutes
les teintes qui s’employent dans chacune de
ces parties, que file peintre metroitfur le front, <
par exemple, une de celles qui appartiennent
•aux joues, il n’y auroit plus d’union entre çes
teintés. D’ un autre côté, fi de ces teintes défi
tinées pour peindre le front il mettoit, dans '
la malle îumineuiVj, quelqu’ une de celles qui
doivent appartenir aux parties fuyantes, il n’y
auroit plus d’union .dans lè$ tons.
Ce que nous venons de dire pour une partie
de détail, par rapport au coloris, eft applicable
à de plus,grandes parties d’ un ouvrage de peinture
: ç’eft ainfi qu’ il faut de l’union dans le
fond, dans les tons d’ un c ie l, dans ceux d’une
terraffe. &P & g. (Article de M. Robin,)
U N IV E R S A L I T É (fubft. fem .) C’eft une
qualité neceffaireau peintre d’hiftoire. Suivant Je
îujec qu il doit traiter, il faut qu’il fâche repré-
îenter du payfage ou de.-l’architeâûre. Il peut
etre oblige de peindre des chevaux , des chiens
es tyj|!es, des lions, desferpens. Les armes
guerrières, les uftenfiles des cérémonies facrées,
e" trent jouyent dans fes ouvrages. Enfin il
elt peu d obiets de la nature morte ou vivante
S H puifle être obligé de peindre.
aphaël à vo i t cette univerfalité. « Non feu-
» -ment, dit Fëlibien , il avoit la conduite
» es peintures, mais il ordonnoit encore, dans
» le palais du pape, de tous les ornemcns
» de ltuç ; il fourni floit les deffins pour la me-
» nuiferie; enfin, il n’y avoit point d’ouvriers
j Ieicjuels il n’eût une entière direétion ».
Le brun lé chargea de diriger tous les détails
dans les maifons de Louis X I V . Statues, fer-
rurene, orfèvrerie, tout fe faifoic fur fes defi
lins.
I l eft trçs-utile au peintre d’hiftoire de faire
des études, ou du moins des efquifles de tous
les objets qu’ il rencontre, & qu’ il n’ aura peut
etre pas occafion de revoir s’ il fe trouve un jour
dans la necefficé de le repréfçnter dans quefi
qu ouvrage. ^
Les arciftes de l’antiquité ne fe piquoient pas
d erre universels : la figure humaine étoit. fou-
vent pour eux {’unique objet de leurs études ;
on leur pardonnoit de négliger les acceffoires#
Les modernes n’ont pas la même indulgence.
( L; )'
V R A I ( l e ) ( fubft. maf.) Rien lie jl beau
qiie le vrai, le vrai feu l efl aimable. Le vrai eft
de l’efïënce des beaux arts, tous les avantages
qui lui font attribués, leur appartiennent
aufli,
Sans le vrai l’art eft nul. La fon&ion fpé-
ciale de l ’art étant de parler aux yeux , fou
but efl manqué s’ il ne leur préfente le vrai9
C’ eft par lui feul que Vart peut nous monr
trer les élépieris, les laitons , les climats., les
diflances, les corps , les habitations , les rangs,
les carafteres ; & ç’eft lui qui donne les
nuances aux- pallions.
Sans le vrai, l’ art n’a rien exprimé ; il ne
peut alors être ni jugé ni fenti.
C’ eft dire combien un artifte eft voifin de la
perfeélïon, que de louer fa fupériorité dans
le mérite d’être vrai : s’il ne la poffède pas il
n’y a plus d’enfemble, de flgefte, de variété",
de {implicite, de grand, ni de mouvement dans
fes ouvrages. D’où il fuit que malgré tous fes efi
fortfs, l’artifte qui laifle voir d£s parties fÿmmétVi-
ques où il faut des çontraftes q u i, par fyftêmè ou
par manie met indifféremment de l’âgitâtiqfi
dans toutes fes figures, ou qui ne leur fait pas
exprimer tout ce qu’elles doivent fentir': cèç
artifte
artifte, dit-je, quelque talent qu’il ait d’ailleurs
eft un artifte foible. Nous convenons
pourtant qu’on peut intéreffer les gens de l’art
par des beautés d’exécution, Ces parties peuvent
faire réuffir quelque tems uia artifte; mais-fes
fuccès feront paflagers. En vain le Vou e t, par
l’aifance de fes compofitions, la hardieffe de
fon pinceau & la témérité de fes teintes, fi je
puis m’ exprimer ainfi ; en vain, dis-je ce peintre
eft parvenu , par les partifans exaltés, à faire
éloigner le Poiflin de notre France, ce même
Vouetré eR. aujourd’hui connu que de quelques
pofleffeurs de tableaux, au lieu que le nom du
Pouflin fert à indiquer tout ce qui fe rencontre
de grand & de fage dans un ouvrage de peinture.
La première penféé d’un tableau ou d’une
ftatue doit avoir le vrai pour bafe. Si ce premier
point n’eft rempli, les détails les plus précieux
ne pourrons fixer l’admiration. Il ne fuffit
pas d’être copifte infipîde pour imprimer à une
compofition le caraétère du vrai j il faut s’occuper
de répondre., par une difpofition poétique,
aux .idées que les fpeélateurs ont dû fe former
des fujets ou des pérfonnages qu’pn a le défir
de leur faire reconnoître. C’eft moins pour
fatisfa-i-re les hommes qui auront connu fes modèles
, que pour les peindre aux fiècles futurs,
que l’artifte doit travailler : fa tâche eft
de tranfmettre à la poftérité les vertus & les
caraélères de fes héros.
Or , ce n’eft pas avec des vérités in d i-.
v iduelles, & préfentées fans chaleur &
fans choix, que l’artifte remplira cette tâche
noble & difficile.. Ni le ftatuaîre Dupré , ni
le peintre de Marie de Médicis, Rubens, ne
nous ont repréfenté Henri le Grand avec une
ftature petite éc mefquine, telle que la nature
l ’a voit donnée à ce héros. Dans fa ftatue au
milieu de cette capitale, & dans cette fuite de
tableaux ’enchanteurs qifë le public pouvoit
admirer n’aguère. dans la galerie du Luxembourg,
la. figure de Henri eft noble, fière Sic
d ’un bel enfemble.
C ’ eft avec raifon qu’on a blâmé Pigale d’avoir
copié fervilemenc la corpulence lourde & ën-
gorgée du Maréchal de Saxe. Une proportion
bien découplée., des formes v.igoureufes & ref-
fenties , .euffent peint à la poftérité & l’ame
de ce guerrier & le phyfiquë agile & robufte
que l’hiftoire lui attribuera dans fes descriptions-
•; Si le voeu de ce citoyen râiibnnable , qui demande
que la ftatue de Voltaire foit érigée
dans la place Dauphine., étoit mis à exécution,
je ne voudrois pas que l ’artifte nous le pré-
lëntât fous la forme d’un vieillard defféché
& d’ une nature abjecte, ainfi que fe montre
la ftatue de Pigale, Je ne voudrois pas
même que, courbé fous la charge- pefanter des
années, il parût a (lis & drapé en philofophe
Beaux-Ans. Tome U.
* antique, ainfi que l ’a rendu M. Houdon avec
| tant finoffe & de pureté. Non, il faudroic
que fimpleinent couvert de la tunique des poètes
antiques , faifi dans cet âge heureux où il enrichit
notre-fcêne, de Mérope, d’Alzire & de
Mahomet, on le montrât débout, l’air in f-
pire, tout occupé de la perfeélïon de fa Hen-
riade, fixant fes yeux enflammés fur la ftatue
de fon héros . immortel. Son attitude élancée
concourroit avec fa taille fvelte à exprimer le
mouvement & la légèreté précieufe dont il
anima toutes fes produélions. Enfin nos n eveux,
& nous même trouverions la ftatue de Voltaire
en rapport avec cette abondance , cette fubti-
lité d’efprit & ce fel inimitable, qu’il a fu répandre
dans fes ouvrages.
On voit donc qu’il ne fuffit pas de copier
indifféremment la nature. On voit qu’il faut ia
choifir -avec fentiment, & que c’eft au génie
feul a nous donner, le vrai.
Qu’on n’aille pas cependant croire que pour
etre vrai, on doive, dans tous les cas, être élégant
& recherché ; un véritable artifte , c’eft-à-dire
celui qui n’eft pas borné à l’exécution mécha-
nique de fon arc, fe tran(porte à toutes le*
fcenes qu’ il veut peindre : il eft fimple & pauvre
dans la chaumière de Philemon. & fiaucis ; il
eft voluptueux dans les bofquets où il nous
découvre le grouppe de Renaud & d’Armide;
il répand de la grâce à Paphos, & de la fu-
blime, & refpeélâble beauté dans la grotte
où Diane & fes nymphes fe repofent d’ une
«haffe fatigante. Enfin c’eft en s’oubliant foi-
même, c’eft en faifant pafler dans fon âme le
caraâère propre de fes fu jets que l’artifte peut
nous montrer le vrai.
Une fois bien pénétré de ce befoin de peindre
toujours à l’efprit, les vérités de détails viendront
d’accord fe placer dans fon ouvrage. I l
ne peindra pas les malheurs de Marfèille fous
un ciel brillant & ferein : l’air , le feuillage
des arbres , les liabitations elles-mêmes, tout
dans; fon tableau^, prendra la teinte de cette
vapeur > empeftée qui répand fur toutes les figures*
la ’douleur ,- l ’horreur & la mort. Mais
par qu’elle, route parvient-on à commander,
pour ainfi dire, à fon art ^ & à le faire- plier
j à fes:-volontés? cette route eft fimple & mal-
; heureiifbment peu fréquentée. Les fyftêmes d’é-
! colby’la manie de fuivi-e fes maîtres en efclaveÿ
nolisécartent des moyens de trouver & de rendre
le Vrai.
G es moyens fe bornent, comme nous l’avons
d it‘ .à l’article infiruclion , à n’acquérir de
fçience qu’avec fon propre efprit, qu’avec fes
propres’ yeux , à bien étudier l’antique , les or-
ganesi & les caufes- des> mouvements des êtres
animes, enfin la nature dans toutes fes circon.fi-
ta-nce'sr ...
’ C ’eft par des vues fondes fur le vrai 8c fur
H h h.