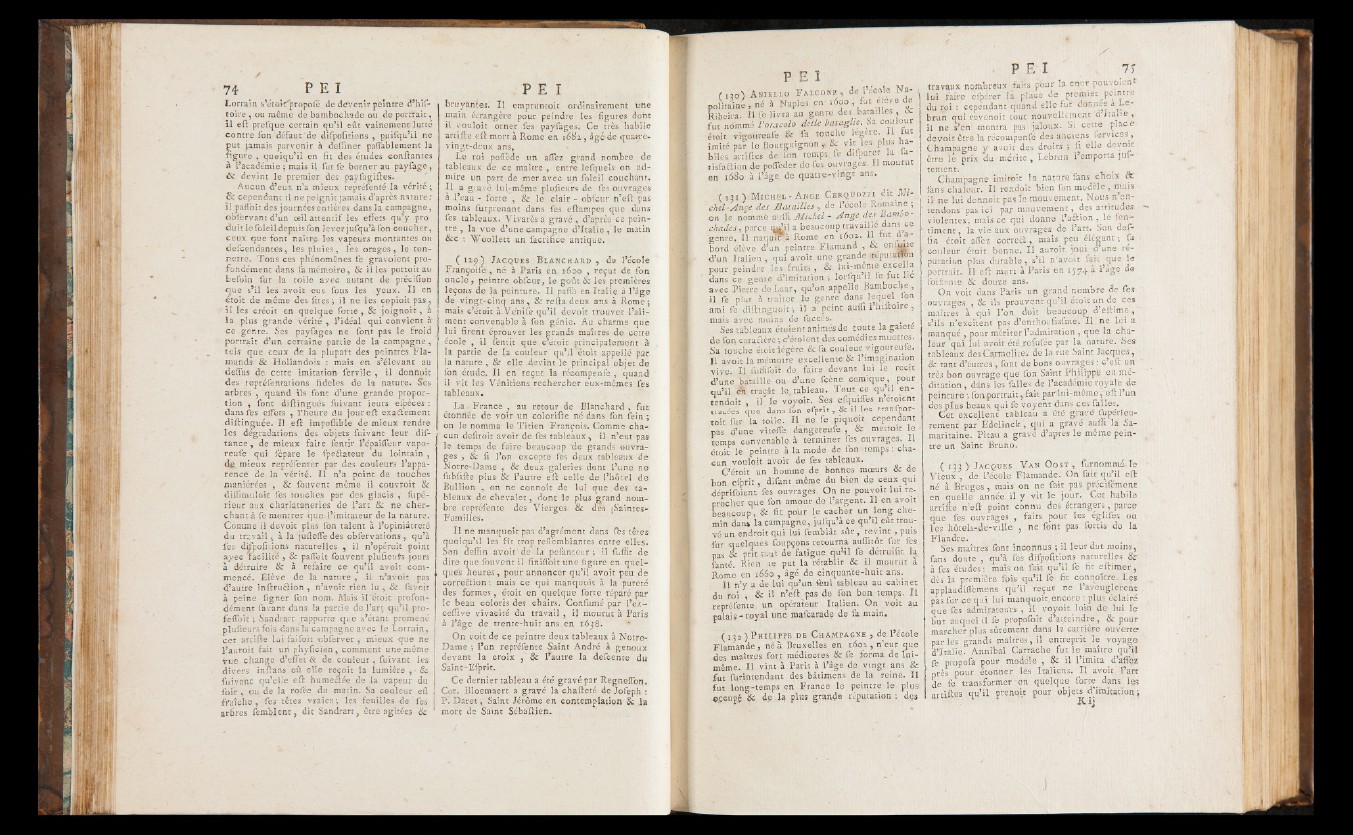
74 P E I
Lorrain s’étok'rpropofé de dévenir peintre d’hif-
toire , ou même de bambochade ou de portrait,
Il eft prefque certain qu’ il eût vainement lutté
contre Ton défaut de difpofitions , pjiifqu’ il ne
put jamais parvenir à defliner paflablement la
figure , quoiqu’ il en fit des études confiantes
à l’académie ; mais il fut fe borner au payfage,
& devint le premier des paÿfagiftes.
Aucun d’eux n’a mieux repréfenté la vérité ;
& cependant il ne peignit jamais d’après nature
jl pafloit des journées entières dans la campagne,
obiervant d’un oeil attentif les effets-.qu’y pro
duitlefoleildepuisfon lever jufqu’àfon coucher,
ceux que font naître- les vapeurs montantes ou
defcendantes, les pluies, les orages, le tonnerre.
Tous ces phénomènes fe gravoient profondément
dans fa mémoire, & il les portoit au
befoin fur la toile avec autant de précifion
que s’ il les avoit. eus fous les yeux. I l en
étoit de même des fîtes ; il ne les cepioit pas,
i l les créoit en quelque forte , & jo ign o it, à
la plus grande vérité , l’ idéal qui convient à
ce genre. Ses payfages ne font pas le froid
portrait d’un certaine partie de la campagne,
tels que ceux de la plupaft des peintres Flamands
& Hollandois : mais en s’élevant au
deffus de cette imitation fervile , il donnoit
des repréfentations fideles de la nature. Ses
arbres , quand ils font d’une grande proportion
, font diflingués fuivant leurs efpèces :
dans fes effets , l’heure du jour eft exactement
diftinguée. Il eft impoflible de mieux rendre
les dégradations des objets fuivant leur distance
, de mieux faire fentir l’épaifleur vapo- ,
reufe qui féparè le fpedateur du lointain ,
cfe mieux repréfenrer par des couleurs l ’apparence
de la vérité. I l n’ a point de touches
maniérées , & fouvent même il couvroit &
diffimuloit fes touches par des glacis , fupé-
rieur aux charlataneries de l’art & ne cherchant
à fe montrer que.l’imitateur de la nature. -
Comme il devoit plus fon talent à l’opiniâtreté
du travail , à la juftefle des obfervations , qu’à
ies difpofitions naturelles , il n’opéroit point
avec facilité , & pafloit fouvent plufieufs jours
à détruire & à refaire ce qu’ il avoit commencé.
Élève de la nature , i l n’a voit pas
d’autre inftruétion , n’avoit rien lu , & favoit
à. peine ligner fon nom. Mais il'étoit profondément
favant dans la partie dé l’art q-u’ il pro-
fefloit ; Sandrart rapporte que s’étant promené
plufieurs fois dans là campagne avec le Lorrain,
cet artifte lui faifoit obferver , mieux que né
l’auroit fait un phyficien, comment une même ,
vue change d’effet & de couleur , fuivant les
divers inftâns où elle reçoit la lumière , - &
fuivant qu’elle eft humectée de la vapeur du
fofr , ou de la rofée du matin. Sa couleur efl
fraîche , fes têtes vraies ; les feuilles de fes
arbres femblent, dit Sandrart, être agitées &
P E I
bruyantes. Il emprimtoit ordinairement une
| main étrangère pour peindre les figures dont
t il vouloit orner fes payfages. Ce très habile
artifte eft mort à Rome en i6 8 z , âgé-de quatre-
vingt-deux ans,
Le roi poflede un aflez grand nombre de
tableaux de ce maître , entré lefquels on admire
un port de mer avec un foleil couchant.
U a gravé lui-même plufieurs de fes ouvrages
à d’eau - forte , & le clair - obfcur n’eft pas
moins furprenant dans fes eftampes que dans
fes tableaux. Vivarès a gravé , d’après ce peint
r e , la vue d’ une campagne d’Italie , le matin
& c : Woollett un facrifice antique.
( 129) Jacques Blanchard , d@ l ’école
Françoifè), né à Paris en.,■ 1600 , reçut de fon
oncle 9 peintre obfcur, le goût & les premières
leçons de la peinture. Il pafla en Italie à l’âge
de vingt-cinq ans, & refta deùx ans à Rome ;
mais c’étoit. àV énife qu’il devoit. trouver l ’aliment
convenable à fon génie. Au charme que
lui firent éprouver les grands maîtres de cette
école , il fentit que c’étoit! principalement à
la partie de la couleur qu’ i l étoit appelle par
la nature , & elle -devint le principal objet de
fon étude. Il en reçut la fccompenfe , quand
il vit les Vénitiens rechercher eux-mêmes fes
tableaux.
La France , au retour de Blanchard, fut
étonriée de voir un coloriîle né dans fon foin;
on le nomma le Titien François. Comme chacun
defiroit avoir de fes tableaux il n’eut pas
le .temps de faire-beaucoup de grands ouvrages
, & fi l’on excepte fes deux tableaux de
Notre-Dame ,■ & deux^ galeries dont l ’ une ne
fubfifte plus & l’autre eft celle de l’hôtel de
Bullion , on ne connoît de lui que des tableaux
de chevalet, dont le plus grand nombre
repréfente des Vierges & des {Saintes-
Fainilles. _ -
Il ne manquoit pas d’agrément dans fes têtes
quoiqu’ il les fît trop reflèmblarites entre elles.
Son deflin avoit’ de la pefanteur ; il fuffit de
dire que fouvent il finifloit une figure en qüel-
qués heures , pour annoncer qu’ il avoit peu de
correction : mais ce qui manquoit à la pureté
des formes, étoit en quelque forte réparé par
le beau coloris des chairs. Confumé par l’ex-
ceffive vivacité du travail , il mourut à Paris
à l’âge de trente-huit ans en 1638. -
On voit de ce peintre deux tableaux à Notre-
Dame ; l’ un repréfente Saint André à genoux
devant la croix , & l’ autre la defcente du
Saint-Efprit.
Ce dernier tableau a été gravé par Regneflon.
Cor. Bloemaert a gravé la chafteté de Jofeph :
P 'D a r e t , Saint Jérôme en contemplation & la
mort de Saint Sébaftien.
P E 1
f i j o ) A n i e l io F A ie o k e -, de l’é co le N a p
olitain e , né à N a p les e n - 1600 , fu t etóve de
R tbeira. Il fe liv ra au g en re des b a tailles , Ce
fu t nom m é l'ouicolo delle bataglie. Sa n o u leu t
étoit v igottreû fc tk fa to u ch e leg ere. 1 ut
im ité par le B o u rgu ign o n f v it le s p in s h a biles.
artiftes d e io n tem ps, fe d .lp u tcr la ta -
tisfa d ié n d e poffèd er.de fes ou vra ges. 11 m ourut ,
en 1680 à l’âge, d e q u a tr e -v in g t ans.
( 121 ) Michel - A nge C ekqüozzi dît Mi-
chel-Ange des B Mailles, de l’école Romaine ;
on le nommé aufli Michel - Ange des Bambo-
chad.es, parce cuTil a beaucoup travaille dans ce
'genre. Il naquît1,à Rome en i6oz. Il rut d. a-
bord élève d’un peintre Flamand , & enfuite
d’un Italien , qui avoit une grande ÆeputaWm
pour peindre.fos fruits , & lui-meme excella
dans ce genre d’ imitation ; lorfqu il ieTut lie
avec Pierre de Laar, qu’on appelle Bamboche ,
il fe plut à traiter le genre dans lequel Ion
ami fe diftinguoit; il a peint aufli l’hiftoire,
mais ayec moins de fuccès. , f
Ses tableaux étoient animes de toute la gaiete
de Ton caraftèrc ; c’étoient dès comédies muettes.
Sa touche étoitiégère & fa couleur vigoureufe.
Il avoit la mémoire excellente & l ’imagination
vive. I l fuffifoit de. faire devant lui le récit
d’une bataille om d’une feene comique^, pour
qu’i l ëii traçât le, tableau. Tout ce qu’ il en-
tendoit , Ü le voyoit. Ses efquifles n étoient
tracées que dans fon e f p r i t & il les tranfpor-
toit fur la toile. I l ne fe piquoit cependant
pas d’ une vitefle dangereufe., & mettoit le *
temps convenable à terminer fes ouvrages. Il
étoit lé peintre à la mode de fon temps : chacun
vouloit avoir de fes tableaux.
C’étoit un homme de bonnes moeurs & de
bon efprit, difant même du bien de ceux qui
déprifoient fes ouvrages.. On ne pouvoit lui reprocher
que fon amour de l’argent. Il en avoit
beaucoup, & fit pour le cacher un long chemin
dans la campagne, jufqu’à ce qu’ il eût trouvé
un endroit qui lui femblât sûr re v in t, puis
fur quelques foupçons retourna auflitot fur fes
pas & prit de fatigue, qu'il fe détruifit la
fànté. Rien ne put la rétablir & il mourut à
Rome en 1660 , âgé de cinquante-huit ans.
Il n’y a de lui qu’ un foui tableau au cabinet
du roi , & il n’eft pas de fon bon temps. Il
repréfente un opérateur Italien. On voit au
palais - royal une mafearade de fa main.
(133 ) Philippe de Champagne , de l’ école
Flamande, né à Bruxelles en i6oz , n’eut que
des maîtres fort médiocres & fe forma de lui-
même. I l vint à Paris à l’âge de vingt ans &
fut fur.intendant des bâtimens de la reine. Il
fut long-temps en France le peintre le plus
$£çupé & d? la plus gran4® réputation : des
P E I 7 ;
, travaux nombreux faits pôur îa cour pou voient
\ lui faire efpérer la place de premier peintre
du roi : cependant quand elle fut donnée a T e -
brun qui revenoit tout nouvellement d L a L e ,
il ne s’en1 montra pas jaloux. Si cette place
devoit être la récoinpenfë des anciens fervices ,
Champagne y avoir des droits ; fi elle dévoie-
être le prix du mérite , Lebrun 1 emporta justement.
‘ p
Champagne imitoit la nature fans choix ce
fans chaleur. Il rendoit bien fon modèle, mais
il ne lui donnoit pas le mouvement. Nous n en~
’ tendons pas ici par mouvement, des attitudes
violentes-, mais ce qui donne l’ açlion , le fen—
timent, la vie aux ouvrages de l’art. Sort déifia
étoit aflez c o r r e é lm a is peu élégant; fa
' couleur étoit bonne. I l auroit joui d une réputation
plus durable, s’ il n'avoit fait ^cjue le
portrait. I l eft mort à Paris en 1574 a l,ag e Q®
ioifante & douze ans.
On voit dans- Paris un grand nombre de fes
ouvrages , & ils prouvent qu’ il étoit un de ces
maîtres à qui l’on doit beaucoup d eftime,
s’ ils n’excitent pas .d’enthoufiafme. I l ne lui a
manqué , pour mériter l’admiration , que la chaleur
qui lui avoit étéjrefufée par la nature. Ses
tableaux des Carmélites de la rue Saint Jacques,
& tant d’autres , font de bons ouvrages : c’eft un
très bon ouvrage que fon- Saint Philippe en méditation,
dâns les faïles de l’académie royale de
peinture -, fon.portrait, fait par’lui-meme'peft l’un
des plus beaux qui fe voyënt dans ces {ailes. ^
Cet excellent tableau a été grave fupérieu-
rement par Edelinck , qui a grave aufli la Samaritaine.
Pitau a gravé d’après le meme peintre
un Saint Bruno.
( 133 ) Jacques V an Oost , fur nommé, le
Vieux , de l’école Flamande: On fait qu’ il eft
né à Bruges, mais on ne fait pas précifément
en quelle année il y vit le jour. Cet habile
artifte n’eft point connu des étrangers, parce
que fes ouvrages , faits pour les églifes ou 1 es hôtels-de-ville , ne font pas fortis de la
Flandre. . .
Ses maîtres font inconnus ; il leur dut moins,
fans doute , qu’ à fes difpofitions naturelles &
à fes études: mais on fait qu’ il.fe fit eftirner,
dès la première fois qü’ il fe fit connoitre. Les
applaudiflemens qu’ il reçut ne l’aveuglerent
pas fur ce qui lui manquoit. encore : plus éclairé
que fes admirateurs , il voyoit loin de lui le
but auquel il fe propofoit d’atteindre, & pour
marcher plus sûrement dans la carrière ouverte?
par les grands maîtres, il entreprit le voyage
d’Italie. Annibal Càrrache fut le maître qu’ il
fe propofa pour modèle , & il l’imita d’aflez
près pour étonner les Italiens. I l avoit l’art
de fe transformer en quelque forte dans les
artiftes qu’ il prenqit pour objets d’imitation ;
K. il