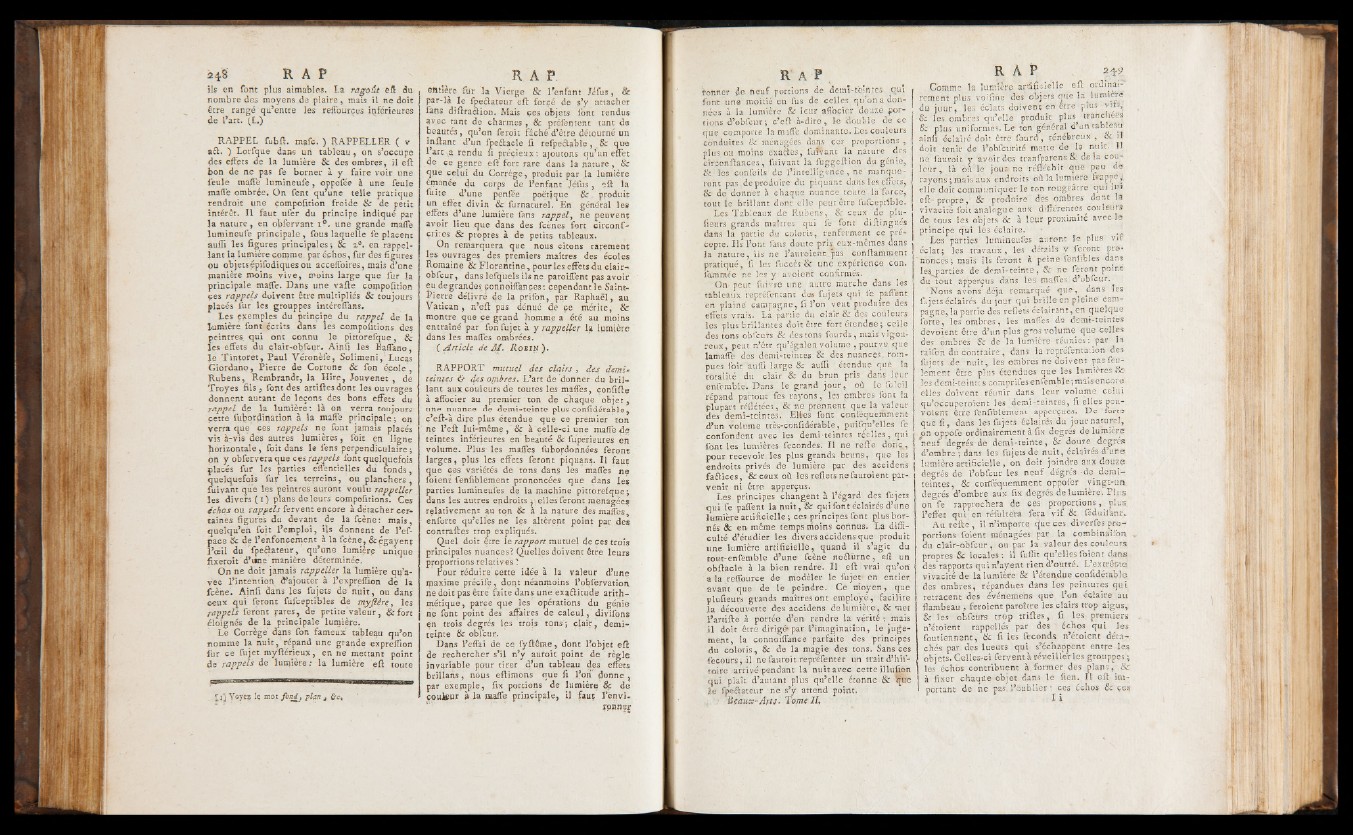
24.8 RAP
ils en font plus aimables. La ragoût eft du
nombre des moyens de plaire, mais il ne doit
être rangé qu’ entre les reffources inférieures
de l’art. (L.)
RAPPEL fubft. mafc. ) RAPPELLER ( v
a61. ) Lorfque dans un tableau , on s’occupe
des effets de la lumière & des ombres, il eft
bon de ne pas fe borner à y faire voir une
feule mafl'e lumineufe, oppofée à une feule
mafle ombree. On fent qu’une telle pratique
rendrait une çompofition froide & de petit
intérêt. I l faut ufer du principe indiqué par
la nature, en obfervant i ù. une grande mafle
lumineufe principale , fous laquelle fe placent
aufli les figures principales*, & 2.0. en rappel-
îant la lumière comme par épbos, fur des figures
pu objetsépifodiques ou accelfoires, mais d’une
pianière moins v iv e , moins large que fur la
principale mafle. Dans une vafte coippofition
ces rappels doivent être multipliés 8c toujours
placés fur les grouppes inté reflans.
Les exemples du principe du rappel de la
lumière font écrits dans les compofitions des
peintres^ qui ont connu le pittorefque, &
les effets du çlair-obfcpr. Afofi les Baffano,
Je Tintoret, Paul Véronèle, Solimeni, Lucas
Giordano, Pierre de Coprone & fon école ,
Rubens, Rembrandt, la Hire, Jouvenet , de
’ï ’royes f ils , font des artiftesdônt les ouvrages
donnent autant de leçons des bons effets du
rappel de la lumière: Jà on verra toujours
cette fubordination à la maffe principale; on
verra que ces rappels ne font jamais placés
vis à-vis des autres lumières, foit en ligne
horizontale, foit dans le fens perpendiculaire ;
pn y obferveraque ces rappels font quelquefqis
placés fur les parties eflentielles du fonds,
quelquefqis fur les terrains, ou planchers ,
fuivant que les peintres auront voulu rappellçr
les divers ( 1 ) plans de leurs compofitions. Ces
échos ou rappels fervent enepre à détacher certaines
figures du devant de la fçène: mais,
quelqu’en foit l’emploi, ils donnent de l’ef-
pace 8c de l’ enfoncement à la fçène. & égayent
l ’oeil du fpeélateur, qu’ une iumierp unique
fixerait d’ t*ne manière déterminée.
On ne doit jamais rappelles la lumière qu’av
e c l’intention Rajouter à l’ expreffion de la
fçène. Ainfi dans les fujets de nuit, ou dans
ceux qui feront fufceptibles de myfière, ie3
rappels feront rares, dé petite valeur, & fo r t
éloignés de la principale lumière.
Le Corrègé dans fon fameux tableau qu’on
nomme la nuit, répand une grande exprefïïon
fur ce fujet mÿft'érieux, en ne mettant point
de rappels de lumière ; la lumière eft toute
lû y°yç5 te mot pl<*n*
R A P
entière fur la Vierge & l'enfant Jéfus, &
par-là le fpeélateur eft forçé de s’y attacher
fans diftraélion. Mais çes objets font rendus
avec tant de charmes , & préfentent tant de
beautés, qu’on ferait fâché d’être détourné un
inftant d’ un fpeélacle fi refpeél^ble, & que
1 art Na rendu fi préçieux : ajoutons qu’ un effet 4e ce genre eft fort rare dans la nature, &
que celui du Corrège, produit par la lumière
émanée du corps de l’enfant Jéfus , eft la
fuite d’une penfée poétique 8c produit
un effet divin & furnacurel. En général les
effets d’une lumière fans rappel, ne peuvent
avoir lieu que dans des fcènes fort cirçonf-
çri:es & propres à de petits tabjeaux.
On remarquera que nous citons rarement
lps ouvrage^ des premiers maîtres des écoles
Romaine & F lorentine, pour les effets du clair-
obfcur, dans lefquels ils ne paroifîent pas avoir
eu de grandes çonnoiflançes : cependant le Saint-
Pierre délivré de la prifon, par Raphaël, au.
Vatican, n’eft pas dénué de ce mérite, &
montre que ce grand homme a été au moins
entraîné par fori fujet à y rappeller 1<* lumière
dans les mafles ombrées.
( Article de M . R obi$ ).
RAPPORT mutuel des clairs, des demi-
teintes & des ojnhres. L’ art de donner du brillant
aux couleurs de toutes les mafles, çonfifte
à aflocier au premier ton de chaque ob jet,
une nuance de demi-teinte plus confidérable,
c’eft-à dire plus étendue que ce premier ton
ne l’eft lui-même, & à celle-ci une mafle de
teiptes inférieures en beauté & fupérieures en
volume. Plus les mafles fubordonnées feront
larges, plus les effets feront piquans. Il faut
qpe çes variétés de tons dans Ie? mafles ne
foient fenfiblement prononcées que dans les
parties lumineufes de la machine pittorefque ;
dans les autres endroits pelles feront ménagées
relativement au ton & à la nature des mafles,
enforte qu’elles ne les altèrent point par des
contraftqs trop expliqués.
Quel doit être le rapport mutuel de ces trois
principales nuances? Quelles doivent être leurs
proportions relatives ?
Pour réduire cette idée à la valeur d?une
maxime précifç, dont néanmoins l’obfervation
ne doit pas être faîte dans une exaélitude arithmétique,
parce que les opérations du génie
ne font point des affaires de ca lcu l, divlfons
pn trois degrés les trois tons; clair, demi-,
teinte & obfcur.
Dans l’ eflai de ce fyftême, dont ffobjet eft
4e rechercher s’ il n’y aurait point de règle
invariable pour tirer d’un tableau des effets
brillans, nous eftimons que fi l ’oii donne ,
par exemple, fix portions de lumière & de
çouteur à la mafle principale, il faut l'environner
R A p
tonner de neuf portions de demï-tèjntçs qui
font une moitié en fus de celles 'qu’on a données
à la lumière & leur aflocier douze portions
d’obfçur; c’eft à-dire, le 'double de ce
que comporte la mafle dominante. Les couleurs
conduites & ménagées dans ccs proportions ,
plus ou moins e’xaftes, fuwant la nature des
circonftances, fuivant la fuggeftion du génie,
& les confeils de l’ intelligence , ne manqueront
pas de produire'du piquant dans lés effets,
& de donner à chaque nuance toute la force,
tout ie brillant dont elle peut être lufçeptible.
Les Tableaux de Rubens, & ceux de plu-
fieurs grands maîtres qui fe font diftingués
dans la partie du coloris, renferment ce précepte.
Ils l’ont fans doute pris eux-mêmes dans
la nature, iis ne l’auroient pas conftamment
pratiqué, fl les fuccès & une expérience con.
iommée ne les y, avoient confirmés.
On peut fuivre une autre marche dans les
tableaux repréfentant des fujets qui le paflent
en plaine campagne, fi l’on veut produire des
effets vrais. La partie du clair & des couleurs
les plus brillantes doit être fort étendaè; celle
des tons ob leurs 8c des tons fourds, mais' vigoureux,
peut n’êtr qu’égal en volume , pourvu que
lamafle des demi-teintes 8c des nuances, rompues
foit aufli large & aufli étendue que la
totalité du clair & du brun pris dans leur
enfemble. Dans le grand jour, où le foleil
répand partout fes rayons, les ombres font la
plupart reflétées,, & ne prennent que la valeur
des demi-teintes. -Eûtes font conféquemment
d’un volume très-confidérable, puifqu’ellcs fe
confondent avec les demi teintes réelles, qui
font les lumières fécondés. I l ne refte donc,,
pour recevoir; les plus grands bruns, que les
endroits privés de lumière par des accidens
faétices, & ceu x où les reflets ne fauroient parvenir
ni être apperçus.
Les principes changent à l’égard des fujets
qui fe paflent la nuit, & qui font éclairés d’ une
lumière artificielle ; ces principes font plus bornés
9c en même temps moins connus. La difficulté
d’étudier les divers accidens que produit
une lumière artificielle, quand il s’agit du
tout-enfemble d’une fçène noélûrne, eft un
obftacle à la bien rendre. I l eft vrai qu’on'
a la reflource de modèler le fujet* en entier
avant que de le peindre. Ce moyen, que'
plufieurs grands maîtres ont employé, facilite
la découverte des accidens de lumière, & met
l’artifte xà portée d’en rendre la vérité *. mais
il doit être dirigé* par l’ imagination, le jugement,
la connoiflance parfaite des principes
du coloris, & de la magie des tons. Sans ces
fecours, il ne fauroit repréfenter un trait d’hif-
toire arrivé pendant la nuit avec cette illufion
qui plaît d’amant plus qu’ elle étonne & Ÿjtie
lè fpeélateur ne s’y attend point.
• Beaux-Arts. Tome IL
R À P ,
Comme la lumière artificielle eft ordrnai-
rement plus votflne des objets que la lumière
du jour , les éclats doivent en être plus vifs,'
& les ombres qu’elle produit plus tranchées
& plus uniforme?. Le ton général d’ un tableau,
ainfi éclairé doit être fourd, ténébreux , de il
doit tenir de i’ obfcurité matte de la nuit. Il
ne fauroit y avoir des tranfparans & delà cou--
le u r , là où le jour ne réfléchit- que peu de
rayons ; mais aux endroits où la lumière frappe
elle doit communiquer le ton rougeâtre qui iui
eft-propre, & produire dés ombres dont la
vivacité foit analogue aux différentes couleurs
de tous les objets & à leur proximité avec le
principe qui les éclaire. *
Les parties lumineufes auront le plus v if
éclat; les travaux , les détails y feront pro-
'nonces ; mais ils feront à peine fenfibles dans
le§parties de demi-teinte, & ne feront point
du tout apperçus dans les mafles d’obfcur.
Nous avons déjà remarqué q ue, dans les
fujets éclairés du jour qui brille en pleine campagne,
la partie des reflets éclairant, en quelque
forte, les ombres, les mafles de demi-teintes
dévoient être d’ un plus gros volume que celles
des: ombres & de la lumière reunies : par la
rai fon du contraire , dans, la rcprefentaiion des
fujets de nuit, les ombres ne doivent pas feulement
être plus étendues que les lumières &
les demi-teinte s comprifes enfemble ; niai s encore
elles doivent réunir dans leur volume celui
qu’occuperaient les demi-teintes, fi elles pou-
voient être fenfiblément apperçüès. De forte
que fi, dans les fujets éclairés du jour naturel,
on oppofe ordinairement à fix degrés de lumière
"neuf degrés de d em i- te in te& douze degrés
d’ombre ; dans les fujets de nuit, éclairés d’une
lumière artificielle , on doit joindre aux douze
degrés de l’obfcur les neuf degrés -de demi-
teintes, & corfféquemment oppofer vingt-un
degrés d’ombre aux fix degrés de lumière. Plus
on fe rapprochera de ces proportions, plus
l’effet qui en réfiiltèra fera v if & féduilanr.
Au re fte , il n’importe cjué ces divçrfes proportions
foient ménagées par la combination
du clair-obfcur , ou par la valeur des couleurs
propres & locales: il fuffit qu’elles foient dans
des rapports qui n’ ay.ent rien d’outré. L’extrêpie
vivacité de la lumière 8c l’étendue confidérable
des ombres, répandues dans les peintures qui
retracent des événemens que l’on éclaire au
flambeau , feraient paraître les clairs trop aigus,
8c les obfcurs trop triftes, fi les. premiers
n’étoient rappel lés par des ' échos qui les
foutiennent, & fi les féconds n’étoient détachés
par des lueurs qui s’échappent entre les
objets. Celles-ci fervent à réveiller les grouppes';
les échos contribuent à former des plans, &
à fixer chaque objet dans le fien. Il eft important
de ne pas. l’oublier : ces échos 8c çes