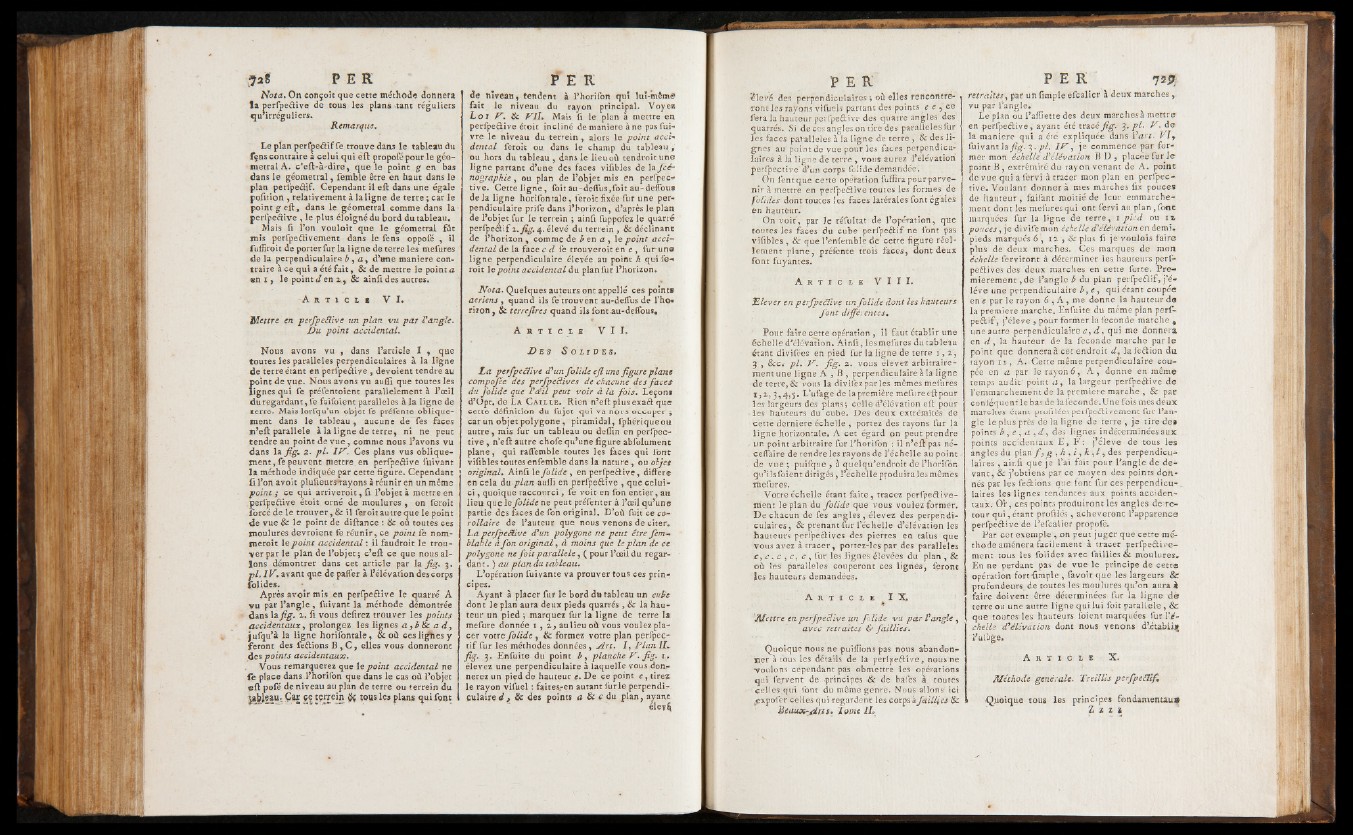
Nota, On conçoit que cette méthode donnera
la perfpe&ive de tous les plans tant réguliers
qu’ irréguliers.
Remarque.
Le plan perfpe&if fe trouve dans le tableau du fçns contraire a celui qui eft propofé pour le géo- metral A. c’eft-à-'dire, que le point g en bas dans le géometral, femble être en haut dans le plan perlpe&if. Cependant il eft dans une égale pofition , relativement à la ligne de terre ; car le
point g eft, dans le géometral comme dans la- perfpeétive , le plus éloigné Mais fi l’on vouloit qued u lbeo rgdé odmu teatrbalel aufû.t mis perfpeétivement dans le fens oppofé , il fuffiroit de porter fur la ligne de terre les mefures tdrea ilrae pàe crep eqnudi ica uéltaéi rfae ibt ,, a&, dde’ umnee ttmrea nleié rpéo icnotn a
en i , le point d en a., & ainfi des autres.
- A r t i c l e VI .
Mettre en perfpe&ive un plan vu par Vangle.
Du point accidentai.
touNteosu lse s apvaornasll èlveus p,e rdpaennds iclu’alaritricelse à Il a, ligqnuee de terre étant en perfpe&ive , dévoient tendre au point de vue. Nous avons vu aufli que toutes les lignes qui fe préfentoient parallèlement à l’oeil du regardant, fe faifoient parallèles à la ligne de tmerernet. Mdaaniss lolerf qtua’bulne aoub ,j eta fuec upnréef ednete foebs lifqaucees
tne’nedftr ep aarua lploèlien t àd ela v luigen, ec odme mteer rneo, usn il ’anveo nsp evuut mdaenns t,l afe f pige.u vge. nptl .m IeFttr. e Ceens pplearnfps ev&uisv eo bfuliiqvuaent
la méthode indiquée par cette figure. Cependant fi l’on avoit plufieurs*rayons à réunir en un même
point ; çe qui arriveroit, fi l’objet à mettre en perlpe&ive étoit orné de moulures , on feroit forcé de le trouver, & il feroit autre que le point de vue & le point de diftance : & où toutes ces moulures devroient fe réunir, ce point Ce nom- vmeerr poaitr llee ppolainnt daec cl’iodbejnetta;i c: ’ielf tf açued rqouiet lneo utrso aullons
démontrer dans cet article par la fig, 3.
p l . lV . avant que de palier à l’élévation des corps toHAdpersè.s avoir mis en perfpe&ive le quarré A vu par l’angle , fuivant la méthode démontrée dans Izfig. 2, fi vous defirez trouver les points
accidentaux, prolongez les lignes a ,b a d , jufqu’à la ligne horifontale, & où ces limbes y
feront des feâions B , C , elles vous donneront des points accidentaux.
Vous remarquerez que le point accidentai ne fe place dans l ’horilon que dans le cas où l’objet
^ft pofé de niveau au plan de terre ou terrein du
jabjçau. Car çe terrein tous les plans qui font
de niveau, tendent à l’horifon qui lui-même1
fait le niveau du rayon principal. Voyez
L o i y & v i l . Mais fi le plan à mettre en
perfpe&ive étoit incliné de maniéré à ne pas fui-
vre le niveau du terrein , alors le point acci*
dental feroit ou dans le champ du tableau ,
ou hors du tableau , dans le lieu où tendroit une
ligne partant d’une des faces vifibles de la fcé-
nographie, ou plan de l’objet mis en perfpec-
tive. Cette ligne, foit au-deffus,foit au-deffous
delà ligne horifontale, ieroit fixée fur une perpendiculaire
prife dans l’horizon, d’après le plan
de l’objet fur le terrein ; ainfi fuppofez le quarré
perfpe&if 2.fig. 4. élevé du terrein , & déclinant
de l’horizon , comme de b en a , le point acci-<
dental de la face c d fe troùveroit en e , fur una
ligne perpendiculaire élevée au point h qui fe-«
roit le point accidentai du plan fur l ’horizon.
Nota. Quelques auteurs ont appellé ces point®
aeriens , quand ils fe trouvent au-deffus de l’ho»
rizon, & terrefires quand ils font-au-dçffous.
A r t i c l e V I I .
Des Solives.
L a perfpe&ive d’un folide efi une figure plane
compofée des perfpectives de chacune des faces
du folide que Voeil peut voir à la fois. Leçon*
d’Üpt. de La Caille. Rien n’eft plusexa& que
cette définition du fujet qui va nous occuper ;
car un objet polygone, piramidal, fphérïqueou
autre, mis fur un tableau ou deflin en perfpec-
tive , n’eft autre chofe qu’ une figure abfolument
plane, qui raffemble toutes les faces qui font
vifibles toutes en femble dans la nature, ou objet
original• Ainfi le folide , en perfpeâive, différé
en cela du plan aufli en perfpe&ive , que celui-
ci , quoique raccourci, fe voit en fon entier, au
lieu que le folide ne peut préfenter à l’oeil qu’une
partie des faces de fon original. D’où fuit ce co~
rollaire de l’auteur que nous venons de citer.
La perfpe&ive d’un polygone ne peut être fem-.
blable à fon original, à moins que le plan de ce
polygone ne fo it parallèle, ( pour l’oeil du regardant.
) au plan du tableau.
L’opération fui vante va prouver tous ces principes.
Ayant à placer fur le bord du tableau un cuire
dont le plan aura deux pieds quarrés , & la hauteur
un pied ; marquez fur la ligne de terre la
mefure donnée 1 , 2 , au lieu où vous voulez placer
votre folide , & formez votre plan perfpec-
t if fur les méthodes données, ylrt. I , Plan IL
fig. 2. Enfuite du point b y planche y - fig. 1»
élevez une perpendiculaire à laquelle vous donnerez
un pied de hauteur e. De ce point e , tirez
le rayon vifuel : faites>-en autant furie perpendiculaire
d j> & des points a & C du plan, ayant
élev§
îêlevê des perpendiculaires ; où elles réncontrefont
les rayons vifuels partant des points e e , ce
fera la hauteur perfpe&ive des quatre angles des
quarrés. Si de ces angles on tire des parallèles fur
les faces parallèles à la ligne de terre , & des li- ;
gnes au point de vue pour les faces perpendiculaires
à la ligne de terre , vous aurez l’élévation
perfpective d’ un corps folide demandée.'
On lent que cette opération fuffira pour parvenir
à mettre en perfpeâive routes les formes de
folides dont toutes les faces latérales font égales
en hauteur.
On v o it, par Je réfultat de l ’opération, que
toutes les faces du cube perfpe&if ne font pas
vifibles , & que l’enlemble de cette figure réellement
plane, préfente trois faces, dont deux
font fuyantes.
A r t i c l e V I I I .
Jilever en perfpe&ive an folide dont les hauteurs
fon t differentes,
' Pour faire cette opération , il faut établir une
échelle d’élévation, Ainfi, lesmefures du tableau
étant divifées en pied fur la ligne de terre 1', 2 ,
3 , & c. p l .V . fig. 2. vous élevez arbitrairement
une ligne A , B , perpendiculaire à là ligne
de terre, & vous la divifez parles mêmes mefures
1 ,2 , 3,4,5. L’ufage de la première mefure eft pour
les largeurs des plans; celle d’élévation eft pour
' les - hauteurs du cube. Des deux extrémités de
cette derniere échelle , portez des rayons fur la
ligne horizontale. A cet égard on peut prendre
un point arbitraire fur rhorifon : il n’eft pas né-
ceflaire de rendre les rayons de l’échelle au point
de vue ; puifque , à quelqu’endroit d e l’horifôn
qu’ i 1 s foiènt dirigés, l’échelle produira les mêmes
mefures.
Votre échelle étant faite, tracez perfpe&ive-
ment le plan du folide que vous voulez former.
De chacun de fes angles, élevez des perpendiculaires,
& prenant fur l’échelle d’élévation les
hauteurs perlpeâives des pierres en talus que
vous avez à tracer, portez-les par des parallèles
c y c , c , c, c y fur les lignes élevées du plan , &
où les parallèles couperont ces lignes, feront
les hauteurs demandées.
A r t i c l e I X
’Mettre en perfpe&ive un folide vu par Vangle,
avec retraites & faillies.
Quoique nous ne puiffions pas nous abandonner
à tous les détails de la perfpe&ive, nous ne
•voulons cependant pàs obmettre les opérations
qui fervent de principes & de bafes à toutes
celles qui font du même genre. Nous allons ici
vexpofer colles qui regardent les corps à fa illie s 8c
lleaux-4 rts. Tome IL
retraites y par un firnple efcalier à deux marches
vu par l’angle.
Le plan ou l’afiiette des deux marches à mettre
en perfpe&ive, ayant été tracé fig . 3. p l. y . delà
maniéré qui a été expliquée dans l’art. VIy
fuivant la fig. 3. pl. i y y je commence par for-
: mer mon échelle d’élévation B D , placée fur le
point B , extrémité du rayon venant de A. point
de vue qui a lervi à tracer mon plan en perspective.
Voulant donnera mes marches fix pouces
de hauteur , faifant moitié de leur emmarche-
ment dont les mefures qui ont fervi au plan, font
marquées fur la ligne de terre, 1 pied ou 12
pouces, je di vile mon échelle cP élévation en demi,
pieds marqués 6 , 12 , & plus fi je voulois faire
plus de deux marches. Ces marques de mon
échelle ferviront à déterminer les hauteurs per P-
pe&ives des deux marches en cette forte. Premièrement,
de l’angle b du plan perfpe&if, j’é-
léve une perpendiculaire b y e , qui étant coupée
en e par le rayon 6 , A , me donne la hauteur de
la première marche. Enfuite du même plan perfpe&
if, j’éleve, pour former la fécondé marche #
une autre perpendiculaire c y d , qui me donnera
en dy la hauteur de la fécondé marche parle
point que donnera à cer endroit dy la fe&ion du
rayon 11, A.-Cette même perpendiculaire coupée
en a par le rayon 6, A , donne en même
temps audit' point a y la largeur perfpe&ive de
remmarchemént de la première marche , & par
conlëquenf le bas de lafeconde.Une fois mes deux
marches étant profilées perfpe&ivement fur l’angle
le plus près de la ligne de terre , je tire de®
points b , e , a , d , des lignes indéterminées aux
points accidentaux E, F: j’éleve de tous les
angles du plan ƒ , g , h , i , k ,/ , des perpendicu^
laites , air.fi que je l’ai fait pour l’angle de devant,
& j’obtiens par ce moyen des points donnés
par les fe&ions que font fur ces perpendiculaires
les lignes tendantes aux points acciden-
taux; ôr, ces points produiront les angles de retour
qui, étant profilés , achèveront l’apparence
perfpe&ive de l’efcalier propofé.
Par cet exemple , on peut juger que cette méthode
amènera facilement à tracer perfpe&ivement
tous les folides avec faillies & moulures.
En ne perdant pas de vue le principe de cette
opération fortfimple , favoir que les largeurs &
' profondeur« de toutes les moulures qu’on aura à
; faire doivent être déterminées fur la ligne de
terre ou une autre ligne qui lui foit parallèle , &
que toutes les hauteurs foient marquées fur IV-
jchelle d’élévation dont nous venons d’établijj
' l’ufage.
A r t i c l e X.
Méthode générale. Treillis perfpeflif,
1 Quoique tous les principes fondamentaux
Z M ï