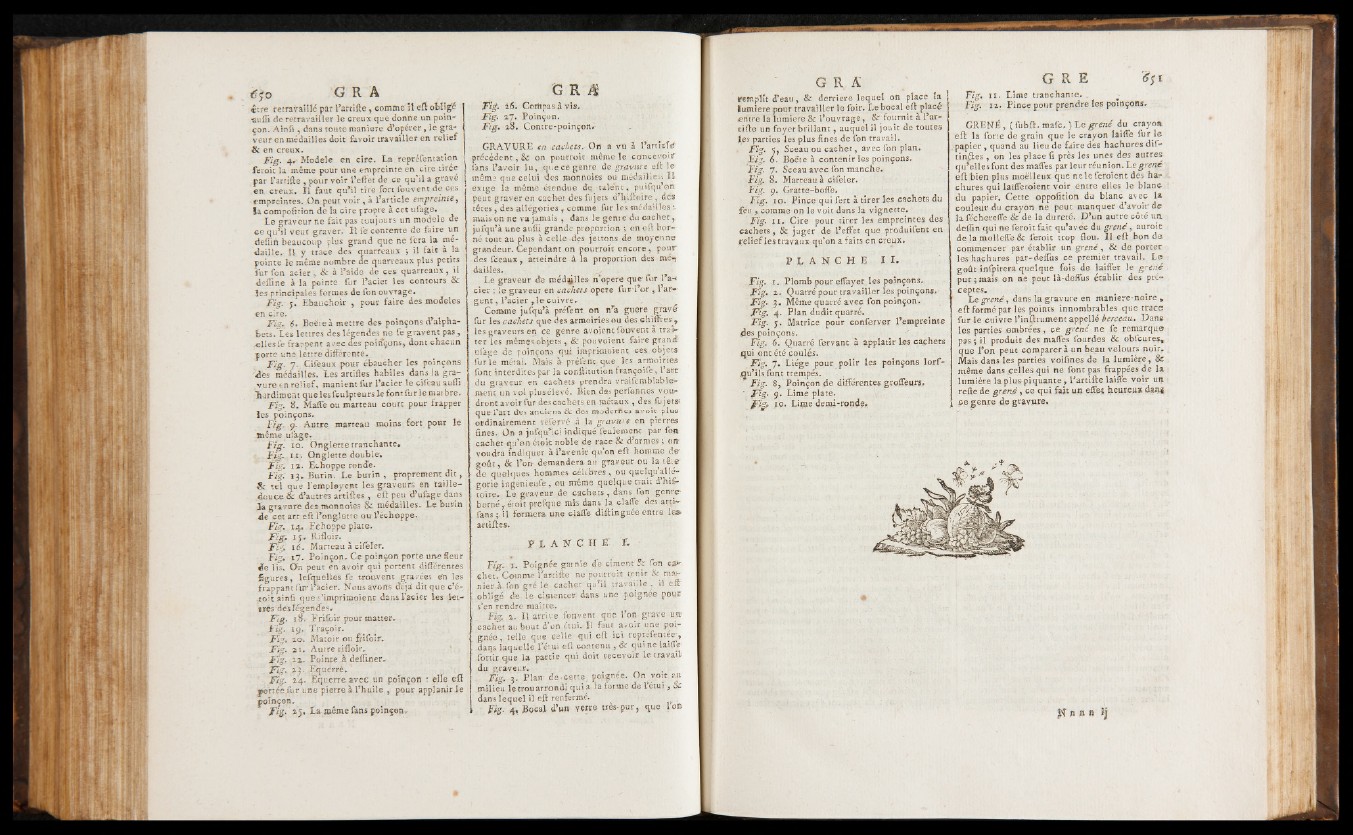
G R À
être retravaillé par l’artifte, comme 51 eft oMigé'
suffi, de retravailler le creux que donne un poinçon.
A in fi, dans tonte maniéré d’opérer , le graveur
en médailles doit favoir travailler en relief
& en creux.
Fig. 4» Modèle en cire. La repréfentation {
feroit la même pour une empreinte en cire tiree j
par l’arrifte , pour voir l’effet de ce qu'il a gravé |
en creux. Il faut qu’ il tire fort fouvent de ces
empreintes. On peut v o ir , à l ’article empreinte,
la compofîtion de la cire propre a cet ufage.
Le graveur ne fait pas toujours un modèle de
6e qu’ il veut graver. I l fe contente de faire un
deffih beaucoup plus grand que ne fera la médaille.
I l y trace des quarreaux ; il fait a la ,
pointe îe même nombre de quarreaux plus petits
fur Ion a c ier, & à l’aide de ces quarreaux, il
deffine à la pointe fur l’acier les contours &
les principales formes de l’on ouvrage.
Fig. $. Ebaucholr , pour faire des modèles
en cire.
Fig, 6. Boëteà mettre des poinçons d’alphabets.
Les lettres des légendes ne le gravent pas,
.-elles fe frappent avec des poinçons, dont chacun
porte un© lettre différente.
Fig. 7* Cifeaux pour ébaucher les poinçons
des médailles. Les artifies habiles dans la gravure
en relief, manient fur l’acier îe ci-feau auffi .
îUrdîment que les fculpteurs le font fur le marbre.
Fig. 8. Maffe ou marteau court pour frapper
les poinçons. '
Fig. 9- Autre marteau moins fort pour le
même ufage.
Fig. io . Onglette tranchante®
Fi*~, h . Onglette double.
Fig'. 12. Echoppe ronde.
Fig: 13 . Burin. Le burin, proprement d it ,
& tel que l’empleyent les graveurs en taille- 1
douce & d’autres artiftes , eft peu 'd’ufage dans 3a gravure des- mon noies & méda-illes. Le burin
de cet art eft l’onglet te ou Péchoppe.
Fig. 14. Echoppe plate.
F ig . 15* Rifloir.
Fig. 16. Marteau à cifeîer.
Fiv. 17. Poinçon. Ce poinçon porte une fieur
de lis. On peut en avoir qui portent différentes
ligures, lefquelles le trouvent gravées en les
frappant fur l’ acier. Nous avoris déjà' dit que c’é- ,
.toit ainfi que s’imprimoient dans l’acier les let- tres desfégendesv
Fig. 18-. Frifoir pour matter„
Fig. 19. Traçoir.
Fig. 2.0. Matoir ou frifoir.
Fig. 25i,- Autre rifloir^
Figr 2.2,.. Pointe à deffiner.
Fig. 2.3* Equérrè.
Fig. 2,4. Equerre avec un poinçon : elfe eff
lîoitée./’ui' une pierre à l’huile , pour applanir le
poinçon,
jFig. 25. La même fans poinçon ^
G R M Fig. i6. Coîtipas à vis.
Fig. 2,7. Poinçon.
Fig. 2.8. Contre-poinçon*-
GRAVURE ci 1 cachets. O ri a vu à l’art iefé
précédent, Sc on pourroit même le concevoir-
fans l’ avoir lu , que ce genre de gravure eft le
même que celui des mon noies ou médailles* I l
exige la même étendue de talent, puifqu’on
peut graver en cachet des fujets d’hiftoire , des
têtes, des allégories y comme fur les médailles *,
mais on ne va jamais , dans le genre du cachet ,>
jufqu’à une auffi grande proportion •> on eft borné
tout au plus à celle .des jettons de moyenne
grandeur. Cependant on pourroit encore, pour
des (beaux, atteindre à la proportion des m é dailles.
Le graveur de médfjlles- n’opere que- fur l’a—*
ci-er : îe graveur en cachets opéré fur'l’or , 1 argent
, l’acier ylecuivre.- . |p
Comme jufqu’ à préfent on n’ a guere gravé*
fur les.cachets que des armoiries ou des chiffres
les graveurs en ce genre avoient Couvent a traiter
les mêmes objets , & pouvoient faire grand
ufage de poinçons qui imprimorent ces objets
furie métal. Mais à prêtent que les armoiries
font interdites par la conflitutipn fr-aaçoife, l’ art
du graveur en cachets prendra vraifciiibîab 1 &-■
ment un vol plu s élevé. Bien des perfonnes voudront
avoir fur des cachets en métaux , des fujets»'
que l’art des anciens & des modernes avoit plus
, ordinairement réfervé à la gravure en pierres
- fines. On a jufqu’ ici indiqué feulement par fon
cachet qu’en étoi-t noble de race& d’armes -, ont
1 voudra indiquer à l’avenir qu’on eft homme de*
\ goû t, & l’on- demandera-au graveur ou la téter
r de quelques hommes célébrés , ou que 1 qu’ai lé-
gorie ingénieufe , ou même quelque trait d’hi£-
; toire.-. Le graveur de cachets , dans fon genre*
borné, éroit prefque mh dans la piaffe des arti*
fans ;, il formera une c-lafte diftinguée entre lasartiftes.
P' L A N C: H £ v. ■
Fig: t. Poignée gain îe de cimenri& fon egy
eh et. Comme l’arcifte ne pourron t;emr ik ma.-
nier à fon gré le cachett qu’ il travaille , i1 eft
obligé d'e le cimenter dans une poignée pour
s’en rendre maître.
Fig. a. Il arrive fetfvent que l’ on grave un?
cachet au bout d’un étui. U faut avoir une poignée,
telle que celle qui eft ic i reprefentée-,
dans laquelle l’étui eft contenu qui ne lai (Te
fortir que la partie qui doit recevoir le travail-
du graveur* • ,
Fig. 3. Plan de-cette, poignée. On.voit au
milieu le trou arrondi qui a la forme de létui , oc
dans lequel il eft renferme.
Fig. 4, Bocal d’ »'» ywre très*pur, que Ion
G R A
remplît d’eau, & derrière lequel on place la <
lumière pour travailler le foir. Le bocal eft place
entre la lumière & l’ouvrage, 8c fournit a l’ ar-
tifte un foyer b rillant, auquel il jouit de toutes
les parties les plus fines de fon travail.
Fig. 5, Sceau ou cachet, avec fon plan,
Fig. 6 . Boëte à contenir les poinçons.
Fig. 7• Sceau avec fon manche.
Fig. 8. Marteau à cifeler.
Fig. 9. Gratte-boffe.
Fig. 10. Pince qui fert à tirer les cachets du
feu y comme on le voit dans la vignette.
Fig. n . Cire pour tirer les empreintes des
cachets, & juger de l’ effet que produifent en
relief les travaux qu’on a faits en creux.
P L A N C H E I I .
Fig. 1. Plomb pour effayer les poinçons.
Fig. 2. Quarré pour travailler les poinçons,
Fig. 3. Même quarré avec fon poiriçon.
Fig. 4» Plan dudit quarré.
Fig. 5. Matrice pour conter ver l’empreinte
des poinçons.
Figi 6. Quarré fervant à applatir les cachets
qui ont été poules.
Fig. 7. Liège pour polir les poinçons lorf-
qu’ ils font trempés.
Fig. 8, Poinçon de différentes grofTgurs,
’ 9« Lime plate.
fi-fy 19* Lijçue denû-ronde,»
G R E %
Fig. 11. Lime tranchante, _
Fig. 12. Pince pour prendre les poinçons,
GRENÉ, ( fubft. mate. ) Le grené du crayon
eft la forte de grain que le crayon laiffe fur le
papier , quand au lieu de faire des hachures dili-
tinples , on les place fi près les unes des autres
qu’ elles font des maffes par leur réunion. Le grené
eft bien plus moelleux que ne le feroient des har
chures qui iaifferoient voir entre elles le blanc
du papier. Cette oppofition du blanc avec la
couleur du crayon ne peut manquer d’avoir de
la féchereffe & de la dureté. D ’ un autre côté un.
deffin qui ne feroit fait qu’ avec du grené, auroic
de la mollette & feroit trop flou. I l eft bon de
commencer par établir un grené y & de porter
les hachures par-deffus ce premier travail. Le
goût infpirera quelque fois de laiffer le grené
pur ; mais on ne peut là-deffus établir des préceptes.
Le grené, dans la gravure en maniere-noire >
eft formé par les points innombrables que trace
fur le cuivre l’ inftrument appelle herçeau. Dans
les parties ombrées, ce grené ne fe remarque
pas ; il produit des maffes lourdes & oblcures.,
que l’on peut comparera un beau velours noir.
Mais dans les parties voifines de la lumière, &
même dans pelles qui né font pas frappées de la
lumière la plus piquante , l ’artifte laiffe voir u$
refte de grené, ce qui fait un effet heureux datif
; c e genre de gravure.