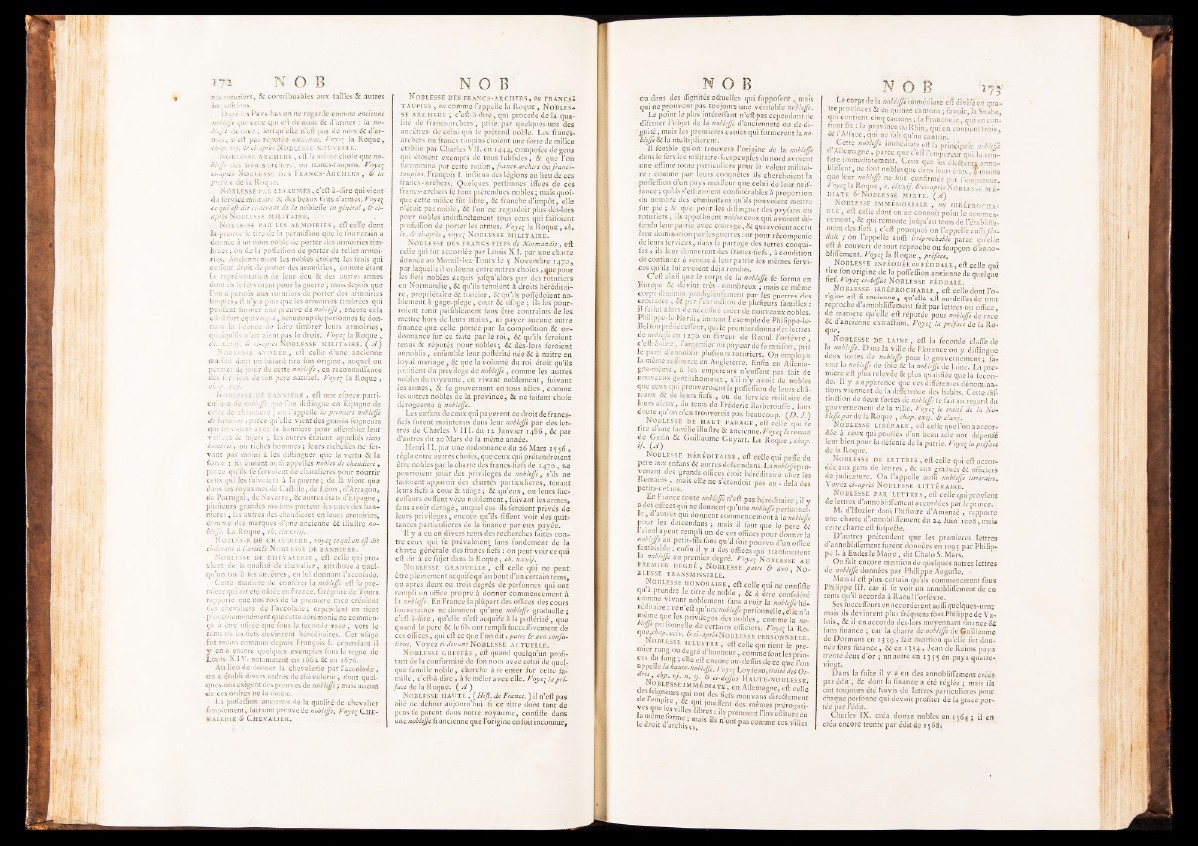
•lés roturiers, & contribuables aux tailles & autres
impolitions.
Dansi les Pays-1xas on ne regarde comme a n c ien n e
■niibtejfc que celle qni eft de nom 6c d’armes : là n o -
■hle f t d<; ra<:e , lor lqu’elle "n’eft pas de nom 6 c d’armes,
iv’eft pas ré{nitée a n c ie n n e . Foye^ la Roque,
ch a p . I l il & 5 Noblesse nouvelle.
Nob 5E ARC:here , eft la même chofe que n o -
M # ^ ;s fi aneSrarc'ners, ou rrancs-taupins. F o y e^
xi-■iiprès No b l ess:s. des Franc s-Archers , & la
F ' de i;a Roqu
les Nô'B lesse p a r ARMES, c’eft-à-dire qui vient
■ du Service militaire &i des beaux faits d’armes. Foye^
•ce qui e f dit ci-devant de la nobleffe en général t & ci-
a p r è s Noblesse m il it a ir e .
-, Noblesse par les a rm o ir ie s , eft celle dont
la preuve fe tire de la permiffion que le fouverain a
donnée à un nom noble de porter des armoiries timbrées
, ou de la poffeffion de porter de telles armoi-
fies. Anciennement les nobles étoient les feuls qui
■ euffenr droit de porter des armoiries, comme étant
la représentation de leur écu & des autres armes
dont ils le fervoient pour la guerre ; mais depuis que
Ton a permis aux roturiers de porter des armoiries
fimplcs, il n’y a plus que les armoiries timbrées qui
puiffent former une preuve nobleffe, encore cela
ed-il fort équivoque, beaucoup de perfonnes fe donnant
la lcence de faire timbrer leurs armoiries,
quoiqu’ils n’en aient pas le droit, Foye\ la Roque ,
cil. xxvij. & ci-après NOBLESSE MILITAIRE. -( A")
Noblfsse a v o u é e , eft celle d’une ancienne
madon dont un bâtard tire fon origine, auquel on
permet de jouir de cette nobleffe , en reconnoilTance
des 1er vices de (on pere naturel. Foye{ la Roque ,
N oblesse dè bannière , eft une efpece particulière
de nobleffe que l’on diftingue en Efpagne de
celle de chaudière ; on l’appelle la première nobleffe
de bannière, parce qu’elle vient des grands feigneurs
qui fervoient avec la- bannière pour affembler leur
valfaux & fujets ; les autres étoient appelles ricos
hombres, ou riches hommes ; leurs richeffes ne fer-
vant pas moins à les diftinguer que la vertu & la
force : iis étoient auffi appellés nobles de chaudière ,
parce qu’ils fe fervoient de chaudières pour nourrir
ceux qui lesfuivoient à la guerre; de là vient que
dans les royaumes de Caftille, de Léon , d’Arragon,
de Portugal, de Navarre, 6c autres états d’Efpagne,
plufieurs grandes mailons portent les unes des bannières
, les autres des chaudières en leurs armoiries,
comme des marques d’une ancienne 6c illuftre no-
bleffe. La Roque, ch. clxxviij.
Noblesse de chaudière , voye[ ce qui en e f dit
çi-devant à l'article NOBLESSE DE BANNIERE.
Noblesse de .ch evaler ie , eft celle qni pro-
vient de la qualité de chevalier, attribuée à quelqu’un
ou à les ancêtres, en lui donnant l’accolade.
Cette maniéré de conférer la nobleffe eft la première
qui ait été ufitée en France. Grégoire de Tours
rapporte que nos rois de la première race créoient
des chevaliers -de l’accolade ; cependant on tient
plus communément que cette cérémonie ne commença
à être ufitée que fous la fécondé race, vers le
rems où les fiefs devinrent héréditaires. Cet ufage
fut moins commun depuis François I. cependant il
y en a encore quelques exemples fous le régné de
Louis X IV . notamment en 1662 6c en 1676. :
Au lieu de donner la chevalerie par l’accolade ,
•on a établi divers-ordres de chevalerie , dont quelques
uns exigent des preuves dé nobleffe; mais aucun
*de ces ordres ne la donne.
La poffieflïon ancienne de la qualité-de chevalier
Simplement, fait une preuve de nobleffe* Foyer C hevalerie
& Ch e v a l ie r .
N o b l e s s e d e s f r a n c s ’-a r c h e r s , ou f r a n c s ^
t a u p i n s , ou comme l’appelle la Roque , N o b l e s s
e a r c h e r e ; c’eft-à-dire, qui procédé de là qualité
de francs-archers, prife par quelques-uns des
ancêtres de celui qui le prétend noble. Les francs-
archers ou francs taupins étoient une forte dé milice
établie par Charles’ VII. en 1444, compofée de gens
qui étoient exempts de tous fubfides, & que l’on
furnomma par cette raifon, francs-archers ou francs-
taupins. François I. inftitua des légions au lieu de ces
francs - archers. Quelques perfonnes iffues de ces
francs-archers fe font prétendues nobles ; mais quoique
cette milice fut libre, 6c franche d’impôt, elle
n’etoit pas noble, & l’on ne regardoit plus dès-lors
pour nobles indiftin&ement tous ceux qui faifoient
profelfion de porter les armes. Foyeç la Roque , ck,
Iv. & ci-aprèsj voye^ NOBLESSE M IL IT A IR E . "
N o b l e s s e d e s f r a n c s -f ie f s de Normandie, eft
celle qui fut accordée par Louis X I . par une charte
donnée au Montil-lez-Tours le 5 Novembre 1470,
par laquelle il ordonna entre autres chofes, que pour
les fiefs nobles acquis jufqu’alors par des roturiers
en Normandie, 6c qu’ils tenoient à droits héréditaire,
propriétaire 6c foncier, & qu’ils poffédoient noblement
à gage-plege, cour 6c ufage ; ils les pour-
roient tonir paifiblement fans être contraints de les
mettre hors de leurs mains, ni payer aucune autre
finance que celle portée par la compofition 6c ordonnance
fur ce faite par le roi , 6c qu’ils feroient
tenus & réputés pour nobles ; 6c dès-lors feroient
annoblis, enfemble leur poftérité née & à naître en
loyal mariage , 6c que la volonté du roi étoit qu’ils
jouiffent du privilège de nobleffe, comme les autres
nobles du royaume, en vivant noblement, fuivant
les armes, & fe gouvernant en tous aâes , comme
les autres nobles de la province, & ne faifant chofe
dérogeante à nobleffe.
Les enfans de ceux qui payèrent ce droit de francs-
fiefs furent maintenus dans leur nobleffe par des lettres
de Charles V I I I . du 12 Janvier i4 8 6 ,6c par
d’autres du 20 Mars de la même année.
Henri 11. par une ordonnance du 26 Mars 1556,'
régla entre autres chofes, que ceux qui prétendroient
être nobles par la charte des francs-fiefs de 1470, ne
pourroient jouir des privilèges de nobleffe, s’ils ne
faifoient apparoir des chartès particulières, tenant
leurs fiefs à cour & ufage ; & qu’eux, ou leurs fuc-
ceffeurs euffent vécu noblement, fuivant les armes,
fans avoir dérogé, auquel cas ils feroient privés de
leurs privilèges, encore qu’ils fiffent voir des quittances
particulières de la finance par eux payée.
Il y a eu en divers tems des recherches faites con?
tre ceux qui fe prévaloient fans fondement de la
charte générale des francs-fiefs : on peut voir ce qui
eft dit à ce fujet dans la Roque, ch. xxxij.
N o b l e s s e g r a d u e l l e , eft celle qui ne peut
être pleinement acquife qu’au bout d’un certain tems,
ou après deux ou trois degrés de perfonnes qui ont
rempli un office propre à donner commencement à
la n o b leffe. En France laplûpart des offices des cours
fouveraines ne donnent qu’une n o b le ffe graduelle ;
c’eft-à-dire, qu’elle n’eft acquife à la poftérité, que
quand le pere 6c le fils ont rempli fucceffivenrent de
ces offices, qui eft ce que l’on d it, p â tr e & a v o c o n fu -
libllS. Voyez c i-d e v a n t N o b l e s s e A CTUEL LE.
N o b l e s s e g r e f f é e , eft quand quelqu’un profitant
de la conformité de fon nom avec celui de quelque
famille noble, cherche à (è enter fur cette fa-,
mille, c’eft-à-dire, à fe mêler avec elle. Foye^lapréface
de la Roque. ( A )
N o b l e s s e h a u t e , (Hifl. de France.fû n’eft pas
ailé de définir aujourd’hui fi ce titre dont tant de
gens fe parent dans notre royaume, confifte dans
une nobleffe fx ancienne que l’origine enfoit inconnue,
©u dans des dignités aôuelles qui fuppofent, friais
qui ne prouvent pas toujours une véritable nobleffe.
Le point le plus intéreflànt n’eft pas cependant de
difeuter l ’objet de la nobleffe d’ancienneté ou de dignité
, mais les premières caufes qui formèrent la nobleffe
6c\ a multiplièrent.
Il femble qu’on trouvera l’origine de la nobleffe
dans le fervice militaire. Lespeuples du nord avoient
une eftime toute particuliere pour la valeur militaire
: comme par leurs conquêtes ils cherchoient la
poffeffion d’un pays meilleur que celui de leur naif-
fance ; qu ils s elhmoient confiderables à proportion
du nombre des combattans qu ils pouvoient mettre
fur pie ; & que pour lesdiftinguer des payfans ou
roturiers, ils appelloient nobles ceux qui avoient défendu
leur patrie avec courage, Ôüquiavoientaccru
leur domination par lesguerres.: or pour récompenfe
de leurs fervices, dans le partage des terres conquises*
ils leur donnèrent des francs-fiefs, à condition
de continuer à rendre à leur patrie les mêmes fervices
qu’ils lui avoient déjà rendus.
C’eft ainfi que le corps de la nobleffe fe forma en
Europe 6c devint très - nombreux ; mais ce même
corps diminua prodigièufement par les guerres des
croifades , Sc par l’exrin£Hon de plufieurs familles :
ri fallut alors de néceftité créer de nouveaux nobles.
Phi!ippe-le-Hardi, imitant l ’exemple de Philippe-le-
Bel fon predécefleur, qui le premier donna des lettres
de nobleffe en 1270 en faveur de Raoul l’orfé vre ,
c eft-à-dire, l’argentier ou payeur de fa maifon, prit
le pajn d annobür plufieurs roturiers. On employa
la meme reffource en Angleterre. Enfin en Allema-
gne-même, fi les empereurs n’euffent pas fait de
nouveaux gentilshommes, s’il n’y avoit de nobles
que ceux qui prouveroient la pofteffion de leurs châteaux
6c de leurs fiefs , ou du fervice militaire de
leurs aïeux, d^u tems de Frédéric Barberouffe, fans
doute qu’on n’en trouveroit pas beaucoup. (D . J.)
N o b l e s s e d e h a u t p a r a g e , eft celle q u i le
tire d’une famille illuftre & ancienne. Foye{ le roman
de Garm 6c Guillaume Guyart. La Roque ; chap.
y . {A)
Noblesse h ér éd it a ir e , eft celle qui paffe du
pere aux enfans 6c autres defeendans. Lanobleffenro-
venant des grands offices étoit héréditaire chez les
Komams , mais elle ne s’étendoit pas au - delà des
petits-epîans.
| ,, * . . ----- -J”
t e , ci autres qui donnent commencement à la noble)
pour les defeendans ; mais il faut que le pere 1
I aïeul ayent rempli un de ces offices pour donner
M Ë Ê Ëm ^ns qu’il foit pourvu d’un offic
femblable ; enfin il y a des offices qui tranfmettei
la nobleffe au premier degré. Foyer Noblesse a
premier degré, Noblesse /«*/* & avo Ne
blesse transmissible.
..WornESSE KdNORAiRE, eft celle qui Heconfid
qu à prendre le titre de noble , & à être confidé.
comme vivant noblement fans avoir la noUrffi ht
rcditaire : cen eft qu’t,ne«tt</eperfonhelle.(9ten'
meme que les pnviieges des nobles , comme la m
M pei tonnelle de certains officièfS: Voye, la Rt
B Ê Ê Ê M Noblesse personnelu
Noblesse illustre, eft celle qui tient le pre
d’honneur, comme (ont les prit
11 / )• ’ c e c-* encore a::- delais de ce que i’o
appelle & hauu-nohufc. ^ Loyféau,tr^edes O,
H — ■ B * S B H Haute-noblessb
d e s f iW SSEI“ MEDf t e , ep Allemagne,eft cell
de l’empire^ 2^* ° - de^ ' efs mouvans direàemen
ves que les vill W Ê B m ëÊ Ê m mêmes prércigati
la même forme“ m a k n l1 ’ prenn*ntnay#ffi,,<re<l
le droit d’arfhives ^ " pnt pas*omme ces ville
Le corps de îa nobleffe immédiate eft divîle en quâ*
tre provinces & en quirize cantons ; fav.oir, la Suabe,
qui contient cinq cantons ; la Franconie, qui encon*
ir 1 3 Pr? v*n<:e Rhin, qui en contient trois,
6c IA Kace, qui hé fait qu’un canton.
Cette nobleffe immédiate eft la prinçipâîe nobleffe
Allemagne , parce que c’eft l’empereur qui la con-
tere immédiatement. Ceux que les éledeurs anno-
bhffenr, ne font nobles que dans leurs états “ moins
que leur nobleffe ne foit confirmée par l’empereur*
F o ye t^la Roque , c. c l x x i j . & ç i-a p r è s 'N o B L E S S E MÉDIATE
& Noblesse m ix t e . (A )
N o b l e s s e im m é m o r i a l e , Ou i r r é p r o c h a *
b l e , eft celle dont on ne connoît point le cpmmen*
cernent, & qui remonte jufqu’au tems de I’établiffe-
ment des fiefs ; c’eft pourquoi on l’appelle auffi/éo-
dalt ; on l’appelle auffi irréprochable parce qu’elle
f j j couvert de tout reproche ou foupçon d’anno-
bhffement. Foye{ la Roque , préface.
Noblesse inféodée ou féo d ale, eft celle qui
tire fon origine de, Ja poffeffion ancienne de quelque
fief. Fjyei ci-deffus NOBLESSE FÉODALE.
Noblesse irré pr ochab le , eft celle dont l’o-
figine eft fi ancienne, qu’elle eftau-deffusile tout
reproche d’annobliffement fait par lettres ou office,
de maniéré qu’elle eft réputée pour nobleffe de race
& d’ancienne extrâ&iôn. Foye^ la préface de là Ro-
que.
N o b l e s s e d e l a i n e , eft la fécondé claffe de
la nobleffe. Dans la ville de Florence on y diftingue
deux fortes de nobleffe pour le gouvernement ; fa-
voir la nobleffe de foie 6c la nobleffe de laine. La première
eft plus relevée & plus qualifiée que la fécondé.
Il y a apparence que ces différentes dénominations
viennent de la différence des habits. Cette dif-
tinfrion de deux fortes de nobleffe fe fait au reoard du
gouvernement de la ville. Foye^ le traité de la No-
bluffe par de la Roque , chap. exij. & clxvj. \ ,
N o b l e s s e l i b e r a l e , eft celle que l’on a accordée
a ceux qui poufiés d’un beau zele ont dépenfe
leur bien pour la défenfe de la patrie. Foye1 la préfau
de la Roque. • ;
Noblesse de lettres , eft celle qui eft accordée
aux gens de lettres , 6c aux gradués & officiers
de judicature. On l’appelle anfli nobleffe littéraire.
Voyez ci-après Noblesse l it t é r a ir e .
Noblesse par le t t r e s , eft celle qui provient
de lettres d’annobliffement accordées par le prince.
M. d Hozier dans l’hiftoirë d’Amanzé , rapporte
une charte d annobliffement du 24 Juin 1008, mais
cette charte eft fufpeéle.
D ’aiîtres prétendent que les premières lettres
d’annobliffement furent données en 1095 par Philips
pe I. à Eudes le Maire, dit Chalo S. Mars.
On fait encore mention de quelques autres lettres
de nobleffe données par Philippe Augufte. •
Mais il eft plus certain qu’ils commencèrent fous
Philippe III. car il fe voit un annobliffement de c c
tems qu’il accorda à Raoul l’orfévre.
Ses iucceffeurs en accordèrent auffi quelques-uns;
mais ils devinrent plus ftéquens fous Philippe de Valois
, 6c il en accorda dès-lors moyennant finance 8c
fans finance ; car la charte de nobleffe de Guillaume
de Dormans en 1339 ; fait mention qu’elle fut donnée
fans finance, & en 13 54, Jean de Reims paya
trente écus d’or ; un autre en 13 5 5 en paya quatre-
vingt.
Dans la fuite il y a eu des annobliffemens créés
par éd it, & dont la finance a été réglée ; mais ils
ont toujours été fui vis de lettres particulières pouf
chaque perfonne qui devoit profiter de la grâce portée
par l’édit.
Charles IX. créa douze nobles en 1564 ; il en
çréa encore trente par édit de 1568*