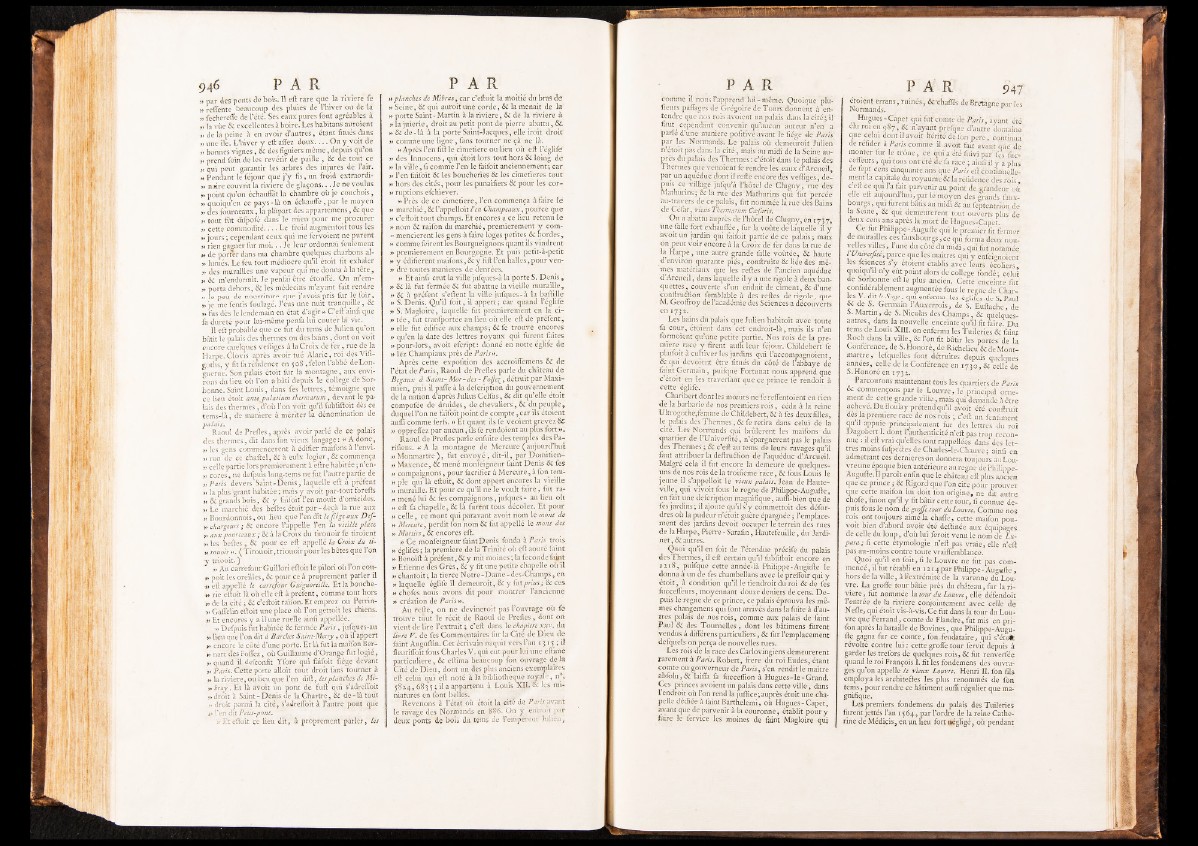
» par des ponts de bois. Il eft rare que la riviere fe
„ reflente beaucoup des pluies de l’hiver ou de la
» fechereffe de l’été. Ses eaux pures font agréables à!
» la vue & excellentes à boire. Les habitans auroient
„ de la peine à en avoir d’autres, étant fxtués dans
„ une île. L’hiver y eft allez doux----On y voit de
» bonnes vignes, & des figuiers même, depuis qu’on
» prend foin de les revêtir de paille , & de tout ce
» qui peut garantir les arbres des injures de l’air.
» Pendant le féjour que j’y fis, un froid extraordi-
» mûre couvrit la riviere de glaçons.. . Je ne voulus
» point qu’on échauffât la chambre où je couchois,
» quoiqu’en ce pays-là on échauffe, par le moyen
» des fourneaux, la plûpart des appartenons, & que
» tout fut difpofé dans le mien pour me procurer
» cette commodité..’ . . Le froid augmentoit tous les
» jours ; cependant ceux qui me fervoient ne purent
» rien gagner fur m oi.. . Je leur ordonnai feulement
» de porrer dans ma chambre quelques charbons al-
» lumés. Le feu tout médiocre qu’il étoit fit exhaler
» des fnürallles une vapeur qui me donna à la tê te ,
» &c m’endormit. Je penfai être étouffé. On m em-
» porta dehors, & les médecins m’ayant fait rendre
» le peu de nourriture que j’avois pris fur le foir,
» je mefentis foulagé. J’eus une nuit tranquille, &
» fiis dès le lendemain en état d’agir » C ’eft ainfi que
fa dureté pour lui-même penfa lui coûter la' vie.
Il eft probable que ce frit du tems de Julien qu’on
bâtit le palais des thermes ou des bains, dont on voit
encore quelques veftiges à la Croix de fe r , rue de la
Harpe. Clovis après avoir tué Alaric, roi Tes Vifi-
goths, y fit faréfidence en 508 , félon l’abbé deLon-
guerue. Son palais étoit fur la montagne, aux environs
du lieu où l’on a bâti depuis le college de Sorbonne.
Saint Louis, dans fes lettres, témoigne que
ce lieu étoit antejalatium thermarum, devant le palais
des thermes , d’où l’on voit qu’il fubfiftoit des ce
tems-là, de maniéré à mériter la dénomination de
^ Raoul de Prefles, après avoir parlé de ce palais
des thermes, dit dans foh vieux langage : « A donc,
» les gens commencèrent à édifier maifons à l’envi*
» ron de ce chaftel,& à eùlx logier, & commença
» celle partie lors premièrement à eftre habitée ; n’en-
» cores, ne defpuis long-tems ne fut l’autre partie de
» Paris devers Saint-Denis, laquelle eft à préfent
» la plus grant habitée ; mais y avoit par-tout forefts
» & Grands bois, & y faifoit l’en moult d’omicides.
» Le marchié des beftes étoit par - deçà la rue aux
» Bourdonnois, ou lieu que l’en dit le Jiège aux Défit
chargeurs g & encore l’appelle l’en la vieille place
» aux pourceaux ; & à la Croix du tirouoir fe tiroient
» les beftes , & pour Ce eft appellé la Croix du ti-
» rouoir ». ( Tirouoir,triouoir pour les bêtes que l’on
y triooit. ) .
» Au carrefour Guillori eftoit lè pilori où l’on cou-
» poit les oreilles, & pour ce à proprement parler il
•» eft appellé le carrefour Gûiguordlle. Et la bouche-
» rie eftoit là où elle eft à préfent, comme tout hors
» de la cité ; & c’eftoit raifon. Ët emprez ou Pernn-
» Gâffelin eftoit une place où l’on gettoit les chiens.
■ » Et encores y a il une ruelle ainfi appellée.
» Defpuis Fut habitée & fermée Paris , jufques-au
» lieu que l’on dit à B archet Saint-Merry, où il appert
» encore le côté d’une porte. Et là fut la maifon Bér-
» nart des Fofiéz, où Guillaume d’Orange fut logie,
» quand il defconfit Yfore qui faifoit fiége devant
» Paris. Cette porte alloit tôut droit fans tourner à
» la riviere, ou lieu que l’en dift, les planches de Mi-
y> bray. Et là âvoit un pont de fuft qui s’àdre'flbit
»droit à Saint-Denis de laChartre, & de -là tout
» droit parmi la cité, s’adreffoit à l’autre pont què
t> l’en dit Petit-pont.
» Et eftoit çe lieu dit, 'à proprément parler, les
» planches de Mibras, car c’ eftoit la moitié du bras de
» Seine, & qui auroit une corde, & la menait de la'
» porte Saint - Martin à la riviere, & de la riviere à
» la juierie, droit au petit pont de pierre abattu, &
» & de -là à la porte Saint-Jacques, elle iroit droit
» comme une ligne, fans tourner ne çà ne là.
»Après l’en fift le cimetiere ou lieu où eft l’églifé
» des Innocens, qui étoit lors tout hors & loing dé
» la v ille , fi comme l’en le faifoit anciennement; car
» l’en faifoit & les boucheries & les cimetières tout
» hors des cités, pour les punaifiers & pour les cor-
» ruptions efchiever.
» Près de ce cimetiere, l’en commença à faire lé
» marchié, & l’appelloit l'en Champeaux, pource que
» c’ eftoit tout champs. Et encores a ce lieu retenu le
» nom & raifon du marchié, premièrement y com-
>3 mencierent les gens à faire loges petites & bordes,
» comme feirent les Bourgueignons quant ils vindrent
» premièrement en Bourgogne. Et puis petit-à-petit
» y édifièrent maifons, & y .fift l’en halles ,pour ven-
» dre toutes maniérés de denrées.
» Et ainfi crut la v ille jufques-à la porte S. Denis ,
» & là fut fermée & fut abattue la vieille muraille I
» & à préfent s’eftent la ville jufques-à la baftille
» S.Denis. Qu’il foit, il appert; car quand l’églife
» S. Magloire, laquelle fut premièrement en la ci-
» tée, fut tranfportée au lieu où elle eft de préfent,
» elle fut édifiée aux champs ; & fe trouve encores
» qu’en la date des lettres royaux qui furent faites
» pour-lors, avoit efcript : donné en notte églife de
» îéz Champiaux près de Paris».
Après cette expofition des accroiffemens & de
l’état de Paris, Raoul de Prefles parle du château de
Bega.ux à Saint- Mor-des - Fotfe{ , détruit par Maxi-
mièn, puis il paffe à la defcription du gouvernement
de la nation d’après Julius Celfus, & dit qu’elle étoit
compofée de druides, de chevaliers, & du peuple,
duquel l’on ne faifoit point de compte, car ils étoient
aum comme ferfs. « Et quant ils fe veoient grevez ôc
» oppreffez par aucun, ils fe rendoient au plus fort »J
Raoul de Prefles parle enfuite des temples dés Pa-
rifiens. « A la montagne de Mercure (aujourd’hui
» Monmartre ) , fut en vo yé, dit-il, par Domitien-
» Mayence, & mené monfëigneur faint Dénis & fes
» compaignons, pour facrifier à Mercure, à fon tem-
» pie qui là eftoit, &c dont appert encores la vieille
» muraille. Et pour ce qu’il ne le voult faire, fut ra-
» mené lui & fes compaignons, jufques- au lieu où
» eft fa chapelle, & là furent tous décolez. Et pour
» celle, ce mont qui paravant avoit nom le mont de
» Mercure, perdit fon nom & fut appellé le mont des
» Mar tirs, & encores eft.
» Ce monfeigneur faint Denis fonda à P avis^ trois
» églifes ; la première de la Trinité où eft aoure faint
» Benoift à préfent, & y mit moines ; la fécondé faint
» Etienne des Grès, & y fit une petite chapelle où il
» chantoit; la tierce N otre-Dame-des-Champs, en
» laquelle églife il demeuroit, & y fut prius; & ces
» chofes nous avons dit pour montrer l’ancienne
» création de Paris ».
Au refte, on ne devineroit pas l’ouvrage où le
trouve tout le récit de Raoul de Prefles, dont on
vient de lire l’extrait ; c’ eft dans le chapitre xxv. du
livre V. de fes Commentaires fur la Cité de Dieu de
faint Augiiftin. Cet écrivain naquit vers l’an 1 3 1 5 ; il
fleuriffoit fous Charles V. qui eut pour lui une eftimé
particulière, & eftima beaucoup fon ouvrage de la
Cité de D ieu, dont un des plus anciens exemplaires
eft celui qui eft noté à la bibliothèque royale, n°*
5824,683 5 ; il a appartenu à Louis XII. 6c les mi-
niafures en font belles. 3 ,; , ,
Revenons à l’état où étoit la cité de Paris avant
le ravage des Normands en 88*6. On ÿ entre<1 par
deux ponts de bois du tems de ■l’empèfeur Julien*.
comme il nous l’apprend lui - même. Quoique plù-
fieurs paffages de Grégoire de Tours donnent à entendre
que nos vois avaient un palais dans la cité ; il
faut ^ cependant ^ convenir qu’aucun auteur n’en a.
parlé d’une maniéré pofitivè- àvant le fiége de Paris
par les Normands. Le palais où demeuroit Julien'
n etoit pas dans la cité, mais au midi de la Seine auprès
du palais des Thermes : c’étoit dans le palais des
Thermes que venoient fe rendre les eaux d’Arcueil,
par un aqueduc dont il refte encore dés veftiges, depuis
ce village jufqu’à l’hôtel de Clugny, me des'
Mathurins ; & la nie des Mathurins qui fut percée
au-travers de ce palais, fut nommée la rué dès Bains
de Cefar, viens Thermarum CcefariS. "
On a abattu auprès de l’hôtel de Clugny, en 1737,
une falle fort exhaufîee, fur la voûte de laquelle il y
avoit un jardin qui faifoit partie de ce palais ; mais
on peut voir encore à la C roix dé fer dans la' rue de
la Harpe, une autre grande falle voûtée, & haute
d’envirori quarante piés, conftruite & liée des mêmes
matériaux que les reftes de l’ancien aquéduc
d ’Arcueil, dans laquelle il y a une rigole à deux banquettes,
couverte d’un enduit de ciment, & d’une
conftruâion femblable à des reftes de rigole , que
M. Geoffroy de l’académie des Sciences a découverts
en 1732. ;
Les bains du palais que Julien habitoit avec toute
fa cour , étoient dans cet endroit-là, mais ils n’ en
formoient qu’une petite partie. Nos rois de la première
race y firent aufîi leur féjour. Cliildebert fe
plaifoit à cultiver les jardins qui l’accompagnoient,
& qui dévoient être fitués du côté de l’abbaye de
faint Germain, puifque Fortunat nous apprend que
c’étoit -en les traverfant que ce prince fe rendoit à
cette églife.
Charibert dont les moeurs ne fe reffentoient en rien
de la barbarie de nos premiers rois, céda à la reine
Ultrogothe, femme de Childebert, & à fes deux filles,
le çalais des Thermes, & fe retira dans celui de dâ
cite. Les Normands qui brûlèrent les maifons du
qnartier de l’Univerfité, n’épargnèrent pas le palais
des Thermes ; & c’eft au tems de leurs ravages qu’il
faut attribuer la deftru&ion de l’aquéduc d’Arcueil.
Maigre cela il fut encore la demeure de quelques-
uns de nos rois de la troifieme race, & fous Louis le
jeune.il s’appelloit le vieux palais.'] enn de Haute-
ville, qui vivoit fous le régné dé Philippe-Augufte,
en fait une defcription magnifique, auffi-bien que de
fes jardins ; il ajoute qu’il s’y commettoit des défor-
dres où la pudeur n’étoit guère épargnée ; l’emplacement
des jardins devoit occuper le terrein des rues
de la Harpe, Pierre - Sarafin, Hautefeuille, du Jardinet
, & autres.
Quoi qu’il en foit de l’étendue précife du palais
des Thermes, il eft certain qu’il fubfiftoit encore en
j z i 8, puifque cette année-là Philippe-Augiifte le
donna à un de fes chambellans avec le preffoir qui y
étoit, à condition qu’il le tiendroit du roi & de fes
fucceffeurs, moyennant douze deniers'de cens. Depuis
le régné de ce prince, ce palais éprouva les mêmes
changemens qui font arrivés dans la fuite à d’autres
palais de nos rois, comme aux palais de faint
Paul & des Tournelles, dont les bâtimens furent
vendus à différens particuliers, & fur l’emplacement
defquels on perça de nouvelles rues.
Les rois de la race des Carlovingiens demeurèrent
rarement à P arts. Robert, frere du roi Eudes, étant
comte ou gouverneur de Paris, s’en rendit le maître
abfolu, & laiffa fa fuceéffion à Hugues-le-Grand.
Ces princes a voient un palais dans cette v ille, dans
l’endroit où l’on rend la juftice; auprès étoit une chapelle
dediee à faint Barthelemi, où Hugues-Capet,
avant que de parvenir à la couronne, établit pour y
faire le fervice les moines de faint Magloire qui
étoient errans, m inés, &*chaffés de Bretagne par les
Normands.,
Hugues-Capet qui futcomtede Paris, ayant été
élu roi en 987, &c n’ayant prêfque d’autre domaine
que celui dont il avoit hérité de fon pere , continua
de refider à Paris^ comme il avoit fait avant que de
monter fur le trône, ce qùi a'été fuivi parafes fi’ic-
• feffeursi, qui tous ont été de'fa racé ; ainfi il y à plus
de fept cens cinquante,ans que Paris eft continuellement
la capitale du royaume&la réfidencë dés rpis,
c’eft ce qui l’a fait parvenir au point de grandeur où
elle eft aujourd’hui, par lé'moyen des grands fatix-
bourgs, qui furent bâtis au miefi' & au feptentrion de
la Seine, & qui demeurèrent tout ouverts plus'de
deux cens ans après la môrf de Hugues-Çapet.
Ce fut(Philippe-Augufte qui le premier fit fermer
de murailles cës fauxbourgs , ce qui forma deux nouvelles
villes, l’une du côte du m idi, qui fut nommée
VUniverfité; parce que les maîtres qui y ënfeignôîént'
les lciences s’y etoient établis avec leurs écoliers,
quoiqu’il n’y eût point alors de college.fondé; celui
de Sorbonne-èft le plus ancien. Cette enceinte fut
confiderablement augmentée fous le regne de Char-
les V. dit le Sage, qui enferma Tes églilès.de S. Paul
oc de S. Germain l’Auxerrois, de S. Euftàche, de
S. Martin, de S. Nicolas des Champs, & qüelques-
autres, dàns la nouvelle enceinte qu’il fit faire? Du
tems^de Louis XIII. on enferma les Tuileries. & faint
Roch dans la ville, & l’on fit bâtir les portés de la
Conférence, de S. Honoré, de Richelieu &: de Montmartre,
lefquefles font détruites depuis quelques
années, celle de la Conférence en 1730, & celle de
S. Honoré en 173 2. ' -
Parcourons maintenant tous les quartiers de Paris
& commençons par le Louvre, le principal ornement
de cette grande ville, mais qui demande à être
achevé. Du Boulay prétend qu’il avoit été conftruit
des la première race de nos-rois ; c’eft un fentiment
qu’il appuie principalement fur des lettrés du roi
Dagobert I. dont l’authenticité n’eft pas trop reconnue
: il eft vrai qu’elles font rappellées dans des lettres
moins fufpeftes de Charles-le-Chauve ; ainfi en
admettant ces dernieres on donnera toujours au Louvre
une époque bien antérieure au regne de Philippe-
Augufte. Il paroît enfin que le château eft plus ancien
que ce prince ; & Rigord que l’on cite pour prouver
que cette maifon lui doit fon origine, ne dit autre
chofe, finon qu’il y fit bâtir cette tour, fi connue depuis
fous le nom de große tour du Louvre. Comme nos
rois ont toujours aime la chaffe, cette maifon pou-
voit bien d’abord avoir été deftinée aux équipages
de celle du loup, d’où lui feroit venu le nom de Lu-
para; fi cette étymologie n’eft pas vraie, elle n’efl:
pas. au-moins contre toute vraiffemblance.
Quoi qu’il en foit, fi le Louvre ne fut pas commencé
, il fut rétabli en 1214 par Philippe- Augafte ,
hors de la ville, à ^extrémité de la varenne du Louvre.
La große tour bâtie près du château, fur la rivière
, fut nommee la tour du Louvre, elle défendoit
l’entrée de la riviere conjointement avec celle de
N elle, qui étoit vis-à-vis. Ce fut dans la tour du Louvre
que Ferrand, comte de Flandre, fut mis en pri-
fon après la bataille de Bovines, que Philippe-Augu-
fte gagna fur ce comte, fonYeudataire, qui s’étolt
révolté contre lui : cette grofîe tour fervit depuis à
garder les trefors de quelques rois, & fut renverfée
quand le roi François I. fit les fondemens des ouvrages
qu’on appelle le vieux Louvre. Henri II. fön fils
employa les architeftès les plus renommés de fon
tems, pour rendre ce bâtiment aufli régulier que magnifique.
Les premiers fondemens du palais des Tuileries
furent jettés l’an 1564, par l’ordre de la reine Catherine
de Médieis, en un lieu fort négligé, où pendant