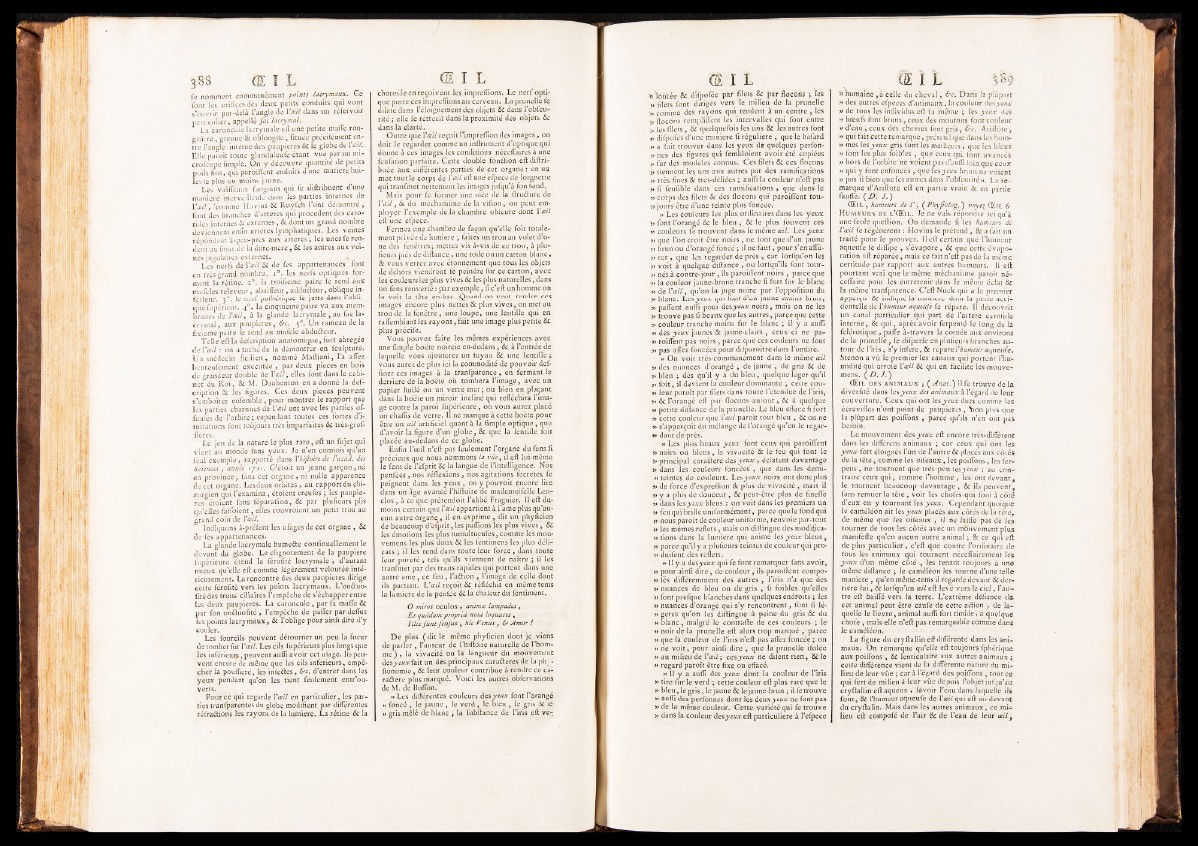
^88 OEIL
fe nomment communément points lacrymaux. Ce
'font les orifices des deux petits conduits qui vont
s’ouvrir par-delà l’angle de l 'oeil dans un réfervoir
particulier, appellé fac lacrymal. ^
La caroncule lacrymale eft une petite maffe rougeâtre
, grenue & oblongite, fituée précifement entre
l’angle interne des paupières 8c le globe de 1 ail.
Elle paroît toute glanduleufe étant vue jsar un mi-
crofcope fimple. On y découvre quantité de petits
poils fins, qui paroiffent enduits dune matière hui-
leufe plus ou moins jaune. .
Les vaiffeàux fanguins qui fe diftribuent d une
maniéré merveilleufe dans les parties internes cle
Y oeil t ‘comme Hovius 8c Ruyfch l’ont démontré ,
font des branches d’arteres qui procèdent des carotides
internes & externes, & dont un grand nombre
deviennent enfin arteres lymphatiques. Les veines
répondent à-peu-près aux arteres ; les unes fe rendent
au finus de la dure-mere, 6c les autres aux veines
jugulaires externes, #
Les nerfs de l'oeil 8c de fes appartenances font
en très-grand nombre. i° . les nerfs optiques forment
la rétine. 2°. la troifieme paire fe rend aux
mnfcles releveur, abaiffeur, addufteur, oblique inférieur.
3°. le nerf pathétique fe jette dans l’oblique
fupérieur. 40. la cinquième paire va aux membranes
de l'oeil, à la glande lacrymale , au fac lacrymal,
aux paupières, &c. 50. Un rameau de la
fixieme paire fe rend au mufcle abdufteur.
Telle eftla defeription anatomique, fort abrégée
de l'oeil : on a taché de la démontrer en fculprure.
Un médecin ficilien, nomme Maftiani, la allez
heureufement executée , par deux pièces en bois
de grandeur double de Y ail-y elles font dans le cabinet
du Roi, & M. Daubenton en a donné la defeription
& les figures. Ces deux pièces peuvent
s’emboîter enfemble , pour montrer le rapport que
les parties charnues de Yail ont avec les parties of-
feufes de l’orbite ; cependant toutes ces fortes d’imitations
font toûjours très-imparfaites ôc très-grof-
iieres.
' Le jeu de la nature le plus rare, eft un fujet qui
vient au monde fans yeux. Je n’en connois qu’un
feul exemple , rapporté dans Yhifioire de Vacad. des
Sciences, année 1721. G*étoit un jeune garçon,né
en province, fans cet organe, ni nulle apparence
de cet organe. Les deux orbites > au rapport du chirurgien
qui l’examina, étoient creufes ; les paupières
étoient fans féparation, 8c par plusieurs plis
qu’elles faifoient, elles couvroient un petit trou au
grand coirt de Yail.
Indiquons à-préfent les ufages de cet organe , 8c
de fes appartenances.
La glande lacrymale hume&e continuellement le
devant du globe. Le clignotement de la paupière
fupérieure étend la férofité lacrymale , d’autant
mieux qu’elle eft comme légèrement veloutée intérieurement.
La rencontre des deux paupières dirige
cette férofité vers les points lacrymaux. L’onttuo-
fité des trous ciliaires l’empêche de s’échapper entre
les deux paupières. La caroncule , par fa malle 8c
par fon onéluofité, l’empêche de palier par-deffus
les points lacrymaux, & l’oblige pour ainfi dire d’y
couler.
Les fourcils peuvent détourner un peu la fueur
de tomber fur Y oeil. Les cils fupérieurs plus longs que
les inférieur, peuvent aulîi avoir cet ufage. Ils peuvent
encore de même que les cils inférieurs, empêcher
la poufliere, les infeétes, &c. d’entrer dans les
yeux pendant qu’on les tient feulement entr’ou-
verts.
Pour ce qui regarde Y oeil en particulier, les parties
tranfparentes du globe modifient par différentes
réfractions les rayons de la lumière. La rétine 6c la
<E I L
choroïde en reçoivent les imprelîions. Le nerf optique
porte ces imprelîions au cerveau. La prunelle fe
dilate dans l’éloignement des objets 8c dans l’obfcu-
rité ; elle fe rétrécit dans la proximité des objets 8c
dans la clarté.,
Outre que Y oeil.reçoit l’impreflion des images, on
doit le regarder comme un inftrument d’optique qui
donne à ces images les conditions néceffaires à une
fenfation parfaite. Cette double fon&ion eft diftri-
buée aux différentes parties de cet organe : en un
mot tout le corps de Yail eft une efpece de lorgnette
qui tranfmet nettement les images jufqu’à fon fond.
Mais pour fe former une idée de la ftruûure de
Y a il, & du méchartifme de la vilion, on peut employer
l’exemple de la chambre obfcure dont Yail
eft une efpece.
Fermez une chambre de façon qu’elle foit totalement
privée de lumière ; faites un trou au volet d’une
des fenêtres; mettez vis à-vis de ce trou, à plufieurs
piés de diftance, une toile ou un carton blanc,
& vous verrez avec étonnement que tous les objets
de dehors viendront fe peindre fur ce carton, avec
les couleurs les plus vives 8c les plus naturelles, dans
un fens renverfé : par exemple, fi c’eft un homme on
le voit la tête en-bas. Quand on veut rendre ces
images encore plus nettes & plus vives, on met au
trou de la fenêtre, une loupe, une lentille qui en
raffemblant les rayons, fait une image plus petite 8c
plus précife.
Vous pouvez faire les mêmes expériences avec
une fimple boëte noircie en-dedans, 6c à l’entrée de
laquelle vous ajouterez un tuyau 6c une lentille ;
vous aurez de plus ici la commodité de pouvoir def-
finer ces images à la tranfparence, en fermant le
derrière de la boëte où tombera l’image, avec un
papier huilé ou un verre mat ; ou bien en plaçant
dans la boëte un miroir incliné qui réfléchira l’image
contre la paroi fupérieure, où vous aurez placé
un chaflis de verre. Il ne manque à cette boëte pour
être un ail artificiel quant à la fimple optique, que
d’avoir la figure d’un globe, 6c que la lentille foit
placée au-dedans de ce globe.
Enfin l’oeil n’eft pas feulement l’organe du fens fi
précieux que nous nommons la vue, il eft lui-même
le fens de l’efprit 6c la langue de l’intelligence. Nos
penfées, nos réflexions, nos agitations fecretes fe
peignent dans les y e u x , on y pouvoit encore lire
dans un âge avancé l’hiftoire de mademoifelle Len-
clos, à ce que prétendoit l’abbé Fraguier. 11 eft du-
moins certain que Yoeil appartient à l’ame plus qu’aucun
autre organe,, il en exprime , dit un phyficien
de beaucoup d’efprit, les pallions les plus viv es , 6c
les émotions les plus tumultueufes, comme les mou*
vemens les plus doux 6c les fentimens les plus délicats
; il les rend dans toute leur force , dans toute
leur pureté, tels qu’ils viennent de naître ; il les
tranfmet par des traits rapides qui portent dans une
autre ame, ce feu , l’ a&ion , l’image de celle dont
ils partent. L’oeil reçoit ôc réfléchit en même tems
la lumière de la penfée 6c la chaleur du fentiment.
O miros oculos , anima lampades ,
Et quâdam propriâ nota loquaces ,
Illîcfunt fenfus , hîc Vtnus , & Amor !
De plus (dit le même phyficien dont je viens
de parler , l’auteur de l’hiftoire naturelle de l’homme
) , la vivacité ou la langueur du mouvement
des yeux fait un des principaux cara&eres de la ph\ -
fionomie, 6c leur couleur contribue à rendre ce ca-
ra&ere plus marqué. Voici les autres obfervations
de M. de Buffon.
» Les différentes couleurs des yeux font l’orangé
» foncé , le jaune , le v erd , le bleu , le gris 6c le
» gris mêlé de blanc ; la fubftance de l’iris eft ve-
XË ï L
C o û té e 6c difpofée par filets 6c par flocons ; les
*„ filets font dirigés vers le milieu de la prunelle
comme des rayons qui tendent à un centre , les
»flocons rempliffent les intervalles qui font entre
» les filets , 6c quelquefois les uns 6c les autres font
» difpofés d’une manière fi régulière , que le hafard
» a fait trouver dans les yeux de quelques perfon-
» nés des figures qui fembloient àvoir été copiées
» fur des modèles connus. Ces filets 6c ces flocons
» tiennent les uns aux autres par des ramifications
» très-fines 6c très-déliées ; aufli la couleur n’ëft pas
» fi fenfible dans cés ramifications, que dans le
» corps des filets 8c des flocons qui paroiffent tou-
» jours être d’une teinte plus foncée-.
» Les couleurs les plus ordinaires dans les yeux
» font l’orangé 6c le bleu , 6c le plus fou vent ces
» couleurs fe trouvent dans le même oeil. Les yeux
» que l’on croit être noirs , ne font que d’un jaune
» brun ou d’orangé foncé; il ne faut, pour s’en affû-
» re r , que les regarder de près •, eût lorfqu’on lés
» voit à quelque diftance , ou lorfqu’ils font totir-
» nés à contre-jour, ils paroiffent noirs , parce que
» la couleur jaune-brune tranche fi fort fur le blanc
,> de Y oeil, qu’on la juge noire par l’oppofition du
» blanc. Les yeux qui font d’un jaune moins brun,
9> paffent aufli pour des yeux noirs, mais on rie lés
& trouve pas fi beaux que les autres, parce que cette
9> couleur tranche moins fur le blanc ; il y a aufli
9> des yeux jaunes 8c jaune-clairs , ceux-ci ne pa-
roiffent pas noirs, parce que ces couleurs ne font
*> pas affei foncées pour difparoître dans l’ombre.
» On voit très-communément dans le même oeil
» des nuances d’orangé , de jaune , de gris 8c de
s> bleu ; dès qu’il y a du bleu, quelque léger qu’il
foit, il devient la couleur dominante ; cette cou-
3>) leur paroît par filets dans toute l’étendue de Fins,
9> 8c l’orangé eft par flocons autour, 6c à quelque
» petite diftance de la prunelle. Le bleu efface fi fort
» cette couleur que Y oeil paroît tout bleu , 6c on ne
» s’apperçoit du mélange de l’orangé qu’en le regar-
» dant de‘près.
» Les plus beaux j >eux font ceux qui paroiffent
» noirs Ou bleus, la vivacité 8c le feu qui font le
»principal caraétere des yeux y éclatent davantage
»dans les couleurs foncées', que dans les demi-
» teintes de couleurs. Les yeux noirs ont donc plus
» de forcé d’eXpreflion 8c plus de vivacité , mais il
» y a plus de douceur , & peut-être plus de fineffe
» dans 1 es yeux bleus : on voit dans les premiers un
» feu qui brille uniformément, parce quele fond qui
» nouS paroît de couleur uniforme, renvoie par-tout
» les mêmes reflets, mais on diftingue des modiÇca-
» tions dans la lumière qui anime les yeux bleus ,
» parce qu’il y a plufieurs teintes de couleur qui pro-
» duifent des reflets i
» 11 y a desyeux qui fe font remarquer fans avoir,
» pour ainfi dire, de couleur, ils paroiffent cornp©-
» fés différemment des autres , l’iris n’a que des
» nuances de bleu ou de gris , fi foibles qu’elles
» font prefque blanches dans quelques endroits ; les
» nuances d’orangé qui s’y rencontrent, font-fi lé-
» gérés qu’on les diftingue à peine du gris & du
» blanc, malgré le contrafte de ces couleurs ; le
• » noir de la prunelle eft alors trop marqué , parce
» que la couleur de l’iris n’eft pas affez foncée ; on
» ne v o it , pour ainfi dire , que la prxtnelle ifolée
» au milieu de Yoeil ; ces yeux ne dif ènt rien, ôc le
» regard paroît être fixe ou effacé.
» Il y a aufli des yeux dont fa couleur de l’iris
» tire fur le verd ; cette couleur eft plus rare que le
» bleu, le gris, le jaune & le jaune-brun ; il fe trouve
» aufli des perfonnes dont -les de\xxyeux ne font pas
» de la même couleur. Cette variété qui fe trouve
» dans la couleur des yeux eft particulière à l’efpece
fs ï L lit
b h u m a i n e , à c e l l e d u c h e v a l , & c . D a n s fa p lu p a r t
» d e s a u t r e s e f p e c e s d ’ a n im a u x , l a c o u l e u r d esyeux
» d e t o u s l e s in d i v id u s è f t l a même ; l e s yeux d e s
» b oe u f s f o n t b r u n s , c e u x d é s m o u t o n s f o n t c o u l e u r
» d ’ e a u -, c e u x d e s c h e v r e s f o n t g r i s , & c . A r i f t o t e ,
» q u i f a i t c e t t e r e m a r q u e , p r é t e n d q u e d a n s l e s h o m -
» m e s 1 esyeux g r i s f o n t l e s m e i l l e u r s , q u e l e s b l e u s
'» f o n t l e s p lu s f o i b î e s , q u e c e u x q u i f o n t a v a n c é s
» h o r s d e l ’o r b i t e n e v o i e n t p a s d ’ a u f l i l ô ïn ’q u e c e u x
» q u i y f o n t e n f o n c é s , q u e 1 esyeux b r u n s n e v o i e n t
» p a s l i b i e n q u e l e s a u t r e s d a n s l ’o b f c u r i t é » . L a r e m
a r q u e d ’A r i f t o t e e f t e n p a r t i e v r a i e 8c e n p a r t i e
f a u f f e . ( Z > . J . ' )
(EiL , h um e u r s d e ( P h y j î o lo g .) voye^ CE IL &
Humeurs de l’CEil. J é n e v a i s r é p o n d r e i c i q u ’ à
u n e f e u l e q u e f t i o n . O n d e m a n d e f i l e s h um eu r s de
l 'oe i l f e r é g é n è r e n t : H o v i u s l é p r é t e n d , & a f a i t u n
t r a i t é p o u r l e p r o u v e r . I l e f t c e r t a i n q u e l ’h u m e u r
a q u e u f e f è d i f l i p e , s ’ é v a p o r e , & q u e c e t t e é v a p o r
a t i o n e f t r é p a r é e , m a i s c e f a i t n ’ e f t p a s d e l a m ê m e
c e r t i t u d e p a r r a p p o r t a u x a u t r e s h u m e u r s . Il e f t
p o u r t a n t v r a i q u e l e m êm e m é c h a n i lm e p a r o î t n é -
c e f f a i r è p o u r l e s é n t r e t e n i r d a n s l e m ê m e é c l a t 6 c
l a m ê m e t r a n f p a r e n c e . C ’ e f t N u c k q u i a l e p r e m i e r
a p p e r ç u 6 c in d iq u é l a m a n i é r é d o n t la p e r t e a c c i d
e n t e l l e d e Y h um e u r a q u e u fe f e r é p a r e . I l d é c o u v r i t -
u n c a n a l p a r t i c u l i e r q u i p a r t d é l ’ à r t e r e c a r o t i d e
i n t e r n e , ô c q u i , a p r è s a v o i r f e r p e n t é l e l o n g d e l à
f e l é r o t i q u e , p a f f e à - t r a v e r s l a c o r n é e a u x e n v i r o n s
d e l a p r u n e l l e , f e d i f p e r f e e n p lu f i e u r s b r a n c h e s au-^
t o u r d é l ’i r i s , s ’ y i r i f e r e , 8c r é p a r e Y humeur a q u e u f e .
S t e n o n a v û l e p r e m i e r l e s c a n a u x q u i p o r t e n t l’hu^
m i d i t é q u i a r r o l e Yoeil 6c q u i e n f a c i l i t e l e s m o u v e z
m e n s . ( D . J . )
OEil des animaux -, ( Anat.) i l f e t r o u v e d e l à
d i v e r f i r é d a n s l e s yeux des animaux à l ’ é g a r d d e l e u r
c o u v e r t u r e . C e u x q u i o n t \esyeux d u r s c o m m e l e s
é c r e v i f l e s n ’ o n t p o in t d e p a u p i è r e s , *h o n p lu s q u e
l a p lu p a r t d e s p o i f f o n s , p a r c e q u ’ i l s n ’ e n o n t p a s
b e ï b i n .
L e m o u v e m e n t d e s yeux e f t e n c o r e t r è s - d i f f é r e n t
d a n s l e s d i f f é r e n s a n im a u x ; c a r c e u x q u i o n t l e s
yeux f o r t é l o i g n é s l ’u n d e l ’ a u t r e ô c p l a c é s a u x c ô t é s
d e l a t ê t e , c o m m e l e s O i f e a u x , l e s p o i f f o n s , 1 l e s f e r -
p e n s , n é t o u r n e n t q u e t r è s - p e u 1 esÿèux : a u c o n t
r a i r e c e u x q u i , c o m m e l’ h o m m e , l e s o n t d e v a n t ,
l e t o u r n e n t b e a u c o u p d a v a n t a g e , 6 c - i l s p e u v e n t ,
f a n s r e m u e r l a t ê t e , v o i r l e s c h o f e s q u i - f o n t à c ô t é
d ’ e u x e n y t o u r n a n t l e s yeux. C e p e n d a n t q u o iq u ë
l e c a m é l é o n a i t l è s yeux p l a c é s a u x c ô t é s d e l a t ê t e ,
d e m ê m e q u e l é s o i l è a u x , i l n e J a ï f le p a s d e l e s
t o u r n e r d e t o u s l e s c ô t é s a v e c u n m o u v e m e n t p l u s
m a n i f e f t e q u ’ e n a u c u n a u t r e a n im a l ; 8î c é q u i e f t
d e p lu s p a r t i c u l i e r , c ’ e f t q u e c o n t r e l ’ o r d i n a i r e d e
t o u s l e s a n im a u x q u i t o u r n e n t n é c e f f a i r e m e n t lek
yeux d ’u n m ê m e c ô t é , l e s t e n a n t t o u j o u r s à u n e
m ê m e d i f t a n c e ; l e c a m é l é o n l e s t o u r r i e d ’ u n e t e l l e
m a n i é r é , q u ’ e n m êm e - t em s i l r e g a r d é d e v a n t 6 c d e r r
i è r e l u i , 6 c l o r f q u ’ u n oeil e f t l e v é v e r s l e c i e l , l ’ a u t
r e e f t b à i f f é v e r s l a t e r r e . L ’ e x t r ê m e d é f i a n c e d 6
c e t a n im a l - p e u t ê t r e c â u f e d e c e t t e a é t io n , d e l a q
u e l l e l e l i e v r e , a n im a l a u f l i f o r t t im i d e , a q u e l q u e
c h o f e , m a i s e l l é n ’ e f t p a s r em a r q u a b l e c o m m e d a n s
l e c a m é l é o n .
L a f i g u r e d u c r y f t a l l i n e f t d i f f é r e n t e d a n s l e s a n i m
a u x . O n r e m a r q u e q ü ’ e l l e e f t t o u j o u r s f p h é f i q u e
a u x p o i f l 'o n s - , 6 c l e n t l c u l a i r é a u x a u t r e s a n im a u x ;
c e t t e d i f f é r e n c e v i e n t d e la d i f f é r e n t e n a t u r e d u m i l
i e u d e l e u r v u e ; c a r à l ’ é g a r d d e s p o i f f o n s , t o u t c e -
q u i f e r t d e m i l i e u à l e u r v u e d e p u i s l ’o b j é t jü f q u ’ a u
c r y f t a l l i n e f t a q u e u x , f â v o i r l ’ e à u d a n s l a q u e l l e i l s
f o n t , 6 c l ’h u m e u r a q u e u f e d e Yoeil q u i e f t a u - d e v a n t
d u c r y f t a l i n . M a i s d a n s l e s a u t r e s a n im a u x , c e m i l
i e u e f t c o m p o f é d e l ’ a i r 6 c d e l ’ e a u d e l e u r oe i l x