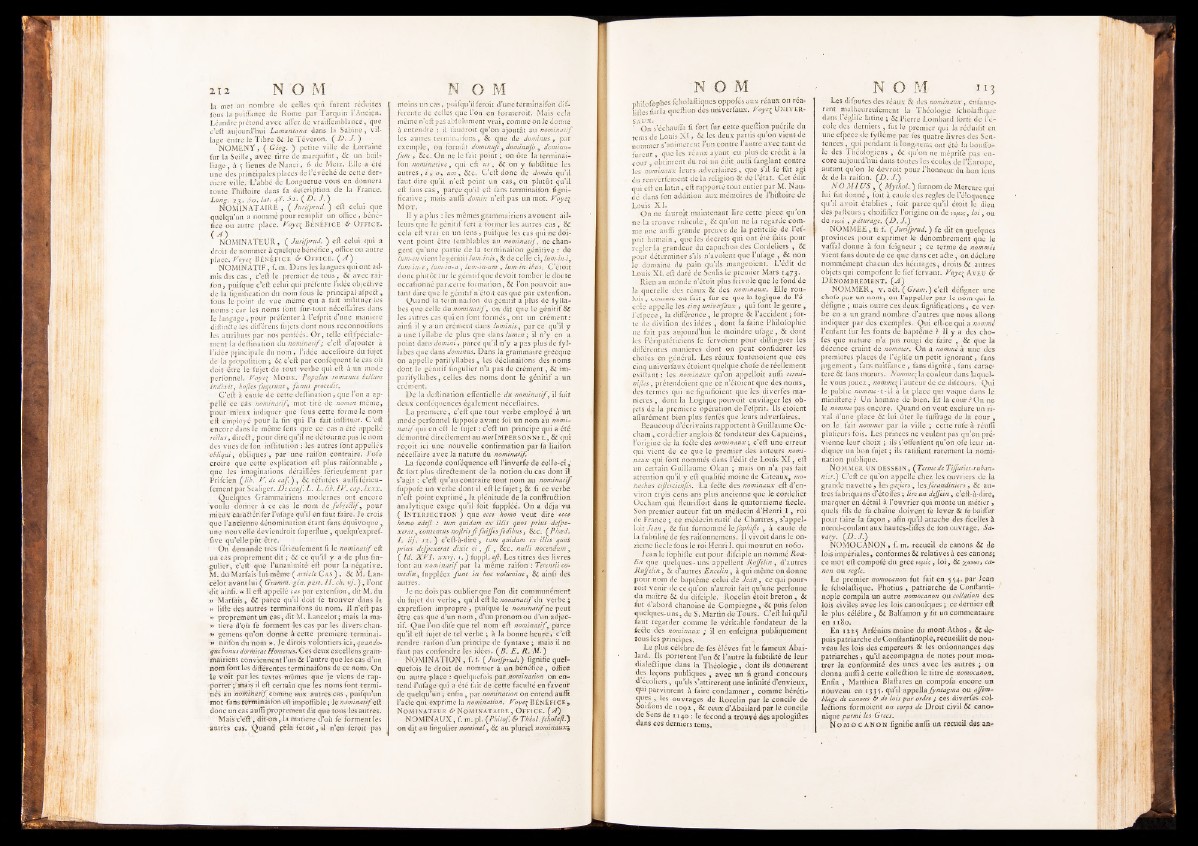
la met an nombre de celles qui furent réduites
fous la puilTanee de Rome par Tarquin l’Ancien.
Léandreprétend avec affez de vraiffemblaricè, que
c’eft aujourd’hui Lamantana dans la Sabine, village
entre le Tibre 6c le Téveron. ( D . J . )
NOM EN Y , ( Géog. ) petite ville de Lorraine
fur la Seille, avec titre de marquifat, 6c un bailliage
, à 5 lieues de Nanci, 6 de Metz. Elle a été
une des principales places de l’éveché de cette dernière
ville. L’abbé de Longuerue vous en donnera
toute l’hiftoire dans fa description de la France.
Long. 23. 5 o. lac. 48. Sz. (-£>. J.')
NOM1NÀTAIRE , ( Jurijprud. ) eft celui que
quelqu’un a nommé pour remplir un office , béné-
fice ou autre place. Foye£ B é n é f i c e ' & O f f i c e .
( A )
NOMINATEUR, ( Jurijprud. ) eft celui qui a
droit de nommer à quelque bénéfice, office ou autre
place, Foye\ B é n é f i c e & O f f i c e . ( A )
NOMINATIF, f. m. Dans les langues qui ont admis
des cas , t ’eft le premier de tous , 6c avec raifon
j puifque c’eft celui qui préfente l’idée objettive
de la fignification du nom fous le principal afpett,
fous le point de vue même qui a fait inftituer les
noms : car les noms font fur-tout néceflaires dans
le langage , pour préfenter à l’efprit d’une maniéré
diftintte les différens fujets dont nous reconnoiflbns
les attributs par nos penféés. Ô r , telle eflfpéciale-
ment la deftihation du nominatif; c’eft d’ajouter à
l ’idée principale du nom , l’idée accefloire du fujet
de la propolition ; 6c c’eft par conféquent le cas où
doit être le fujet de tout verbe qui eft à un mode
perfonnel. Foye^ M o d e . Populos romanus bellum
indixil, liojles fugerunt, funus procedit.
C ’eft à cflufe de cette deftination, que l’on a app
e lé ce eàs nominatifs mot tiré de nomen même,
pour mieux indiquer que fous cette forme le nom
eft employé pour la fin qui l’a fait inftituer. C ’eft
encore dans le même fens que ce cas a été appelle
recluss d irett, pour dire qu’il ne détourne pas le nom
des vues de fon inftitufiort : les autres font appelles
obliqui y obliques * par une raifon contraire. J’ofe
croire que cette explication eft plus raifortnable ,
que les imaginations détaillées férieufement par
Prifcien £/ib. F. de caji) , 6c réfutées auffi férieufement
par Scaliger. De cauf. L. L. lib. IF . cap. Lxxx.
Quelques Grammairiens modernes ont encore
voulu doriner à ce cas le nom de fubjeciif, pour
mi'èilX cârattérifer l’ulage qu’il en faut faire. Je crois
que l’aneieiine dénomination étant fans équivoque ,
une nouvelle deviendront fuperflue , quelqu’expref-
live qu’elle put être.
On demande très férieufement fi le nominatif eft
u n tas proprement dit ; 6c ce qu’il y a de plus fin-
gulier, c’eft que l’unanimité eft pour la négative.
M. dil Marfais lui-mêmfe ( ar’ticlc C AS ) , & M. Lan-
cèlot avant lui ( Grafiirïi. gén. part. i l . ch. vj. ) , l’ont
dit ainfi. « II èft appelle cas par extenfion, dit M. du
» Mariais, 6c parce qu’il doit fê trouver dans la
» lifte des autres terminaifonS du nom. II n’eft pas
» proprement un cas * dit M. Lancelot ; mais la ma-
» tiere d’où fe forment les cas par les divers chan-
» gemens qù’on donne à cette première terminai-
-» naifon du nom ». Je dirois volontiers ici , quando-
que bonus dorrnitat Moments. Ces deux ex-celléns grammairiens
conviennent l’un & l’autre que les cas d’un
nom foht les différentes terminaifonS de ce nom. On
Te voit par les textes mêmes que je viens de rapporter
mais il eft certain que les noms font terminés
àtt nvWti'nanf comme aux autres cas , pnifqu’un
mot fans tefminàifon eft itnpoflible ; le nominatif eft
donc un cas auffi proprement dit qite tous les autres.
Mais'c’-éft, dit-on, la matière d’où fe forment les
autres cas. Quand Çèla feroit, il n’en ferait pas
moins un cas, puifqu’ ilferoit d’une terminaifon differente
de celles, que l’on en formeroit. Mais cela
même n’eft pas ablolument v rai, comme on le donne
à entendre : il faudroit qu’on ajoutât au nominatif
les autres terminaifonS, & que de do minus, par
exemple, on formât dominuji, dominufo , dominu-
fum , 6cc. On ne le fait point ; on ôte la terminai-
fon nominative, qui eft u s , & on y fubftitue les
autres, i , o, urn , 6ce. C ’eft donc de domin qu’il
faut dire qu’il .n’eft point un cas* ou plutôt qu’il
eft fanscas , parce qu’il eft lans terminaifon figni-
ficative; mais auffi domin n’eft pas un mot. Foyeç
Mot.
Il y a plus : les mêmes grammairiens avouent ailleurs
que le génitif fert à former les autres cas , 6c
cela eft vrai en un fens, puifque les cas qui fie doivent
point être femblables au nominatif, ne changent
qu’une partie de la terminaifon génitive : de
Lum-en vient le génitif lutn-inis s 6t de celle ci, lum-in-i,
lum-in-e, lumin-a , lum-in-um , lum-in ibus. C ’étoit
donc plutôt lur le génitif que devoir tomber le doute
occafionné par.cette formation, 6c l’on pouvoit autant
dire que le génitif n’éto.t casque par extenfion.
Quand la terminaifon du génitif a plus de fylia—
bes que celle du nominatif, on dit que le génitif 6c
les autres cas qui en font formés, ont un crément:
ainfi il y a un crément dans Luminis, par ce qu’il y
a une fyllabe de plus que dans lumen ; il n’y en a
point dans domini, parce qu’il n’y a pas plus de fyl-
labes que dans doininus. Dans la grammaire grecque
on appelle parifyllabes, les décliriaifons des noms
dont le génitif fingulier n’a pas de crément, 6c im-
parifyllabes, celles des noms dont le génitif a un
crément.
De la deftination eflentielle du nominatifs il fuit
deux conféquences également néceflaires.
La première, c’eft que tout verbe employé à un
mode perfonnel fuppOÎê avant foi un nom au nominatif
qui en eft le lujet : c’eft un principe qui a été
démontré directement au mot Impersonnel, & qui
reçoit ici une nouvelle confirmation par fa liailon
néceflaire avec la nature du nominatif
La fécondé conféquence eft l’inverfe de celle-cî
& fort plus directement de la notion du cas dont il
s’agit : c’eft qu’au contraire tout nom au nominatif
fuppofe un verbe dont il eft le fujet ; & li ce verbe
n’eft point exprimé, la plénitude de la conftruttion
analytique exige qu’il foit fuppléé. On a déjà vu
( Interjection ) que ecce homo veut dire cccc
homo adejl : ium quidam ex' illis quos prius -defpe-
xerat, contentûs no(Iris f i fuijfes fedibus, 6cc. ( Phoed.
I. iij. 12 . ) c’eft-à-dire , tum quidam ex illis quoi
p ri us defpexerat dixil ei , j i , 6cc. nulli nocendum y
( ld. X F I . xxvj. i. ) fupph ejl. Les titres des livres
font au nominatif par la même raifon : Terentii co-
mediats ftippléez funt in hoc volumines 6c ainfi des
autres.
Je ne dois pas oublier que l’on dit communément
du fujet du verbe, qu’il eft le nominatif du verbe ;
expreffion impropre * puifque le nominatif ne peut
être cas que d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif.
Que l’on dife que tel nom eft nominatifs parce
qu’il eft fujet de tel verbe ; à la bonne heure, c ’efl:
rendre raifon d’un principe de fyntaxe ; mais il ne
faut pas confondre les idées. ( 5 . E . R. M. )
NOMINATION , f. f. (Jurijprud.') lignifie quelquefois
lè droit de nommer à un bénéfice , office
ou autre place : quelquefois par. nomination on entend
Tufage qui a été fait de cette faculté en faveur
de quelqu’un ; enfin, par nomination on entend auffi
Patte qui exprime la nomination. Foyeç BÉNÉFICE,
Nominateür & Nominataire, Office. (A )
NOMINAUX, f. m. pl. (PhiLof. & Théol. fcholafl.')
on dit tau fingulier nominal y 6c au pluriel nominaux.
p h ilo fô p b e S fc h o la f t iq u e s ©ppofés a u x r é a u x o u réa -
fifte s fur la q u e ft io n d e s u f l iv e r fa u x . F o y e ^ U n i v e r -
^AQri s’échauffa fi fort fur cette queftion puérile du
tems de Louis X I , 6c les deux partis qju’on vient de
nommer s’animèrent l’un contre l’autre avec tant de
fureur , que les réaux ayant eu plus, de crédit à la
cour , obtinrent du roi un édit auffi fanglant contre
les nominaux leurs- adverfaires , que s’il fe fût agi
du renvèrlement de la religion & de l’état. Cet edit
qui eft en latin , eft rapporté tout entier par M. Nau-
clé dans fon addition aux mémoires de l’hiftoire de
Louis X I .
On ne fauroit maintenant lire cette piece qu’on
ne la trouve ridicule, 6c qu’on ne la regarde comme
une anfli grande preuve de la petitefl’e de Pef- ■
prit humain , que les decrets qui ont été traits pour
regler la grandeur du capuchon des Cordeliers , 6c
pour déterminer s’ils n’a voient que l’ulage , & non
le domaine dy pain qu’ils mangeoient. L’edit de
Louis XI. eft daté de Senlis le premier Mars 1473.
Rien au monde n’étok plus frivole que le fond de
la querelle des réaux & des nominaux. Elle rou-
loit, comme on fa it, fur ce que la logique de l’école
appelle les cinq univerfaux, qui font le genre ,
Peipece, la différence, le propre & l’accident ; forte
de divifion des idées ^ dont la faine Philofophie
ne fait pas aujourd’hui le moindre ufage, & dont
les Péripatéticiens fe fervoient pour distinguer les
différentes maniérés dont on peut confidérer les
choies en général. Les réaux foutenoient que ces
cinq univerfaux étoient quelque chofe de réellement
exiftant : les nominaux qu’on appelloit auffi termï-
nijies, prétendoient que ce n’étoient que des noms,
des termes qui ne fignifioient que les diverfes maniérés
, dont la Logique pouvoit envifager les objets
de la première opération de l’efprir. Ils étoient
aflùrément bien plus fenfés que leurs adverfaires.
Beaucoup d’écrivains rapportent à Guillaume Oc-
cham , coj-delier anglois 6c fondateur des Capucins,
l’origine de la fette des nominaux ; c’eft une erreur
qui vient de ce que le premier des auteurs nominaux
qui font nommés dans l’édit de Louis X I , eft
un certain Guillaume Okan ; mais on n’a pas fait
attention qu’il y eft qualifié moine de Citeaux, mo-
nachus cijlercienjis. La fette des nominaux eft d’environ
trois cens ans plus ancienne que le cordelier
Occham qui fleuriffoit dans le quatorzième fiecle.
Son premier auteur fut un médecin d’Henri I , roi
de France ; ce médecin natif de Chartres, s’appel-
loit Jean , 6c fut furnommé le Jophijle , à caule de
la fubtiliré de fes raifonnemens. Il vivoit dans le onzième
fiecle fous le roi Henri I. qui mourut en 1060.
Jean le fophifte eut pour difciple un nommé Root-
lin que quelques-uns appellent Roffelin, d’autres
Rujjelin, & d’autres Encelin, à qui même on donne
pour nom de baptême celui de Jean, ce qui pour-,
roit venir de ce qu’on n’auroit fait qu’une perïonne
du maître & du difciple. Rocelin étoit breton , &
fut d’abord chanoine de Compiegne, •& puis félon
quelques-uns, de S. Martin de Tours. C’eft lui qu’il
faut regarder comme le véritable fondateur de la
fette des nominaux ; il en enfeigna publiquement
tous les principes.
Le plus célébré de fes éléves fut le fameux Abai-
lard. Ils portèrent l’un 6c l ’autre la fubtilité de leur
dialettique dans la Théologie, dont ils donnèrent
des leçons publiques , avec un fi grand concours
*1 écoliers, qu’ils s’attirèrent une infinité d’envieux,
qui parvinrent à faire condamner, comme hérétiques
, les ouvrages de Rocelin par le concile de
Soiflbns de 109 1 , & ceux d’Abailard par le concile
de Sens de 1140: le fécond a trouvé des apologiftes
dans ces derniers tems.
Les difputes des réaux & des nominaux, enfantèrent
malheureiifement la Théologie fiçholaftiqiie
dans Péglile latine ; 6c Pierre Lombard forti de l’école
des derniers , fut le premier qui la rédijifit en
une efpece de fyftème par fes quatre livres des Sentences
, qui pendant fi long-tems ont été la bouflo-
le des Théologiens , 6c qu’on ne méprife pas encore
aujourd’hui dans toutes, les écoles de l’Eu-rope,
autant qu’on le devroit pour l’honneur du bon fens
& de la raifpn. (D . J.)
N O M I US s ( Mythol. ) furnom de Mercure qui
lui fut donné, foit à caufe des réglés de l’éloquence
qu’il avoit établies , foit parce qu’il étoit le dieu
des pafteurs ; choififfez l’origine ou de vo/aoc, lo i, ou
de re/y.» , pâturage. (D . J.)
NOMMÉE, it f. ( Junfprud. ) fe dit en quelques
provinces pour exprimer le dénombrement que le
vaffal donne à fon feigneur ; ce terme de nommée
vient fans doute de ce que dans cet atte, on déclare
nommément chacun des héritages, droits & autres
objets qui compofent le fief fervant. Foye^ Aveu <5*
Dénombrement. (A )
NOMMER, v . att. ( Gram.) c’eft déiigner une
chofe par un nom, ou l’appqller par le nom qui la
défigne ; mais outre ces deux lignifications, ce verbe
en a un grand nombre d’autres que nous allons
indiquer par des exemples. Qui eft-çe qui a nomme
l’enfant fur les fonts de baptême ? Il y a des cho-
fes que nature n’a pas rougi de faire , 6c que la
decence craint de nommer. On a nommé à une des
premières places de l’églife un petit ignorant, fans
jugement, fans naiffance , fans dignité , fans caractère
6c fans moeurs. Nommera, couleur dans laquelle
vous jou ez, nommeç l’auteur de ce, difeours. Qui
le public nomme-t - il à la place qui vaque dans le.
miniftere ? Un homme de bien. Et la cour? On ne
le nomme pas encore. Quand on veut exclure un rival
d’une place 6c lui ôter le luffrage de la cour ,
on l e , fait nommer par la ville ; cette rufe à réuffi
plufieurs fois. Les princes ne veulent pas qu’on prévienne
leur choix ; ils s’offenfent qu’on oie leur indiquer
un bon fujet ; ils ratifient rarement la nomination
publique.
NOM M E R u n d e s s e i n , ( T e rm e d e T ijfu tie r - r u b a n -
n i s r . ) C ’eft ce qu’on appelle chez les, ouvriers de la
grande navette , les g a b ie r s , les f é r a n d i n ü r s , & autres
fabriqua ns d’étoffes ; lire un d c j f e in , c’elhà-dire,
marquer en détail à l’ouvrier qui monte un métier >
quels fils de fa chaîne doivent fe lever & fe baiffer
pour faire la façon , afin qu’il attache des ficelles à
noeud-coulant aux hautes-lifles de fon ouvrage. Sa-
v a r y , ( £ ) . J . )
NOMOCANON » f. m. recueil de canons & de
lois impériales, conformes 6c relatives à ces canons;
ce mot eft compofé du grec vopôçlo i, 6c xu.mv> car
non ou réglé.
Le premier nomocunon fut fait en 554. par Jean
le fcholaftique. Photius , patriarche de C.onftanti-
nople compila un autre nomocanon ou collation des
lois civiles avec les lois canoniques j ce dernier eft
le plus célébré, 6c Balfamon y fit un commentaire
en 118,0.
En 1125 Arfenius moine du mont-Afhos, & depuis
patriarche de Conftaotinople, recueillit de nouveau
les lois .des empereurs & les ordonnances des
patriarches » qu’il accompagna de notes pour montrer
la conformité des unes avec les autres ; on
donna auffi à cette collettion Le titre de nomocanon.
Enfin , Matthieu Blaftares en compolà encore un
nouveau en 13 3 5. qu’il appella fy magma .ou ajfem-
blage de canons & de lois par ordre ; ces diverses col-
lettions -formoient un corps de Droit civil 6c canor
nique parmi les Grecs. ,
N om .o c a n o n lignifie auffi un recueil des an