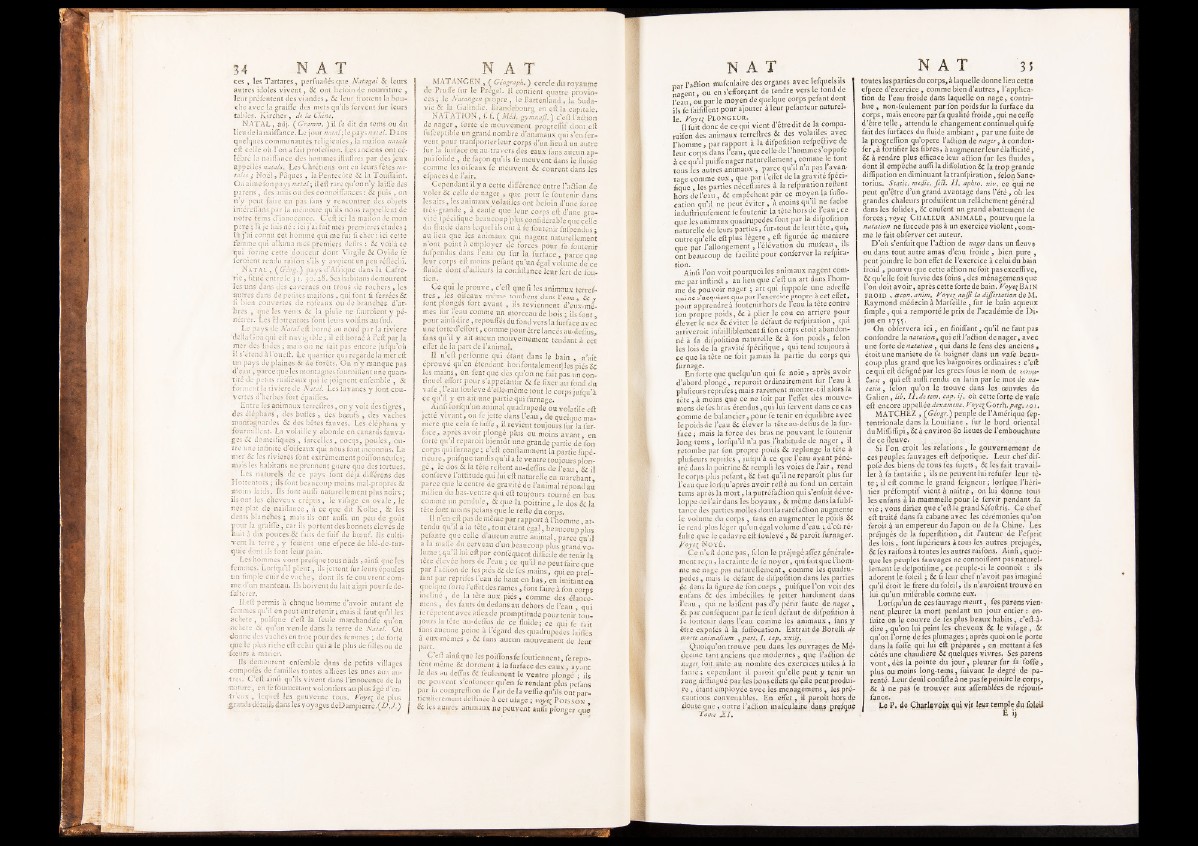
ces v les Tartares, perfuadés que Natagai & leurs
autres idoles v iv en t , & ont beloin de nourriture ,
leur présentent des viandes, 8c leur frottent la bouche
avec la graiffe des mets qu’ils fervent lur leurs
tables. Kircher, de la Chine.
NATAL , adj. ( Gramm. ) il fe dit du tems ou du
lieu de la naiffance. Le jour natal-, le pttysnatal. Dans
quelques communautés religieufes, la maifon natale
eft celle où ■ l’on a fait profeffion. Les anciens ont célébré
la naiflance des honimes illuftres par des jeux
appelles natals. Les Chrétiens ont eu leurs fêtes natales
; N oël, Pâques , la Pentecôte St la Toiiffaint.
On aime fon pays natal ; il eft rare qu’on n’y laiffe des
parens, des amis ou des connoiffances : 8c puis , on
n’y peut faire un pas fans y rencontrer des objets
intérelîans par la mémoire qu’ils nous rappellent de
notre tems d’innocence. C’eft ici la maiîon de mon
pere ; là je luis né : ici j’ai fait mes premières études ;
là j’ai connu cet homme qui me fut fi cher : ici cette
femme qui alluma mes' premiers defirs : & voilà ce
'qui forme cette douceur dont Virgile 8t Ovide fe
feroient rendu raifôn s’ils y avoient un peu réfléchi.
Natal , ( Géog. ) pays d’Afrique dans la Cafre*
r ie , fitué entre le 3 1. 30. 28. Ses habitans demeurent
les uns dans des cavernes ou trous de rochers , les
autres dans de petites maifons , quifont fi ferrées 8c
û bien couvertes de rofeaux ou de branches d’arbres
, que les vents 8c la pluie ne fauroient y pénétrer.
Les Hottentots font leurs voifins au fud.
Le pays de Natalefl borné au nord par la riviere
délia Goa qui eft navigable ; il eft borné à l’eft par la
mer des Indes ; mais on ne fait pas encore jufqu’où
il s’étend à l’oueft. Le quartier qui regarde la mer eft
un pays de plaines & de forêts. On n’y manque pas
d’eau , parce que les montagnes fourniffent une quantité
de petits ruiflëaux qui Té joignent enfemble , &
forment la riviere de Natal. Les lavanes y font couvertes
d’herbes fort épaiffes.
Entre les animaux terreftres, on y voit des tigres,
des éléphans, des bufles , des boeufs , des vaches
montagnardes 5c des bêtes fauves. Les éléphans y
fourmillent. La volaille y abonde en canards fauvages
8c domeftiques , farcelles , cocqs', poules, outre
une infinité d’oifeaux qui nous font inconnus. La
mer 8t les rivières font extrêmement poiffonneufes;
mais les habitans ne prennent guere que des tortues.
Les naturels, de ce pays font déjà différens des
Hottentots ; ils font beaucoup moins mal-propres &
moins laids. Ils font auiîi naturellement plus noirs;
ils ont les cheveux crépus, le vifage en o v a le , le
nez plat deffiaiffance, à ce que dit K o lb e, & les
dents blanches ; mais ils ont aufli un peu de goût
pour la graiffe, car ils portent des bonnets élevés de
huit à dix pouces 8c faits de fuif de boeuf. Ils cultivent
la terre , y fement une efpece de blé-de-tur-
quie dont ils font leur pain.
Les hommes vont prefqne tousnûds, ainfi que les
femmes. Lorfqu’il pleut, ils jettent fur leurs épaules
un limplé cuir de vache-, dont ils fe couvrent comme
d’un manteau. Ils boiventdu lait aigri pourfede-
faltérer.
Il.cft permis à chaque homme d’avoir autant de
femmes qu’il en peut entretenir ; mais il faut qu’il les '
acheté, puifqüe c’eft la feule marchandife qu’on
-acheté & qu’on vende dans la terre de Natal. On
-donne des vaches en troc pour des femmes ; de forte
que le plus riche eft celui qui a le plus de filles ou de
foeurs à marier.
Ils demeurent enfemble dans de petits villages
•compoles de familles toutes alliées les unes aux autres.
C ’eft ainfi qu’ils vivent dans l’innocence de la
.•nature, en fe foumetfant volontiers au plus âgé d’ea-
Tr eux , lequel les gouverne tous. Voye£ de plus
^grands détails dansles voyages deDampierre.(A ƒ.)
MATANGEN , ( Gètfgraph, ) cercle du royaume
de Pruffe fur le Pregei. Il contient quatre provinces
; le Natnngen propre , le Bartenland , la Suda-
vie & la Galindie. Brandebourg en cil la capitale.
NATATION , f. f. ( Med, gyrnnafi, ) c’eft l'action
de nager , forte de mouvement progreflif dont eft
fufceptible un grand nombre d’animaux qui s’enier-
vent pour trpnfporterleur corps d’un lieu à un autre
fur la furfaeë ou art-travers des eaux fans, aucun appui
folide , de façon qu’ils fe meuvent dans le fluide
comme ies oifeaux fe mêuvént êc courent dan. les
efpacestic l’a::.
Cependant il y a cette différence entre I’aQion de
voler & celle de nager j que polir fc foutenir dans
l.ÇfCÛs, les cttunaux volatiles ont befointi’une force
très-grande , à.caufe que leur corps efl: d’une gravité
fpécifique beaucoupîplus confidérâblè que celle
du fluide dans lequel iis ont à fe foutenii; fufpenàus ;
au beu que les amiraux qui nagent naturellement
n’ont point à employer de forces pour Tel foutenir
fitfpendus dans l’eau ou fur la furface, parce que
leur corps eft moins pefant, qu’un égal volume de ce
fluide dont d’ailleurs la conliflancc leur fert de fou-
tien.
Ce qui le prouve, c’eft quel! les animauxierref-
tres , les oiieaitx même tombent dans Peau , & y
font plongés fort avant , ils reviennent a’eux-ml-
mes fur l’eau Comme un morceau de bois ; iis (ont
pour ainfi dire ,repouffés du fond vers la furface avM
une forte d’effort, comme pour être lancés au-dèfïits,
fans qu’il y ait aucun ntouvementent tendant à cet
effet de la part de l’animal.
Il n’eft perfonne qui étant dans le bain , n’ait
éprouvé qu’en étendant horifontalement] les piés 8c
les mains, on fent que dès qu’on ne fait pas un continuel
effort pour s’appefantir Sc fe fixer au fond du
v a fe , l’eau fouleve d’elle-même tout le corps jufqu’à
ce qu’il y en ait une partie qui fumage.
Ainfi lorfqu’un animal quadrupède ou volatile eft
jette vivant, ou fe jette dans l^eau, de quelque maniéré
que cela fe fafle, il revient toujours fur la fur-
face, après avoir plongé plus ou moins avant, en
forte qu’il reparoît bientôt une grande partie de fon
corps qui fumage ; c’eft conftamment la partie fnpé-
rieure, puifque tandis qu’il a le ventre toujours plongé
, le dos & Ia tête reftent au-deffus de l’eau , & il
confcrve l’attitude qui lui eft naturelle en marchant
parce que le centre de gravité de l’animal répond au
milieu du bas-venîre qui eft toujours tourné en bas
comme un pendule, & que la poitrine, le dos Sc la
tête font moins pefans que le reifte du corps.
Il n en eft pas de meme par rapport à l’homme, attendu
qu’il a la tête, tout étant égal, beaucoup plus
pefante que celle d’aucun autre animal, parce qu’il
a la mafte du cerveau d’un beaucoup plus grand volume
; qu’il lui eftpar conféquent difficile de tenir la
tete élevee hors de 1 eau ; ce qu’il ne peut faire que
par l’adion de fes piés 8c de fes mains, qui en pref-
fant par reprifes l’eau de haut en bas, en imitant en
quelque forte l’effet des rames , font faire à fon corps
incliné , de la tête aux piés, comme des élance-
mens , des fauts du dedans au dehors de l’eau , qui
fe répètent a vec allez de promptitude pour tenir toujours
la tête au-deffus de ce fluide; ce qui fe fait
fans aucune peine à l’egard des quadrupèdes laifles
à eux-mêmes , 8c fans aucun mouvement de leur
part;
C ’eft ainfi que lespoiffonsfefoutiennent, ferepo-
fent même 8c dorment à la furface des eaux, ayant
le dos au deffus Sc feulement le ventre plongé ; ils
ne peuvent s’enfoncer qu’en fe rendant plus pefans
par la compreffion de l’air de la veffie qu’ils ont particulièrement
deftinée à cet ufage ; voye{ Poisson
éç les autres animaux ne peuvent aufli plonger que
nar ™ H 1 mufculaire des organes avec lefquelsils
„agent ou en s’efforçant de tendre vers le tond de
l’eau, ou parle moyen de quelque corps pefant dont
ils fe faififfent pour ajouter à leur pefanteur naturelle.
Voyez Plongeur.
Il fuit donc de ce qui vient d’etredit de la compa-
raifon des animaux terreftres & des volatiles avec
l’homme, par rapport à la difpofition refpeÇhve de
leur corps dans l’eau, que celle de l’homme s oppoiç
à ce qu’il puiffe nager naturellement, comme le font
tous les autres animaux , parce qu’il n’a pas. I avantage
comme eu x, que par l’effet de la gravite fpem-
fique , les parties nécçffaires à la refpiration reftent
hors de l’eau, 8c empêchent pâr cç moyen la fufto-
cation qu’il ne peut éviter , à moins qu il ne fâche
induftrieufement fe foutenir la tête hors de l’eau ; ce
que les animaux quadrupèdes font par la difpofition
naturelle de leurs parties, fur-tout de leur tete, qui,
outre qu’elle eft plus légère, eft figurée ap manière
que par l’allongement, l’élévation du mufeau , iis
ont beaucoup de facilité pour conferver la relpira-
tion.
Ainfi l’on voit pourquoi les animaux nagent comme
par inftinft , au lieu que c’eft un art dans l’homme
de pouvoir nager ; art qui fuppofe une adreffe
qui ne s’acquiert que par l’exerçice propre effet,
pour apprendre à foutenir hors de 1 eau la tete contre
fon propre poids, & à plier le cou en arriéré pour
élever le nez 8c éviter le défaut de refpiration, qui
arriveroit infailliblement il fon corps étoit abandonné
à fa difpofition naturelle 8c à fon poids, félon
les lois de la gravité fpécifique, qui tend toujours à
ce que la tête ne foit jamais la partie dw corps qui ,
furnag.e. , ^
En forte que quelqu’un qui fe noie , apres^avoir
d’abord plongé, reparoît ordinairement fur 1 eau à
plufieurs reprifes ; mais rarement montre-t-il alors la
tê te , à moins que ce ne foit par l’effet des mouvez*
mens de fes bras étendus, qui lui fervent dans ce cas
comme de balancier, pour fe tenir en équilibre avec
le poids de l’eau 8c élever la tête au-deffus de la ftir-
face ; mais la force des bras ne pouvant le foutenir
long-tems, lorfqu’il n’a pas l’habitpde de nager , il
retombe par fon propre poids 8c replonge la tête à
plufieurs reprifes , jufqu’à ce que l’eau ayant pénétré
dans la poitrine 8c rempli les voies de l’air, rend
le corps plus pefant, 8c fait qu’il ne reparoît plus fur
l ’eau que lorfqu’après avoir refté au fond un certain
tems après la mort, la putréfaction qui s’enfuit développe
de l ’air dans les b oyaux, & même dans la fuhf-
tance des parties molles .dont la raréfaction augmente
le volume du corps , fans en augmenter le poids 8c
le rend plus léger qu’un égal volume d’eau ; d’où r^
fuite que. le cadavre eft foulevé , 8f paroît furnager.
Vayç{ Noyé.
Ce n’eft donc pas, félon le préjugé affçzgénéralement
reçu , la crainte de fç noyer, qui fait que l’homme
ne nage pas naturellement, comme les quadrupèdes
, mais .le défaut de difpofition dans les parties
$C dans la figure de fon corps , puifque l ’on voit des
enfans & dçs imbéciles le jetter hardiment dqps
l ’eau , qui ne laiffent pas d’y périr faute de nagtf ,
& par çonféquentjpar le feul défaut de difppfition à
fe foutenir dans l’eau comme les animaux , fans y
être expofés à la fuffocation. Extrait de Borelli dç
inorte animaitum , part. I. cap. xxiij.
Quoiqu’on trouve peu dans les ouyrages de Médecine
tant anciens que modetnes ? que l?a$ipn 4?
mgçr^ foit qidc au nombre de? exercices qtiles à 1?
fanté ; cependant il paroît qu’elle petit y tenir \in
yang djftingué parles bous effets quelle peut produire
, étant employée ayeç les mêuagptnens, les prér
.cautions convenables.. En effet ? d parpît hors de
doute que, outre l ’acjiqn mufçttl^iie dftP? prçfqpç
Tome X I .
toutes les parties du corps, à laquelle donne lieu cette
efpece d’exercice , comme bien d’autres, l ’application
de l’eau froide dans laquelle on nage, contribue
, non-feulement par fon poids fur la furface du
corps, mais encore par fa qualité froide, qui ne ceflç
d’être telle, attendu le changement continuel qui fe
fait des furfaces du fluide ambiant, par une fuite de
la progreffion qu’opere l’a&ion de nager, à conden-
fer, à fortifier les fibres, à augmenter leur élafticité,
& à rendre plus efficace leur aftion fur les fluides,
dont il empêche aufli la diffolution & la trop grande
diffipation en diminuant latranfpiration, félon Sanc-
toriits. Staùc. medic. Jlcl. I L aphro. xiv. ce qui ne
peut qu’être d’un grand avantage dans l’é té , où les
grandes chaleurs produifentun relâchement général
dans les folides, & caufent un grand abattement de
forces \voye{ Chaleur animale, pourvu que la
natation ne fuccede pas à un exercice violent, comme
le fait obferver cet auteur.
D ’où s’enfuit que l ’aôion de nager dans un fleuve
ou dans tout autre amas d’eau froide , bien pure ,
peut joindre le bon effet de l ’exercice à celui du bain
froid , pourvu que cette aftion ne foit pas exceflîve,
& qu’elle foit fuivie des foins , des ménagemens que
Ton doit a voir, après cette fortede bain. Voyt{BaiH
FROID , cecon. anim. Voye£ aujji la dijfertation de M.
Raymond médecin à Marfeille , fur le bain aqueux
fimple, qui a remporté le prix de l’académie de D ijon
en 1755.
On obfervera i c i , en finiffant, qu’il ne faut pas
confondre la natation, qui eftl’aâion de nager, avec
une forte de natation , qui dans le fens des anciens ,
étoit une maniéré de fe baigner dans un vafe beaucoup
plus grand que les baignoires ordinaires : c ’eft
ce qui eft défignépar les grecs fous le nom de y.oxvpt-
Cnaiç , qui eft aufli rendu en latin par le mot de na-
tatio, félon qu’orï le trouve dans les oeuvUes de
Galien, lib. I I . de tem. cap. ij. où cette forte de vafe
eft encore appelliedexamene. Voye{Gorrh.pag, to i.
MATCHEZ t^Géogr.') peuple de l’Amérique fep-
tentrionale dans la Louifiane , fur le bord oriental
du Miffiffipi, & à environ 80 lieues de l’embouchure
de ce fleuve.
Si î’oq croit les relations, le gouvernement de
ces peuples fauvages eft defpotique. Leur chef dif-
pofe des biens de tous fes fujets, & les fait travailler
à fa fantaifie ; ils ne peuvent lui refufer leur tête
; il eft comme le gfapd feigneur ; lorfque, l’héritier
préfomptjf vient à naître , on lui donne toi\s
les enfans à la.mammelle pour le fervir pendant fa
vie ; vous diriez que c’eft le grandSéfoftris. Ce chef
eft traité dans fa cabane avec les cérémonies qu’on
feroit à un empereur du Japon ou de la Chine. Les
préjugés de la fuperftition, dit l’aqteur de l’efprit
des lois , font fupérieurs à tous les autres préjugés,
& fes raifons à toutes les autres raifons. Ainfi, quoique
les peuples fauvages ne connoiffent pas naturellement
le diefpotifme, ce peuple-ci le çonnoît : ils
adorent le.foleil ; & fi leur chef n’avoit pas imaginé
qu’il étpit le frere du foleil, ils n’aurpient trouvé en
lui qu’un miférable comme eux.
Loriqu’un de ces fau vage meurt, fes parens viennent
pleprer la mpft pendant un jour entier : en-
fuite pn le couvre de fes plus beaux habits, c’eft-à-
dire, qu’pn lui peint les cheveux 8f le vifage , &
qu’on l’orne de les plumages ; après quoi on le porte
daps la foffe qui lui eft préparée , en mettant à fes
côtés une chaudière 8c quelques vivres. Ses parens
Vont,d ès la pointe du jour, pleurer fur fa foffe ,
plus ou mdins long’ teiPs > fuivant le degré de parenté.
Leur deuil çonfifte à ne pas fe peindre le corps,
8c à ne pas fe trouver aux affemblées de réjouif-
fance.
Le P, de Charlevoix qui vit leur temple du foleil
E i j