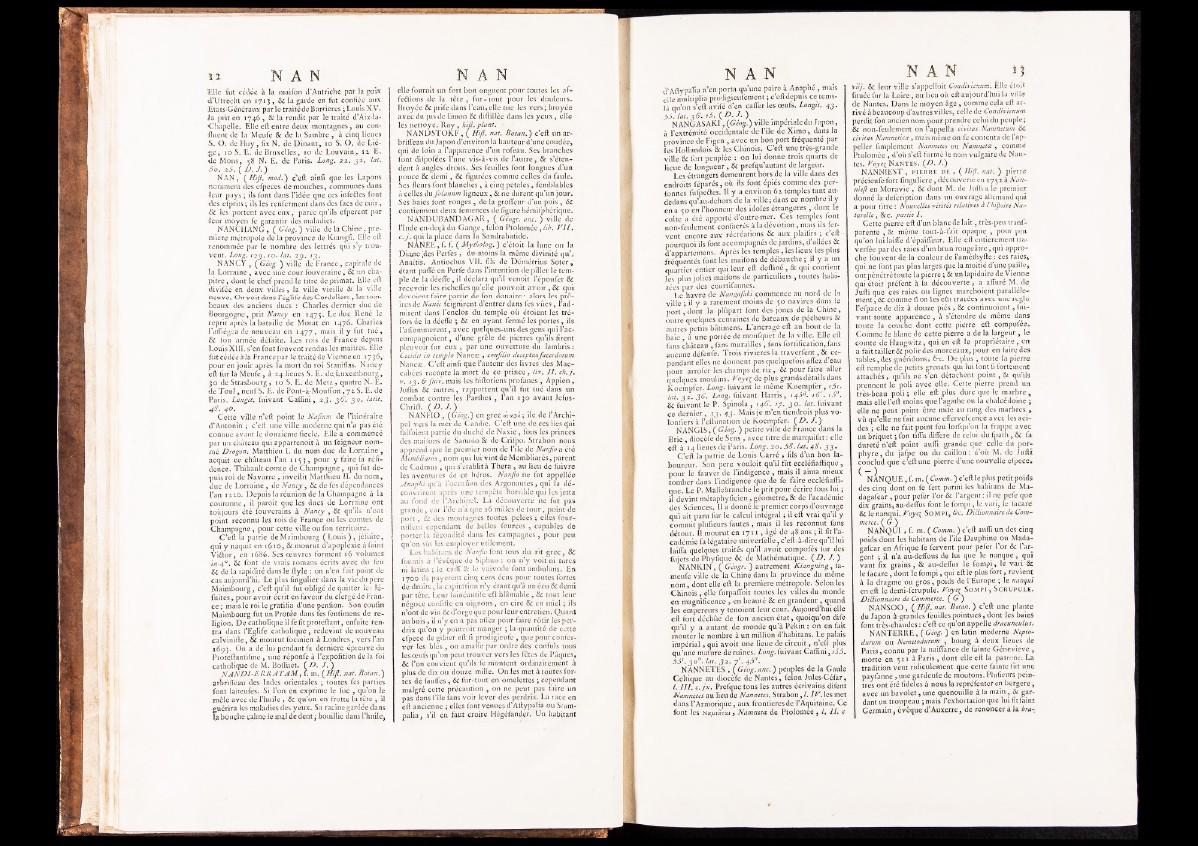
îî N A N
Elle fut cédée à la maifon d’Autriche par la paix
d’Utrecht en 17 13 , 6c la garde en fut confiée aux
Etats-Généraux par le traité de Barrières ; Louis XV.
Ja prit en 1746, & la rendit par le traité d’Aixla-
Oha.pelle. Elle eft entre deux -montagnes, au confluent
de la Meufe & de la Sambre , à cinq lieues
S. O. de H u y , fix N. de Dinant, 10 S. O. de Lièg
e , 10 S. E. de Bruxelles, 10 de Louvain, 12 E.
de Mons, 58 N. E. de Paris. Long. 22. 32 . lac.
5 o. x 5. ( D. J .)
N AN, ( Hijl. moi.') c’eft ainfi que les Lapons
nomment des efpeces de mouches, communes dans
leur pays ; ils font dans l’idée que ces infeôes font
des efprits ; ils les renferment dans des facs de cuir,
6c les portent avec eu x, parce qu’ils efperent par
leur moyen fe garantir des maladies.
NANCHANG, ( Giog. ) ville de la Chine, première
métropole de la province de Kiangfi. Elle eft
renommée par le nombre des lettrés qui s’y trouvent.
Long. 12J9. 10. lat. 20. i j .
NANCY , ( Géog. ) ville de France, capitale de
la Lorraine , avec une cour fouveraine, 6c un chapitre
, dont le chef prend le titre de primat. Elle eft
divifèe en deux villes, la ville vieille & la ville
neuve. On voit dans l’églife des Cordeliers, les tombeaux
des anciens ducs : Charles dernier duc de
Bourgogne, prit Nancy en 1475. Le duc René le
reprit après la bataille de Morat en 1476. Châties
l’aftiégea de nouveau en 14 7 7 , mais il y fut tue,
& Ion armée défaite. Les rois de France depuis
Louis XIII. s’en font fou vent rendus les maîtres. Elle
fut cédée à la France par le traité de Vienne en 1736»
pour en jouir après la mort du roi Staniflas. Nancy
eft fur la Meufe, à 24 lieues S. E. de,Luxembourg,
30 de Strasbourg, 10 S. E. de Metz, quatre N. E.
de T o u t , neufS. E. de Pont-à-Mouffon, 72 S. E. de
Paris. Longit. fuivant Caflini, 2 3 . 3 G. j o . latit.
48. 40.
Cette ville n’ eft point le Nafiurn de l’itinéraire
d’Antonin ; c’eft une ville moderne qui n’a pas été
connue avant le douzième fiecle. Elle a commencé
par un château qui appartenoit à un feigneur nommé
Drogon. Matthieu I. du nom duc de Lorraine ,
acquit ce château l’an 1 15 3 , pour y faire fa réfi-
dence. Thibault comte de Champagne, qui fut depuis
roi de Navarre , inveftit Matthieu II. du nom,
duc de Lorraine , de Nancy, 6c de fes dépendances
l’an 1220. Depuis la réunion de la Champagne à la
couronne, il paroît que les ducs de Lorraine ont
toujours été fouverains à Nancy , & qu’ils n’ont
point reconnu les rois de France ou les comtes de
Champagne, pour cette ville ou fon territoire.
C ’eft la patrie de Maimbourg ( Louis ) , jéfuite,
qui y naquit en 1610, & mourut d’apoplexie à faint
V iû o r , en 1686. Ses oeuvres forment 16 volumes
in-40. 6c font de vrais romans écrits avec du feu
6c de la rapidité dans le ftyle : on n’en fait point de
cas aujourd’hi. Le plus fingulier dans la vie du pere
Maimbourg, c’eft qu’il fut obligé de quitter les Jé-
fuites, pour avoir écrit en faveur du clergé de France
; mais le roi le gratifia d’une penlion. Son coufin
Maimbourg fut un Protce dans fes fentimens de religion.
De catholique il fe fît proteftant, enfuite rentra
dans l’Eglife catholique , redevint de nouveau
calvinifte, 6c mourut focinien à Londres, vers l’an
1693. On a de lui pendant fa derniere épreuve du
Proteftantifme, une réponfe à l’expofition de la foi
catholique de M. Bofluet. ( D . J . )
N AN D1-E K K A T AM y f. m. ( Hijl. nat. Botan.)
arbriffeau des Indes orientales ; toutes fes parties
font laiteufes. Si l’on en exprime le fuc , qu’on le
mêle avec de l’huile, 6c qu’on en frotte la tête , il
guérira les maladies des yeux. Sa racine gardée dans
fa bouche calme le mal de dent3 bouillie dans l’huile,
N A N
elle fournit un fort bon onguent pour toutes les af*
fe&ions de la tête , fur-tout pour les douleurs.
Broyée 6c prife dans l’eau, elle tue les vers ; broyée
avec du jus de limon 6c diftillée dans les y eu x, elle
les nettoye. R a y , hiß. plant. '
NANDSTOKF , ( Hiß. nat. Botan.) c’eft un ar*
brifteau du Japon d’environ la hauteur d’une coudée,
qui de loin a l’apparence d’un rofeâu. Ses branches
font difpofées l’une vis-à-vis de l’autre, & s’étendent
à angles droits. Ses feuilles font longues d’un
pouce & demi, Si figurées comme celles du faule.
Ses fleurs font blanches , à cinq petales, femblables
à celles du Jolanum ligneux, & ne durent qu’un jour.
Ses baies lont rouges , de la grofleur d’un pois , 6c
contiennent deux femences de figure faémifphérique.
NANDUBANDAG AR , ( Géogr. anc. ) ville de
l’Inde en-deçà du Gange, félon Ptolomée, lib. V i l .
c .j. qui la place dans la Sandrabatide.
NANÉE, f. f. ( Mytholog. ) c’étoit la lune ou la
Diane jdes Perfes , du-moins la même divinité qu\
Anaïtis. Antiochus VIL fils de Démétrius Soter,'
étant pafle en Perfe dans l’intention de piller le temple
de la déefle, il déclara qu’il venoit l’époufer 6c
recevoir les richefles qu’elle pouvoit a vo ir , 6c qui
dévoient faire partie de fon douaire : alors les prê-
ires de Nanéc feignirent d’entrer dans fes vû e s , l’admirent
dans l’enclos du temple oh étoient les tré-
fors de la déefle ; 6c en ayant fermé les portes, ils
l ’aflommerent, avec quelques-uns des gens qui l’ac-
compagnoient, d’une grêle de pierres qu’ils firent
pleuvoir fur eux , par une ouverture du lambris :
Cecidit in tcmplo Nane-æ , confilio deceptusfaetrdotum
Naneas. C ’eft ainfi que l’auteur des livres des Mac-
cabées raconte la mort de ce prince, liv. II. ch. J.
v. i j . & fuiv. mais les hiftoriens profanes , AppienI
Juftin 6c autres, rapportent qu’il fut tué dans un
combat contre les Parthes , l’an 130 avant Jefus-
Chrift. ( D . J . )
NANFIO , ( Géog.) en grec àvatpn ; île de l’Archipel
vers la mer de Candie. C ’eft une de ces îles qui
faifoient partie du duché de Naxie, fous les princes
des maifons de Saiiudo & de Crifpo. Strabon nous
apprend que le premier nom de l’île de Nanfio a été
Membliaros, nom qui lui vint de Membliarès, parent
de Cadmus , qui s’établit à T hera, au lieu de fuivre
les aventures de ce héros. Nanfio ne fut appellée
Anaphé qu’à l’occafion des Argonautes, qui la découvrirent
après une tempête horrible qui les jetta
au fond de l’Archipel. La découverte ne fut pas
grande, car l’île n’ a que 16 milles de tour, point de
port , 6c des montagnes toutes pelées ; elles four-
niffent cependant de belles fources , capables de
porter la fécondité dans les campagnes, pour peu
qu’on sût les employer utilement.
Les habitans de Nanfio font tous du rit grec , 6c
fournis à l’évêque de Siphuo : on n’y voit ni turcs
ni latins ; le cadf & le vaivode font ambulans. En
1700 ils payèrent cinq cens écus pour toutes fortes
de droits, la capitâtion n’y étant qu’à un écu 6c demi
par tête. Leur fainéantife eft blâmable, 6c tout leur
négoce confifte en oignons, en cire 6c en miel ; ils
n’ont de vin 6c d’orge que pour leur entretien. Quant
au bois, il n’y en a pas allez pour faire rôtir les perdrix
qu’on y pourroit manger ; la-quantité de cette
efpece de gibier eft fi prodigieufe , que pour confer-
ver les blés , on amafîe par ordre des corlfuls tous
les oeufs qu’on peut trouver vers les fêtes de Pâques,
6c l’on convient qu’ils fe montent ordinairement à
plus de dix ou douze mille. On les met à toutes fortes
de fauffes , 6c fur-tout en omelettes ; cependant
malgré cette précaution , on ne peut pas faire un
pas dans l’île fans voir lever des perdrix. La race en
eft ancienne ; elles font venues d’Aftypalia ou Sfam-
palia , s’il en faut croire Hégéfander. Un habitant
N A N
d’Aftypàlia n’ en porta qu’une paire à Anaphé, mais
elle multiplia prodigieufement ; c’eft depuis ce tems-
là qu’on s’eft avifé d’en cafter les oeufs. Longit. 43.
55. lat. 36 . i5. (.H. J .') ^ ,
NANGASAK.I, (Géog.) ville impériale du Japon,
à l’extrémité occidentale de l’île de Ximo, dans la
province de Figen , avec un bon port fréquenté par
les Hollandois & les Chinois. C ’eft une très-grande
ville 6c fort peuplée : on lui donne trois quarts de
lieue de longueur, 6c prefqu’autant de largeur.
Les étrangers demeurent hors de la ville dans des
endroits féparés, oîi Ms font épiés comme des per-
fonnes fufpeftes. Il y a environ 62 temples tant au-
dedans qu’au-dehors de la ville; dans ce nombre il y
en a 50 en l’honneur des idoles étrangères , dont le
culte a été apporté d’outre-mer. Ces temples font
non-feulement confacrés à la dévotion, mais ils fervent
encore aux récréations 6c aux plaifirs ; c eft •
pourquoi ils font accompagnés de jardins, d’allées &
d’appartemens. Après les temples, les lieux les plus
fréquentés font les maifons de débauche ; il y a un
quartier entier qui leur eft deftiné, & qui contient
les plus jolies maifons de particuliers , toutes habitées
par des courtifannes.
Le havre de Nangafaki commence au nord de la
ville ; il y a rarement moins de 50 navires dans le
p o r t, dont la plupart font des joncs de la Chine,
outre quelques centaines de bateaux de pécheurs &
autres petits bâtimens. L’ancrage eft au bout de la
baie à une portée de moufquet de la ville. Elle eft
fans château , fans murailles, fans fortification, fans
aucune défenfe. Trois rivières la traverfent, & cependant
elles ne donnent pas quelquefois affez d’eau
pour arrofer les champs de, r iz , 6c pour faire aller
quelques moulins. Voyc^ de plus grands détails dans
Koempfer. Long, fuivant le même Koempfer, i5 i .
lat. 32. 36 . Long, fuivant Harris, 146^. iG'. iS".
& fuivant le P. Spinola, 14G. 17. 30 . /a*, fuivant
ce dernier, 23. 43. Mais je m’en tiendrois plus vo lontiers
à l’eftimation de Koempfer. {D , J .)
NANGIS, ( Géog. ) petite ville de France dans la
Brie , diocèfe de Sens , avec titre de marquifat : elle
eft à 14 lieues de Paris. Long. 20. 5 8 . lat. 48. 3 3 .
C ’eft la patrie de Louis Carré , fils d’un bon laboureur.
Son pere vouloit qu’il fût eccléfiaftique ,
pour le fauver de l’indigence , mais il aima mieux
tomber dans l’indigence que de fe faire eccléfiaftique.
Le P. Mallebranche le prit pour écrire fous lui ;
il devint métaphyficien, géomètre, & de l’académie
des Sciences. Il a donné le premier corps d’ouvrage
qui ait paru fur le calcul intégral ; il eft vrai qu’il y
commit plufieurs fautes , mais il les reconnut fans
détour. Il mourut en 1 7 1 1 , âgé de 48 ans ; il fit l’académie
fa légataire univerfelïe, c’eft-à-dire qu’il lui
laiffa quelques traités qu’il avoit compofés fur des
fujets de Phyfique 6c de Mathématique. { D . J . )
NANKIN, ( Géogr. ) autrement Kiangning, fa-
meufe ville de la Chine dans la province du même
nom, dont elle eft la première métropole. Selon les
Chinois , elle furpaffoit toutes les villes du monde
en magnificence, en beauté 6c en grandeur, quand
les empereurs y tenoient leur cour. Aujourd’hui elle
eft fort déchûe de fon ancien état, quoiqu’on dife
qu’il y a autant de monde qu’à Pékin : on en fait
monter le nombre à un million d’habitans. Le palais
impérial, qui avoit une lieue de circuit, n’eft plus
qu’une mature de ruines. Long, fuivant Caflini, i55.
55'. 30". lat. 32. 7 '. 46"..
NANNETES , ( Géog. anc. ) peuples de la Gaule
Celtique au diocèfe de Nantes, félon Jules-Céfar,
l. I II, c .jx . Prefque tous les autres écrivains difent
Namnetes au lieu de Nannetes. Strabon, /. IV. les met
dans l’Armorique, aux frontières de l’Aquitaine. Ce
font les Na^iÎTcw , Namnetes de Ptolomée , /. II. c
N A N ^
vii/. & leur ville s’appelloit Condivunum. Elle éloi*
fituée fur la Loire, au lieu où eft aujourd’hui la ville
de Nantes. Dans le moyen âge , comme cela eft ar-^
rivé à beaucoup d’autres villes, celle de Condivienunt
perdit fon ancien nom pour prendre celui du peuple;
6c non-feulement on l’ appella civitas Namneturn 6c
civitas Namnttica, mais même on fe contenta de l’ap-
peller Amplement Namnetes ou Narnnetce , commé
Ptolomée , d’où s’eft formé le nom vulgaire de Nan*
tes. Voye{Nantes. {D .J .)
NANNIEST , pierre de , ( Hijl. Hat. ) pierre
précieufe fort finguliere, découverte en 1752 à Nan-
niefi en Moravie , 6c dont M. de Jufti a le premier
donné la defeription dans un ouvrage allemand qui
a pour titre : Nouvelles vérités relatives à Ihijloire Na*
turelle , &C. partie I,
Cette pierre eft d’un blaricdc la it , très-peu tranf»
parente , & même tout-à-fait opaque , pour peu
qu’on lui laide d’épaiffeur. Elle eft entièrement tra^
verfée par des raies d’un brun rougeâtre, qui appro*
che fouvent de la couleur de i’améthyfte : ces raies,
qui ne font pas plus larges que la moitié d’une paille,
ont pénétré toute la pierre ; & un lapidaire de Vienne
qui étoit préfent à la découverte, a afltiré M. de
Jufti que ces raies ou lignes marchoient parallèlement
, 6c comme fi on les eût tracées avec une réglé
l’efpace de dix à douze piés , 6c continuoient, fuivant
toute apparence, à s’étendre de même dans
toute la couche dont cette pierre eft compofée*
Comme le blanc de cette pierre a de la largeur, le
comte de Haugtvitz, qui en eft le propriétaire, en
a fait tailler & polir des morceaux, pour en faire des
tables,des guéridons, &c. D e plus , toute la pierre
eft remplie de petits grenats qui lui font fi fortement
attachés, qu’ils ne s’en détachent poin t, & qu’ils
prennent le poli avec elle. Cette pierre prend un
très-beau poli ; elle eft plus dure que le marbre „
mais ellel’eft moins quel’agathe ou la chalcédoine 5
elle ne peut point être mife au rang des marbres^*
vû qu’elle ne fait aucune effervefcence avec les acides
; elle ne fait point feu lorfqn’on la frappe avec
un briquet ; fon tiflii différé de celui du fpath, 6c fa
dureté n’eft point aufli grande que celle du porphyre,
du jafpe ou du caillou : d’où M. de Jufti
cônclud que c ’eft une pierre d’une nouvelle efpece*
^ NANQUE, f. m. {Comm. ) c’eft le plus petit poids
des cinq dont on fe fert parmi les habitans de Ma-
dagafear , pour pefer l’or 6c l’argent : il ne pefe que
dix grains, au-deflus font le fompi, le vari, le lacaré
6c le nanqui. Voye[ SoMPi, &c. Dictionnaire de Commerce.
{ G )
N ANQUI, f. m. ( Comm. ) c’eft aufli un des cinq
poids dont les habitans de l’île Dauphine ou Mada-
gafear en Afrique fe fervent pour pefer l’or 6c l’argent
; il n’a au-deffous de lui que le nanque, qui
vaut fix grains, & au-deflus le fompi, le vari &
le facare, dont le fompi, qui eft le plus fort, revient
à la dragme ou gros, poids de l’Europe ; le nanqui
en eft le demi-fcrupule. Voyeç Sompi , Scrupule.
Dictionnaire de Commerce. { G )
NANSOO, ( Hift. nat. Botan. ) c’eft une plante
du Japon à grandes feuilles pointues, dont les baies
font très-chaudes : c’eft ce qu’on appelle dracunculus*
NANTERRE, ( Géog. ) en latin moderne Nepto*
durum ou Nemetodurum , bourg à deux lieues de
Paris connu par la naiflance de fainte Génevieve ,
morte en 511 à Paris, dont elle eft la patrone. La
tradition veut ridiculement que cette fainte fût une
payfanne, une gardeufe de moutons. Plufieurs peintres
ont été fideles à nous la repréfenter en bergere,
avec un bavolet, une quenouille à la main, & gardant
un troupeau ; mais l’exhortation que lui fit faint
Germain, évêque d’Auxerre, de renoncer à la bra