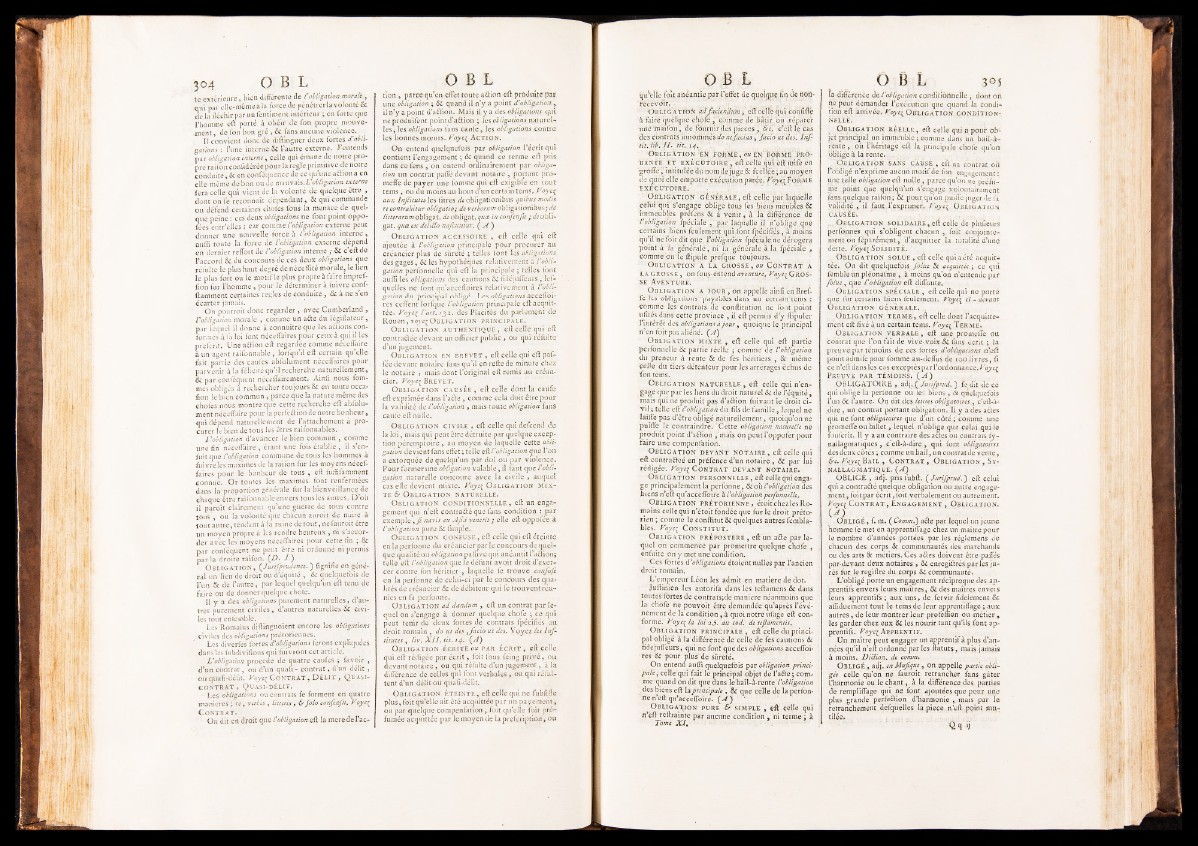
te extérieure, bien différente de i'obligation morale ,
.qui par elle-même a la force de pénétrer la volonté &
de la fléchir par un fentiment intérieur ; en forte que
l’homme eft porté à obéir de fon propre mouve-
.ment, de fon bon gré , 6c fans aucune violence.
Il convient donc de diftinguer deux fortes d'obligations
: l’une interne 6c l’autre externe. J’entends
par obligation interne, celle qui émane de notre propre
raifon confidérée pour la réglé primitive de notre
conduite, & en conféquence de ce qu’une aétiona en
elle-même de bon ou de mauvais .L'obligation externe
fera celle qui vient de la volonté de quelque etre ,
dont on fe reconnoît dépendant, & qui commande
ou défend certaines chofes fous la menace de quelque
peine : ces deux obligations ne font point oppo-
fées entr’elles ; car comme l'obligation externe peut
donner une nouvelle forcé à l'obligation interne,
suffi toute la force de l'obligation externe dépend
en dernier refl'ort de l'obligation interne ; 6c c’eft de
l’accord & du concours de ces deux obligations que
réfulte le plus haut degré denéceffité morale, le lien
le plus'fort ou le motif le plus propre à faire impref-
lion fur l’homme , pour le déterminer à Cuivre conf-
ftamment certaines réglés de conduite , & a ne s en
écarter jamais.
On pourroit donc regarder , avec Cumberland ,
Vobligation morale , comme un aéte du légiflateur,
par lequel il donne à connoître que les aûions conformes
à fa loi font néceffaires pour peux à qui il les
preferit. Une attion eft regardée comme néceflaire
à un a»ent raifonnable, lorfqu’il eft certain qu’elle
fait partie des caufes abfolument néceffaires pour
parvenir à la félicite qu’il recherche naturellement,
& par conféquent néceffairement. Ainfi nous fom-
mes obligés à rechercher toujours 6c en toute occa-
fion le bien commun , parce que la nature même des
chofes nous montre que cette recherche eft abfolument
néceflaire pour la perfe&ion de notre bonheur,
qui dépend naturellement de l’attachement a procurer
le bien de tous les êtres raifonnables.
l'obligation d’avancer le bien commun , comme
une fin néceflaire , étant une fois établie , il s’enfuit
que l'obligation commune de tous les hommes à
fuivreles maximes de la raifon fur les moyens néceffaires
pour le bonheur de tous , eft fuffifamment
connue. Or toutes les maximes font renfermées
dans la proportion générale fur la bienveillance de
chaque être raifonnable envers jousles autres. D ’où
il paroît clairement qu’une guerre de tous contre
tous*, ou la volonté que chacun anroit de nuire à
tout autre, tendant à l'a ruine de tout, nefauroit être
un moyen propre à les rendre heureux , ni s’accorder
avec les moyens néceffaires pour cette fin ; 6c
par conféquent ne peut être ni ordonné ni permis
par la droite raifon. (JD. /.) ^ -
O b l i g a t i o n , ( Jurifprudence. ) lignifie en général
un lien de droit ou d’équité , 6c quelquefois de
l’un & de l’autre, par lequel quelqu’un eft tenu de
faire ou de donner quelque chofe.
Il y a des obligations purement naturelles, d’autres
purement civile s, d autres naturelles & civiles
tout enfemble.
Les Romains diftinguoient encore les obligations
/Civiles des obligations prétoriennes.
Les diverfes fortes d'obligations feront expliquées
dans les fubdivifions qui fuivront cet article. '•
L'obligation procédé de quatre caufes ; favoir ,
d’un contrat, ou d’un quafi - contrat, d’un délit,
ou quali-délit. Voye^ C o n t r a t , D é l i t , Q u a s i -
c o n t r a t , Q u a s i - d é l i t .
Les' obligations ou contrats fe forment en quatre
maniérés ; re, verbis , litteris , & folo confenfu. Voye%_
C o n t r a t .
On dit en droit que l'obligation eft la mere del’action
, parce qu’en effet toute aâion eft prôdui,te’par
une obligation ; 6c qua.nd il n’y a point d'obligation,
il n’y a point d’aûion. Mais il y a des obligations qui
neproduifent pointd’aftion ; les obligations naturelles*
les obligations fans caufe, les obligations contre
les bonnes moeurs. Foye^ A c t i o n .
On entend quelquefois par obligation l’écrit qui
contient l’engagement ; 6c quand ce terme-eft pris
dans ce fens , on entend ordinairement par obligation
un contrat paflé devant notaire , portant pro-
meffe de payer une fomme qui eft exigible en tout
tems, ou du moins au bout d’un certain terns. Voye£
aux Injlitutes les titres dfeobligationibus quibus modis
re contrahitur obligation de verborum obligationibus; de
litterarum obligat. de obligat. qua in confenfu ; de obli-
gat. qua ex deliclo nafeuntur. ( A )
O b l i g a t i o n a c c e s s o i r e , eft celle qui eft
ajoutée à l'obligation principale pour procurer au
c r é a n c ie r plus de sûreté ; telles font les obligations
des gages, 6c les hypothèques relativement à l'obligation
perfonnelle qui eft la principale ; telles font
auffi les obligations des cautions 6c fidéjufteurS , lel-
quelles ne lont qu’acceflbires relativement â l'obligation
du principal obligé. Les obligations accefloi-
res ceffent lorfque l'obligation principale eft acquittée.
Voyet^ l'art. 132. des Placités du parlement de
Rouen, voye{O b l i g a t i o n p r i n c i p a l e .
O b l i g a t i o n a u t h e n t i q u e , e ft c e l le q u i e ft
c o n t r a r ié e d e v a n t u n o f f ic ie r p u b li c , o u q u i r é fu lt e
d ’ un ju g em e n t .
O b l i g a t i o n e n b r e v e t , eft celle qui eft paf-
fée devant notaire fans qu’il en reftede minute chez
le notaire , mais dont l’original eft remis au créancier.
Voye{ B r e v e t .
O b l i g a t i o n c a u s é e , eft celle dont la caüfe
eft exprimée dans i’acie , comme cela doit être pour
la validité de l'obligation , mais toute obligation fans
caufe eft nulle.
O b l i g a t i o n c i v i l e , eft celle qui defeend de
la lo i, mais qui peut être détruite par quelque exception
péremptoire , au moyen de laquelle cette obligation
devient fans effet ; telle eft l ’obligation que l ’on
a extorquée de quelqu’un par dol ou par violence.
Pour former une obligation valable, il faut que l'obligation
naturelle concoure avec la civile » auquel
cas elle devient mixte. Voye% O b l i g a t i o n m i x t
e & O b l i g a t i o n n a t u r e l l e .
O b l i g a t i o n c o n d i t i o n n e l l e , eft un engagement
qui n’eft contracté que fans condition : par
exemple , f i navis ex AJidvencrit j elle eft oppofée à
l'obligation pure 6c Ample.
O b l i g a t i o n c o n f u s e , eft celle qui eft éteinte
en la perfonne du créancier par le concours de quelque
qualité ou obligation paffive qui anéantit l’aélion;
telle eft l'obligation que le défunt avoit droit d’exercer
contre fon héritier , laquelle fe trouve çonfufe
en la perfonne de celui-ci par le concours des qualités
de créancier 6c de débiteur qui fe trouventréu-
nies en fa perfonne.
O b l i g a t i o n ad dandum , eft un contrat par lequel
on s’engage à donner quelque chofe ; ce qui
peut tenir de deux fortes de contrats fpécifiés au
droit romain , do ut des 9facio ut des. Voyez ./« Inf-
titutes , liv. X I I . tit. 14. (A~)
O b l i g a t i o n é c r i t e ou p a r é c r i t , eft c e l le
q u i e ft r é d ig é e p a r é c r i t , fo i t fo u s fe in g p r i v é , o u
d e v a n t n o t a i r e , ou q u i r é fu lte d ’un ju g em e n t , à la
d iffé r e n c e d e c e lle s q u i fo n t v e r b a l e s , o u q u i r é fu l-
ten t d ’u n d é lit o u q u a fi-d é lit .
O b l i g a t i o n é t e i n t e , eft celle qui ne fubfifte
plus, foit qu’elle ait été acquittée par un payement,
ou par quelque compenfation, foit qu’elle foit préfumée
acquittée par le moyen de la prefcriptiôp, ou
qifleüe /bit anéantie par j ’çffej de quelque fin de nÔn-
‘recevcfir. ....
Ob l ig a t io n adfaciendum ; eft celle qui,confiftë
à faire quelque chofe. ' comme de bapr ou réparer
nrtè'maifoïi , de fournir des pieces , £c. c’eft le cas
des contrats innom‘mes do rttfaêias -, facio ut des, Inf-
-tit. lib. IL. tit., 14. \
O b l i g a t i o n é N f o r m e , ou ë n ‘ f o r à i e p r ,ô -
ÎBANTE e t E x É c û f ÔIRÉ , e ft c e lîè q u i ë f t m ifè en
g r o f le y in t i tu lé e d u nom d e .jû g e .& fc e l lg e ;.au m o y e n
d e q u o i e l le em p o r te e x é c u t io n pared Foyer F o r m é
e x e c u t o i r e . ;
• O b l i g a t i o n -g e n e r a l e , eft celle par laquelle
celui qui s’engage obligé tous fes '.Biens meubles 6c
immeubles préfens & à venir, à la’ drfeence. de
■ l'obligation i’péciâlë ,'. p.ar laquelle il 'n’ob.ljge„que
certains biens feiilehiënt qu.l ifônt ’fpeçiè<is, à moins
qu’il ne foit dit que'J ^obligation fpéciàlené dérogera
point à la générale, ni Ta générale à la. jfpecialë
comme .on le ftipiilé prëfque toujours.;
O b l i g a t i o n A l à . g iÇo s s e , ou .C o n t r a t à
LA GROSSE , o n fo u s -ën ten d aventuré, Voyé^ G r o s s
e A v e n t u r é -.
O b l i g a t i o n a j o u r , on appelle ainfi enBref-
de les obligations- payables dans un certain tèms :
comme les contrats dé conftitution ne font, point
iifîtés dans cette province , il eft permis d’y ftipuler
l’intérêt des obligations à jour, quoique le principal
n’en foit pas aliéné, (yf)
O b l i g a t i o n m i x t e , eft celle qui eft partie
perfonnelle & partie réelle ; comme' de l'obligation
du preneur à rente & de fes héritiers , êt même
celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de
■ fon tèms:
O b l i g a t i o n n a t u r e l l e , eft celle qui n’engage
que par les liens du droit naturel & de l’équité,
mais qui ne produit pas d’aétion fuivant le droit civil
; telle eft l'obligation du fils de famille, lequel ne
laiflë pas d’être obligé naturellement, quoiqu’on ne
puiflë le contraindre. ‘ Cette obligation naturelle ne
produit point d’aélion , ’màîs on peut l’oppofer pour
faire une compenfation.
O b l i g a t i o n d e v a n t n o t a i r e , e ft c e l le q u i
e ft co n t r a é le é e n p r é fe n c ë d ’iin n o t a i r e , & p a r lu i
r é d ig é e . Voye^ C o n t r a t d e v a n t n o t a i r e .
O b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e , eft celle qui engage
principalement la pêrfoniie, & o ù l'obligation des
biens n’eft qu’acceffoire à l'obligation perfonnelle.
O b l i g a t i o n p r é t o r i e n n e , é to i t c h e z le s R o m
a in s c e l l e q u i n ’ é to i t fo n d é e q u e fu r l e d r o it , p r é to r
i e n ; com m e le c p n f t i t u t& q u e lq u e s a u t r e s fem b la -
b le s . Voye{ C o N S T i T U f ,
O b l i g a t i o n p r é p o s t e r e , eft un a£le par lequel
on commencé par promettre quelque chofe
enfuite on y met une condition.
Ces fortes obligations ètoientruxlies par l’ancien
droit romain.
L ’empereur Léon les admit en matière de dot.
Juftinien les autorifa dans les teftamens & dans
toutes fortes de contratsjde maniéré néanmoins que
la chofe ne pouvoit être demandée qu’après l’événement
de la condition ,,à quoi notrè ufage eft conforme.
Voye^la loi 26. a u cod', de tejlamentis~
O b l i g a t i o n p r i n c i p a l e , eft celle du principal
obligé à la difference de celle de fes cautions &
fidejufleurs, qui ne.font que des obligations àcceffoi-
Tes 6c pour plus‘de sûreté.
On entend auffi quelquefois par obligation principale
, celle qui fait le principal objet de l’aâe ; comme
quand On dit que dans le bail-à-rente l'obligation
} des biens eft la principale , 6c que celle de la perfonne
n’eft qu’acceffoire. ( A )
O b l i g a t i o n p u r e 6* s im p l e , e f t c e l le q u i
n ’è ft r e ft r a in te p a r a u c u n e c o n d it io n , n i te rm e ; à
Tonie X I%
la -d iffé r e n c e d e l'obligation cQ n d i t iô t tn e lle , d o n t on
n e p eu t d em an d er l’ e x é c u t io n q u e q u a n d la c o n d i-
U on e f t . a r r i v é e . - O b'l i g a t i o n c o n d i t i o n -
n é l l é .
OBLLpATiON. RÉE LLE, e ft c e l le q u i a p o u r o b je
t p r in c ip a l u n im q e u b le j.com m e d an s tin b a i l- à -
ren te , o ù l’h é r ita g e e ft la p rin c ip a le ch o fe q u ’o n
o b l ig e à la r e n te . ; .
O b l i g a t i o n s a n s c a u s e , eit un contrat où
I obligé n’éxprime aucun motif de fon engagement :
qne telle obligation eft nulle, parce qu’on ne préfu-
tiVe point que quelqu’un s’engage volontairement
fans quelque raiibn; & pour.qu’on puiffe juger de fa
validité , il faut,l’exprimer. Voye^ O b l i g a t i o n
CAUSEE;
„ . O b l i g a t i o n s o l i d a i r e , elî celle de plufleurs
perfônnés qui s’obligent chacun , foit conjointement
ou féparément, /d’acquitter la totalité d’uné
dette. 7rqy<{SoLiDiTÉ.
. O b l i g a t i o n s o l u e , eft celle qui a été acquittée.
On dit quelquefois, ÿp/fee & acquittée ; ce qui
femble im pléonafme , à moins qu’on n’entende par
foliie,, que l'obïigatio/i eft diffoute.
• O b l i g a t i o n s p é c i a l e ., e ft c e lle q u i n e p o r té
q u e fu r c e r ta in s b ie n s feu lern en t i f ^ o y e i c i - d e v a n t
O b l i g a t i o n g é n é r a l e . ,
O b l i g a t i o n t e r m e , eft celle dont l’acquitte-
jnent eft fixé à un certain tems.Voye^ T e r m e .
O b l i g a t i o n v e r b a l e , eft une prom.effe ou
'contrat que l’on fait de vivè-voix & fans écrit ; la
preuve par témoins de ces fortes d'obligations n’eft
pointadtnifepour fomme au-deflùs de 100 livres, fi
ce n’eft dans les cas exceptés par l’ordonnance,
P r e u v e p a r t é m o i n s , ( A )
OBLIGATOIRE, adj. ( Jurifpmd. ) fendit de ce
qui oblige la perfonne ou les biens , & quelquefois
l’un & l’autre. On dit des lettres obligatoires , c’eft-à-
dire, un contrat portant obligation, Il y à des aéles
qui ne font obligatoires que d’un côté. ; comme une
promeffe ou b illet, lequel n’oblige que celui qui le
foulcrit. Il y a au contraire des actes ou contrais iy -
nallagmatiques , jc’eft-àrdire , . qui font obligatoires
des deux côtés ; comme un bail, un contrat de vente,
.6’c. foyei B a i l , C o n t r a t , O b l i g a t i o n , S y n
a l l a g m a t i q u e . (A ~ )
ÔBLlOÉ , adj. pris lubft. ( Jurifprud. ) eft celui
qui a contraélé quelque obligation ou autre engagement,
foitpar écrit ,foit.verbalement pu autrement.
.V o y e r C O N T R A T , EN G AG EM ENT , O B L IG A T IO N . WnÊÊL WM O b l i g é , f. m. ( Comm.) aéle par lequel un jeune
homme fe met en apprentiffage chez un maître pour
le nombre d’années portées par les réglemens de
chacun des corps & communautés des marchands
ou dès arts & métiers. Ces attes doivent être paffés
par-devant deux notaires > ôc enregiftrés par les jurés
Tur le regiftre du corps & communauté.
L’obligé porte un engagement réciproque des ap-
prentifs envers leurs maîtres, & des maîtres envers
leurs apprentifs ; aux uns, de fervir fidèlement &
affiduement tout le tems de leur apprentiffage ; aux
autres, de leur montrer leur profeffion ou métier .,
les garder chez eux & les nourir tant qu’ils font apprentifs.
Voye^ Â r p r e n t i f .
Un maître peut engager un apprentif à plus d’années
qu’il n’eft ordonné par les ftatuts, mais jamais
.à,moins. Diction, de comm.
O b l i g é , a d j . enMufique, o n a p p e lle partie obligée
c e lle qu*on n e fa u r o i t r e t r a n c h e r fan s g â t e r
l ’h a rm o n ie o u le c h a n t , à la d iffé r e n c e des, p a r tie s
d e rem p liffa g e q u i n e fo n t a jo u té e s q u e pQttr une
p lu s g r an d e p e r fe& io n d’h a rm o n ie , ma is p a r le
r e t ran c h em en t , d e fq û e lle s la p ie c e n ’eft- p o in t m u t
i lé e .
Q q >j