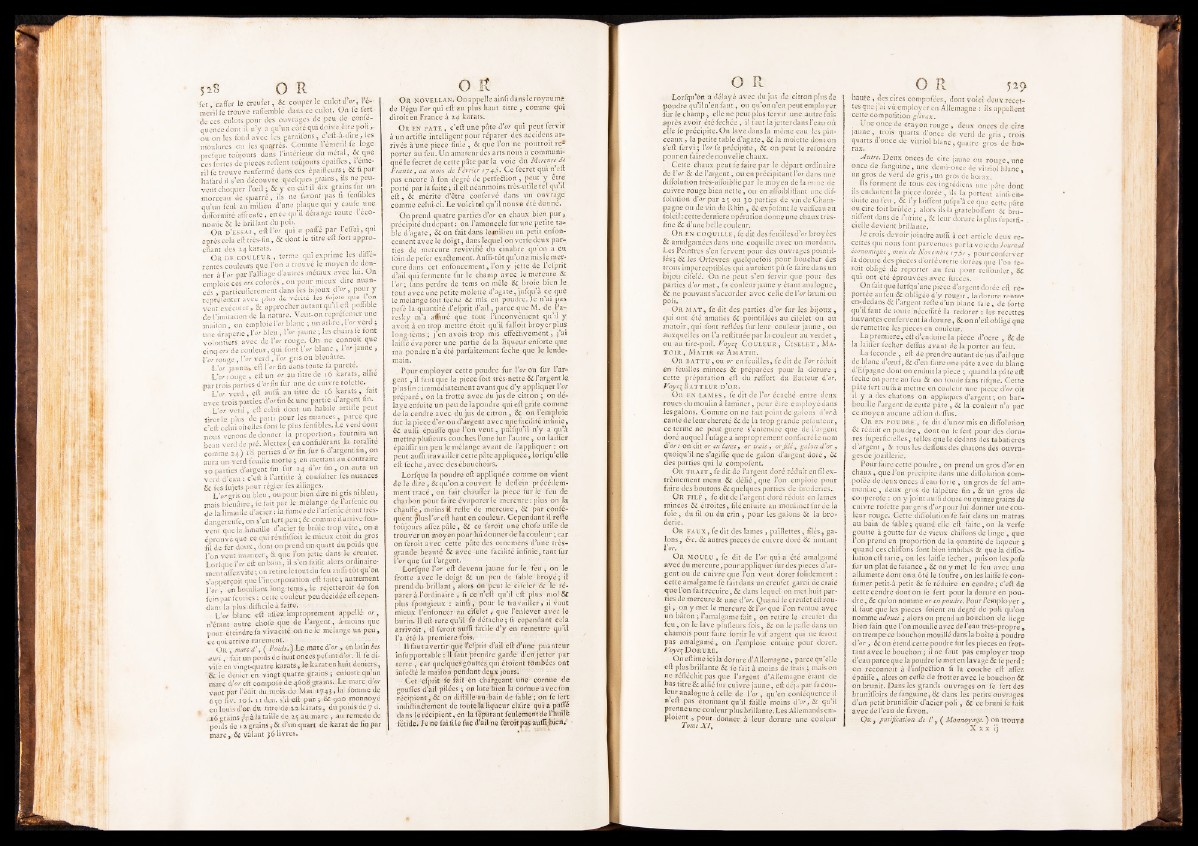
fe t , caffer le creufet, & couper le ciildt d?or', l’é -
meril le trouve raffemblé dans ce culot. On fe fert ■
de ces culots pour des ouvrages de peu de confe-
quencedont il n’y a qu’un côté qui doive^être poli,-
ou on les fond avec les garnil'ons, c’ell-a-dire, les
moulures ou les qiujfrés. Comme 1 emeril fe loge
prefque toujours dans l’interieur du métal, & que
ces fortes de pièces relient toujours épaiffes, l emeril
fe trouve renfermé dans ces épaifleurs ; & fi par
-hafard il s’en découvre quelques grains , ils ne peuvent
choquer l’oeil ; & y en eut-il dix grains fur un
morceau de quarré, ils ne feront pas fi fenfibles
qu’un feul au milieu d’une plaque qui y caufe une
-difformité affrewfe, en ce qu’il dérange toute 1 économie
& le brillant du poli. »
Or d’essai, e f t lV qui a paffe par l e ffai, qui
après cela eft très-fin, & dont le titre eft fort approchant
des 24 karats. • .
Or de couleur , terme qui exprime les differentes
couleurs que l’on a trouvé le moyen dé ton ner
à I V par l’alliage d’autres métaux avec lui. On
emploie ces ors colorés , ou pour mieux dire nuancés
, particulièrement dans les bijoux d V , pour y
•-reorélenter avec plus de vérité les fujets que. l’on
veut exécuter, & approcher autant qu’il eft poffible
de l’imitation de la nature. Veut-on repréfenter une
mailbn on emploie IV blanc ; un arbre, I V verd ;
une draperie, IV ble.u, I V jaune ; les chairs le ront
volontiers avec de IV rouge. On ne connoît que
cinq ors de couleur, qui font I V blanc , I V jaune ,
I V rouge, Yor verd , IV gris ou bleuâtre.
L V jaune*, eft I V fin dans toute la pureté. I
L V rouge , eft un or au titre de 16 karats, allie
par trois parties d V fin fur une de cuivre rolette.
L V verd , eft aufli au titre de 16 karats , fait
avec trois parties d’or fin & une partie d’argent fin.
L’or v e rd , eft celui dont un habile artiftè peut
tirer le plus de parti pour les nuances, parce que
e’eft celui où elles font le plus fenfibles. Le verd dont
nous venons de donner la proportion , fournira un
beau verd de pré. Mettez( en conftdérant la totalité
comme 14 ) El parties d’or fin fur 6 d’argentifin, pn
aura un verd feuille morte ; en mettant au.contraire
ïo parties d’argent fin fur 14 d’or fin , on aura un
verd d’eau : c’eft à l’artifte à confulter fes nuances
& fes fujets pour régler fes alliages. . . - :,
L ’orgrisou bleu, ou pour bien dire ni gus nibleu,
mais bleuâtre, fe fait par le.mélange d,el’aifemcou
<le la.limaille d’acier : la-fumée de l’arfenic étant tres-
dangereufe, on s’en i'ert peu ;& comme il arrive fou-
vent que la.limaille d’acier le brûle trop vite * on a
éprouvé que ce qui réuflifloit le mieux étoit du gros
fil de fer doux, dont on prend un quart du poids que
l’on veut nuancer, &que l’on jette dans lecreulet.
Lorfque Yor eft en bain, il s’en faifit alors .ordinairementaffezvite;
on retire le.tout du feu aufli-tôt qu’on
s’apperçoit que l’incorporation eft faite ;■ autrement
I V , en bouillant .long.-tenus., le rejetteroit de fon
fein parfeories ; cette couleur peu décidée eft cependant
la plus.difficile à faire. •
L’or blanc eft affez improprement appelle or. ,
n’étant autre chofe que de l’argent, à-moins, que
pour éteindre fa vivacité on ne le mélange un p eu,
ce qularrive rarement. . -
Or 1 marc d' , ( Poids*).Le mate d or , en latin bes
auri, • fait un poids de huit onces pefmt d or. i l le di-
vife en vingt-quatre karats, le karaten huit deniers,
& le denier en. vingt-quatre! grains ; enforte qu’un
marc dfor eft compolé de.460^ grains.. Le• marc d or
vaut par l’édit du mois;de. Mar >1743, lai fomme de
650 liv. 10 f. 11 den. s^iLeft >puDpr&; 900 monnoyé
en louis d’or.du litreïclèiza kâratp, du poids d ey d.
.16 grains ^ .à la taille de,.215 àu-marc , au remede de
poids de 1 2 grains, & d’un quart de karat de fin par
marc, & valant 36livres,
O R
O r n o vel lan. On appelle ainfi dans le royaume
de Pégu l’or qui eft au plus haut titre , comme qui
diroiten France à 24 karats.
Or en p â t e , c’eft une pâte d’or qui peut fervir
à un artifte intelligent pour reparer des accidens arrivés
à une piece finie , & que l’on ne pourroit rea
porter au feu. Un amateur des arts nous a 'communiqué
le fecret de cette pâte par la voie du Mercure dt
France, au mois de Février 1746. Ce fecret qui n’eft
pas encore à fon degré de perfection, peut y etre
porté par ia fuite ; il eft néanmoins très-utile tel qu il
e f t , & mérite d’être confervé dans un ouvrage
comme celui-ci. Le voici tel qu’il nous a été donné.
On prend quatre parties d’or en chaux bien pur,
précipité du départ: on l’amoncele fur une petite table
d’agate, & on fait dans lennilieu un petit enfoncement
avec le doigt, dans lequel on verfe deux parties
de mercure revivifié du cinabre qu’on a eu
foin de pefer exactement. Aufli-tôt qu’on a mis le mercure
dans cet enfoncement, l’on y jette de l’efprit
d’ail qui fermente fur le champ avec le mercure &
l’or; fans perdre de tems on mêle & broie bien le
tout avec une petite molette d’agate, jufqu’à ce quê
le mélange foit feché &: mis en poudre. Je n’ai pas
pefé la quantité d’efprit d’a i l, parce que M. de Pa-
resky m’a affuré que tout l’inconvénient qu’il y
avoit à en trop mettre étoit qu’il falloit broyer plus
long-tèms ; j’en avois trop mis effectivement, j’ai
laiffé évaporer une partie de la liqueur enforte que
ma poudre n’a été parfaitement feche que le lendemain.
Pour employer cette poudre fur I V ou fur l’argent
, il faut que la piece foit très-nette & l’argent lé
plus fin : immédiatement avant que d’y appliquer l ’or
préparé, on la frotte avec du jus de citron ; on dé*
laye enfuite un peu de la poudre qui eft grife comme
de la cendre avec du jus de citron , on l’emploie
fur la piece d’or ou d’argent avec une facilité infinie,
& aufli épaiffe que l’on v eu t , pmfqu’il n’y a qu’à
mettre plufieurs couches l’une fur l’autre, ou laiffer
épaiflir un peu le mélange avant de l’appliquer : on
peut aufli travailler cette pâte appliquée, lorfqu’elle
eft feche,avec desébauchoirs. .
Lorfque la poudre eft appliquée comme on vient
de le dire , & qu’on a couvert le deffein précédemment
tracé, on fait chauffer la piece furie feu de
charbon pour faire évaporer le mercure : plus on la
chauffe, moins il refte de mercure, & par confé-
quent plusl’oreft haut en couleur. Cependant il refte
toujours affez pâle, & ce feroit une choie utile de
trouver un moyen pour lui donner de la couleur ; car
on feroit avec cette pâte des ornemèns d’une très-
grande beauté & avec une facilité infinie, tant fur
I V que fur l ’argent.
Lorfque I V eft devenu jaune fur le feu , on le
frotte avec le doigt & un peu de fable ' broyé ; il
prend du- b rillant, alors ônpeut le ci le 1er & le réparer
à l’ordinaire , fi ce n’eft qu’il eft plus mol'ôt
plus fpongieux : ainfi, pour le travailler, il vaut
mieux l’enfoncer-au cifelet f qiië l’enlever avec le
burin. Il eft rare qü’-il fe détache ; fi cependant cela
arrivoit, ’il feroit attfli facile d’y en remettre qu’il
l’a été la pfemieré'fois;
Il-faut avertir que l-jefprit d’ail eft d^une puanteur
infupportable : Il faut prendre garde tl’etVjetter par
•terre , car quelqùes'go'nttés; qui étoient tombées ont
1 infefté la maifon pendant deux jbnrsi
Cet ;efprit le raif èn chargeant une- cornue de
goufles d’ail pilées ;' on lùte'bien la cbrtiue’avecfon
récipient, & on diftillé au bain de Tablé i ç>n fe fert
indiftinétement dè totiteîa'liqùeur claire qui a paffé
dans le récipient , ën la féRarant feulemeritde l’huilè
fétide. Je ne fai fi le fuc d’ail ne feroit pas aufli.'bien/
L o r fq i fô n a d é la y é a v e c du ju s d e c i t r o n p lu s d e 1
p o u d r e q u ’i l n ’ e n f a u t , o u q u ’on n’en p eu t em p lo y e r
f u r le c h am p , e lle n e p eu t p lu s f e r v i r u n e a u t r e fo is
« p r è s a v o i r é té fe c h é e , il fa u t la je t te r d a n s l ’e a u o ù
.elle f e p r é c ip it e . O n la v e d an s ia m êm e e a u le s p in c
e a u x , la p e t it e ta b le d ’a g a t e , & la m o le t te d o n t o n
s ’e ft f e r v i ; Yor fe p r é c ip i t e , & o n p eu t le r e fo n d r e
p o u r e n fa i r e de n o u v e l le c h a u x .
C e t t e c h a u x p e u t f e fa ir e p a r l e d é p a r t o rd in a ir e .
d e l ’or & d e l’a r g e n t , o u en p ré c ip it a n t l’ or dans une
d iffo lu t io n t rè s -a ffo ib lie p a r le m o y e n d e la min e de
c u i v r e r o u g e b ie n n e t t e , o u en a ffo ib liffan t une d i f fo
lu t io n d’o r p a r 25 o u 30 p a r tie s d e v in d e C h am p
a g n e o u d e v in d e R h in , & e x p o fa n t le v a if f e a u a u
ïo le i l : c e t te d e rn ie r e o p e ra tio n d o n n e u n e c h a u x t rès-
fin e &c d ’une b e lle c o u le u r .
O r e n c o q u i l l e , fe d it des f e u i l le s d ’or b r o y é e s ,
& am a lg am é e s d ans u n e c o q u i l le a v e c un m o rd a n t .
L e s P e in t r e s s’en f e r v e n t p o u r d e s o u v r a g e s p o in till
é s ; & le s O r f è v r e s q u e lq u e fo is p o u r b o u c h e r d e s
t ro u s im p e r c e p t ib le s q u i a u r o ien t p û fe fa ir e d ans un
b i jo u c i f e lé . O n n e p e u t s ’ e n f e r v i r q u e p o u r d es
p a r t ie s d ’or m a t , fa c o u le u r ja u n e y é ta n t a n a lo g u e ,
& n e p o u v a n t s’a c c o r d e r a v e c c e l le d e l ’o r b ru n i o u
p o l i .
Or m a t , f e d it des p a r t ie s d ’or fu r le s b i jo u x ,
q u i o n t é té am a t ie s & p o in tillé e s a u c i fe le t o u a u
m a t o i r ,q u i fo n t r e fté e s fu r le u r c o u le u r ja u n e , o u
a u x q u e lle s o n l’a r e ft i tu é e p a r la c o u le u r a u v e r d e t ,
o u au t ir e -p o i l. V o y e [ C o u l e u r , C i s e l e t , M a -
t o i r , M a t i r ou A m a t i r .
O r b a t t u , o u or en f e u i l le s , f e d it de l’ or réd u it
e n fe u ille s m in c e s & p ré p a r é e s p o u r la d o ru r e ;
c e t t e p r é p a r a t io n e ft d u r e ffo r t d u B a t t e u r d ’or»
V o y e çB a t t e u r d ’o r .
• O r e n l a m e s , fe d it d e l ’ or é c a c h é e n t re d e u x
r o u e s d um o u lin à lam in e r , p o u r ê t r e em p lo y é 'd a n s
le s g a lo n s . C om m e o n n e fa i t p o in t d e g a lo n s d ’or à
c a u f e d e le u r c h e re té & d e la t ro p g r an d e p e fa n t e u r ,
c e te rm e n e p eu t g u e r e s’ en ten d r e q u e de l ’a rg e n t
d o r é a u q u e l l ’u fa g e a im p ro p r em e n t c o n fa c r é le n om
d ’o r ; o n d it o r en Lame, or trait, or filé , galon d'or ,
q u o iq u ’i l n e s’ a g if fe q u e d é g a lo n d ’a rg e n t d o r é ,
d e s p a r tie s q u i le com p o fen t .
O r t r a i t , fe d it de l ’a r g e n t d o r é r é d u i t en fil e x t
rêm em en t m e n u & d é l i é , q u e l ’on em p lo ie p o u r
fa i r e d e s b o u to n s & q u e lq u e s p a r tie s de b ro d e r ie s .
O r f i l f , f e d it d e l ’a r g e n t d o r é r éd u i t en lam es
m in c e s & é t r o i t e s , filé e n lu ite au m o u lin e t fu r d e la
f o i e , d u fil o u du c r in , p o u r le s g a lo n s & la b r o d
e r ie . 1 : :
O r f a u x , f e d it d e s l a m e s , p a i l le t t e s , f i lé s , g a lo
n s , & c . & a u t r e s p iè c e s d e c u iv r e d o r é & im itan t
l ’or. -
O r m o u l u , f e d it d e l ’or q u i a é té am a lg am é
a v e c d u m e r c u r e , p o u r a p p liq u e r fur d e s p iè c e s d ’a r g
e n t o u d e c u iv r e q u e l’o n v e u t d o r e r l'o lid em en t :
c e t t e am a lg am e fe fa i t dan s un c r e u fe t g a r n i d e c r a ie
q u e l ’o n fa i t r e c u i r e , & d an s le q u e l o n m e t h u it p a r t
ie s d e m e r cu r e & u n e d ’or. Q u a n d le c r e u fe t e ft ro u ? i
g i , o n y m e t le m e r c u r e & l ’or q u e l ’o n r em u e a v e c
u n b â to n ; l ’am a lg am e f a i t , o n r e t i r e le c r e u le t du
f e u , o n l e la v e p lu fieu r s f o i s , &c o n le p a ffe dans un
ch am o is p o u r fa i r e fo r t ir le v i f a r g e n t q u i n e fe ro it
p a s am a lg am é , o n l ’em p lo ie e n fu ite p o u r d o r e r .
V D o r u r e .
O n e ft im e ic i la d o ru r e d ’A llem a g n e , p a r c e q u ’e lle
e ft p lu s b r illa n te & f e fa i t à m o in s de fra is ; m a is o n
n e r é f lé c h it p as q u e l ’a rg e n t d ’A llem a g n e é ta n t de
b a s t it re & a llié fu r c u i v r e ja u n e , e ft d é jà p a r fa c o u le
u r a n a lo g u e à c e l le de l ’o r , q u ’e n co n le q u e n c e il
n e ft pas é to n n a n t q u ’i l fa i l le m o in s d ’o r , & q u ’il
p re n n e u n e c o u le u r p lu s b r illan te . L e s A llem an d s em p
lo ie n t , p o u r d o n n e r à le u r d o ru r e u n e co u le u r
T om e X I , |
Haute , des cires compofées, dont voici deux recettes
que j ai vu employer en Allemagne : ils appellent
cette compofition glivax.
_ Une once de crayon rouge , deux onces de cire
jaune, trois quarts d’once de verd de gris, trois
quarts d once de vitriol blanc quatre gros de borax.
^arre. Deux onces de cire jaune ou rouge, une
once de fanguine, une demi-once de vitriol blanc
un gros de verd de gris, un gros de borax.
Ils forment de tous cës ingrédiens une pâte dont
ils enduifent la piece dorée , ils la portent ainfi enduite
au feu , & l’y laiffent jufqu’à ce que cette pâte
ou cire foit brûlée ; alors ils la grateboffent & bru-
niffent dans de l’uïine, & leur dorure la plus fuperfî-
cieile devient brillante.
Je crois devoir joindre aufli à cet article deux recettes
qui nous font parvenues parla voiedu Journal
économique , mois de Novembre iySi -, pour conferver
la dorure des pièces d’orfèvrerie dorées que l’on ie-
roit obligé de reporter au feu pour reffouder, &c
qui ont été éprouvées avec fuccès.
On faijt que lorfqu’une piece d’a rgent dorée eft reportée
au feu & obligée d ’y rougir, la dorure rentre
en-dedans & l’argent refte d’un blanc l’ale, de forte
qu il faut de toute néceflïté la redorer : les recettes
luivantes confervent la dorure, & on n’eft obligé que
de remettre les pièces en couleur.
La première, eft d’enduire la piece d’ocre , & d e
la laifler fecher deffus avant de la porter au feu.
La fécondé , eft de prendre autant de jus d’ail que
de blanc d’eeuf, & d’en faire une pâte avec du blanc
d Efpagne dont on enduit la piece ; quand la pâte eft
feche on porte au feu & on ioude fans rifque. Cette
pâte fert aufli à mettre en couleur une piece d’or où
il y a des'chatons ou appliques d’argent; on barbouille
l’argent dç cette pâte , & la couleur n’a par
ce moyen aucune action deffus.
O r en poudre , le dit d’un or mis en diffolution
& réduit en poudre , dont on lé fert pour des dorures
fuperficielles, telles que le dedans des tabatières
d’argent, & tous les deffous des chatons des ouvrages
de joaillerie.
Pour faire cette poudre, on prend un gros d’or en
chaux, que l ’on précipite dans une diffolution com-
pofée de deux onces d’eau forte , un gros de fel ammoniac
, deux gros de falpêtre fin , & un gros de
couperofe : on y joint aufli douze ou quinze grains de
cuivre rofette par gros d’or pour lui donner une couleur
rouge. Cette diflblution fe fait dans un matras
au bain de fable ; quand elle eft faite, on la verfe
goutte à goutte fur de vieux chiffons de linge , que
l’on prend en proportionne la quantité de liqueur ;
quand ces chiffons font bien imbibés & que la diflblution
eft tarie, 011 les laiffe fecher, puis on lespofe
fur un plat de faïance , & on y met le feu avec une
allumette dont on a ôté le foufre, on les laiffe fe con-
fumer petit-à-petit & fe réduire en cendre ; c’eft de
cette cendre dont on fe fert pour la dorure en poudre
, & qu’on nomme or en poudre. Pour l’employer ,
il faut que les pièces foient au degré de poli qu’on
nomme adouci ; alors ou prend un bouchon de liege
bien fain que l’on mouille avec de l’eau très-propre ,
on trempe ce bouchon mouillé dans la boîte à poudre
d'or , & on étend cette poudre fur les pièces en frottant
avec le bouchon ; il ne faut pas employer trop
d’eau parce que la poudre fe met en lavage & fe perd :
on reconnoît à l’infpeftion fi la couche eft affez
épaiffe, alors on ceffe de frotter avec le bouchon &
on brunit. Dans les grands ouvrages on fe fert des
bruniffoirs de fanguine, & dans les petits ouvrages
d’un petit bruniffoir d’acier p o li, & ce bruni fe fait
avec de l’eau de favon.
Qr , purification de ( Monnoyage. ) on trouve
X x x ij