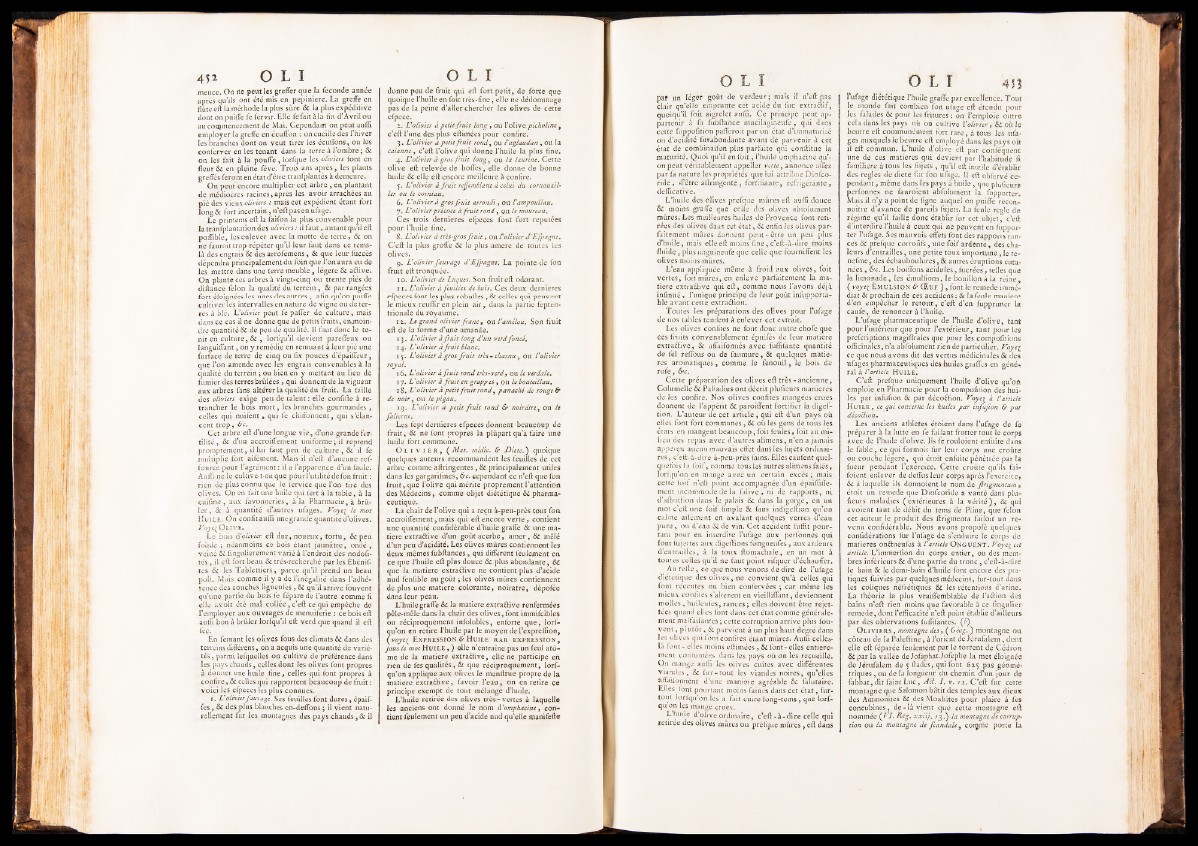
mence. On ne peut les greffer que la fécondé année
après qu’ils ont été mis en pepiniere. La greffe en
flûte eft la méthode la plus sûre 6c la plus expéditive
dont on puiffe fe fervir. Elle fe fait à la fin d’Avril ou
au commencement de Mai. Cependant on peut aufli
employer la greffe en écuffon : on cueille dès l’hiver
les branches dont on veut tirer les écuffons, ou les
conferver en les tenant dans la terre à l’ombre ; &
on les fait à la pouffe, lorfque les o l iv ie r s font en
fleur 6c en pleine fève. Trois ans après, les plants
greffés feront en état d’être tranfplantés à demeure.
On peut- encore multiplier cet arbre , en plantant
de médiocres racines, après les avoir arrachées au
pié des vieux o liv ie r s : mais cet expédient étant fort
long & fort incertain, n’eft pas en ufage.
Le printems efl la faifon la plus convenable pour
la tranfplantation des o l iv ie r s : il faut, autant qu’il eft
poffible, les enlever avec la motte de terre, 6c on
ne fauroit trop répéter qu’il leur faut dans ce tems-
là des engrais 6c des arrofemens, & que leur fuccès
dépendra principalement du foin que l’on aura eu de
les mettre dans une terre meuble, légère 6c aûive.
On plante ces arbres à vingt-cinq ou trente pies de
diftance félon la qualité du terrein, & par rangées
fort éloignées les unes des autres , afin qu’on puiffe
cultiver les intervalles en nature de vigne ou de terres
à blé. L'o l iv i e r peut fe pafler de culture, mais
dans ce cas il ne donne que de petits fruits, ervmoin-
dre quantité 6c de peu de qualité. Il faut donc le tenir
en culture, & , lorfqu’il devient pareffeux ou
languiffant, on y remédie en remuant à leur pié une
furface de terre de cinq ou fix pouces d’épaiffeur,
que l’on amende avec les engrais convenables à la
qualité du terrein ; ou bien en y mettant au lieu de
fumier des terres brûlées , qui donnent de la vigueur
aux arbres fans altérer la qualité du fruit. La taille
des o liv ie r s exige peu de talent : elle confifte à retrancher
le bois mort, les branches gourmandes ,
celles qui nuifent, qui fe chiffonnent, qui s’élancent
trop, &c.
Cet arbre eft d’une longue v ie , d’une grande fertilité
, 6c d’un accroiffement uniforme ; il reprend
promptement, il lui faut peu de culture, 6c il fe
multiplie fort aifément. Mais il n’eft d’aucune ref-
fource pour l’agrément : il a l’apparence d’un faille.
Aufli ne le cultive-t on que pour l’utilité defon fruit :
rien de plus connu que le lervice que l’on tire des
olives. On en fait une huile qui lert à la table, à la
cuifine , aux favonneries, à la Pharmacie, à brûler
, & à quantité d’autres ufages. Voye^ le mot
Hu ile. On confit aufli une grande quantité d’olives.
V o y e {O l iv e.
Le bois à ? o liv ie r eft dur, noueux, tortu, 6 c peu
folide ; néanmoins ce bois étant jaunâtre, ondé ,
veiné 6c fingulierement varié à l’endroit des nodofi-
té s , il eft fort beau 6 c trés-recherché par les Ébénif-
tes 6c les Tablettiers, parce qu’il prend un beau
poli, Mais comme il y a de l’inégalité dans l’adhérence
des couches ligneufes, 6 c qu’il arrive fouvent
qu’une partie du bois fe fépare de l’autre comme fi
elle avoit été mal collée, c’eft ce qui empêche de
l’employer aux ouvrages de menuiferie ; ce bois eft
aufli bon à brûler lorfqu’il eft verd que quand il eft
fec.
En femant les olives fous des climats 6c dans des
- terreins différens, on a. acquis une quantité de variétés
, parmi lefquelles on cultive de préférence dans
les pays chauds, celles.dont le.s olives font propres
à donner, une huile fine , celles qui font propres à
confire, 6c celles qui rapportent beaucoup de fruit :
voici les efpeces les plus connues.
i . U olivierfàuvagc. Ses feuilles font dures, épaif-
fes, & des plus blanches en-deffons ; il vient naturellement
fur les montagnes des pays chauds, & il
donne peu de fruit qui eft fort petit, de forte que
quoique l’huile en foit très-fine, elle ne dédommage
pas de la peine d’aller chercher les olives de cette
efpece.
2. U olivier à petit fruit long, ou l’olive picholine ,
c’eft l’une des plus eftimées pour confire.
3. U olivier à petit frttit rond., ou l ’aglaudan, ou la
caïanne, c’eft l’olive qui donne l’huile la plus fine.
4. U olivier à gros fruit long, ou la laurine. Cette
olive eft relevée de boffes, elle donne de bonne
huile 6c elle eft encore meilleure à confire.
f . L ’olivier à fruit reffemblant à celui du cornouail-
ler ou le corniau,
6. U olivier a gros fruit arrondi , ou Campoullau.
7. V olivier précoce à fruit rond , ou le rnoureau.
Ces trois dernieres efpeces font fort réputées
pour l’huile fine.
8. L’olivier à très-gros fru it, ou V olivier d’Efpagne.
C’eft la plus groffe 6c la plus amere de toutes les
olives.
9. L’olivier fauvage d ’Efpagne. La pointe de fon
fruit eft tronquée.
10. L’olivier de Luques. Son fruit eft odorant.
1 1. L’olivier à feuilles de buis. Ces deux dernieres
efpeces font les plus robuftes, 6c celles qui peuvent
le mieux reuflir en plein a ir , dans la partie fepten-
trionale du royaume.
11. Legrand olivier franc, ou l’amélou. Son fruit
eft de la'forme d’une amande.
13. U olivier à fruit long d’un verd foncé.
14. L ’olivier à fruit blanc.
1 y. L’olivier à gros fruit très - charnu, ou l ’olivier
royal.
16. L ’olivier a fruit rond trïs-verd, ou le verdale. -
17. L ’olivier à fruit en grappes , ou le bouteillau,
18. L ’olivier à petit fruit rond, panaché de rouge &
de noir, ou le pigau.
19. L ’olivier à petit fruit rond & noirâtre, ou le
faller ne. .
Les fept dernieres efpeces donnent beaucoup de
fruit, 6c ne font propres la plûpart qu’à faire une
huile fort commune.
O l i v i e r , ( Mat. médic. & Dicte. ) quoique
quelques auteurs recommandent les feuilles de cet
arbre comme aftringentes, 6c principalement utiles
dans les gargarifmes, &c. cependant ce n’eft que fon
fruit, que l’olive qui mérite proprement l’attention
des Médecins, comme objet diététique 6c pharmaceutique.
La chair de l’olive qui a reçu à-peu-près tout fon
accroiffement, mais qui eft encore v erte, contient
une quantité confidérable d’huile graffe & une matière
extra&ive d’un goût acerbe, amer, 6c mêlé
d’un peu d’acidité. Les olives mûres contiennent les
deux mêmes fubftances, qui different feulement en
ce que l'huile eft plus douce 6c plus abondante, &
que la matière extraâive ne contient plus d’acide
nud fenûble au goût ; les olives mûres contiennent
de plus une matière colorante, noirâtre, dépofée
dans leur peau.
L’huile graffe 6c la matière extraftive renfermées
pêle-mêle dans la chair des olives, font immifcibles
ou réciproquement infolubles, enforte que, lorf-
qu’on en retire l’huile par le moyen de l’expreflion,
( v o y e i Expression & Huile rar expression,
jous le mot Hu ile , ) elle n’entraîne pas un feul atome
de la matière extraâive, elle ne participe en
rien de fesqualités, & que réciproquement, lorf-
qu’on applique aux olives le menttrue propre de la
matière extra&ive, favoir l’eau, on en retire ce
principe exempt de tout mélange d’huile.
L’huile retirée des olives très-vertes à laquelle
les anciens ont donné le nom 6’omphacine, contient
feulement un peu d’acide nud qu’elle manifefte
paf un léger goût de verdeur ; mais il n’eft pas
clair qu’elle emprunte cet acide du fuc extra&if,
quoiqufil foit aigrelet aufîi. Ce principe peut appartenir
à fa fubftance mucilaginèufe, qui dans
cette fnppoïition pafferoit par un état d’immaturité
Ou d’acidité fùràbondante avant de parvenir à cet
état de combinaifon plus parfaite qui conftitue la
maturité. Quoi qu’il en foit, l’huiié omphacine qu’-
on peut véritablement appeller verte, annonce affèz
par fa nature les propriétés que lui attribue Diofcô-
fid é , d’être aftringenté, fortifiante, réfrigérante,
deflicative.
L ’huile des olives prefque mûres eft aufli douce
& moins graffe que celle des olives abfolument
mûres. Les meilleures huiles de Provence font retirées
des olives dans cet état, 6c enfin les olives parfaitement
mûres donnent peut-être un peu plus
d’huile, mais elle eft moins fine, c’eft-à-dire moiqs
fluide, plus unguineufe que celle que fourniffent les
olives moins mûres.
L’eau appliquée même à froid aux olives, foit
vertes, foit mûres, en enleve parfaitement la matière
eitraüive qui eft, comme nous l’avons déjà
infinué, l’unique principe de leur goût infupporta-
ble avant cette extraâion.
Toutes les préparations des olives pour l’ufagie
de nos tables tendent à enlever cet extrait.
Les olives confites ne font donc autre chofe que
ces fruits convenablement épuifés de leur matière
extrattive* & affaifonnés avec fuffifante quantité
de fel reffous ou de faumure, & quelques matières
aromatiques, comme le fenôüil, le bois de
ro fe , &c.
Celte préparation des olives eft très-ancienne,
Columelle 6c Palladius ont décrit plufieurs maniérés
de les confire. Nos olives confites mangées crues
donnent de l’appétit 6c paroiffent fortifier la digef-
tion. L’auteur de cet article, qui eft d’un pays oii
elles font fort communes, 6c oii les gens de tous les
états en mangent beaucoup, foit feules', foit au milieu
des repas avec d’autres alimens, n’en a jamais
apperçu aucun mauvais effet dans les fujets ordinaires,
c’eft-à-dire à-peu-près fains. Elles caufent quelquefois
la foif, comme tous les autres alimens falés,
lorlqu’on en mange avec un certain excès ; mais
cette foif n’eft point accompagnée d’un épaiïïilfe-
ment incommode de la falive , ni de rapports, ni
d’aftriéfion dans le palais 6c dans la gorgé, en un
mot c’eft une foif fimple & fans indigeftion qu’on
calme aifément en avalant quelques verres d’eau
pure, ou d’eau 6c de vin. Cet accident fuffit pourtant
pour en interdire l’ufage aux perfonnes qui
font fujettes aux digeftions fongueufes, aux ardeurs
d’entrailles, à la toux ftomachale, en un mot à
toutes celles qu’il ne faut point rifquer d’échauffer.
Au refte, ce que nous venons de dire de l’ufage
diététique des olives, ne convient qu’à celles qui
font récentes ou bien confervées ; car même les
mieux confites s’alcerent en vieilliffant, deviennent
molles, huileufes, rances ; elles doivent être rejet-
tées quand elles font dans cet état comme généralement
malfaifantes ; cette corruption arrive plus fou-
vent , plu tô t, & parvient à un plus haut degré dans
les olives qui font confites étant mûres. Aufli celles-
là font - elles moins eftimées , 6c font - elles entièrement
confumées dans les pays oii on les recueille.
On mange aufîi les olives cuites avec différentes
viandes, 6c fur-tout les viandes noires, qu’elles
affaifonnent d’une maniéré agréable 6c falutaire.
Elles font pourtant moins faines dans cet é ta t, fur-
tout lorlqu on les a fait cuire long-tems, que lorf-
qu on les ihange crues.
L huile d’olive ordinaire, c’e ft-à -d ire celle qui
retirée des olives mures Ou prèfque mûres, eft dans
1 ufage diététique l’huile graffe par excellence. Tout
le monde fait combien fon ulàge eft étendu pour
les falades 6c pour les fritures : on l’emploie outre
cela dans les pays où on cultive l’olivier, 6c oh le
beurre eft communément fort rare, à tous les ufa-
ges auxquels le beurre eft employé dans les pays où
il eft commun. L’huile d’olive eft par conféquent
une de ces matières qui devient par l’habitude fii
familière à tous les fujets , qu’il eft inutile d’établir
des réglés de diete fur fon ufage. Il eft obfervé cependant
, même dans les pays à huile, que plufieurs
perfonnes ne fauroient abfolument la fupporter»
Mais il n’y a point de ligne auquel on puiffe recon-
noître d’avance de pareils fitjets. La feule réglé de
régime qu’il, faille donc établir fur cet objet, c’eft
d’interdire l’huile à ceux qui ne peuvent en fuppor-
ter l’ufage. Ses mauvais effets font des rapports rances
6c prefque corrofifs, une foif ardente, des chaleurs
d’entrailles, une petite toux importune, le te*
nefme, des échauboulures, & autres éruptions cutanées
, &c. Les boiffons acidulés, fucrées, telles que
la limonade, les émulfions, le bouillon à la reine,
(yoyei Émulsion & (Euf ) , font le remede immédiat
& prochain de ces accidens ; & la feule maniéré
d’en empêcher le retour, c’eft d’en fupprimer la
caufe, de renoncer à l’huile.
L ’ufage pharmaceutique de l’huile d’olive, tant
pour l’intérieur que pour l’extérieur, tant pour les
preferiptions magiftrales que pour les compofitions
officinales, n’a abfolument rien de particulier. Voyez
ce que nous avons dit des vertus médicinales & des
ufages pharmaceutiques dés huiles graffes en général
à Varticle Huile.
C ’eft prefque uniquement l’huile d’olive qu’oft
emploie en Pharmacie pour la compofiiion des huiles
par infufion & par décoftion. Voyeç à L'article
Huile, ce qui concerne les huiles par infujion & par
décoction.
Les anciens athlètes étoient dans l’ufage de fe
préparer à la lutte en fe faifant frotter tout le corps
avec de l’huile d’olive. Ils fe rouloient enfuite dans
le fable, ce qui formoit fur leur corps une croûte
ou couche légère, qui éroit enfuite pénétrée par la
fueur pendant l’exercice. Cette croûte qu’ils fai-
foient enlever de deffus leur corps après l’exercice,
6c a laquelle ils dônnoient le nom de firigmentum ,
étoit un remede que Diofcoride a vanté dans plu-
fieurs maladies ( extérieures à la vériré)* & qui
a voient tant de débit du tems de Pline, que félon
cet auteur le produit des ftrigmenta faifoit un revenu
confidérable. Nous avons propofé quelques
confédérations fur l’ufage de s’enduire le corps de
matières onftueufes à l'article Onguent. Voye^cet
article. L’immerfion du corps entier, ou des membres
inférieurs 6c d’une partie du tronc, c’eft-à-dire
-le bain & le demi-bain d’huile font encore des pratiques
fuivies par quelques médecins, fur-tout clans
les coliques iiéfrétiques & les rétentions d’urine.
La théorie la plus vraiffemblable de l’aélion des
bains n’eft rien moins que favorable à ce fingulier
remede, dont l’efficacité n’eft point établie d’ailleurs
par des obfervations fuffifantes. (b)
Oliviers , montagne des, ( Géog. ) montagne ou
coteau de la Paleftine, à l’orient de Jérufalem, dont
elle eft féparée feulement par le torrent de Cédron
6c par la vallée de JofaphatJofephe la met éloignée
de Jérufaiem de 5 ftades , qui font 615 pas géométriques
, où de îa longueur du chemin d’un jour de
fabbat, dit faint Lu c, Âct. I . v. 12. C ’eft fur cette
montagne que Salomon bâtit des temples aux dieux
des Ammonites & des Moabites pour plaire à fes
concubines r de - là vient que cette montagne eft
nommée Eeg. x x iij. /j .j la montagne de corruption
ou la montagne de fcandale, comme porte la