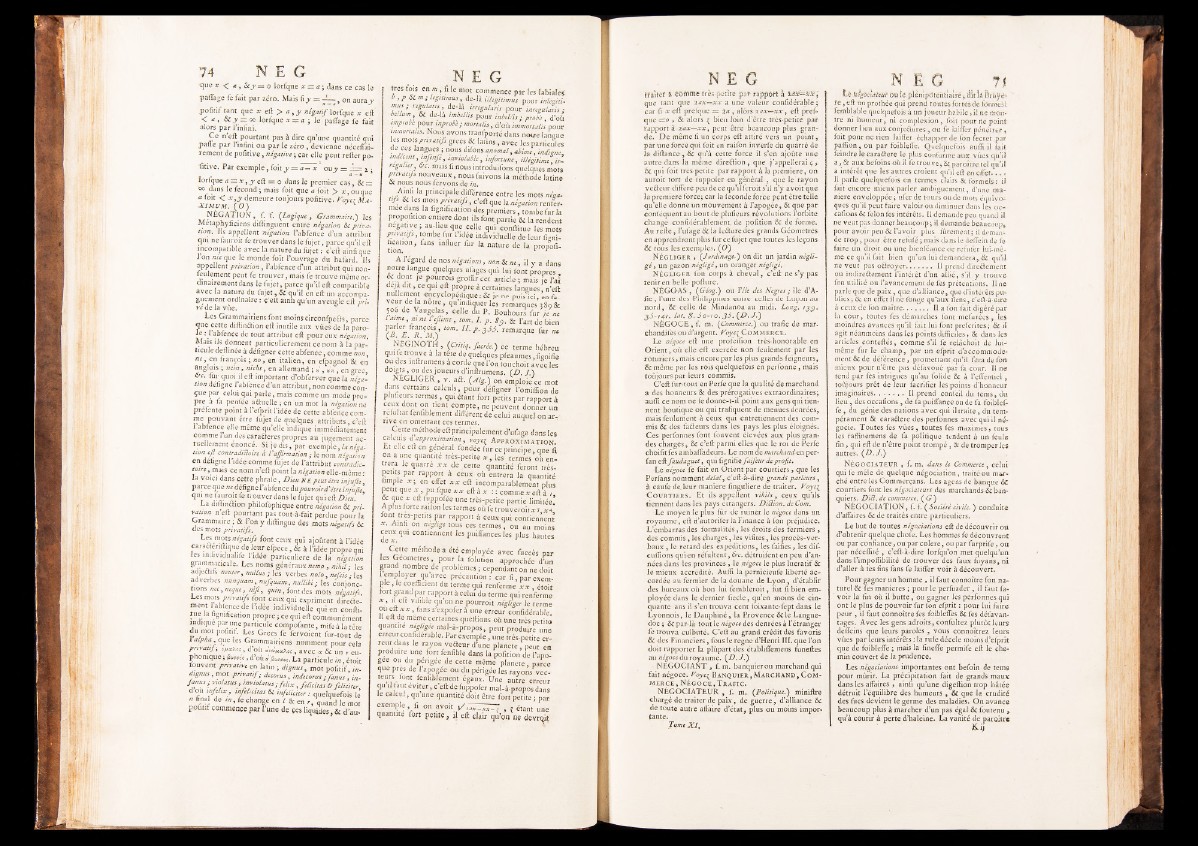
'ique x < g. , S c y — © lorfque x = a ; dans ce cas le
paffage fe fait par zéro. Mais fi y — on aura^y
pofitif tant que a: eft > a , y n é g a t i f lorfque * eft'
< a > & .y = oc lorfque x = a ; le paffage fe fait
alors par l’infini.
Ce n eft pourtant pas à dire qu’une quantité qui
paffe par l’infini ou par le zéro , devienne néceffai-
rement de pofitive, n é g a tiv e j car elle peut refter positive.
Par exemple, foit y = a — x ouy = -— 2 •
Jorfque a = x , y eft = o dans le premier cas, & =
00 dans le fécond ; mais foit que a foit > x , ou que
n foit < x , y demeure toujours pofitive. V o y e ? M a x
i m u m .\ ( O ) x
N ÉGATION, f. f. (L o g iq u è , G r a m m a ir e ,) les
Métaphyficiens diftinguent entre n é g a tio n & p r i v a t
i o n . Ils appellent n é g a tio n l’abfence d’un attribut
qui ne fauroit fe trouver dans le fujet, parce qu’il eft
•incompatible avec la nature du fujet : c’eft ainfi que
l’on n ie que le monde foit l’ouvrage du hafard. Ils
appellent p r i v a t i o n , l’abfence d’un attribut qui non-
feulement peut fe trouver, mais fe trouve même ordinairement
dans le fujet, parce qu’il eft compatible
avec la nature du fujet, & qu’il en eft un accompagnement
ordinaire : c’eft ainfi qu’un aveuele eft p r iv
e de la vue.
Les Grammairiens font moins circonfpedte, parce
que cette diftinûion eft inutile aux vûes de la parole
: l’abfence de tout attribut eft pour eux négation.
Mais ils donnent particulièrement ce nom à la particule
deftinée à défigner cette abfence, comme non,
n c> eQ françôis ; no, en italien, en efpagnol & en
anglois ; nein, nicht, en allemand ; «', §|jI en grec,
fur quoi il eft important d’obferver que la n é g a t
i o n défigne l’abfence d’un attribut, non comme conçue
par celui qui parle, mais comme un mode propre
à fa penfée aéluelle ; en un mot la n é g a tio n ne
préfente point à l’efprit l’idée de cette abfence comme
pouvant être fujet de quelques attributs , c’eft
1 abfence elle-meme qu’elle indique immédiatement
comme l’un des carafteres propres au jugement actuellement
énoncé. Si je dis, par exemple,la n é g a -
tlo r i e ft c o n tra d ic to ir e à l'a ffirm a tio n ; le nom n é g a tio n
en défigne l ’idée comme fujet de l’attribut c o n tra d ic to
ir e , mais ce nom n’eft point la n é g a tio n elle-même •
la voici dans cette phrale, D i e u n e p e u t être in iu fte ’
parce que n e défigne l’abfence du p o u v o ir d 'ê tr e in ju fle
qui ne fauroit fe trouver dans le fujet qui eft D i e u . g
La diftin&ion philofophique entre n é g a tio n & p r i v
a t io n n’eft pourtant pas tout-à-fait perdue pour la
Grammaire ; & l’on y diftingue des mots n é g a tifs &
des mots p r i v a t i f s .
Len .mots négatifs font ceux qui ajoûtent à l’idée
caraaenftique de leur efpece, & à l’idée propre qui
les mdivicmalife 1 idee particulière de la négation
grammaticale. Les noms généraux «me., nihil; les
adjectifs neuler, nullus ; les verbes' nolo, mfeis ■ les
adverbes nunquam, mifiuam, nullibi; les conionc-
tipns n ec .n tp e, nifl, quin, font des mots négatifÆ
Les mots pnvatifs font ceux qui expriment direûe-
ment U H U de l’idée individuelle qui en oonfti-
tue la lignification propre ; ce qui eft communément
indique par une particule compofante, mife à la tête
du mot pofitif. Les Grecs fe fervoient fur-tout de
1 alpha, que les Grammairiens nomment pour cela'
pnvanj-, opaMs, d’oit ivtlfutto, avec,« & un , euphonique^
igùvffoç, d’où apu..0ç. Là particule in étoit
fouvent privât,v. en latin ; dignus, mot pofitif, indignas,
mot privatif; dtcortts, indccorus;fanPs, in-
fanus i violatùs, tnviolatus ; ftlix , fdicitas W W W
dou tnfclix, tnfeUcWas &i infUicitcr ■: quelquefois lé
« final de m, fe change en l & en r , quand le mot
pofitif commence par 1 une de çes liquides, & d’aufres;£
ois en m j fi le mot commence par les' labiales
H B H | liguants, de.-là illégitimité.pétit inUgiit.
mus; régulant/, U f t S H U M M imtgularis ;
■ bcllum, & de-là MbtUts pour inédits; prête , d’où
■ tmprote pour tnprete; mortaiû, d’où immortaüs pour
tnmertalts. Nom ayons tranfpor,té dans notre langue
les moispnvattfi grecs & latins, avec les particules
de ces langues : nous difons anomal, abîme indigna
miUuntyinfenfl, inviolable, infortune, illégitime irrégulier
Æ-r. mais fi nous introduirons quelques mots
privatifs nouveaux, nous fuiyons la méthode latine
& nous nous fervouj de in.
■ r4 in* îla Ptinapaje tlifférence entre les mots nem-
Wk & les mots privatifsI ç’eft que la négation renfér-
mee dans la lignification des premiers, tombe fur la
propofmon entière'dont ils font partie & la rendent
négative ; au-J,eu que celle qui conftime les mots
privatifs, tombe fur l’idée individuelle de leur figni-
fication, fans influer fur la nature de la propofi-
tion. r r r
A l’égard de nos négations, non & ne, il y a dans
notre langue quelques ufages qui lui font propres
& dont je pourrais groffir cet article ; mais je l’aî
déjà dit, ce qui eft propre à certaines langues, n’eft
nullement encyclopédique: & .je ne puis ic i, en fa-
yeur de là notre, qu’indiquer les remarques a8g&
506 de Vaugelas, celle du P. Bouhours fur je ne
é aime, ni ne lefitme, tom. I. p . .g j^ c l’art de bien
parler ftançois , Mit,. B W — W fur ne-
E . R. M.) n
NÉGINOTH, OCritiféJatiéeff ce terme hébreu
qui Je trouve à la tete dequelques pféaumes-figqifie
ou des inftrumens à corde que l’on touchoit a v id e s
doigts , ou des joueurs d’inftrumens.
NEGLIGER, v . a ci. (/llg.) on emploie ce mot
dans certains calculs, pour défigner l'odiiffion de
plufieurs termes , qui étant fort petits par rapport à
ceux dont on tient compte, ne peuvent donner un
relultat fenfiblement différent de celui auquel on arrive
en omettant ces termes. ' '
Cette méthode eft principalement d’ufage dans les
calculs à approximation, Voyc[ Approximation.
fit elle eft en général fondée liir ce principe que fi
on a une quantité très-petite * , les termes où entrera
le quarre x x de cette quantité feront très-
petits par rapport à ceux où entrera la> quantité
fample x ; en effet x x eft incomparablement plus
petit que.ac, puffque x.v eft à ■* : : comme x eft à /,
« que_x eft fuppofée une très-petite partie limitée
Aplus forteraifon les termes oùfetrouveroitxs *4
•font tres-peuts par rapport à ceux qui comiennènt
x. Ainfi ,0rttjitglige tous ces terijtés , ou au moins
ceux.qui contiennent les puiffances les plus hautes
de x. c
■ Cette méthode a été employée avec fûccès par
les Géomètres , pour la. folution approchée d’ùn
grand nombre de problèmes; cependantomnedOit
I employer qu avec précaution : car f i , par exemple
, le coefficient du terme qui renferme x x , était
rort grand par rapport à celui du terme qui renferme
x , il eft viftble qu’on ne pourrait négliger ie ferme
ou elt x x fans s’expoferà une erreur confidérable.
II eit de même certaines quéttions où fine très petit®
quantité ««gAg« mal-à-propos, peut produire une
erreurconfiderable. Par exemple, une très-petite erreur
dans le rayon veâeur d’une planète peut en
produire une fort fenfible dans la pofition de l’apo-
gee ou du périgée de cette même planete, parce
que près de 1 apogée ou du périgée les rayons vec-
teurs font fenfiblement égaux. U n e. autre erreur
qu fi faut éviter, c’eft de.fuppbfer mal-à-propos dans
le calcul, qu Une quantité doit être fort petite ; par
exemple , fi on avoir , pétant une
quantité fort petite, il eft clair qu’on ne (levrqit;
traiter \ CôifllWè très-petite pàt ràppôrt à \Aiê^)cX]
que tant qite aax—xx a une valeur confidérable ;
car fi x eft prefque = 2a , alors 2a x~ x x , eft presque
i=f> ? & alors £ bien loin d’être très-petite par
rapport à xax—x x , peut être beaucoup plus grande.
De même fi un corps eft attiré vers un point,
par une force qui foit en raifon inverfe du quarré de
la diftance , & qu’à cette force il s’en ajoute une
autre dans la même direction, que j ’appellerai ç i
qui foit très-petite par rapport à la première, on
auroit tort de fuppoler en général , que le rayon
veêteur différé peu de ce qu’il feroit s’il n’y avoit que
la première force; car la lèconde.force peut être telle
qu’elle donne un mouvement à l’apogée, & que par
conléquent au bout de plufieurs révolutions l’orbite
change confidérablement de pofition & de forme*
Au refte, l’ufage & la lefture des grands Géomètres
en apprendront plus fur ce fiijet que toutes les leçons -
& tous les exemples* (O)
Négliger , ( Jardinage.) on dit un jardin négligé,
un gazon négligé, un oranger négligé.
Négliger fon corps à cheval, c’ell ne s’y pas
tenir en belle pofture.
NÉGOAS , ( Géog.) ou Vile des Negres ; île d’A-
l ie , l’une des Philippines entre celles de Luçon au
nord, & celle de Mindanoa au midi. Long. 13g.
36-141. lat. S. 60-10L36• (D . Z.)
N ÉG O C E , f. m. {Commerce.') ou trafic de mar-
chandifes ou d’argent* Voye1 C ommerce.
Le négoce eft une profeffion très-honorable en
Orient, où elle eft exercée non feulement par les
roturiers, mais encore parles plus grands feigneurs,
& même par les rois quelquefois en perfonne , mais
toujours par leurs commis*
C ’eft fur-tout en Perfe que la qualité de marchand
a des honneurs & des prérogatives extraordinaires;
auffi ce nom ne fe donne-t-il point aux gens qui tiennent
boutique ou qui trafiquent de menues denrées,
mais feulement à ceux qui entretiennent des commis
& des faâeurs dans les pays les plus éloignés.
Ces perfonnes font fouvent élevées aux plus gram
des charges, & c’eft. parmi elles que le roi de Perfe
choifit fes ambaffadeurs. Le nom de marchand en per-
fan eft faudaguet, qui fignifie faifeur de profit.
Le négoce fe fait en Orient par courtiers, que les
Perfans nomment delai, c’eft-à-dire grands parleurs,
à eaufe de. leur maniéré finguliere de traiter. Poye^
C ourtiers. Et ils appellent vïkils, ceux qu’ils
tiennent dans les pays étrangers. Diçlion. de Com,
Le moyen le plus fur de ruiner le négoce dans un
royaume, eft d’autorifer la Finance à fon préjudice.
L ’embarras des formalités, les droits des fermiers ,
des commis, les charges, les vifites, les procès-verbaux
, le retard des expéditions, les faifies, les dif-
cufîions qui en réfultent, &c. détruifent en peu d’années
dans les provinces, le négoce le plus lucratif &
le mieux accrédité. Auffi la pernicieufe liberté accordée
au fermier de la douane de Ly on , d’établir
des bureaux où bon lui fembleroit, fut fi bien employée
dans le dernier fiecle, qu’en moins de cinquante
ans il s’en trouva cent foixante-fept dans le
Lyonnois, le Dauphiné, la Provence & le Languedoc
; & par-là tout le négoce des denrées à l’étranger
fe trouva culbuté. C ’eft au grand crédit des favoris
& des Financiers, fous le régné d’Henri III, que l’on
doit rapporter la plupart des établiffemens funeftes
au négoce du royaume. (D . J.)
NEGOCIANT , f. m. banquier ou marchand qui
fait négoce. Poye^ Banquier,Marchand, C ommerce,
Négo ce,T rafic.
NÉGOCIATEUR , f. m. ( Politique.) miniftre
chargé de traiter de paix, de guerre, d’alliance 6c
de toute autre affaire d’état, plus ou moins importante.
Terne X I .
Lè ïïegôbiàieur ôu îë {jienip&tehtiairè ; dît ià.Brüÿé1
t è , eft un prothée qui prend toutes fortes de formel
fcmblable Quelquefois à un joueur habile > il ne mon*
tre ni humeur, ni complexion , foit pour né point
donner lieu aux eonje&ures, ou fe lâiffer pénétrer 4
foit pour ne rien laiffer échapper de fôn fecret par
paffion j où par foibleffe. Quelquefois auffi il fait
feindre le caraflere lç plus conforme aux vûes qu’il
a , & aux befoins Où il fe trouve, & paroître tel qu’il
a intérêt que les autres croient qu’il eft en e ffet.. . .
Il parle quelquefois en termes clairs & formels : il
fait encore mieux parler ambiguement, d’une maniéré
enveloppée; ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir ou diminuer dans les oc-*
cafions & félon fes intérêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup*
pour avoir peu & l’avoir plus fûrement ; il deman^
de trop, pour être refufé ; mais dans le deffein de fe
faire ün droit ou une bienféance de refufer lui-même
ce qu’il fait bien qu’on lui demandera,.& qu’il
ne veut pas ottroÿer*............Il prend direâtement
ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve
fon utilité ou l’avancement de fes prétentions. Il ne
parle que de p a ix, que d’alliance, que d’intérêts pu--
blics ; & en effet il ne fonge qu’aux liens, c ’eft-à-dire
à ceux de fon maître............. Il a fon fait digéré par
la cour, toutes fes démarches font mefurées , les
moindres avances qu’il fait lui font preferites; & il
agit néanmoins dans les points difficiles, & dans les
articles conteftés, comme s’il fe reiâchoit de lui-
même fur le champ, par un efprit d’accommodement
& de déférence, promettant qu’il fera de fon
mieux pour n’être pas défavoué par fa cour. Il ne
tend par fes intrigues qu’au folide & à l’effentiel,
toûjours prêt de leur facrifîer les points d’honneur
imaginaires................Il prend conleil du tems, du
lieu , des occafions, de fa puiffance ou de fa foibleffe
, du génie des nations avec qui il traite, du tempérament
& caraâere des perfonnes avec qui il négocie.
Toutes fes vûes, toutes fes maximes, tous
les raffinemens de fa politique tendent à un feule
fin, qui eft de n’être point trompé, & de tromper les
autres. ( D .J .)
Négociateur , f. m. dans le Commerce, celui
qui fe mêle de quelque négociation, traité ou marché
entre les Gommerçans. Les agens de banque &
courtiers font les négociateurs des marchands & banquiers.
D ici. de commerce. (G )
NÉGOCIATION, f. f. ( Société civile. ) conduite
d’affaires & de traités entre particuliers.
Le but de toutes négociations eft de découvrir ou
d’obtenir quelque chofe. Les hommes fe découvrent
ou par confiance, ou par colere, ou par furprife, où
par néceffité , c’eft-à-dire lorfqti’on met quelqu’un
dans l’impoffibilité de trouver des faux fuyans, ni
d’aller à lès fins fans fe laiffer voir à découvert.
Pour gagner un homme , il faut connoître fon naturel
& Tes maniérés ; pour le perfuader , il faut fa-
voir la fin où il butte, ou gagner les perfonnes qui
ont le plus de pouvoir fur Ion efprit : pour lui faire
peur , il faut connoître fes foibleffes & fes défavan-
tages. Avec les gens adroits, confultez plutôt leurs
deffeins que leurs paroles , vous connoîtrez leurs
vûes par leurs intérêts : la rufe décele moins d’efprit
que de foibleffe ; mais la fineffe permife eft le chemin
couvert de la prudence.
Les négociations importantes ont befoin de tems
pour mûrir. La précipitation fait de grands maux
dans les affaires , ainfi qu’une digeftion trop bâtée
détruit l’équilibre des humeurs , & que la crudité
des fucs devient le germe des maladies. On avance
beaucoup plus à marcher d’un pas égal & foutenu ,
qu’à courir à perte d’haleine. La vanité de paroître