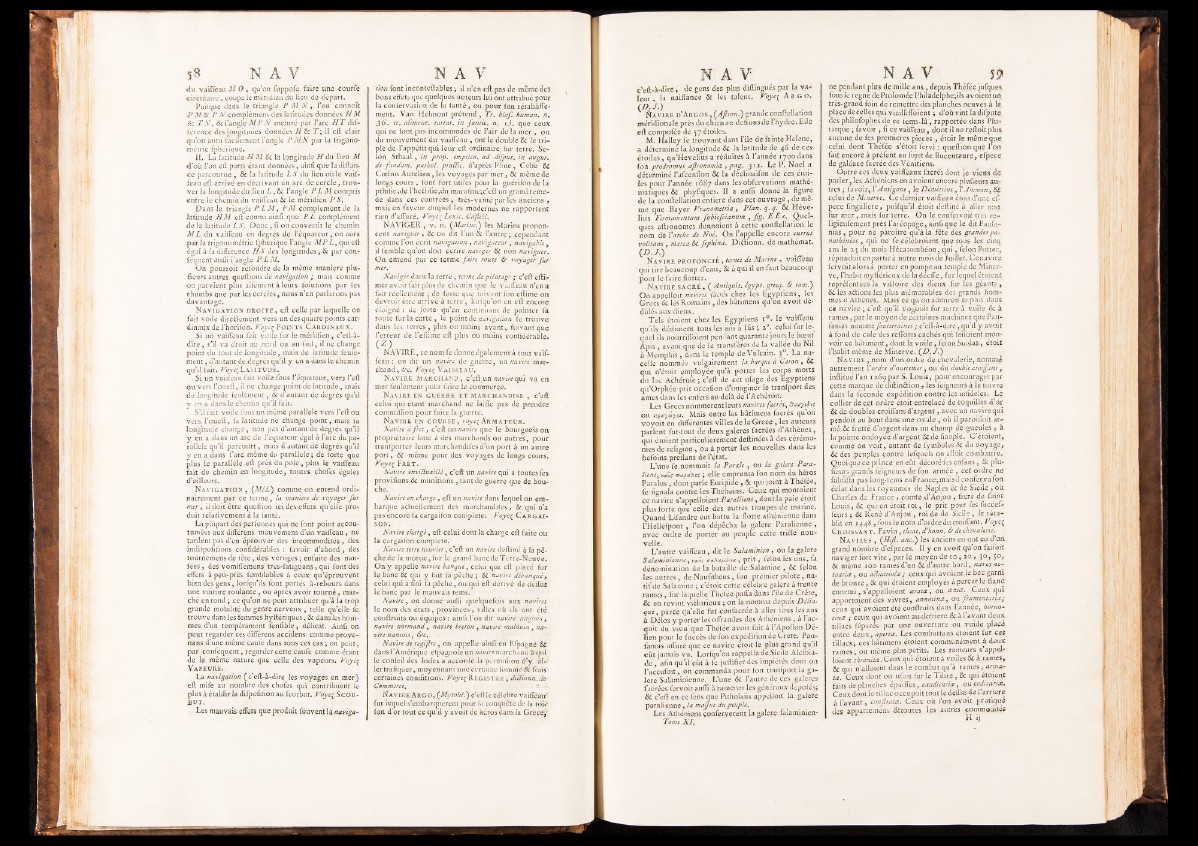
5 « N A V
<3u vaifieau iS£ 0 , qu’on fuppofe faire une courfe
circulaire , coupe ie méridien du lieu de départ.
Puifque dans le triangle P M N , l’on connoît
F M & P N complémens des latitudes données H M
& T N y & l’angle M P N meluré par l’arc H T différence
des longitudes données H & T ; il eft clair
qu’on aura facilement l’angle P M N par la trigonométrie
fphérique.
II. La latitude H M 6c la longitude H à u lieu M
d ’où l’on eft parti étant données, ainlique ladiftan-
c e parcourue, & la latitude L S du lieu où le vaiffeau
eft arrivé en décrivant un arc de cercle, trouver
la longitude du lieu L , &: l’angle P LM compris
entre le chemin du vailTeau & le méridien P S.
Dans le triangle P L M , PM complément de la
latitude HM eft connu ainfi que P L complément
de la latitude L S . D on c ,fi on convertit le chemin
M L du vaifieau en degrés de l’équateur, on aura
par la trigonométrie fphérique l’angle MP L , qui eft
égal à la différence H S des longitudes, & par conséquent
aufîi i ’angle P L M.
On pourroit réfoudre de la même maniéré plusieurs
autres queftions de navigation ; mais comme
on parvient plus aifément à leurs Solutions par les
rhumbs que par les cercles, nous n’en parlerons pas
davantage.
Navigation droite, eft celle par laquelle on
fait voile directement vers un des quatre points cardinaux
de l’horifon. Foyez Points Cardinaux.
Si un vaiffeau fait voile fur le méridien, c’eft-à-
dire, s’il va droit au nord ou au lud, il ne change
point du tout de longitude, mais de latitude feulement
, d’autant de degrés qu’il y en a dans le chemin
qu’il fait. FoyeiLATITUDE.
Si un vaifieau fait voile fous l’équateur, vers l’eft
ou vers l’oueft, il ne change point de latitude, mais
de longitude feulement, & d’autant de degrés qu’il
y en a dans le chemin qu’il fait.
S’il fait voile fous un même parallèle vers l’eft ou
vers l’oueft, fa latitude ne change point, mais fa
longitude change, non pas d’autant.de degrés qu’il
y en a dans un arc de l’équateur égal à l’arc du par
rallele qu’il parcourt, mais d’autant de degrés qu’il
y en a dans l’arc même du parallèle ; de lorte que
plus le parallèle eft près du pôle , plus le vaiffeau
fait de chemin en longitude, toutes chofes égales
d’ailleurs.
Navigation , {Mèdé) comme on entend ordinairement
par ce terme , la maniéré de voyager fur
mer, il doit être queftion ici des effets qu’elle produit
relativement à la fanté.
La plupart des perfonnes qui ne font point accoutumées
aux différens mouvemens d’un vaiffeau, ne
tardent pas d’en éprouver des incommodités , des
indilpofitions confidéràbles : favoir d’abord, des
tournemens de tête, des vertiges ; enfuite des nau-
fées, des vomiffemens très-fatiguans, qui font des
effets à-peu-près femblables à ceux qu’éprouvent
bien des gens, lorfqu’ils. font portés à-rebours dans
une voiture roulante, ou après avoir tourné, marché
en rond ; ce qu’on ne peut attribuer qu’à la trop
grande mobilité du genre nerveux , telle qu’elle fe<
trouve dans les femmes hyftériques, & dans les hommes
d’un tempérament fenfible, délicat. Ainfi on
peut regarder ces différens accidens comme prove-
nans d’une même caufe dans tous ces cas ; on peut,
par conséquent, regarder cette caufe comme étant
de la même nature que celle des vapeurs. Foye[
Vapeurs.
La navigation ( c ’eft-à-dire les voyages en mer)
eft mife au nombre des chofes qui contribuent le
plus à établir la difpofition au feorbut. Foye^ Scorb
u t .
Les mauvais effets que produit fouvent la naviga-
N A V
iion font inconteftables ; il n’en eft pas de même des
bons effets que quelques auteurs lui ont attribué pour
la confervation de la fanté , ou pour fon rétabliffe-
ment. Van Helmont prétend, Tr. blaf. human. n,
J?6\ tr. aliment, tartar. in fan tic. n. iS. que ceux
qui ne font pas incommodés de l’air de la mer , ou
du mouvement du vaiffeau , ont le double 6c le triple
de l’appétit qui leur eft ordinaire fur terre. Selon
Sthaal, in prop. emptico. ad difput. in augur.
de ftindam. pathol. praclic. d’après Pline, Celfe 6c
Coelius Aurelian, les voyages par mer, & même de
longs cours , font fort utiles pour la guérifon de la
pthifie,de l’he&ifie,du marafmejc’eft un grand reme-
de dans ces contrées, très-vantéparles anciens,
mais en faveur duquel les modernes ne rapportent
rien d’affuré. Foye{ Lexic. Caftell.
NAVIGER , v . n. (Marine.) les Marins prononcent
naviguer , & on dit l’un 6c l’autre ; cependant
comme l’on écrit navigation , navigateur, navigable ,
il femble qu’on doit écrire naviger 6c non naviguer.
On entend par ce terme faire route & voyager fur
mtr.
Naviger dans la terre , terme de pilotage ; c’eft efti-
mer avoir fait plus de chemin que le vaiffeau n’en a
fait réellement ; de forte que iuivant fon eftime on
devroir être arrivé à terre, lorfqu’on en eft encore
éloigné : de forte qu’en continuant de pointer fa
route fur la carte , le point de navigation fe trouve
dans les terres , plus ou moins avant, fùivant que
l’erreur de l’eftime eft plus ou moins confidérable.
< * ) „ v B M I
NAVIRE, ce nom fe donne egalement à tout vaiffeau
on dit un navire de guerre, un navire marchand
, &c. Foye^ Vaisseau.
Navire marchand, c ’eft un navire qui va en
mer feulement pour faire le cbmmerce.
Navire en guerre et marchandise , c’eft
celui qui étant marchand ne lai fie pas de prendre
commiffion pour faire la guerre.
Navire en course, voye^Armateur.
• Navire à fret, c’eft un navire que le bourgeois ou
propriétaire loue à des marchands ou autres, pour
tranfporter leurs marchandifes d’un port à un autre
port, 6c même pour des voyages de longs cours.
Foyei Fret.
Navire envicluaillê, c’eft un navire qui a toutes fes
providions & munitions , tant de guerre que de bouche.
Navire en charge, eft un navire dans lequel on embarque
actuellement des marchandifes, & qui n’a
pas encore fa cargaifon complété. Foye{ Cargaison.
Navire chargé, eft celui dont la charge eft faite ou
la cargaifon complété.
Navire terre muvier, c’eft un navire deftiné à la pêche
de la morue, fur le grand banc de Terre-Neuve.
On y appelle navire banque, celui qui eft placé fur
le banc 6c qui y fait fa pêche ; 6c navire débanquè,
celui qui a fini fa pêche, ou qui eft dérivé de deffus
le banc par le mauvais tems.
Navire, on donne aufli quelquefois aux navires
le nom des états, provinces, villes où ils''Ont été
conftruits ou équipés : ainfi l'on dit navire■ anglois,
navire normand 9 navire breton , navire malouin . navire
nanto 'iSy &c.
Navire de regijlre, on appelle ainfi en Efpagnè 6c
dans l’Amérique efpagnole un navire marchand à'c/ui
le confeil des Indes a accordé la permiiïion d’y ‘âl--
lertrafiquer, moyennant unecertaine fomnié St fous
certaines conditions. Foye^ Registre, dicliohrt.de
Commerce.
Navire k'R.GOi {Mytohl.) c’eft le célébré vaiffé*aur
fur lequel s’embarquèrent pour la conquête de la tpii*
fon d’or tout ce qu’il y avoit de héros dans la Grèce,’
N A V i
c’eft-à-dire, de gens des plus diftingués par la valeur
, la naiffance & les talens. F o y e i A R g 6.
(.D .j.y
Navire d’Argos , (.AJlron.) grande conftellation
méridionale près du chien au-deifous de l’hydre. Elle
eft compofée de 57 étoiles. ^
M. Halley fe trouvant dans l’île de fainte Helene,
a déterminé la longitude 6c la latitude de 46 de ces.
étoiles, qu’Hevelius a réduites à l’année 1700 dans
fon prodromus aflronomice , pag. 31Z. Le P. Noël a
déterminé l’afeenfibn 6ç la déçlinaifon de ces étoilés
pour l’année 1687 dans les obfer varions mathématiques
6c phyfiques. Il a aufii donne la figure
de la conftellation entière dans cet ouvrage, de mê- .
me que Bayer Franometria , Plan. q. q. 6c Héve-
lius Firmamentum fobiefeianum , fig. F F e. Quelques
aftronomes donnoient à cette conftellation le
nom de V arche de Noé, On l’appelle encore currus
volitans, marc a 6c fephina. Di&ionn. de mathemat.
m>.j .)
Navire PROFONÇIÉ , terme de Marine , vaiffeau
qui tire beaucoup d’eau, & à qui il en faut beauepup
pour le faire flotter.
Navire sacré, {Antiquité égypt. grecq. & rom.')
On appelloit navires facrés chez les Egyptiens , les
Grecs 6c les Romains., des bâtimens qu’on avoit dé*
didés aux dieux. ,
Tels étoient chez les Egyptiens i ° . le vaiffeau
qu’ils dédioieDt tous les ans à Ifis ; 20. celui fur lequel
ils nourriffoient pendant quarante jours le boeuf
Apis , avant que de le transférer de la vallée du Nil
à Memphis , dans le temple de Vulcain. 30.' La nacelle
nommée vulgairement la barque à Caron, 6c
qui n’étoit employée qu’à porter les corps morts
du lac Achérule ; .c’eft de cet ufage des Egyptiens
qu’Orphée prit occafion d’imaginer le tranfport des
âmes dans les enfers au-delà de l’Achéron.
Les Grecs nommèrent leurs navires facrés, Stayifoi
©u npcLjùyot. Mais entre les bâtimens facrés qu’on
yoyoit en différentes villes de la G re ce , les auteurs
parlent fur-tout de deux galeres facrees d’Athènes,
qui étoient particulièrement deftinées à des cérémonies
de religion, ou A porter les nouvelles dans les
befoins preffans de l’état.
L’une fe nommoit la Parait , ou la galere Para-?
liene, vaZç ^apelxoç elle emprunta fon nom du héros
Paralus, dont parle Euripide , & qui joint àThefee,
fe fignala contre les Thébains. Ceux qui montoient
ce navire s ’appelloient Parallitns,,dont la paie etoit
plus forte que celle des autres troupes de marine.
Quand Lifandre eut battu la flotte athénienne dans
l ’Hellefpont, l’on dépêcha la galere Paralienne ,
avec ordre de porter au peuple cette trifte nouvelle.
L’autre vaiffeau, dit le Salaminien, ou la galere
Salaminitnne, moç traXct/xlvia, p r it , .félon les uns, fa
dénomination de la bataille de Salamine , & félon
les autres , de Naufitheus, fon premier pilote , natif
de Salamine ; e’étoit cette célébré galere à trente
rames, fur laquelle Thélée paffa dans l’île de Crete,
& en revint viftorieux ; on la nomma depuis Délia-
que y parce qu’elle fut confacrée à aller tous les ans
à Délos y porter les offrandes des Athéniens , à l’acquit
du voeu que Théfée avoit fait à l’Apollon De-
lien pour le fuccès de fon expédition de Crete. Pau-
fanias affure que ce navire étoit le plus grand qu’il
eût jamais vu. Lorfqu’on rappella de Sicile Alcibiade
, afin qu’il eût à fe juftifier des impiétés dont on
l’accufoit, on commanda pour Ion tranfport la galere
Salaminienne. L’une & l’autre de ces galeres
facrées fervoit aufli à ramener les généraux dépofes;
& c’eft en ce fens que Pitholaiis appelloit la galere
paralienne, la rnqfjue du peuple.
Les Athépiens çonferverent la galere falaminien-
Tome X I ,
N A V ^
ne pendant plus de mille an s, depuis Théfée jufqueü
fous le regne dePtolomée Philadelphe;ils avoientuft
très-grand foin de remettre des planches neuves à lâ
place de celles qui vieilliffoient ; d’où vint la difpute
des philofophes de ce tems-là, rapportée dans Plu*
tarque ; (avoir , fi ce vaiffeau, dont il ne reftoit plus
aucune de fes premières pièces , étoit le même que
celui dont Théfée s’étoit fervi : queftion que l’on
fait encore à préfetit au fujet de Bucentaure, efpece
de galéacç facrée des Vénitiens.
Outre ces deux vaiffeaux facrés dont je viens de
parler, les Athéniens en a voient encore plufieurs autres
; favoir,\Antigone, le Déniétrius, 1’Ammon, ÔC
celui de Minerve. Ce dernier vaiffeau étoit d’une efc
pece finguliere, puifqu’il étoit deftiné à aller nört
fur mer, mais fur terre. On le confer.vojt très re-
ligieufement près l’aréopage, ainfi que le dit Paufa-*
nias , pour ne paroître qu’à la fête des grandes pa-
nathénées , qpi ne fe célébroient que tous les cinq
ans le 13 du mois Hccatombéon, q u i, félon Pottef,
répondoitenpartieà notre mois de Juillet. Ce navire
fervoit alors à porter en pompe au temple de Minerve,
l’habit myûérieux de la déeffe, fur lequel étoient
repréfentées la viéloire des dieux fur les géants,
& les aftions les plus mémorables des grands honi'»
mes d’Athènes. Mai? ce qu’op admiroit le plus d^ns
ce navire ; c’pft qu’il voguoit fur terre à voile & à
rames, par le moyen de certaines machines que PaU-
fanias hotnmtfouterraines ; c’eft-à-dire , qu’il y avoit
à fond dé cale'des rfcfforts cachés qui faifoient mou*
voir ce bâtiment, dont la v o ile , félon Suidas, étoit
l’habit même de Minerve. {D . J.)
Na v ire , nom d’un ordre de chevalerie, nommé
autrement Vordre d'outremer y ou du double croijfarit,
inftitue l’an 1269 par S. Louis, pour encourager paf
cette marque de diftinâion, les feigneurs à le luivro
dans'la fécondé expédition contre les infidèles. Le
collier de cet'ordre étoit entrelacé de coquilles d’or
& de doubles croiffans d’argent, avec un navire qui
pendoit au bout dans une ovale , où il paroiffoit ar*
m,é & fretté d’argent dans un champ- de gueules > à
la pointe ondoyée d’argent & d e finople. C ’étoient,
comme on v o it , autant de fymboles & du yoyage,
6c des .peuples contre lefquels on aIloit combattre.
Quoique ce prince en eût décoré fes enfans, & plu*
fieurs grands feigneurs de fon armée , cet ordre ne
fubfifta pas long-tems enFrance;maisilconfervafon
éelat dans lç,s royaumes de Naples 6c de Sicile , où
Charles de Érance , comte d’Anjou , frere de faint
Louis , 6c qui.en étoit ro i, le prit pour fes fuccef*
feurs ; 6c René d’Anjou , roi de de Sicile , le rétablit
en 1448 , fous le nom d’ordre du croiffant. Foye^
Croissant. Favin, theat. d'honn. & de chevalerie.
Navires , {Hiß. anc.)les anciens en ont eu d’un
grand nombre d’efpeces. Il y en avoit qu’on fai foie
naviger fort v ite , par le moyen de 10, 20 > 30, 50,
& même 100 rames d’un & d’autre bord, navesac-
tuaria, ou acluariolce ; ceux qui avoient le bec garni
de bronze, & qui étoient employés à percer le flâne
ennemi, s’appelloient oeratee, ou (stzeæ. Ceux qui
apportoient des vivres, annotinesy ou frumentariæ}
ceux qui avoient été conftruits dans l’année, horno-
tinte ; ceux qui avoient au-derriere & a l’avant deux
tillacs féparés par une ouverture ou vuide placé
entre deux, apertee. Les combattans étoient fur Ces
tillacs; ces bâtimens étoient communément à deux
rames, ou même plus petits. Les rameurs s’appelloient
thranitee. Ceux qui étoient à voiles 6c à rames,
6c qui n’alloient dans le combat qu’à rames , armat
toi. Ceux dont on ufoit fur le Tibre , & qui etoient
faits de planches épaiffes, caudicarice, pu codicaria*
Ceux dont le tillac occupoit tout le deffus de l’arriere
à l’avant, confratoe. Ceux où l’on avoit pratique
des appartemens écoutes les autres commodités