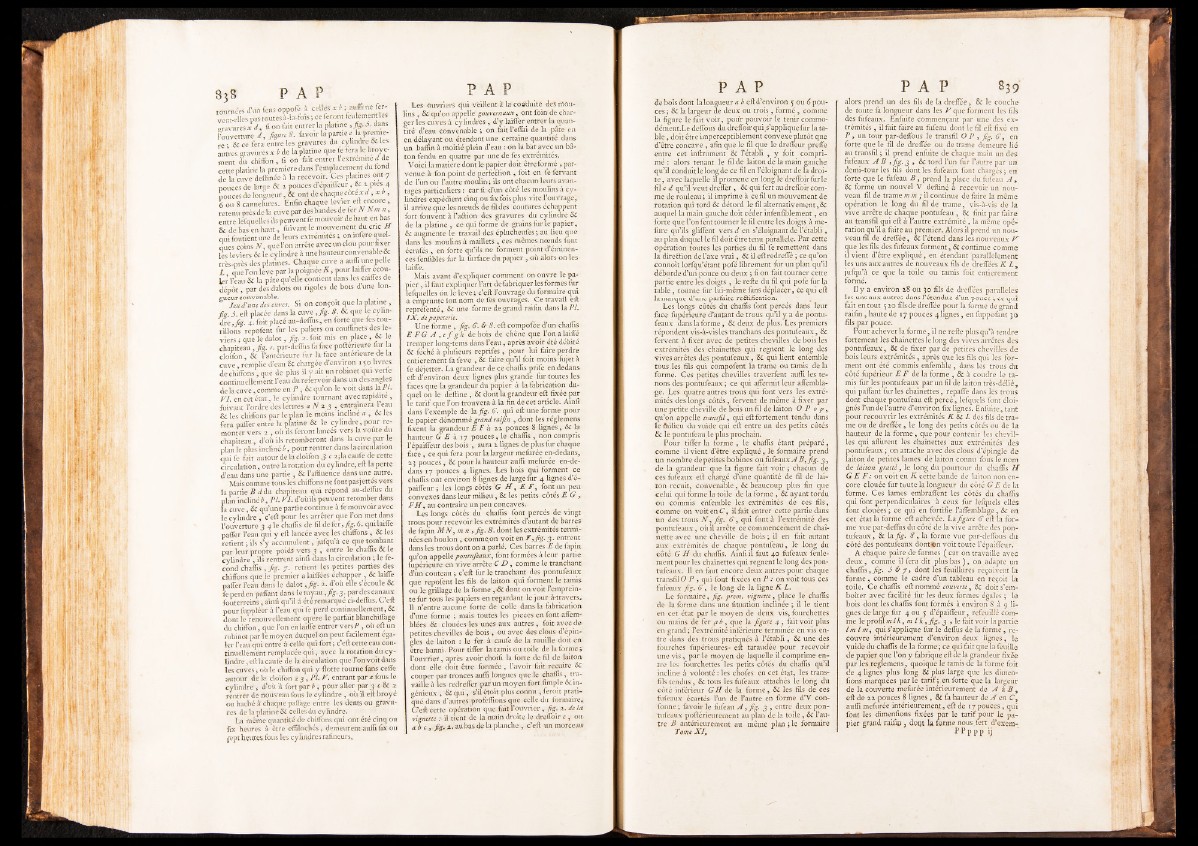
t o u r n é e s d ’u n f e u s o p p o f é - à c e l l e s . - c i ;• a » ® n e f t r -
v e n t - e l l é s iyci s t o u t e s à - b u f o i s ; c e i e t o n t f e u l em e n t le s
« r a v i n e s * ü f i o n f e i t e n t r e r l a p l a t in e ! d a n s
l ’ o u v e r t u r e t , f i e * . » . f a v o i r l a p a r t i e « l a p r e m i è r
e - & ; c e l e v a e n t r e l e s g r a v u r e s d u c y l i n d r e « e u e s
a u t r e s e r a v ù r e s * i d e l a p l a t in e q u e f e f é r a l e t t o i y e - HÉH S a c h i f f o n , f i o n f e i t e n t i e r l e x t r e m i t e d d e
cette platine là première dans remplacement du tond
de la cuve' deftinée à la recevoir. Ces platines ont 7
pouces de large & » pouces d’épaiffeur , & | E | j»
poircesde longueur, & ont de chaque cote , x b ,
6 ou 8 cannelures. Enfin chaque levier eft encore,
retenu près de là cuve par desbandes de fier N « m n H
entre lefquéfiesiispeuventfemdtivoff dehaut en bas
& de Bas en haut, fuivant le mouvement du cric I I
qui fioutiéntune de leurs extrémités ; omnfere quelques
coins N , qpé l’oit arrête avec un clou pour fixer
les leviers & le cylindre à une Hauteur convenable^
très-près des platines. Chaque cuve a auffi unepelle
£ que l’on leye par la poignée K , pour laiffer éeou-
k r l’eau 8£ la pâte qu’elle conüènt dans les caifleafles
dépôt, par desdalots ou rigoles de bois d’une longueur
convenable. I . , ■
J eU d ’u n e d e s c u v e s . Si on conçoit que la platine ,
f i g i eft placée dans la eu>v.e , f i g - 8 . & que le cylindre,
f i g . 4. fait placé au-deffus , en forte que fies tourillons
repofent fur les paliers ou couflinets des leviersÿ
que lé dàtot , f ig . a. foit mis en ^place , & le
chapiteau,/#. 1 par-deffusfafecepofterieure fur.la
cloifon, & l’anterieure fur la face anterietire de la
cuve . remplie «Beau êc chargée d’environ iqS livres
de chiffons , que de plus il y ait un robmet qui verfe
continu ellemènt l’eau du refervoir dans un des angles
de la cuve, comme en P , & qu’on le voit dans la PL.
V I . en cét état, le cylindre tournant avec rapidité ,
fuivant l’ordre des lettres a N z 3 , entraînera l’eau
& les chiffons par le plan le moins incline a , & les
fera paffer entre la platine & le cylindre, pour remonter
vers 2 , oh ils feront lancés vers la voûte du
chapiteau, d’où ils retomberont dans la cuve par le
plan le plus incliné b ,. pour rentrer dans la circulation
qui fe fait autour de la cloifon 3 é ^;la caufe de cette
circulation , outre la rotation du cylindre, eft la perte
d’eau dans une partie , & l’aftluence dans une autre.
Mais comme tous les chiffons ne fontpasjettés vers
la partie B d. du chapiteau qui répond au-deffus du
plan incliné b , PL. V I . d’oùils peuvent retomber dans
la cuve, & qu’une partie continue à fe mouvoir avec
le cylindre , c’eft pour les arrêter que l’on met dans
l’ouverture 3 4 le chaffis de fil de fer, 6. quilaiffe
paffer l’eau qui y eft lancée avec les chiffons , &les
retient ; ils s’y accumulent, jufqu’à ce que tombant
par leur propre poids vers 3 , entre le chaffis &c le
cylindre , ils rentrent ainfi dans la circulation ; le fécond
chaffis , f i g . 7 . ' retient les petites parties des
chiffons que le premier a laiffées échapper , & laiffe
paffer l’eau dans le dalot , f i g . m d’où elle s’écoule &
fe perd en paffant dans le tuyau, fig - 3 • par des canaux
fouterreins ; ainfi qu’il à éteremarqué ci-deffus. C’eft
pour fuppléer à l’eau qui fe perd continuellement, &
dont le renouvellement opéré le parfait blanchiffage
du chiffon, que l’on en laiffe entrer vers P , oîx eft un
robinet par le moyen duquel on peut facilement égaler
l’eau qui entre à celle qui-fort; c’eft cette eau continuellement
remplacée qui, avec la rotation du cylindre
, eft la caufe de la circulation que l’on voit dans
les cuves $ oh le chiffon qui- y flotte tourne fans ceffe
autour de la cloifon ± 3 , P I . V . entrant par affoiis le
cylindre, dfoù il fort par b , pour aller par 3 c & 2
rentrer de fiouveau fous le cylindre , oii il eft broyé
ou haché à chaque paffage entre les dents ou gravu
res de la platine & celles du cylindre.
La même quantité de chiffons qui ont été cinq ou
fix heures à être effilochés, demeurent auffi fix ou1
fept heures: fous les cylindres rafineurs,
Les ouvriers qui vaillent à la conduite des nlôu-
lins , & qu?on appelle g o u v e r n a u x , ont foin de charger
les cuves à cylindres , d?y laiffer entrer la quantité'
d?eau convenable ; on faitl’effai delà pâte en
en délayant ou étendant une certaine quantité dans
un baffin à moitié plein d’eau- : on là bat avec un bâton
fendu en quatre par une de fes extrémités'.
Voici la matière dont le papier doit être formé , parvenue
à' fon point de perfection , foit en fe fervant
de l’un ou l’autre moulin«; ils ont chacun leurs avantagés
particuliers : car fi d’un côté les moulins à cylindres
expédient cinq-ou fix fois plus vite l’ouvrage,
il arrive que les noeuds de fil. des coutures échappent
fort fouvent à l’aCtion des gravures du cylindre &
de la platine , ce qui forme de grains fur le papier,
& augmente le travail des éplucheufés ; au lieu que
dans les moulins à maillets , ces mêmes noeuds font
écrafés , en forte qu’ils ne forment point d’éminences
fenliblés lùr la furface du papier , o ù alors on les
laiffe.
Mais avant d’expliquer comment on ouvre le papier
, il faut expliquer l’art de fabriquer les formes fur
efquelles o n le leve ; c’eft l’ouvrage du formaire qui
a emprunté fon nom de fes ouvrages. Ce travail eft
| reprefenté, & une forme de grand raifin dans la P I .
I X . d e p a p e te r ie .
Une forme , f i g . G . 6* 8 \ eft compofée d’un chaffis
E F G A , e f g h die bois de chêne que l’on a laiffe
! tremper long-tems dans l’eau, après avoir été débité
& féché à plufieurs reprifes , pour lui faire perdre
entièrement fa feve , & faire qu’il foit moins fujet à
fe déjetter. La grandeur de ce chaffis prife en dedans
eft d’environ deux lignes plus grande fur toutes les
1 faces que la grandeur du papier à la fabrication du-
1 quel on le deftine , & dont la grandeur eft fixée par
le tarif que l’on trouvera à la fin de cet article. Ainfi
; dans l’exemple de la f i g . 6 . qui eft une forme pour
i le. papier dénommé g r a n d r a i f in , dont les réglemens
fixent la grandeur E F à 22 pouces 8 lignes, & la
hauteur G E à 17 pouces,- le chaffis , non compris
répaiffelir des bois , aura 2 lignes de plus fur chaque
face , ce qui fera pour la largeur mefurée en-dedans,
23 pouces, & pour la hauteur auffi mefurée en-de-
dans 17 pouces 4 lignes. Les bois qui forment ce
chaffis ont environ 8 lignes de large fur 4 lignes d’épaiffeur
; les longs côtés G H , E F , font un peu
convexes dans leur milieu, & les petits côtés E G ,
F H y au contraire un peu concaves.
Les longs côtés du chaffis font percés de vingt
trous pour recevoir les extrémités d’autartt de barres-
de fapin M N , m n y f i g . 8 . dont les extrémités terminées
en boulon , comme,on voit en F , f i g . 3 . entrent
dans les trous dont on a parlé. Ges barres E de fapin
qu’on appelle p o n tu f e a u x y font formées à leur partie
uipérieure en vive arrête C D , comme le tranchant-
d’un couteau ; c’eft fur le tranchant des pontufeaux
que repofent les fils de laiton qui forment le tamis
ou le grillage de la forme , ■ & dont on voit l’empreinte
fur tous les papiers en regardant le jour à-travers.
Il n’entre aucune forte de colle dans la fabrication,
d’une forme ; mais toutes les pièces en font affem-1
blées & clouées1 les unes aux autres , foit avec de
petites chevilles de bois , ou avec des clous d’épingles
de laiton : le fer à caufe de la rouille doit en
etre banni. Pour tiffer la tamis ou toile de la forme ÿ
l’ouvrier, après avoir choifi la forte de fil de laiton
dont elle doit être formée, l’avoir fait recuire &C
couper par tronces auffi longues que le chaffis, travaille
à les redreffer par un moyen fort fimple & ingénieux
, & qui, s’il étoit plus connu , feroit pratiqué
dans d’autres profeffions que celle du formaire.
G’eftCette opération que-fait l’ouvrier , f i g . 2. d e La
v ig n e t t e : il tient de la main droite le dreffoir c , ou-
a b C } fig. z . aubas de la planche , c’eft un morceau/
d e b o i s d o r t t l a l o n g u e u r a b e f t d ’ e n v i r o n 5 o u 6 p o u c
e s ; & l a l a r g e u r d e d e u x o u t r o i s , f o r m é , c o m m e
l a f i g u r e l e f a i t v o i r , p o u r p o u v o i r l e t e n i r c o m m o -
d é m e n t .L e d e f f o u s d u d r e f f o i r q u i .s ’ a p p l iq u e f u r l a t a b
l e , d o i t ê t r e im p e r c e p t i b l e m e n t c o n v e x e p l u t ô t q u e
d ’ ê t r e c o n c a v e , a f in q u e l e f i l q u e l e d r e f f e u r p r e f f e
e n t r e c e t in f i n im e n t & l’ é t a b l i , y f o i t c o m p r i m
é : a l o r s t e n a n t l e f i l d e l a i t o n d e l a m a in g a u c h e
q u ’ i l c o n d u i t l e l o n g d e c e f i l e n l ’ é l o i g n a n t d e l a d r o i t
e , a v e c l a q u e l l e i l p r o m e n e e n l o n g l e d r e f f o i r f u r le
f i l c d q u ’ i l v e u t d r e f f e r , & q u i f e r t a u d r e f f o i r c o m m
e d e r o u l e a u ; i l im p r im e à c e f i l u n m o u v e m e n t d e
r o t a t i o n q u i t o r d & d é t o r d l e f i l a l t e r n a t i v e m e n t ,&
a u q u e l l a m a in g a u c h e d o i t c é d e r i n f e n f i b l e m e n t , e n
f o r t e q u e l ’ o n f e n t t o u r n e r l e f i l e n t r e l e s d o i g t s à m e -
f u r e q u ’ i l s g l i f f e n t v e r s d 'e n s ’ é l o i g n a n t d e l ’ é t a b l i ,
a u p l a n d u q u e l l e f i l d o i t ê t r e t e n u p a r a l l è l e . P a r c e t t e
o p e r a t i o n t o u t e s l e s p a r t i e s d u f i l f e r e m e t t e n t d a n s
l a d i r e c t i o n d e l ’ a x e v r a i , & i l e f t r e d r e f f é ; c e q u ’o n ,
c o n n o î t l o r f q u ’ é t a n t p o f é l i b r e m e n t f u r u n p l a n q u ’ i l
d é b o r d e d ’u n p o u c e o u d e u x ; f i o n . f a i t t o u r n e r c e t t e
p a r t i e e n t r e l e s d o i g t s , l e r e f t e d u f i l q u i p o f e f u r 1^
t a b l e , t o u r n e f u r l u i -m ê m e fa n s d é p l a c e r , c e q u i e f t
l a m a r q u e d ’ u n e p a r f a i t e r e é d i f ic a t io n .
L e s l o n g s c ô t é s d u c h a f f i s f o n t p e r c é s d a n s l e u r
f a c e f u p é n e u r e d ’ a u t a n t d e t r o u s q u ’ i l y a d e p o n t u f
e a u x d a n s l a f o r m e , & d e u x d e p lu s . L e s p r e m i e r s
r é p o n d e n t v i s - à - v i s l e s t r a n c h a n s d e s p o n t u f e a u x , &
f e r v e n t à f i x e r a v e c d e p e t i t e s c h e v i l l e s d e b o i s l e s
e x t r é m i t é s d e s c h a î n e t t e s q u i r é g n e n t l e l o n g d e s
v i v e s a r r ê t e s d e s p o n t u f e a u x , & q u i l i e n t e n f em b l e
t o u s . l e s f ils q u i c o m p o f e n t l a t r a m e o u t a m i s d e l a
f o rm e . C e s p e t i t e s c h e v i l l e s t r a v e r f e n t a u f f i l e s t e n
o n s d e s p o n t u f e a u x ; c e q u i a f f e rm i t l e u r a f f em b l a -
g e . L e s q u a t r e a u t r e s t r o u s q u i f o n t v e r s l e s e x t r é m
i t é s d e s l o n g s c ô t é s , f e r v e n t d e m ê m e à f i x e r p a r
u n e p e t i t e c h e v i l l e d e b o i s u n f i l d e l a i t o n O P o p ,
q u ’ o n a p p e l l e t r a n s fiL , q u i e f t f o r t e m e n t t e n d u d a n s
l e f h i l i e u d u v u i d e q u i e f t e n t r e u n d e s p e t i t s c ô t é s
& l è p o n t u f e a u l e p l u s p r o c h a in .
P o u r t i f f e r l a f o rm e , l e c h a f f i s é t a n t p r é p a r é ,
c o m m e i l v i e n t d ’ ê t r e e x p l i q u é , l e f o rm a i r e p r e n d
u n n o m b r e d e p e t i t e s b o b i n e s o u f ù f e a u x ^ B , f i g . 3 ,
d e l a g r a n d e u r q u e l a f i g u r e f a i t v o i r ; c h a c u n d e
c e s f u f e a u x e f t e n a r g é d ’ u n e q u a n t i t é d e f i l d e l a i t
o n r e c u i t , c o n v e n a b l e , & b e a u c o u p p lu s f in q u e
c e l u i q u i f o rm e l a t o i l e d e l a f o rm e , & a y a n t t o r d u
o u c o m m i s e n f e m b l e l e s e x t r é m i t é s d e c e s f i l s ,
c o m m e o n v o i t e n G , i i f a i t e n t r e r c e t t e p a r t i e d a n s
u n d e s t r o u s N , f i g . G , q u i f o n t à l ’ e x t r é m i t é d e s
p o n t u f e a u x , o ù i l a r r ê t e c e c o m m e n c e m e n t d e c h a î n
e t t e a v e c u n e c h e v i l l e d e b o i s ; i l e n f a i t a u t a n t
a u x e x t r é m i t é s d e c h a q u e p o n t u f e a u , l e l o n g d u
c ô t é G H d u c h a f f i s . A i n f i i l f a u t 4 0 f u f e a u x f e u l e m
e n t p o u r l e s c h a î n e t t e s q u i r é g n e n t l e l o n g d e s p o n t
u f e a u x . 11 e n f a u t e n c o r e d e u x a u t r e s p o u r c h a q u e
t r a n s f i l O P , q u i f o u t f i x é e s e n P : o n v o i t t o u s c e s
f u f e a u x f i g . G \ l e l o n g d e l a l i g n e K L .
L e f o r m a i r e , f i g . p r e tn . v ig n e t t e , p l a c e l e c h a f f i s
d e l a f o rm e d a n s u n e f i t u a t i o n in c l i n é e ; i l l e t i e n t
e n c e t é t a t p a r l e m o y e n d e d e u x v i s , f o u r c h e t t e s
o u m a in s d e f e r a b , q u e l a f ig u r e 4 , f a i t v o i r p lu s
e n g r a n d ; l ’ e x t r é m i t é i n f é r i e u r e t e rm in é e e n v i s e n t
r e d a n s d e s t r o u s p r a t i q u é s à l ’ é t a b l i , & u n e d e s
f o u r c h e s f u p é r i e u r e s * e f t t a r a u d é e p o u r r e c e v o i r
u n e v i s , p a r l e m o y e n d e l a q u e l l e i l c o m p r im e e n t
r e l e s f o u r c h e t t e s l e s p e t i t s c ô t é s d u c h a f f i s q u ’ i l
i n c l i n e à v o l o n t é : l e s c h o f e s e n c e t é t a t , l e s t r a n s f
i l s t e n d u s , & t o u s l e s f u f e a u x a t t a c h é s l e l o n g d u
c ô t é i n f é r i e u r G H d e l a f o r m e , & l e s f i l s d e c e s
f u f e a u x é c a r t é s l ’u n d e l ’ a u t r e e n f o rm e d ’ V c o n -
f o n n e ; f a v o i r l e f u f e a u A , f i g . 3 , e n t r e d e u x p o n t
u f e a u x p o f t é r i e u r e m e n t a u p l a n d e l a t o i l e , & l ’ a u t
r e B a n t é r i e u r em e n t a u m ê m e p l a n ; l e f o rm a i r e
T om e X I ,
alors prend un des fils de la dreflee, & le couche
de toute fa longueur dans les V que forment les .fils
des fufeaux. Enfuite commençant par une des extrémités
, il fait faire au fufeau dont le fil eft fixé en
P , un toiir par-deffous le transfil O P y f i g . G , en
forte que le fil de dreffée ou de trame demeure lié
au transfil ; il prend enfuite de chaque main un des
fufeaux A B , f ig . 3 , & tord l’un fur l’autre par un
demi-tour les fils dont les fùfeaûx font chargés ; en
forte que le fiifeaù B , prend la place du fufeau A ,
& forme un nouvel V deftiné à recevoir un nouveau
fil de trame m m ; il continue de faire la même
opération le long du fil de trame, vis-à-vis de la
vive arrête de chaque pontufeau, & finit par faire
au transfil qui eft à l’autre extrémité, la meme opération
qu’il a faite au premier. Alors il prend un nouveau
fil de dreffée, & l’étend dans les nouveaux V
que les fils des fufeaux forment, & continue comme
il vient d’être expliqué, en étendant 'parallèlement
les uns aux autres de nouveaux fils de dreffées K L y
jufqu’à ce que la toile ou tamis foit entièrement
formé.
Il y a environ 28 ou 30 fils de dreffées parallèles
les uns aux autres dans l’étendue d’un pouce ; ce qui
fait en tout 520 fils de dreflee pour la forme de grand
raifin, haute de 17 pouces 4 lignes, en fuppôfant 30
fils par pouce.
Pour achever la forme, il ne refte plus qu’à tendre
fortement les chaînettes le long des vives arrêtes des
pontufeaux, & de fixer par de petites chevilles de
bois leurs extrémités, après que les fils qui les forment
ont été commis enfemble, dans les trous du
côté fupérieur E F de la forme , & à coudre le tamis
fur les pontufeaux par un fil de laiton très-délié,
qui paffant fur les chaînettes, repaffe dans lés trous
dont chaque pontufeau eft percé, lefquels font éloignés
l’un de l’autre d’environ fix lignes. Enfuite, tant
pour recouvrir les extrémités A & L des fils de trame
ou de dreffée, le long des petits côtés ou de la
hauteur de la forme, que pour contenir les chevilles
qui aflùrent les chaînettes aux extrémités des
pontufeaux ; on attache avec des clous d’épingle de
laiton de petites lames de laiton connu fous le nom
de l a i to n g r a t t é , le long du pourtour du chaffis H
G E F : on voit en K cette bande de laiton non encore
clouée fur toute la longueur du côté G E de la
forme. Ces lames embraffeiit les côtés du chaffis
qui font perpendiculaires à céux fur lefquels elles
font clouées ; ce qui en fortifie l’affemblage, & en
cet état la forme eft achevée. La fig u r e G eft la forme
vue par-deffiis du côte de la vive arrête des pontufeaux
, & la f i g . 8 , la forme vue par-deffous du
côté des pontufeaux dontfcn voit toute l’épaiffeur.
A chaque paire de formes ( car on travaille avec
deux, comme il fera dit plus bas ) , on .adapte un
chaffis, f i g . S & y t dont les feuillures reçoivent la
forme, comme le cadre d’un tableau en reçoit la
toile. Ce chaffis eft nommé c o u v e r te , & doit s’emboîter
avec facilité fur les deux formes égales ; le
bois dont les chaffis font formés à environ 8 à 9 lignes
de large fur 4 ou 5 d’épaiffeur, refeuillé comme
le profil m l k y m l k , f i g . 3 , le fait voir la partie
L m l m , qui s’applique fur le deffus de la forme, recouvre
intérieurement d’environ deux lignes, le
vuide du chaffis de la forme ; ce qui fait que la feuille
de papier que l’on y fabrique eft ae la grandeur fixée
par les reglemens, quoiquè le tamis de la forme foit
de 4 lignes plus long & plus large que les dimen-
fions marquées parle tarif; en forte que la largeur
de la couverte mefiirée intérieurement de A à B ,
eft de 22 pouces 8 lignes , & fa hauteur de A en C,
auffi mefurée intérieurement, eft de 17 pouces , qui
font les dimenfions fixées par le tarif pour le papier
grand raifto, dont U forme nous.fort d’exem-
p p p p p ij