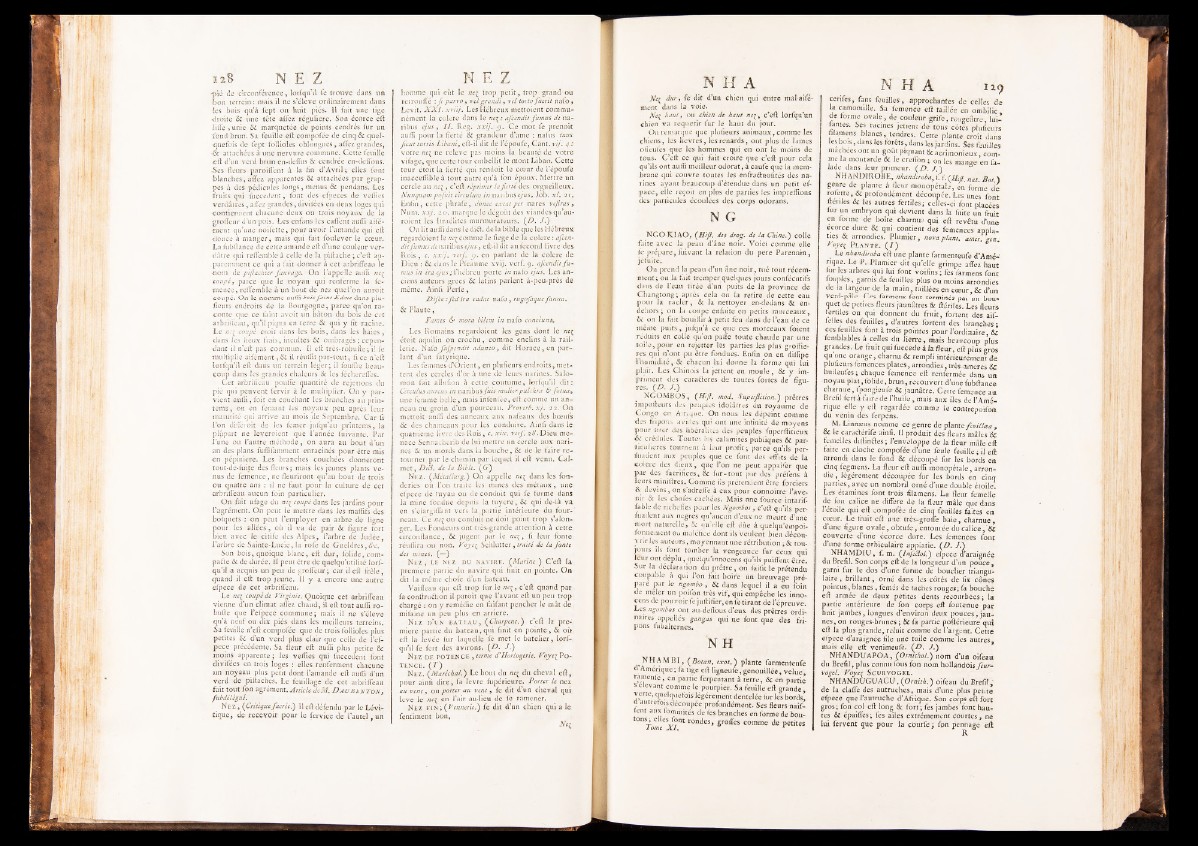
î i 8 N E Z N E Z
-pié de circonférence, lorfqu’ il fe trouve clans un
4jon terrein : mais il ne s’élève ordinairement dans
■ les bois qu’à lept ou huit pies. Il fait une tige
■ droite 6c une tête allez régulière. Son écorce eft
lilTe j unie 6c marquetée de points cendrés fur un
fond brun. Sa feuille eft compofée de cinq & quelquefois
de fept follioles oblongues, aflez grandes,
-& attachées à une nervure commune. Cette feuille
eft d’un vercl brun en-deflus & -cendrée en-deflous.
•Ses fleurs paroiflent à la fin d’Avril ; elles font
blanches, aflez apparentes 6c attachées par grappes
à des pédicules longs, menus 6c pendans. Les
fruits qui fuccedent, font des efpeces de vefiies
verdâtres, allez grandes, divilées en deux loges qui
■ contiennent chacune deux ou trois noyaux de la
gro fleur d’un pois. Les enfans les caflént aufli aifé-
■ ment qu’une noifette, pour avoir l’amande qui eft
douce à manger, mais qui fait foulever le coeur.
La fubftance de cette amande eft d’une couleur verdâtre
qui reffemble à celle de la piftache ; c’eft apparemment
ce qui a fait donner à cet arbrifleau le
corn de piflachier fauvage. On l ’appelle aufli ne{
coupé, parce que le noyau qui renferme la fe-
■ mence, reffemble à un bout de nez que l’on auroit
coupé. On le nomme aufli bois faint Edme dans plu-
fieurs endroits de la Bourgogne, parce qu’on raconte
que ce faint avoit un bâton du bois de cet
arbrifleau, qu’il piqua en terre & qui y fit racine.
Le ns[ coupé croît dans les bois, dans les haies,
clans les lieux frais, incultes 6c ombragés ; cependant
il n’eft pas commun. Il eft très-robufte; il fe
multiplie aifément, 6c il réuflit par-tout, fi ce n’eft
lorfqu’il eft dans un terrein léger; il fouffre beaucoup
dans les grandes chaleurs & les fécherefles.
Cet arbrifleau pouffe quantité de rejettons du
pié qui peuvent fervir à le multiplier. On y parvient
aufli, foit en couchant les branches au prin-
tems, on en femant les noyaux peu après leur
maturité qui arrive au mois de Septembre. Car fi
l ’on difléroit de les femer jufqu’au printems, la
plupart ne leveroient que l’année fuivante. Par
i ’une ou l’autre méthode, on aura au bout d’un
an des plans fuffifamment enracinés pour être mis
en pépinière. Les branches couchées donneront
tout-de-fuite des fleurs ; mais les jeunes plants v enus
de femence, ne fleuriront qu’au bout de trois
ou quatre ans : il ne faut pour la culture de cet
arbrifleau aucun foin particulier.
On fait ulage du m^ coupé dans les jardins pour
l ’agrément. On peut le mettre dans les maflifs des
bolquets : on peut l’employer en arbre de ligne
pour les allées, oîi il va de pair & figure fort
bien avec le citife des Alpes, l’arbre de Judée,
l ’arbre de Sainte-Lucie, la rofe de Gueldres,&c.
Son bois, quoique blanc, eft dur, folide, compacte
& de durée. Il peut être de quelqu’utilité iorf-
qu’il a acquis un peu de grofleur ; car il eft frêle,
quand il eft trop jeune. 11 y a encore une autre
efpece de cet arbrifleau.
Le ne[ coupé de Virginie. Quoique cet arbrifleau
vienne d’un climat aflez chaud, il eft tout aufli ro-
bufte que l’efpece commune; mais il ne s’élève
qu’à neuf ou dix piés dans les meilleurs terreins.
Sa feuille n’eft compofée que de trois follioles plus
petites 6c d’un verd plus clair que celle de l’efpece
précédente. Sa fleur eft aufli plus petite 6c
moins apparente ; les veflïes qui fuccedent font
divifées en trois loges : elles renferment chacune
un noyaau plus petit dont l’amande eft aufli d’un
verd de piftaches. Le feuillage de cet arbrifleau
fait tout fon agrément. Article deM. D a u b l n t q n ,
fub délégué.
Ne z , (Critique facrée.') Il eft défendu par le Lévi-
tique, de recevoir pqur le fervice de l’autel, un
homme qui eut le ne[ trop petit, trop grand ou
retroufle : fi parvo, vel grandi, vel torto fùerit nafo,
Levit. X X L xviij. Les Hébreux mettoient communément
la colere dans le ne{: afeendit furnus de na-
ribus ejus, II. Reg. xxij. g . Ce mot fe prenoit
aufli pour la fierté 6c grandeur d’ame : nafus iuus
Jicut turris Libani, eft-il dit de l’époufe, Cant. vij. 4 *
votre ne[ ne releve pas moins la beauté de votre
vifage, que cette tour embellit le mont Liban. Cette
tour étoit la fierté qui rendoit le coeur de i’époufe
inacceflible à tout autre qu’à fon époux. Mettre un
cercle au ne[ , c’eft réprimer la fierté des orgueilleux.
Nunquampofuit circulum in nanbus ejus, Job. xl. 21.
Enfin, cette phrafe, donec extat per nares veflras,
Num. xx j. 20. marque le dégoût des viandes qu’au-
roient les Ilraélites murmurateurs. (D . 7.)
O11 lit aufli dans lediél. delà bible que les Hébreux
regardoient le ne{comme le fiege de la colere: afeen-
ditfumusde naribns ejus, eft-il dit au fécond livre des
Rois , c. xxij. verf c). en parlant de la colere de
Dieu : & dans le Pfeaume xvij. verf. 9. afeendit fu-
rnus in ira ejus; l’hébreu porte in nafo ejus. Les anciens
auteurs grecs 6c latins parlent à-peu-près de
même. Ainft Perfe,
Difce :fed ira cadat nafo, rugofaqtte fanna.
& Plaute,
Famés & mora bilem in nafo conciunt<,
Les Romains regardoient les gens dont le neç
étoit aquilin ou crochu, comme enclins à la raillerie.
Nafo fufpendit adunco, dit Horace, en parlant
d’un fatyrique.
Les femmes d’Orient, en plufieurs endroits, mettent
des cercles d’or à une de leurs narines. Salomon
fait allufion à cette coutume, lorfqu’il dit :
Circulus aureus in naribus fuis mulier puldira & fatua,
une femme belle, mais infenfée, eft comme un anneau
au groin d’un pourceau. Proverb.xj. 22. On
mettoit aufli des anneaux aux nafeaux des boeufs
6c des chameaux pour les conduire. Ainfi dans le
quatrième livre des Rois, c. xix. verf. 28.Dieu menace
Sennacherib de lui mettre un cercle aux narines
& un mords dans la bouche, 6c de le faire retourner
par le chemin par lequel il eft venu. Cal-
met, Did. de la Bible. ( G)
N e Z. (Métallurg.') On appelle ne{ dans les fonderies
où l’on traite les mines des métaux, une
efpece de tuyau ou de conduit qui fe forme dans
la mine fondue depuis la tuyere, 6c qui de-là va
en s’élargiflant vers la partie intérieure du four-'
neau. Ce ne? ou conduit ne doit point trop s’alon-
ger. Les Fondeurs ont très-grande attention à cette
circonftance, 6c jugent par le n e fi leur fonte
réuflira ou non. Voye^ Schlutter, traité de la fonte
des mines. (—)
Ne z , le nez du navire. (Marine ) C ’eft la
première partie du navire qui finit en pointe. On
dit la même chofe d’un bateau.
Vaiffeau qui eft trop fur le ne^, c’eft quand par
fa conftru&ion il paroît que l’avant eft un peu trop
chargé : on y remédie en faifant pencher le mât de
milaine un peu plus en arriéré.
N e z d ’u n b a t e a u , (Charpent.) c’eft la première
partie du bateau,qui finit en pointe, & où
eft la levée fur laquelle fe met le batelier, lorfqu’il
fe fert des avirons. (D . 7.)
Nez de potence , terme d'Horlogerie. Voye{ Potence.
(T )
Nez. (Maréchal.) Le bout du nc{ du cheval eft,
pour ainfi dire, fa levre fupérieure. Porter le nez
au vtnt, ou porter au vent, fe dit d’un cheval qui
leve le en l’air au-lieu de fe ramener.
Nez fin ; (Pennerie.') fe dit d’un chien qui a le
fçntiment bon,
Net
N H A
Hc{ dur y fe dit d’un chien qui entre mal-aifé-
ment dans la voie.
M l haut, ou chien de haut ne^, c’eft lorfqu’un
chien va requérir fur le haut du jour.
On remarque que plufieurs animaux, comme les
chiens, les lievres, les renards, ont plus de lames
ofl'eulès que les hommes qui en ont le moins de
tous. C ’eft ce qui fait croire que c’eft pour cela
qu’ils ont aufli meilleur odorat, à caufe que la membrane
qui couvre toutes les enfraéhiofités des narines
ayant beaucoup d’étendue dans un petit ef-
pace, elle reçoit en plus de parties les impreflions
des particules écoulées des corps odorans.
N G
NGO K IAO , (Hift. des drog. de la Chine.) colle
faite avec la peau d’âne noir. Voici comme elle
fè prépare, fuivant la relation du pere Parennim,
je fui te.
On prend la peau d’un âne noir, tué tout récemment;
on la fait tremper quelques jours confécutifs
dans de l’eau tirée d’un puits de la province de
Changtong; après cela on la retire de cette eau
pour la racler, & la nettoyer en-dedans & en-
dehors ; on la coupe enfuite en petits morceaux,
6c on la fait bouillir à petit feu dans de l’eau de ce
même puits, iufqu’à ce que ces morceaux foient
réduits en colle qu’on pâlie toute chaude par une
toile, pour en rejetter les parties les plus groflie-
res qui n’ont pu être fondues. Enfin on en dilfipe
l ’humidité, & chacun lui donne la forme qui lui
plaît. Les Chinois la jettent en moule, 6c y impriment
des caraûeres de toutes fortes de figures.
(D . J .j &
NGOMBOS, (Hifl. mod. Superfiition.) prêtres
■ impo fleurs: des peuples idolâtres du royaume de
Congo en Ainque. On nous les dépeint comme
fies fripons avides qui ont une infinité de moyens
pour tirer des libéralités des peuples fuperftitieux
6c crédules. Toutes les calamités publiques 6c particulières
tournent à leur profit ; parce qu’ils per-
fuadent aux peuples que ce font des effets de la
colere des dieux, que l’on ne peut appaifer que
par des facrifiees, 6c fur-tout par des préfens à
leurs miniftres. Comme ils prétendent être forciers
& devins, on s’adreffe à eux pour connoître l’ave- i
nir & les chofes cachées. Mais nne fource intarif-
fable de richeffes pour les Ngombos, c’eft qu’ils per-
fuadent aux negres qu’aucun d’eux ne meurt d’une
moit naturelle, 6c quelle eft due à quelqu’empoi- i
fon ne ment ou maléfice dont ils veulent bien décou- :
vrir les auteurs, moyennant une rétribution ; & toujours
ils font tomber la vengeance fur ceux qui I
leur ont déplu, quéiqu’innocens qu’ils puiffent être.
Sur la déclararion du prêtre, on faifit le prétendu
coupable à qui l’on fait boire un breuvage préparé
par le ngombo , 6c dans lequel il a eu foin
de meler un poifon très-vif, qui empêche les inno-
cens de pou voir fe juftifier, en fe tirant de l’épreuve.
Les ngombos ont au-deffous d’eux des prêtres ordinaires
appelles gangas qui ne font que des fripons
fubalternes.
N H
txot.') plante farmenteufe
d Amérique ; fa tige eft ligneufe, genouillée, velue,
ïameufe, en partie ferpentant à terre, 6c en partie
S elevant comme le pourpier. Sa feuille eft grande,
verte, quelquefois légèrement dentelée fur les bords,
d autrefois découpée profondément. Ses fleurs naif-
lent aux lommités de fes branches en forme de bou-
°ny, elleMont.rondes, groflès comme de petites
N H A 12.9
cerifes, fans feuilles, approchantes de celles de
la camomille. Sa femence eft taillée en ombilic,
de ferme o vale, de couleur grife, rougeâtre Iiii-
fantes. Ses racines jettent de tous côtés plufieurs
nlamens blancs, tendres. Cette plante croît dans
. les bois, dans les forêts, dans les jardins. Ses feuilles
: machees ont un goût piquant ôc acrimonieux, comme
la moutarde & le crefiôn ; on les mange en fa-
lade dans leur primeur. (£>./.)
NH ANDIROBE, nhandirobay f. f. (Hift. nat. Bot.)
genre de plante à fleur monopétale, en forme de
rofette, & profondément découpée. Les unes font
ftériles & les autres fertiles; celles-ci font placées
lur un embryon qui devient dans la fuite un fruit
en forme de boîte charniu qui eft revêtu d’une
écorce dure & qui contient des femences appla-
ties & arrondies. Plumier, nova plant, amer, gen
Voye^ Plante. ( / ) * 6
Le nhandiroba eft une plante farmenteüfe d’Amérique.
Le P. Plumier dit qu’elle grimpe aflez haut
fur les arbres qui lui font voifins ; fes farmens font
fouples, garnis de feuilles plus ou moins arrondies
de la largeur de la main, raillées en coeur, & d’un
verd-pâle. Ces farmens font terminés par un bouquet
de petites fleurs jaunâtres & ftériles. Les fleurs
fertiles ou qui donnent du fruit, fortent des aif-
felles des feuilles, d’autres fortent des branches ;
ces feuilles font à trois poinres pour l’ordinaire, 6c
femblables à celles du lierre, mais beaucoup plus
grandes. Le fruit qui fuccede à la fleur, eft plus gros
qu’une orange, charnu 6c rempli intérieurement de
plufieurs femences plates, arrondies, très-ameres 6c
huileufes ; chaque femence eft renfermée dans un
noyau plat, folide, brun, recouvert d’une fubftance
charnue, fpongieufe 6c jaunâtre. Cette femence au
Brefil fert à faire de l'huile, mais aux îles de l’Amérique
elle y eft regardée comme le contrepoifon
du venin des ferpens.
M. Linnæus nomme ce genre de plante fevillaa ,
& le caraftérife ainfi. Il produit des fleurs mâles 6c
femelles diftinûes ; l’enveloppe de la fleur mâle eft
faite en cloche compofée d’une feule feuille ; il eft
arrondi dans le fond & découpé fur les bords en
cinq fegtnens. La fleur eft aufli monopétale, arrondie
, légèrement découpée fur les bords en cinq
parties, avec un nombril orné d’une double étoile.
Les étamines font trois filamens. La fleur femelle
de fon calice ne différé de la fleur mâle que dans
l’étoile qui eft compofée de cinq feuilles faites en
coeur. Le fruit eft une très-groffe baie, charnue,
d une figure o vale, obtufe, entourée du calice, 6c
couverte d’une écorce dure. Les femences font
d’une forme orbiculaire applatie. (D . 7.)
NHAMDIU, f. m. (Injïclol.) efpece d’araignée
du Brefil. Son corps eft de la longueur d’un pouce,
garni fur le dos d’une forme de bouclier triangulaire
, brillant, orné dans les côtés de fix cônes
pointus, blancs, feir.és de taches rouges; fa bouche
eft armée de deux petites dents recourbées ; la
partie antérieure de fon corps eft foutenue par
huit jambes, longues d'environ deux pouces, jaunes,
ou rouges-brunes ; 6c fa partie poftérieure qui
eft la plus grande, reluit comme de l ’argent. Cette
efpece d’araignée file une toile comme les autres9
mais elle eft venimeufe. (D . 7.)
NHANDUAPOA, ( Ornithol.) nom d’un oifeau
du Brefil, plus connu fous fon nom hollandois feur-
VOgel. Voyer SCURVOGEL.
NHANDUGUACU, (Ornith. ) oifeau du Brefil,
de la claffe des autruches, mais d’une plus petite
efpece que l’autruche d’Afrique. Son corps eft fort
gros; fon col eft long & fort; fes jambes font hautes
6c épaiffes; fes aîles extrêmement courtes, ne
lui fervent que pour la côurfe ; fpn pennage eft