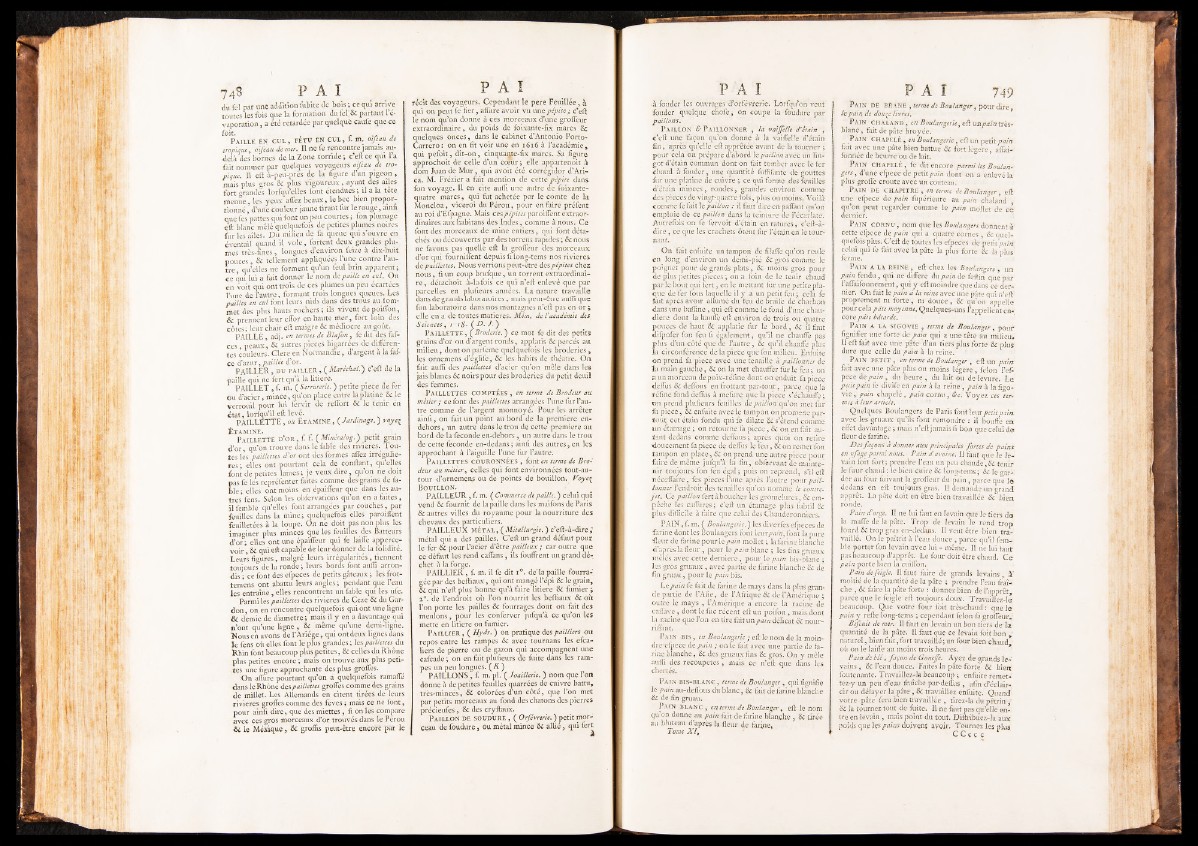
74S P A ï
du fel par une addition fubite de bois ; ce qui arrive
toutes les fois que la formation du fel & partant 1 e-
vaporation, a été retardee par quelque caufe que ce
foit. | 9 c - r i
Paille en c u l , fétu en c ü l , f. m. oifeau de
tropique, oifeau de mer. Il ne fe rencontre jamais au-
delà des bornes de la Zone torride; c’eft ce qui l’a
fait nommer par quelques voyageurs oifeau de tropique.
Il eft à-peu-près de la figure d’un pigeon,
mais plus gros 8c plus vigoureux, ayant des ailes
fort grandes lorfqu’elles font étendues ; il a la tete
menue, les yeux allez beaux, le bec bien proportionné,
d’une couleur jaune tirant fur le rouge, ainfi
que fes pattes qui font un peu courtes ; fon plumage
eft blanc mêlé quelquefois de petites plumes noires
fur les ailes. Du milieu de fa queue qui s’ouvre en
éventail quand il v o le , fortent deux grandes plumes
très-fines, longues d’environ feizè à dix-huit
pouces, 8c tellement appliquées l’une contre l’autre
, qu’elles ne forment qu’un feul brin apparent;
ce qui lui a fait donner le nom dq paille en cul. On
en voit qui ont trois de ces plumes un peu ecartces
l’une de l’autre , formant trois longues queues. Les
pailles en cul font leurs nids dans des trous au.fom-
met des plus hauts rochers; ils vivent depoiffon,
& prennent leur effor en haute mer, fort loin des
côtes; leur chair eft maigre 8c médiocre au goût.
PAILLÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit des faf-
ces , peaux, 8c autres pièces bigarrées de différentes
couleurs. Clere en Normandie, d argent à là fafi
ce d’azur, paillée d’or. ,
PAILLER, DU PAILLER, ( Maréchal.) c èit de la
paille qui ne fert qu’à la litiere.
PAILLET , f. m. ( Serrurerie. ) petite piece de fer
ou d’acier, mince, qu’on place entre la platine & le
verrouil pour lui fervir de reffort 8c le tenir én
éta t, lorfqu’il eft lève.
PAILLETTE, ou ÉTAMINE, ( Jardinage. ) voyei
Étam ine. <.
Paillette d’o r , f. f. ( M i n e r a l o g . j petit grain
d’o r, qu’on trouve dans le fable des rivières. Toutes
\e s p a i l le t te s d 'o r ont des formes affez irrégiilie-
res ; elles ont pourtant cela de confiant, qu’elles
font de petites lames ; je veux dire, qu’on ne doit
pas fe les repréfenter faites comme des-grains. de fable
; elles ont moins én épaiffeur que dans les autres
fens. Selon les obfervatiôns qu’ori én a faites ,
il femble qu’elles font arrangées par couches, par
feuilles dans la mine; quelquefois elles paroiffent
feuilletées à la loupe. On ne doit pas non plus les
imaginer plus minces que les feuilles des Batteurs
d’or ; elles ont une épaiffeur qui fe laiffe apperce-
v o ir , 8c qui eft capable de leur donner de la folidité.
Leurs figures, malgré leurs irrégularités’, tiennent
toujours de la ronde ; leurs bords font aufii arrondis
; ce font des efpeces de petits gâteaux ; les frot-
temens ont abattu leurs angles ; pendant que l’eau
les entraîne, elles rencontrent un fable qui les ufe.
Parmi les paillettes des rivières de Ceze 8c du Gardon
on en rencontre quelquefois qui ont une ligne
& demie de diamètre ; mais il y en a davantage qui
n’ont qu’une ligne , 8c même qu’une demi-ligne.
Nous en avons de l’Ariége, qui ont deux lignes dans
le fens oii elles font le plus grandes ; les paillettesdu
Rhin font beaucoup plus petites, 8c celles du Rhône
plus petites encore ; mais on trouve aux plus petites
une figure approchante des plus groffes.
:On affure pourtant qu’on à quelquefois ramaffé
dans le Rhône des paillettes groffes comme des grains
de millet. Les Allemands en citent tirées de leurs
rivières groffes comme des fèves ; mais ce ne font,
pour ainfi dire, que des miettes, fx on les compare
avec ces gros morceaux d’or trouvés dans le Pérou
Sc le Mexique, 8c groflis peut-être encore par le
P A I
récit dès voyageurs. Cependant le pere Feuillée, à
qui on peut fe fier, affure avoir vu une pépite ; c’eft
le nom qu’on donne à ces morceaux d’une groffeur
extraordinaire, du poids de foixante-fix marcs 8c
quelques onces, dans le cabinet d’Antonio Porto-
Carrero: on en fit voir une en 1616 à l’académie,
qui pefoit, dit-on, cinquante-fix marcs. Sa figure
approchoit de celle d’un coeur ; elle appartenoit à
dom Juan de Mur, qui avoit été corregidor d’Ari-
ca. M. Frézier a fait mention de cette pépite dans
fon voyage. Il en cite aufii une autre de foixante-
quatre marcs, qui fut achetée par le comte de la
Moncloa, viceroi du Pérou, pour en faire préfent
au roi d’Efpagne. Mais ces pépites paroiffent extraordinaires
aux habitans des Indes, comme à nous. Ce
font des morceaux de mine entiers, qui font détachés
ou découverts par des torrens rapides ; 8c nous
ne favons pas quelle eft la groffeur des morceaux
d’or qui fourniffent depuis fi long-tems nos rivières
de paillettes. Nous verrions peut-etre des pépites chez
nous, fi un coup brufque, un torrent extraordinaire
, détachoit à-la-fois ce qui n’eft enlevé que par
parcelles en plufieurs années. La nature travaille
dans de grands laboratoires ; mais peut-être aufii que
fon laboratoire dans nos montagnes n’eft pas en or ;
elle en a de toutes matières. Mém. de l'académie des.
Sciences, /"/#• ( D. J. )
Paillette , ( Brodent. ) ce mot fe dit des petits
grains d’or ou d’argent ronds, applatis 8c percés au
milieu, dont on parfeme quelquefois les broderies ,
les ornemens d’églife, 8c les habits de théâtre. On
fait aufii des paillettes d’acier qu’on mêle dans les
jais blancs 8c noirs pour dés broderies du petit deuil
des femmes.
PAILLETTES COMPTÉES , en terme de Brodeur au
métier ; ce font des paillettes arrangées l’une fur l’autre
comme de l’argent monnoyé. Pour les arrêter
ainfi, on fait un point au bord de la première en-
dehors , un autre dans le trou de cette première au
bord dé la féconde en-dehors, un autre dans le trou
de cette fécondé en-dedans ; ainfi des autres, en les
approchant à l’aigiiille l’üné fur l’ autre.
Paillettes COURONNÉES , font en terme de Brodeur
au métier y celles qui font environnées tout-autour
d’ornemens ou de points de bouillon. Voyeç
Bouillon.
PAILLEUR , f. m. ( Commerce de paille. ) celui qui
vend 8c fournit de la paille dans les maifôns de Paris
: 8c autres villes du royaume pour la nourriture des
chevaux des particuliers.
PAILLEUX métal , ( Métallurgie. ) c’ eft-à-dire ,'
métal qui a des pailles. C’eft un grand défaut pour
le fer 8c pour l’acier d’être pailleux ; car outre que
ce défaut les rend caffans, ils fouffrent un grand dé-,
chet à la forge.
PAILLIER, f. m. il fe dit i° . de’ la paille fourra-,
gée par des beftiaux, qui ont mangé l’épi 8c le grain,
oc qui n’eft plus' bonne qu’à faire litiere 8c fumier ;
2°. de l’endroit oîx l’on nourrit les beftiaux 8c oîi
1-on porte les pailles 8c fourrages dont on fait des
meulons, pour les conferver jufqu’à ce qu’on les
mette en litiere ou fumier.
PAILLIER, ( Hydr. ) on pratique des pailliers ou
repos entre les rampes 8c avec tournans les efea-
liers de pierre ou de gaZon qui accompagnent une
cafcade ; on en fait plufieurs de fuite dans les rampes
un peu longues. ( K. )
PAILLONS , f. m. pl. ( Joaillerie. ) nom que l’on
donne à de petites feuilles quarréès de cuivre battu,
très-mincés, 8c colorées d’un côté, que l’on met
par petits morceaux au fond des chatons des pierres
précieufes, 8c des cryftaûx.
Paillon de soudure , ( Orfèvrerie. ) petit morceau
de foudure, ou métal mince 8c alfié, qui fert
P A I
■ à fonder les ouvrages d’orfèvrerie. Lorfqu’oii veut
fonder quelque cnofè, on coupe la foudtire par
paillons.
Paillon & Paillônner , la vaiffelle d'é tain ,
c’eft une façon qu’on donne à la vaiffelle d’étain
fin, après qu’elle eft apprêtée'avant de la tourner ;
pour cela on prépare d’abord le p a illo n avèè un lingot
d’étain commun dont on fait tomber avec le fer
chaud à fbuder, une quantité fuffifante de gouttes
fur une platine de cuivre ; ce qui forme ;des:feuilles
d’cta'in minces, rondes, grandes environ comme
des pièces de vingt-quatre fols, plus ou moins. Voilà
comme fe fait le p a illo n : il faut dire en paffant qu’on
emploie de ce paillon dans la teinture de l’ écarlate.
Autrefois on fe fer voit d’étain en ratures * c’eft-à-
dire , ce que les Crochets ôtent fur l’étain en le tournant.
On fait enfiiite un tampon de filaffe qu’on roule
en long d’environ un demi-pié 8c gros comme lé
poignet pour de grands plats, 8c moins- gros pour
de plus petites pièces;; pn a foin de le tenir chaud
par le bout qui fert, en le mettant fur une petite plaque
de fer fous laquelle il y a un petit feu ; cela fe
fait après avoir allumé du feu de braife de charbon
dans une bafline, qui eft comme le fond d’une chaudière
dont la hauffe eft environ de trois ou quatre
pouces de haut 8c applatie fur le bord, 8c il faut
difpofer fon feu fi également, qu’il ne chauffe pas
plus d’un côté que de l’autre, 8c qu’il chauffe plus
la circonférence de la piece que fon milieu. Enfiiite
on prend fa piece avec une tenaille à p a illo h n tr de
la main gauche, 8c on la met chauffer fur lé feu; on
ia un morceau de poix-réfine dont on enduit fa piece
deffus 8c deffous en frottant par-tout, parce que la
réfine fond defliis à mefure que la pièce s’échauffe ;
X)ï i prend plufieurs feuilles de p a illo n qu’on met fur
fa piece, 8c enfuite avec le tampon onpromene partout
cet étain fondu qui fe dilate 8c s’étend comme
un etamage ; on retourne fa p iece, 8c on en fait autant
dedans comme deffous ; après quoi on retire
xloucement fa piece de deffus le feu , 8c on remet fon
tampon en place, 8c on prend une autre piece pour
faire de même jufqu’à la fin, obfervant de maintenir
toujours fon feu égal; puis on reprend, s’il eft
néceffaire, fes pièces l’une après l’autre pour p a il-
lonner l’endroit des tenailles qu’on nomme le contre-
j e t . Ce p a illo n fert àboucher les gromelures, 8c empêche
les caffures ; c’eft un étamage plus fubtil 8c
plus difficile à faire que celui des Chauderonniers.
PAIN, f. m. ( Boulangerie. ) les diverfes efpeces de
farine dont les Boulangers font leurpaïny font la pure
fleur de farine pour le pain mollet ; la farine blanche
d’après la fleur , pour le pain blanc ; les fins gruaux
mêlés avec cette derniere, pour le pain bis-blanc ;
les gros gruaux , avec partie de farine blanche Sc de
fin gruau, pour le pain bis.
Le p a in fe fait de farine de mays dans la plus grande
partie de l’Afie, de l’Afrique 8c de l’Amérique ;
outre le mays , l’Amérique a encore la racine de
caffave, dont le fuc récent eft un poifon, mais dont
la racine que l’on en tire fait un p a in délicat 8c nour-
riffant.
Pain bis , en Boulangerie ; eft le nom de la moin-
di-e-efpece de pain ; on le fait avec une partie de farine
blanche, 8c des gruaux fins 8c gros. On y mêle
aufli des recoupetes , mais ce n’eft que dans les
chertés.
Pain BIS-BLANG, terme de Boulanger, qui lignifie
le pain au-deffous du blanc, 8c fait de farine blanche
8c de fin gruau.
Pain b l a n c , en terme de Boulanger, eft le nom
qu on donne au pain fait de farine blanche , ÔC tirée
au bluteau d’après la-fleur de farine,
T om e X I t
P A I 749
Pain dé BRAKE , terme de Boulanger, pour dire,
te pain de douçe livres-,
Pain CHAlan d , en Boulangerie y eft unpain très-
blane, fait de pâte broyée.
Pain CHapelÉ , en Boulangerie, eft un petit pain
fait avec une pâte bien battue 8c fort légère affai-
forinée de beui-re bu de lait.
Pain CHAPELÉ, fe dit encore parmi les Boulangers
, d’une efpece de petit pain dont on a enlevé la
plus groffe croûte avec un couteau.
PAIN DÉ CHAPITRE , en terme de Boülafi<rer eft
une efpece de pain fupérieure au pain chaland
qu’ori peut regarder comme le pain mollet de ce
dernier-.
Pain co rnu , nom qiie les Boulangers donnent à
cette efpece de pain qui a quatre cornes , 8c quelquefois
plus. C’eft de toutes les efpeces de petit pain:
celui qui fe fait avec la pâte la plus forte 8c la plus
ferme.
Pain A LA reine , eft chez les Boulangers > un
pain fendu, qui ne différé, du pain de feftin que par
l’affaifonnement, qui y eft moindre que dans ce dernier.
On fait le pain à la reine avec une pâte qui n’eft
proprement ni forte, ni douce, 8c cju’on appelle
pour cela pâte moyenne. Quelques-uns l’appellent en-'
core pâte bâtarde,
Pain A la SïGOVÏE , terme de Boulanger, pour
fignifîer une forte de pain qui a une tête au milieu.
Il eft fait avec une pâte 'd’un tiers plus forte 8c plus
dme que celle du pain à la reine.
Pain PETIT , en terme de Boulanger y eft un pain
fait avec une pâte plus ou moins légère , félon l’efi
pëce de pain , du heure , du lait ou de levure. Le
petit pain fe divife en pain à la reine , pain à la figo-
v ie , pain chapelé, pain cornu, &c. Voyez ces termes
à leur article, ; .
Quelques Boulangers de Paris font leur petit pain
avec les gruaux qu’ils font remoudre : il bouffe en
effet davantage ; mais n’eft jamais fi bon que celui de
fleur de farine» -
Des façons à donner àUx principales fortes de pains
en ufâge parmi nous. Pain d'avoine. Il faut que le levain
foit fort; prendre l’eau un peu chaude,8c tenir
le four chaud : le bien cuire 8c long-tems; 8c le garder
au four fuivant la groffeur du pain, parce que le
dedans en eft toujours gras. Il demande un grand
apprêt. La pâte doit en être bien travaillée 8c bien
ronde.
Pain d’orge. Il ne lui faut en levain que le tiers da
la maffe de la pâte. Trop de levain le rend trop
lourd 8c trop gras en-dedans. Il Veut être bien travaillé.
On le paîtrit à l’eau douce , parce qu’il femble
porter fon levain avec lui - même. Il ne lui faut
pas beaucoup d’apprêt. Le four doit être chaud. C e
pain porte bien la cüiffon.
Pain defeigle. Il faut faire de grands levains, àf
moitié de la quantité de la pâte ; prendre l’eau fraîche
, 8c faire la pâte forte : donnez-bien de l’apprêt,
parce que le feigle eft toujours doux. Travaillez-le
beaucoup. Que votre four foit très-chaud : que le
pain y refte long-tems ; cependant félon fa groffeur.
Bifcuit de mer. Il finit en levain un bon tiers de la
quantité de la pâte. Il faut que Ce levain foit bon
naturel, bien fait, fort travaillé; un four bien chaud f
oîi on le laiflè au moins trois heures.
Pain de ble, façon de Goneffe. Ayez de grands levains
, Sc l’eau douce. Faites la pâte forte 8c bien
foutenante. Travaillez-la beaucoup ; enfuite remet-
tez-y un peu d’eau fraîche par-deffus , afin d’éclaircir
ou délayer la pâte , 8c travaillez enfuite. Quand
votre pâte fera bien travaillée , tirez-la du pétrin |
8c la tournez tout de fuite. Il ne faut pas qu’elle entre
en levain, mais point du tout. Diftribuez-la aux
poids que les pains doivent avoir. Tournez les plus
C C ç c c