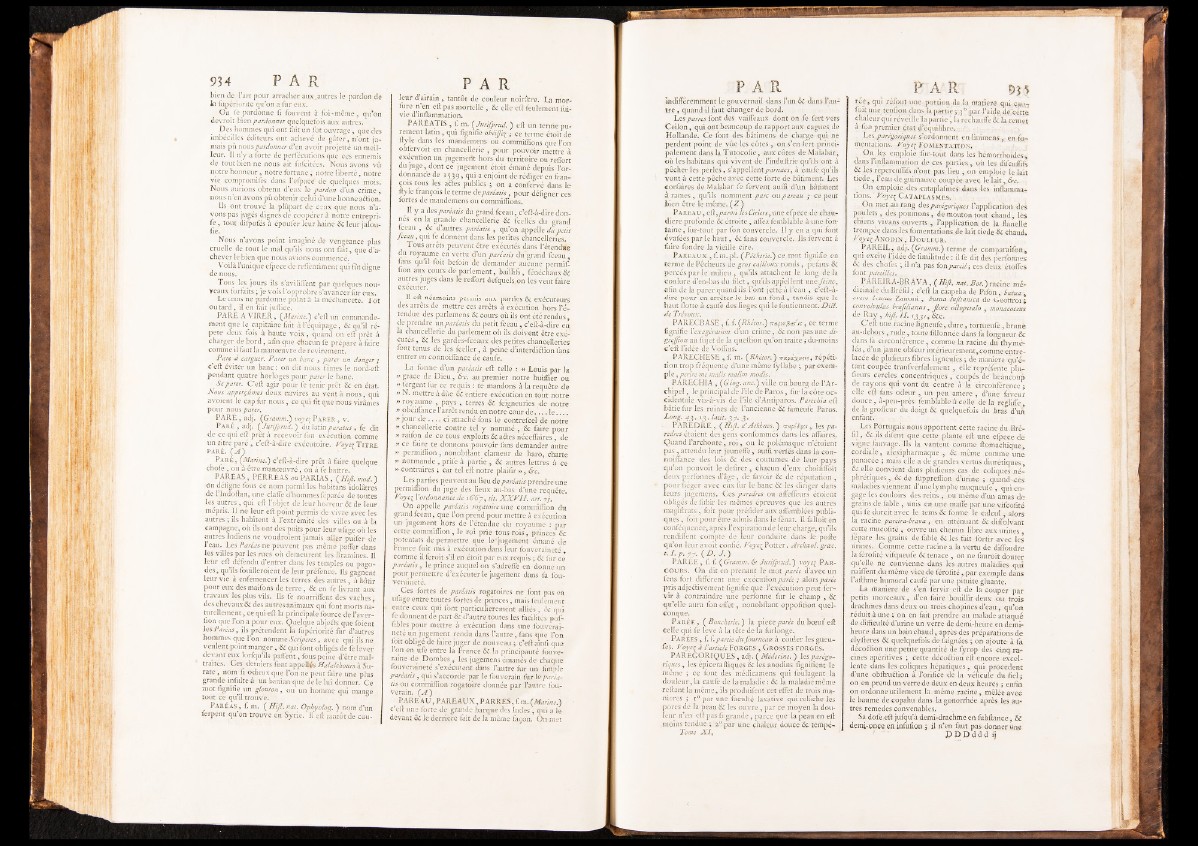
bien de l’art pour arracher aux^autres le pardon de
la fupériorite qu’on a fur eux.
On fe pardonne fi fouvent à foi-même, qu’on
devroit bien pardonner quelquefois aux autres.
Des hommes qui ont fait un fot ouvrage, que des
imbecilles éditeurs ont achevé de gâter, n’ont jamais
pû nous pardonner d’en avoir projetté un meilleur.
Il n’y a forte de perlécutions que ces ennemis
de tout bien ne nous ait fui citées. Nous avons vu
notre honneur, notre fortune,' notre liberté notre
vie compromises dans l’efpace' de quelques mois.
Nous aurions obtenu d’eux le pardon d’un crime,
nous n’en avons pû obtenir celui d’une bonne attion.
Ils ont trouve la plupart de ceux que nous n’avons
pas jugés dignes de coopérer à notre entrepri-
fe , tout diipofésa épotifer leur haine & leu r jalou-
fie.
Nous n’avons point imaginé de vengeance plus
cruelle de tout le mal qu’ils nous ont fait, que d’achever
le bien que nous avions commencé.
Voilà l’unique efpece de reiTentiment qui fût diene
de nous. .. ■
Tous les jours ils s’aviliiTent par quelques nouveaux
forfaits ; je vois l’opprobre s’avancer fur eux.
Le tems ne pardonne point à la méchanceté. Tôt
ou tard, il en fait juftice.
PARE A V IRER, (Marine.)c’e{\. un commandement
que le capitaine fait à l’équipage, 8c qu’il répété
deux fois à haute v o ix , quand on eft prêt à
charger de bord, afin que chacun fe prépare à faire
comme il faut la manoeuvre de revirement.
Pare à carguer. Parer un banc , parer un danger ;
c’eft éviter un banc: on dit nous fîmes le nord-eft
pendant quatre horloges pour parer le banc.
Séparer. C’eft agir pour fe tenir prêt & en état.
Nous apperçumes deux navires au vent à nous, qui
avoient le cap fur nous, ce qui fît que nous virâmes
pour nous parer.
PARÉ , adj. ( Gramm.) voyeç Parer , v.
Pa r e , adj. ( Jurifprud. ) du latin paratus, fe dit
de ce qui eft prêt à recevoir fon exécution comme
un titre pare, c’eft-a-dire exécutoire. Voyer T itre
PARÉ. ÇA ) - 1
Paré , (Marine.') c’eft-à-dire prêt à faire quelque
chofé , ou à être manoeuvré, ou à fe battre.
PARÉAS , PERRÉAS ou PARIAS, ( Hifi. mod. )
on défigne fous ce nom parmi les habitans idolâtres
de l’Indoftan, une claffe d’hommes féparée de toutes
les autres, qui eft l’objet de leur horreur & de leur
mépris. Il ne leur eft point permis de vivre avec les
autres ; ils habitent à l’extrémité des villes ou à la
campagne, où ils ont des puits pour leur ufage où les
autres Indiens ne voudroient jamais aller puifer de
l ’eau. Les Parias ne peuvent pas même paffer dans I
les villes par les rues ou demeurent les Bramines. Il
letir eft défendu d’entrer dans les temples ou pago- *
des', qu’ils fouilleroient de leur préfence, Ils gagnent
leur vie à enfemencer les terres des autres, à bâtir
pour eux des maifons de terre, 8c en fe livrant aux
travaux les plus vils. Ils fe nourrilfent des vaches
des chevaux 8c des autres animaux qui font morts na- ?
turellement, ce qui eft la principale fource de l’aver-
fion que l’on a pour eux. Quelque abjects que foient
les P arias, ils prétendent la fupériorité fur d’autres
hommes que l’on nomme Scriperes, avec qui ils ne
veulent point manger, 8c qui font obligés de fe lever
devant eux lorfqu’ils paffent, fous peine d’être maltraites.
Ces derniers font appelles Halalchours à Surate
, nom fi odieux que l’on ne peut faire une plus
grande infulte à un banian que de le lui donner. Ce
mot fignifîe un glouton, ou un homme qui mange
tout ce qu’il trouve.
Pare as , f. m. ( Hif.nat. Ophyolog. ) nom d’un J
ferpént qu’on trouve en Syrie. Il eft tantôt de couleur
d’airain , tantôt de couleur noirâtre. La mor-
fure n’en eft pas mortelle , &; elle eft feulement fui-
vie d’inflammation.
PARÉATIS , f. m. ( Jurifprud. ) eft un terme pu-
r^ment latin, qui fignifîe obéijje{ ; ce terme étoit de
ftyle dans les mandemens ou commiffions que l’on
obfervoit en chancellerie , pour pouvoir mettre à
exécution un jugemerit hors du territoire ou reflort
du juge, dont ce jugement étoit émané depuis l’ordonnancé
de 1539, qui a enjoint de rédiger en fran-
Ç°is tous les aétes publics ; on a confervé dans le
ftyle françois le terme depariatis, pour défigner ces
fortes de mandemens ou commiffions.
Il y a dzs pariatis du grand fceau, c’eft-à-dire donnes
en la grande chancellerie 8c fcellés du grand
fceau , & d’autres pariatis , qu’on appelle du petit
fceau, qui fe donnent dans les petites chancelleries.
Tous arrêts peuvent être exécutés dans l’étendue
du royaume en vertu d’un pariatis du'grand fceau,
fans qu il foit befoin de demander aucune permif-
fion aux cours de parlement, baillifs, fénéchaux 8c
autres juges dans le reflort defquels.on les veut faire
executer.
Il eft néamoins permis aux parties 8c exécuteurs
des arrêts de mettre ces arrêts à exécution hors l’étendue
des parlemens & cours où ils ont été rendus
de prendre un pariatis du petit fceau , c’eft-à-dire en
la chancellerie du parlement où ils doivent être exécutes
, 8c les gardes-fceaux des petites chancelleries
font tenus de les fceller, à peine d’interdiétion fans
entrer en connoifîance de caufe.
La forme d’un pariatis eft telle : « Louis par la
» grâce de D ieu , &c. au premier notre huiffier ou
» fergent fur ce requis : te mandons à la requête de
» N. mettre à dûe 8c entière exécution en tout notre
» royaume , pays , terres 8c feigneuries de notre
» obeiflance l’arrêt rendu en notre cour de. . ; ,;le.. .1.
» jour de . . . . ci attaché fous le contrefcel de notre
» chancellerie contre tel y nommé , 8c faire pour
» raifon de ce tous exploits 8c aôes néceflaires , de
» ce faire te donnons pouvoir fans demander autre
» permiffion, nonobftant clameur de haro, charte
» normande , prife à partie , 8c autres lettres à ce
» contraires ; car tel eft notre plaifir » , &c.
Les parties peuvent au lieu de pariatis prendre une
permiffion du juge des lieux au-bas d’une requête.
Voye{Yordonnance de 1 G6y, tit. X X V I I . art. vj.
On appelle pariatis rogatoire une Commiffion du
grand fceau, que l’on prend pour mettre à exécution
un jugement hors de l’étendue du royaume : par
cette commiffion, le roi prie tous rois, princes 8c
potentats de permettre que le'jugement émané de
France foit mis à exécution dans leur fouveraineté
comme il feroit s’il en étoit par eux requis ; 8c fur ce
pariatis, le prince auquel on s’adreffe en donne un
pour permettre d’exécuter le jugement dans fa fou-
veraineté.
Ces fortes de pariatis rogatoires ne font pas en
ufage entre toutes fortes de princes, mais feulement
entre ceux qui font particulièrement alliés , 8c qui
fe donnent de part 8c d’autre toutes les facilités pof-
fibles pour mettre à exécution dans une fouveraineté
un jugement rendu dans l’autre , fans que l’on
foit obligé de faire juger de nouveau ; c’eft ainfi que
l’qn, en ufe entre la France 8c la principauté fouve-
raine de Dombes , les jugemens émanés de chaque
fouveraineté s’exécutent dans l’autre fur un fimple
pariatis, qui s’accorde par le fotiverain fur le pariatis
ôx± commiffion rogatoire donnée par l’autre foiîr
verain. (A )
PAREAU, PAREAUX, P ARRES, fini. (Mzrwze.) -
c’eft une forte de grande barque des Indes , qui a le
devant 8c le derrière fait de la même façon. On met
Hidiflefemment le gouvernail dans, l’un 8c dans l’autre
, quand il faut changer de bord.
L esparres font des vaifleaux dont on :fe fert yers
Ceilon, qui ont beaticoup de rapport aux cagues, de
Hollande. Ce font des bâtimens de charge-qui ne
perdent point de vûe les côtes ,, on s’en fert principalement
dans la Tutocofie, aux côtes dé Malabar ,
où les habitans qui vivent de l’induftrie qu’ils '©ht à
pêcher les perles, s’appellentparnaes, à .caufe qu’ils
vont à cette pêche avec cette forte dé bâtiment. Les
corfaires de Malabar fe fervent auffi d’un bâtiment
à rames, qu’ils nomment parc ou pareau / ce petit
bien être le même. ( Z )
Pareau , eft,parmi lesCiriers, une efpece de chaudière
profonde 8c étroite, affez femblable à-une fontaine
, fur-tout par fon couvercle. Il y en a qui font
évafées par le h aut, 8c fans couvercle. Ils fervent à
faire fondre la vieille cire.
Pa reaux , f. m. pi. (Pecheriei)- ce mot fignifie en
terme de Pêcheurs de gros cailloux ronds , pefans 8c
percés par le milieu , qu’ils attachent le long de la
coulure d’en-bas du filet, qu’ils appellent unzfeine:,
■ afin de la parer quand ils l’ont jetté à l’eau , c’eft-à-
dire pour en arrêter le bas au fond , tandis qUe le
haut flotte à caufe des lieges qui le foutiennent. Dicl.
de Trévoux.
PARECBASE, f. f. (Rhitor.) vapêK/W/ç, ce terme
lignifie Y exagération d’un crime, ,8c non pas une di-
greffion au fujet de la queftion qu’on traite ; du-moins
c ’eft l’idée de Voffius.
% PARECHESE , f. m. ( Rhitor. ) Trxpcixiiçiç,- répétition
trop fréquente d’une même ïyllabe ; par exemple
, perire me malis malim modis. •
PARECHIA , (Giog. anc.) ville ou bourg de l’Archipel
, le principal de l’île de Paros, fur la côte occidentale
vis-à-vis de l’île d’Antiparos. Parechia eft
bâtie fur les ruines de l’ancienne 8c fameufe Paros.
Long. 43 .,1,g - latit. 3 y. 3 .
PAR ED RE , ( H f . d 'Athènes-.) ’Tmpllpoi, les pa-
redres étoient des gens confommés dans les affaires,.
Quand l’archonte, ro i, ou le polémaque n’étoient
pas , attendu leur jeuneffe, auffi verfés dans la con-
noiffance des lois 8c des coutumes de leur pays
qu*on pouvoit le defirer, chacun d’eux ehoififfoit
deux perfonnes d’âge, de favoir 8c. de réputation ,
pour fiéger avec eux fur le banc 8c les diriger dans
leurs jugemens. Ces paredres ou afleffeurs étoient
obligés de fubir les mêmes épreuves que les autres
magiftrats , foit pour préfider aux affemblées publiques
, foit pour être admis dans le fénat. Il falloit en
conféquence, après l’expiration de leur charge, qu’ils
rendiflènt compte de leur conduite dans le pofte
qu’on leur avoit confié. Vjyeç Potter. Archoeol. grac.
u l.p .y y . CD. J .)
PARÉE, f. f. ( Gramtil. & jurifpfud. ) voÿe^ PARCOURS.
On dit en prenant le mot parée d?avec un
fens fort différent une exécution parie ; alors parie
pris adje&ivement fignifîe que l’exécution peut fer-
vir à contraindre une perfonne fur le champ , &
qu’elle aura fon eftet, nonobftant oppofitiori quelconque.
Pa r é e , ( Boucherie.) la piece parie du boeuf eft
celle qui fe leve à la tête de la furlonge.
Parées , f. f. partie du fourneau à- couler les gùeu-
fes. Voyei à l'article FORGES , GROSSES FORGES.
PARÉGORIQUES, adj. ( Médecine. ) les parégoriques
, les épiceraftiques & les anodins lignifient le
même ; ce font des médicamens qui foulagent la
douleur, la caufe de la maladie : 8c la maladie même
-reftant la même, ils produifent cet effet de trois maniérés
; i° par une faculté laxative qui relâche les
pores de la peau 8c les ouvre , par ce moyen la douleur
n’en eft pas fi grande, parce que la peau en eft
moins tendue. ; 20 par une chaleur douce 8c tèmpé- ;
Tome X I ,
tee-, qui réfpiR une. portion;de;la,matiere qui.caii-i
foit une tenfion dans la partië •>'3° par l’aiçlç, defeette
chaleur qui réveillela partie \ la rechauffe 8c la remet
■ à; fon premier | t| | çl’equilibr-ev, ; ! '■
L e s ,parégoriques s’ordonpent en linimens ,- en (9*
mentations. Voyei Fomentation.
_ On les emploie fur-tout dans les hémorrhoides^
dans l’inflammation de ces pärt-ies, 051 le? difeuflifs
Ô^ Ies repereuffifs n’pnt pas, lieu 3. on emploie de lait
tiede , l’eau de guimauve coupée.avecy le lait , 6-c.
On emploie(des icataplafmes^dans des inflamma-î-
tions. ‘ Voye^ Cataplas mes;. . :
On met au tang des parégoriques l’application-des
poulets , des poumons, de mouton tout^chaud, lès
chiens|vivans ouverts , l’application; de la flanelle
trempée dans les fomentations.de lait tiede 8c chaude
Voye[ Anodin , D ouleur.
PAREIL, adj. {Gramm.) terme de comparaifon*
qui excite 1 idee de fimilitude : il fe dit des. perfonnes
8c des chofes 3 .il n’a pas. ion pareil’, ces deux étoffes
font pareilles.
, PAREIRA-BRAVA, (Hiß. nat. Bot.) racine médicinale
dti Bréfil ; c’eft la càapeba de Pifôn, butua±
pvero brutua Zanoni , butua lußtanica de Geoflroi ;
convolvulus brafilianus, flor.e oclopetalo , monacoceus
de R a y , hiß. II. 133;/, 8cc.
Ç eft une racine ligneufe, dure , tortuèufe, brune
au-dehors, rude, toute fillonnée dans fa longueur &
dans fa circonférence , comme la racine du thymé-
lea, d up jaune obfcur intérieurement,comme entrelacée
de plufieurs fibres ligneufes ; de marûere qu’étant
coupée tranfverfalement , elle repréferite plu-
fieurs cercles concentriques , coupés dé :beâucbïtp
de rayons qui vont du centre à la circonférence ;
elle eft fans odeur , un peu arriéré , d’une faveur
douce, à-peu-près femblable ‘à- celle de la regliffe.
de la grofleur du doigt 8c quelquefois du bras d’un
enfant.
Les Portugais nous apportent cette racine du Bré-
f il, &,ils.dilënt que cette jjlante eft une efpece de
vigne fauvage. Ils la vantent comme ftomachique>
cordiale , alexipharmaque , 8c même comme une
panacée ; mais elle a de grandes vertus diurétiques ,
8c elle convient dans plufieurs cas de coliques néphrétiques,
8c de fuppreffion d’urine ; quand-ces
maladies viennent d’une lymphe muqueufe , qui engage
les couloirs des. reins , ou'même d’un amas de
grains de fable , unis en une mafle par.une vifeofité
qui fe durcit avec le tems 8c forme le calcul, alors
la racine pareira-brava , en atténuant 8c diffolvant
cette mueofité , ouvre un chemin libre aux urines,
fépare les grains de fable 8c les fait fortir avec lès
urines. Comme cette racine a la vertu de difloudre
laferofité vifqiteufe & tenace , on ne fauroit douter
qu’elle ne .convienne dans les autres maladies qui
naiffent du même vice de férofité, par exemple dans
l’afthme humoral caufé par une pituite gluante.
La maniéré de s’en fervir .eft de la couper par
petits morceaux, d’en faire bouillir deux ou trois
drachmes dans deux ou trois chopines d’eau, qu’on
réduit à une ; on en fait prendre au malade attaqué
de difficulté d’urine un verre de demi-heure en demi»
heure dans un bain chaud, après des préparations de
clyfteres 8c quelquefois de faignées ; on ajoute à fa
decoâion une petite quantité de fyrop des cinq racines
apéritives ; cette décoftion eft encore excellente
dans les coliques hépatiques, qui procèdent
d’une obftruftion à l’orifice de la véficule du fiel ;
on en prend un verre de deux en deux heures ; enfin
on ordonne utilement la. même racine, mêlée avec
le baume de copahu dans la gonorrhée après les autres
remedes convenables.
Sa dofe.eft jufqu’à demi-drachme en fubftance, &
demi-once en infufion 3 il n’en faut pas donner Une
P D D d d d ij