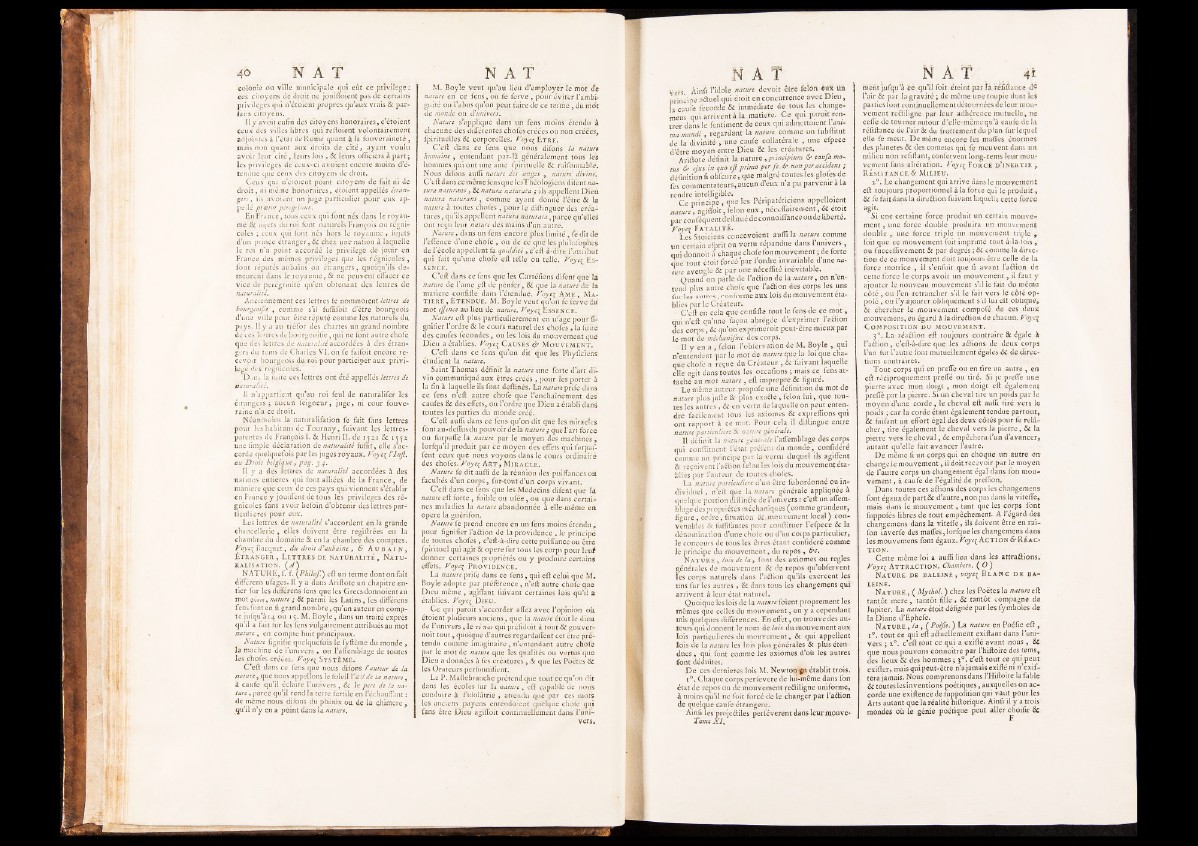
•colonie ou ville municipale qui eût ce privilège :
ces citoyens de droit ne jôuiffoient pas de certains
privilèges qui n’étoiènt propres qu’aux vrais & parfaits
citoyens.
Il y avoit eufin des citoyens honoraires, c’étoient
ceux dés villes libres qui reftoient volontairement
adjointes à l’état de Rome quant à la fouveraineté ,
mais non quant aux droits de cité, ayant voulu
avoir leur c ité , leurs lois, & leurs officiers à part;
les privilèges de ceux-ci avoient encore moins d’étendue
que ceux des citoyens de droit.
Ceux qui n’étoient point citoyens de fait ni de
droit, ni même honoraires, étoient appelles etrangers,
ils avoient un juge particulier pour eux ap-
peilé proetor pèregnnus.
En France, tous ceux qui font nés dans le royaume
6c sujets du roi font naturels François ou régni-
coles ; ceux qui font nés hors le royaume, fujets
d’un prince étranger, 6c chez une nation à laquelle
le roi n’a point' accordé le privilège dé jouir en
France des mêmes privilèges que les regnicoles,
font réputésaubains’ ou étrangers, quoiqu’ils demeurent
dans le royaume, & ne peuvent effacer ce
vice de perégrinité qu’en obtenant des lettres de
naturalité.
Anciennement ces lettres fe nommoient lettres de
lourgeoijie , commé' s’il fuffifôit d’être bourgeois
d’ une ville pour être réputé comme les naturels du
pays. 11 y a au trélor des chartes un grand nombre
de ces le» très de bourgeoise, qui ne font autre chofe
que des lettres de naturalité accordées à des étrangers
du tems de Charles VI. on fe faifoit encore recevoir
bourgeois cl,u roi pour participer aux privilège
des'regnicoles. ‘
Dans la luire ces lettres ont été appelles lettres de
naturalité.
II n’appartient qu’au roi feul de naturaliser les
étrangers; aucun feigneur, juge, ni cour Souveraine
ii’a ce droit.
Néanmoins la naturalifation fe fait fans lettres
pour les habitans deTournay, Suivant les lettres-
patentes de François I. & Henri II. de 1521 6c 1551
une Simple déclaration de naturalité Suffit, elle s’accorde
quelquefois par les juges royaux. Foye%_ l'injl.
au Droit belgique , pag. 34.
Il y a des lettres de naturalité accordées à des
nations entières qui font alliées de la France, de
maniéré que ceux de ces pays qui viennent s’établir
en France y jouiffent de tous les privilèges des ré-
gnicoles fans avoir befoin d’obtenir des lettres particulières
pour eux.
Les lettres de naturalité s’accordent en la grande
chancellerie, elles doivent être regiftrées en la
chambre du domaine & en la chambre des comptes.
Voye^ Bacquet, du droit d'aubaine , & A ub AIN,
Étranger , Lettres de n aturalité , Naturalisation.
(y/)
NATURE, 1. f. ( PhiloJ,!) eff un terme dont on fait
différens ufages. Il y a dans Ariftote un chapitre entier
fur les différens fens que les Grecsdonnoientau
mot çitrii, nature ; & parmi les Latins, les différens
fens font en fi grand nombre, qu’un auteur en compte
jufqu’à 14 ou 15. M. Boyle, dans un traité exprès
qu’il a fait fur les fens vulgairement attribués au mot
nature , en compte huit principaux.
Nature lignifie quelquefois le fyftème du monde ,
la machine de l’univers , ou l’affemblage de toutes
les chofes créées. Foye^ Système.
C ’eft dans ce fens que nous difons Üauteur de la
nature, que nous appelions le foleil Y oeil de la nature,
à caufe qu’il éclaire l ’uni vers , & le pere de la nature
, parce qu’il rend la terre fertile en l’échauffant :
de meme nous difons du phénix ou de la chimere ,
qu’il n’y en a point dans la nature.
M. Boyle veut qu’au lieu d’employer le mot de
nature en ce fens, on fe ferve , pour éviter l’ambiguité
ou l’abus qu’on peut faire de ce terme , du mot
de monde ou d’univers.
Nature s’applique dans un fens moins étendu à
chacune des différentes choies créées ou non créées,
fpirituelles 6c corporelles. Foye^ Etr e .
C ’eft dans ce fens que nous difons ' là nature
humaine , entendant par-là généralement tous les
hommes, qui ont une ame fpirituelle & raifônnable.
Nous difons auffi nature des anges , nature, divine;
C ’eft dans ce même fensque lesThéologiens difent na-
tura naturans , & natura naturata ; ils appellent Dieu
nattera naturans , comme ayant donné l’être & la
nature à toutes chofes , pouf le'diftingùer des créatures
, qu’ils appellent natura naturata, parce qu’elleé
ont reçu leur nature déS "mains d’un autre.
Nature, dans un fens encore plus limité , fe dit dé
l’effence d’unè chofe , Ou de ce que les philosophes
de l’école appellent fa quiddité, c’eft-à-dire l’attribut
qui fait qu’une chofè eft telle ou telle. Foye^ Essence.
C ’eft dans ce fens que les Cartéfiens difent que là
nature de l’ame eft de pénfer, & que la nature de la
matière conlifte dans l’étendue. Foye\ Ame, Matière
, Étendue. M. Boyle veut qu’bri fe ferve dii
mot ejfençe au lieu de nature. Foye£ Essence.
Nature eft plus particulièrement en ufage pouf lignifier
l’ordre & le cours naturel des chofes , la fuite
des caufes fécondés, ou les lois du mouvement que
Dieu a établies. Foye[ Causes & Mouvement.
C ’eft dans ce fens qu’on dit que les Phyficiens
étudient la nature.
Saint Thomas définit la nature une forte d’art divin
communiqué aux êtres créés , pour les porter à
la fin à laquelle ils font deftinés. La nature prife dans
ce fens n’eft autre chofe que l’enchaînement des
caufes & des effets, ou l’ordre que Dieu a établi danà
toutes les parties du monde créé.
C ’eft auffi dans ce fens qu’on dit que les miracles
font au-deffusdu pouvoir de la nature^ que l ’art force
ou furpaffe la nature par le moyen des machines ,
lorfqu’il produit par ce moyen des effets quifurpaf-
fent ceux que nous voyons dans le cours ordinaire
des chofes; Foye^ Art, Miracle.
Nature fe dit auffi de la réunion des puiffancésou
facultés d’un corps, fur-tout d’un corps vivant.
C ’eft dans ce fens que les Médecins difent que là
nature eft forte , foible ou ufée, ou que dans certain
nés maladies la nature abandonnée à elle-même en
opéré la guérifon.
Nature fe prend encore en un fens moins étendu *
pour lignifier l’a&ion de la providence , le principe
de toutes chofes, c’eft-à-dire cette puiffance ou être
fpirituel qui agit & opéré fur tous les corps pour leu#
donner certaines propriétés ou y produire certains
effets. Foye^ Providence.
La nature prife dans ce fens, qui eft celui que M.
Boyle adopte par préférence , n’eft autre chofe que
Dieu même , agiffant fuivant certaines lois qu’il a
établies. Foye[ Dieu.
Ce qui paroît s’accorder affez avec l’opinion où
étoient plufieurs anciens, que la nature étoitle dieu
de 1 univers, le tottuv qui prélidoit à tout 6c gouver-
noit tout, quoique d’autres regardaffent cet être prétendu
comme imaginaire, n’entendant autre chofe
par le mot de nature que les qualités ou vertus que
Dieu a données à fes créatures, & que les Poètes 6c
les Orateurs perfonnifient.
Le P. Mallebranche prétend que tout ce qu’on dit
dans les écoles lur la nature, eft capable de nous
conduire à l’idolâtrie , attendu que par ces mots
les anciens payens enteodoient quelque chofe qui
fans être Dieu agiffoit continuellement dans l’univers.
vers Ainfi l’idole nature devoir être félon eux lin
brinêipé aâuel qui étoit en concurrence avec Dieu j,
la epu'fe fécondé & immédiate de tous les etrangemens
qui arrivent.à là .matière. Ce. :qui paroît rentrer
dans le feptiment de ceux qui admettorent l anima
mandi , regardant la nature comme un fubftitut
de la divinité , «m« Caufe collatérale., une efpece
d’être moyen entre Dieu 8c les créatures.
Ariftote définit la nature ,prmàpium & caufa motus
& tins inqua ejl primo, peefe. & non per accident ;
définition fi ohfcure, que malgré toutes les. glofes de
fes commentateurs, aucun d’eux n’a pu parvenir à la
rendre intelligible.' . . . . m .
Ce principe ', que les Pénpatéticiens appelèrent
nature , agiffoit, félon eux, néccffairemènt, & étoit
par conféquent deftitué de connoiffance ou de liberté.
FATALITÉ. .
l e s Stoïciens çoncevoient auffi la nature comme
Un certain efprit ou verra répandue dans l’univers ,
qui donnoit à chaque chofefon mouvement ; de forte
que’ tout étoit forcé par l’ordre invariable d’une nature
aveugle & par une néceffité inévitable.
Quand qn parte de l’action de la nature , on n’entend
plus autre chofe que l’aSion des corps les uns
fur les autres, conforme aux lois du mouvement établies
par le Créateur.
* C ’eft en cela que conlifte tout le, fens de ce m o t ,
qui n’eft qu’une façon abrégée d’exprimer l’aftion
des corps, & qu’on exprimeroit peut-être mieux par
le mot âe mée/ianifme des corps.
• Il y en a , félon l’oblèrvation de M. Boyle , qui
n’entendent par le mot de nature que la loi que chaque
chofe a reçue du Créateur , 6c fuivant laquelle
elle agit dans toutes les occafions ; mais ce fens attaché
au mot nature , eft impropre & figuré.
Le même auteur propofe une définition du mot de
nature plus jufte & plus exafte , félon lui, que toutes
les autres , 6c en vertu de laquelle on peut entendre
facilement tous les axiomes & expreffions qui
ont rapport à ce mot. Pour cela il diftingue entre
nature particulière & nature generale.
Il définit la nature générale l’affemblage des corps
qui conftituent l’état prélent du monde, confidéré
comme un principe par la vertu duquel ils agiffent
& reçoivent Faction lelon les lois du mouvement établies
par l’auteur de toutes chofes.
La nature particulière d’un être fubordonneou individuel
, n’eft que la nature générale appliquée à
quelque portion diftinfte de l’univers : c’eft un affem-
blage des propriétés méchaniques (comme grandeur,
figure, ordre, fituation Si,mouvement local) convenables
& fuffifantes pour conftituer l’efpece & la
dénomination d’une chofe ou d’un corps particulier,
le concours de tous les êtres étant confidéré comme
le principe du mouvement, du repos , &c.
Nature , lois de la, font des axiomes ou réglés
générales de mouvement 6c de repos qu’obfervent
les corps naturels dans l’aPion qu’ils exercent les
uns fur les autres , & dans tous les changemens qui
arrivent à leur état naturel.
Quoique les lois de la nature foient proprement les
mêmes que celles du mouvement, on y a cependant
mis quelques différences. En effet, on trouve des auteurs
qui donnent le nom de lois du mouvement aux
lois particulières du mouvement, & qui appellent
lois de la nature les lois plus générales & plus étendues
, qui font comme les axiomes d’où les autres
font déduites.
D e ces dernieres lois M. Newton $n établit trois.
i° . Chaque corps perfevere de lui-même dans fon
état de repos ou de mouvement reâiligne uniforme,
à moins qu’il ne foit forcé de le changer par i’a&ion
de quelque caufe étrangère.
Ainfi les proje&iles perféverent dans leur mouve-
Torne X I .
ment jufqu’à ce qu’il foit éteint par là réfiftancc de
l’air & par la gravité ; de même une toupie dont les
parties font continuellement détournées de leur mour
vement re&iligne par leur adhérence mutuelle, ne
eeffe de tourner autour d ’elle-même qu’à caufe de la
réfiftance de l’air 8c du frottement du plan fur lequel
elle fe meut. De même encore les maffes énormes
des planètes & des cometes qui fe meuvent dans urt
milieu non refiftant, confervent long-tems leur mouvement
fans ’altération. Foye^ Force d’inertie ,
Résistance &. Milieu.
z°. Le changement qui arrive dans le mouvement
eft toujours proportionnel à la force qui le produit,
6c fe fait dans la direction fuivant laquelle cette force
aë it;
Si une certaine force produit un certain mouvement
, une force double produira un mouvement
dou ble , une force triple un mouvement triple,
foit que ce mouvement foit imprimé tout à-la-lois ,
ou fucceffivement 8c par degrés ; 6c comme la direct
tion de ce mouvement doit toujours être celle de la
force motrice , il s’enfuit que fi avant l’aélion de
cette force le Corps avoit un mouvement, il faut y
ajouter le nouveau mouvement s’il le fait du même
côté , ou l’en retrancher s’il le fait vers le côté op-
pofé , ou l’y ajouter obliquement s’il lui eft oblique,
8c chercher le mouvement compofé de ces deux
mouveniens, eu égard à ladireâion de chacun. Foye^
Composition du mouvement.
3P. La réaflion eft toujours contraire 8c égale à
l’aftion, c’eft-à-dire que les avions de deux corps
l’un fur l’autre font mutuellement égales & de directions
contraires.
Tout corps qui en preffe ou en tire un autre , en
eft réciproquement preffé ou tiré. Si je preffe une
pierre avec ifnon doigt , mon doigt eft. également
preffé par la pierre. Si un cheval tire un poids par le
moyen d’une corde, le cheval eft auffi tiré vers le
poids ; car la corde étant également tendue partout,
& faifant un effort égal des deux côtés pour fe relâ-?
cher, tire également le cheval vers la pierre, 6c la
pierre vers le cheval, & empêchera.l’un d’avancer,
autant qu’elle fait avancer l’autre*
De même fi un corps qui en choque un autre en
change le mouvement, il doit recevoir par le moyen
de l’autre corps un changement égal dans fon mouvement,
à caufe de l’égalité de preffion.
Dans toutes ces a&ions des corps les changemens
font égaux de part 6c d’autre, non pas dans la vîteffe,
mais dans le mouvement, tant que les corps font
fuppofés libres de tout empêchement. A l’égard des
changemens dans la vîteffe, ils doivent être en rai-
fon inverfe des maffes, lorfque les changemens dans
les mouvemens font égaux. Foyc^ Action 6* Réaction.
Cette même loi a auffi lieu dans les attrapions*
Foyt^ Attraction. Chambers. (O )
Nature de baleine, voye{ Blanc de baleine.
Nature , ( Mythol. ) chez les Poètes la nature eft
tantôt mere, tantôt fille, & tantôt compagne de
Jupiter. La nature étoit défignée par les fy mboles de
la Diane d’Ephefe.
Nature ,/<*,( Poéjte. ) La nature en Poéfie eft ,
i° . tout ce qui elt aPuellement exiftant dans l’univers
; 2°. c’eft tout ce qui a exifté avant nous, 6c
que nous pouvons connoître par Phiftoire des tems,
des lieux & des hommes ; 30. c’eft tout ce qui peut
exifter, mais qui peut-être n’a jamais exifté ni n’exif-
tera jamais. Nous comprenons dans l’Hiftoire la fable
& toutes les inventions poétiques, auxquelles on accorde
une exiftencede fuppofition qui vaut pour les
Arts autant que la réalité hiftorique. Ainfi il y a trois
mondes où le génie poétique peut aller choifir 6c
F.