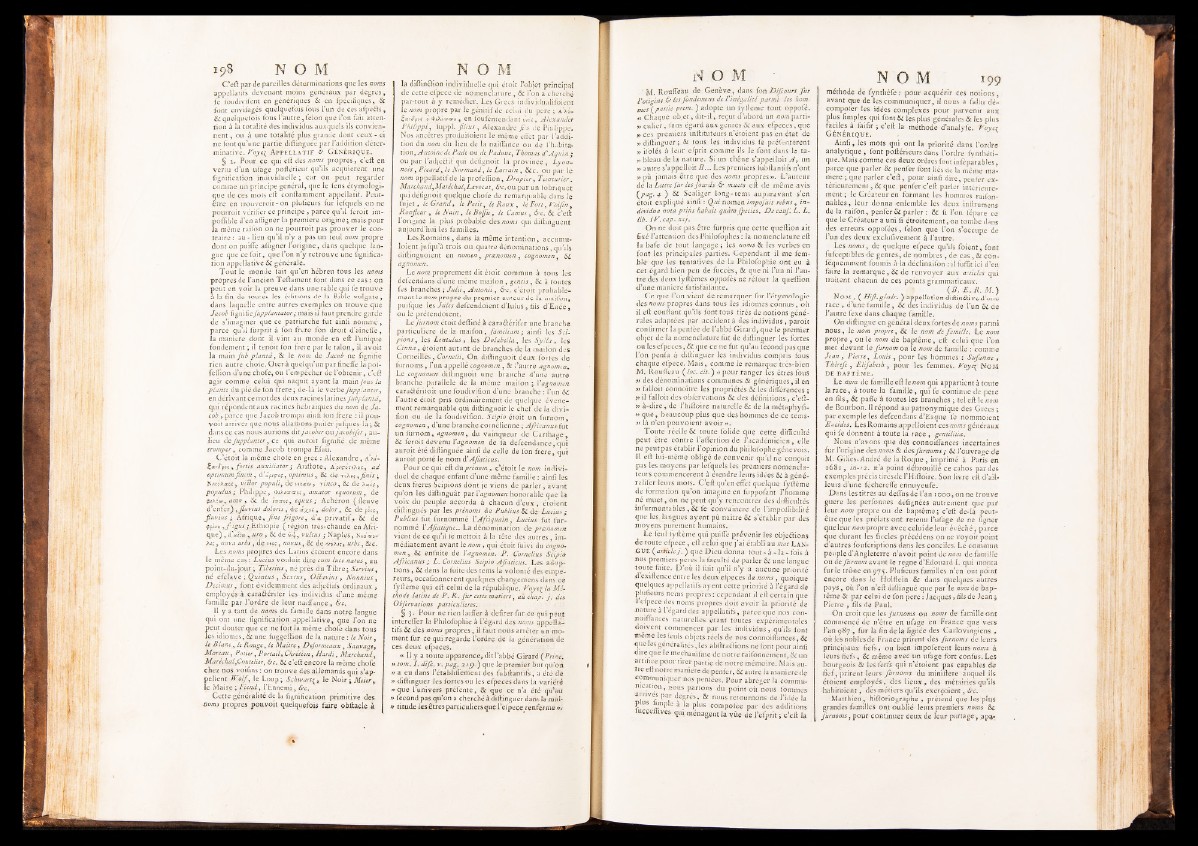
C ’eft par de pareilles déterminations que les noms
appellatifs devenant moins généraux par degrés,
le i'oudivifent en génériques & en fpécifiqués, &
l'ont envifagés quelquefois fous l’un de ces afpeûs,
& quelquefois fous l’autre, félon que l’on fait attention
à la totalité des individus auxquels ils conviennent
, ou à une totalité plus grande dont ceux - ci
ne font qu’une partie diftinguée par l’addition déterminative.
Voyt{ Ap pella t if & G énérique.
§ z. Pour ce qui eft des noms propres, c’eft en
vertu d’un ufage poftérieur qu’ils acquièrent une
lignification individuelle ; car on peut regarder
comme un principe général, que le fens étymologique
de çes mots eft conftamment appellatif Peut-
être en trouveroit-on plufieurs fur lefquels on ne
pourroit vérifier ce principe, parce qu’il feroit im-
pofîible d’en alfigner la première origine; mais pour
la même raifon on ne pourroit pas prouver le contraire
: au - lieu qu’il n’y a pas un léul nom propre
dont on puifle afligner l ’origine, dans quelque langue
que ce foit, que l’on n’y retrouve une lignification
appellative & générale.
Tout le monde fait qu’en hébreu tous les noms
propres de l’ancien Teftament font dans ce cas : on
peut en voir la preuve dans une table qui fe trouve
à la fin de toutes les éditions de la Bible vulgate,
dans laquelle entre autres exemples on trouve que
Jacob fignifiefupplantator; mais il tant prendre garde
de s’imaginer que ce patriarche fut ainli nommé,
parce qu’il furprit à fon frcre fon droit d’aînelîê,
la maniéré dont il vint au monde en eft l’unique
fondement ; il tenoit fon frere par le talon, il avoit
la main fub planta, & le nom de Jacob ne fignifie
rien autre choie. Oter à quelqu’un par fineffe la pof-
feflion d’une chofe, ou l’empêcher de l’obtenir, c’clt
agir comme celui qui naquit ayant la main Jous la
plante, du piéclefon frere; de-là le verbefupplanter,
en dérivant ce mot des deux racines latines Jïibplantâ,
qui répondent aux racines hébraïques du nom de Jacob
, parce que Jacob trompa ainli fon frere : il pou-
voit arriver que nous allaiiions puifer jufques-là; &
dans ce cas nous aurions dit jacober ou jacobijér, au-
lieu de Jupplantcr, ce qui auroit lignifié de même
tromper, comme Jacob trompa Efaii.
C ’étoit la même choie en grec : Alexandre, aa *'-
Za.vS'poi , fortïs auxiliator ; Ariftote, A piç-oTtAnç, ad
optimum jinem, d’apç-c?, optimus, & de TsAec, finis ;
FUxcAacf, viclor popuLi, de vhcuw , vïnco, 6c de Xcilç,
populus ; Philippe , •Jnx/^nroç, amator tquorum, de
ç/As'û), amo , 6c de îWoç, equus; Achéron (fleuve
d’enfer) ,fluvius doloris, de «%oç , dolor, 6c de pôof,
fluvius ; Afrique, fine frigore, d’a. privatif, 6c de
çplxa ,f ig u s ; Ethiopie (région très-chaude en Afrique)
, d'aiâ«,, uro, & de vultus ; Naples, Nsaoe-o-'
A/?, nova urbs , de vtoç, noyus, 6c de -»oA/ç, urbs, &c.
Les noms propres des Latins étoient encore dans
le même cas : Lucius vouloir dire cum luce natus au
point-du-jour ; Tiberius, né près -du T ibre; Servi us,
né efclave ; Quintus , S ex lus, Qcîavius , Nonnius,
Décimas, font évidemment des adjeâifs ordinaux ,
employés-à caraûériier les individus d’une même
famille par l ’ordre de leur naiffance, &c.
Il y a tant de noms de famille dans notre langue
qui ont une fignification appellative, que l’on ne
peut douter que ce ne foit la même chofe dans tous
les idiomes, & une fuggeftion de la nature : le Noir,
le Blanc U Rouge, le Maître , DeJ'ormeaux, Sauvage,
Moreau, Potier, Portail, Chrétien, Hardi, Marchand,
Maréchal,Coutelier, &c. & c ’eft encore la même chofe
chez nos.voifins : on trouve des allemands qui s’appellent^
Wolf, le Loup; Sçhwart^, le Noir; Meier,
le Maire ; Fiend, l’Ennemi, &c.
. Cette généralité de la fignification primitive des
noms propres pouvoit quelquefois faire obftacle à
la diftin&ion individuelle qui étoit l’objet principal
de cette elpece de nomenclature , 6c l’on a cherché
par-tout à y remédier. Les Grecs individualifoient
le nom propre par le génitif de celui du pere ; a a «'-
i'avJ'poi o ihAfwwa, en loufentendant vice, Alexander
Philippi, fuppl. films , Alexandre fils de Philippe.
Nos ancêtres produifeient le même effet par l’addition
du nom du lieu de la naiffance ou de l’habitation,
Antoine de Pade ou de Padoue, Thomas d'Aquin;
ou par l’adjeâif qui défignoit la province , Lyon-
nois, Picard, le Normand, Le Lorrain , &c. -ou par le
nom appellatif de la profeflion, Drapier, Teinturier.
Marchand,Maréchal,Lavocat, (S’c.ou par un lobriquet
qui défignoit quelque chofe de remarquable dans le
lu je t , le Grand, le Petit, le Roux , le F on, Voijîn ,
Ronfleur, le Nain, leBojfu, le Camus, &c. 6i c’eft
l’origine la plus probable des noms qui diftinguent
aujourd’hui les familles.
Les Romains, dans la même intention, accumu-
loient jufqu’à trois ou quatre dénominations, qu’ils
diftinguoient en nomen, preenomen , cognomen, 6c
Le nom proprement dit étoit commun à tous les
defeendans d’une même maifon , gentis, 6c à toutes
fes branches ; Julii, Antonii, &c. c’étoit probablement
\enom propre du premier auteur de la inaifon,
puifque les Jules defcendoient d’Iulus, fils d'Enée,
ou le prétendoient.
Le furnom étoit deftiné à cara&érifer une branche
particulière de la maifon, familiam ; ainfi les S ci-
pions , les Lentulus, les Dolabella, les Sylla, les
Cinna, étoient autant de branches de la maifon des
Corneillës, Cornelii. On diftinguoit deux fortes de
furnoms, l’un appellé cognomen , & l’autre agnomen.
Le cognomen diftinguoit une branche d’une autre
branche parallèle de la même maifon ; Vagnomen
carattériloit une foudivifion d’une branche : l’un 6c
. l’autre étoit pris ordinairement de quelque événement
remarquable qui diftinguoit le chef de la divi-
fion ou de la foudivifion. Scipio étoit un furnom,
cognomen, d’une branche cornélienne ; Africanus- fut
un furnom, agnomen, du vainqueur de Cartha»e,
6c feroit devenu Vagnomen de fa defcendance, qui
auroit été diftinguée ainfi de celle de fon frere, qui
auroit porté le nom d'Afiaticus.
Pour çequi eft dwprénom, c’étoit le nom individuel
de chaque enfant d’une même famille : ainfi les
deux freres Scipions dont je viens de parler, avant
qu’on les diftinguât par Vagnomen honorable que la
voix du peuple accorda à chacun d’eu x , étoient
diftingués par les prénoms de Publius ce de-Lucius ;
Publias fut furnommé VAfriquain, Lucius fut fur-
nommé YAfiaùque.. La dénomination de preenomen
vient de ce qu’il le mettoit à la tête des autres, immédiatement
avant le nom, qui étoit fuivi du cognomen,
& enfuite de Vagnomen. P. Cornélius Scipio
Africanus ; L. Cornélius Scipio Afiaticus. Les adoptions
, 6c dans la fuite des tems la volonté des empereurs,
occafionnerent quelques changemens dans ce
fyftème qui eft celui de la république. la Méthode
latine de P. R . fur cette matière, au chap. j . des
Obfervations particulières.
§ 3- Pour ne rien laifler à defirer fur-ce qui peut
intérelïer la Philofophie à l’égard des noms appella-
tifs & des noms propres, il faut nous arrêter un-moment
fur ce qui regarde l’ordre de la génératiori'de
ces deux efpeces.
« Il y a toute apparence, dit’l’abbé Girard (Prine.
» tom. I. dife. v. pag. a/rj.) que le premier but qu’oii
» a eu dans l’établiflement des fubftantifs, à été de
» diftinguer les fortes ou les efpeces dans la variété
»que l’univers préfente, & que ce n’a été qu’ au
» fécond pas qu’on a cherché à diftinguer dans la màl-
» titude les êtres particuliers que l’elpece renferme >u
• Roufleau de Genève, dans fon Difcours fur
Vorisine & les fondemens de l'inégalité parmi les hommes
{partie prem. ) adopte un lyfteme tout oppofé.
« Chaque objet, dit-il, reçut d’abord un nom parti-
» culier, (ans égard aux genres & aux efpeces, que
» ces premiers inftituteurs n’étoient pas en état de
»diftinguer; & tous les individus fe p/éfenterent
» ifolés à leur efprit .comme ils le font dans le ta-
» bleau de 1a nature. Si un chêne s’appelloir A , un
» autre s’appelloit B... Les premiers fubftantifs n’ont
» pu jamais être que des noms propres». L’auteur
dé la Lettre fur les fourds & muets eft de même avis
(pag. 4 ) 6c Scaliger long-tems auparavant s’en
étoit expliqué ainfi : Qui nomen impofuit rebus, individu
a nota prias habuit quàrn fpecies. De catif. L. L.
lib. IV. cap. xcj.
On ne doit pas être furpris que cette queftion ait
fixé l’attention desPhilofophes : la nomenclature eft
la bafe de tout langage ; les noms & les verbes en
font les principales parties. Cependant il me lem-
ble que les tentatives de la Philofophie ont eu à
cet égard bien peu de fuc.cès, & que ni l’un ni l’autre
des deux fyftèmes oppofés ne rélout la queftion
d’une maniéré fatisfailàn.te.
Ce que l’on vient de remarquer fur l’étymologie
des noms propres dans tous les idiomes connus, oii
il eft confiant qu’ils font tous tirés de notions générales
adaptées par accident à des individus, paroît
confirmer la penfée d.e l ’abbé Girard, que le premier
objet de la nomenclature fut de diftinguer les fortes
ou les efpeces, & que ce ne fut qu’au fèçond pas que
l’on penfa à diftinguer les individus compris fous
chaque efpece. Mais, comme le remarque trèsrbien
M. Rouffeau .(l.oç. cit. ) «pour ranger les êtres fous
» dès dénominations communes & génériques , il en
» falloit c-onnoître les propriétés & les différences ;
» il falloit des obfervations & des définitions, c’eft-
» à-dire, de l’biftoire naturelle & de la métaph.yfi-
» que, beaucoup plus que des hommes de ce tems-
» là n’en pouv.oient avoir ».
Toute réelle & toute folide que cette difficulté
peut être contre l’aflertiop de l’académicien, elle
ne peut pas établir l’opinion du philolophe genevois.
11 eft lui-même obligé de convenir qu’il ne conçoit
pas les moyens par lefquels les premiers nomencia-
teurs commencèrent à étendre leurs idées 6c à génér
ralifer leurs mots. C ’eft qu’en effet quelque fyftème
de formation qu’on imagine en fuppofant l’homme
né muet, on ne peut qu’.y rencontrer des difficultés
infurmontables , & fe convaincre de l’impoffibilité
que lesclangues ayent pii naître & s’érablir par des
moyens purement humains.
Le feul fyftème qui p.uiflè prévenir les objeôions
de toute efpece, eft celui que j’ai établi au mot L a n g
u e (article j . ) que Dieu donna tout- à - la - fois à
nos premiers peres la faculté de parler 6c une langue
toute faite. D ’où il fuit qu’il n’y a aucune priorité
d’exiftence éntre les deux efpeces de noms, quoique
quelques appellatifs ayent cette priorité à l’égard de
plufieurs noms propres : cependant il eft certain que
1 efpece des noms propres doit avoir la priorité de
•nature à 1 égard des appellatifs, parce que nos con-
noiflanees naturelles étant toutes expérimentales
doivent commencer par les individus, qu’ils font
meme les (euls objets réels de nos connoiff ances, &
que les généralités, les abftraâions ne font pour ainfi
dire que le mechanifme de notre raifonnement, 6c un
-artifice pour tirer partie de notre mémoire. Mais autre
eft notre maniéré de penfer, 6c autre la maniéré de
communiquer nos penlées. Pour abréger la communication,
nous partons du point où nous femmes
arrives par degrés, & nous retournons de l’idée la
p lu s îimple à la plus compolee par des additions
lucceiiives qui. ménagent la yûe de i’efprit ; c’eft la
méthode de fynthèfe : pour acquérir ces notions
avant que de les communiquer, il nous a fallu dé-
compolèr les idées complexes pour parvenir aux
plus fimples qui font & les plus générales & les plus
faciles à faifir ; c’eft la méthode d’analyfe. Voyet
G é n é r i q u e .
Ainfi, les mots qui ont la priorité dans l’ordre
analytique , font poftérieurs dans l’ordre fynthéti-
que. Mais comme ces deux ordres fontinféparables,
parce que parler & penfer font liés de la même maniéré
; que parler c’eft, pour ainfi dire, penlèr extérieurement
, 6c que. penfer c’eft parier intérieurement;
le Créateur en formant les hommes raifon-
nables, leur donna enfemble les deux inftrumens
de la raifen, penfer 6c parler : 6c fi l’on fépare ce
que le Créateur a uni fi étroitement, on tombe dans
des erreurs oppofées, félon que l’on s’occupe de
l’un des deux exclufivement à l’autre.
Les noms, de quelque efpece qu’ils foient,.font
fufeeptibies de genres, de nombres, de ca s, & con-
féqnemment fournis à la déclinaifon : il fuffit ici d’en
faire la remarque, 6c de renvoyer aux articles qui
traitent chacun de ces points grammaticaux.
1 ( B .E .R .M . )
Nom , ( Hifl.génér, ) appellation diftin&ive d’une
race, d’îine famille, 6c des individus de l’un & de
l’autre fexe dans chaque famille.
On diftingue en général deux fortes de noms parmi
nous, le nom propre, 6c le nom de famille. Le nont
propre, ou le nom de baptême, eft celui que l’on
met devant le furnom ou le nam-, de famille : comme
Jean , Pierre, Louis , pour les hommes : Sufanne ,
Thérefe , Elifabeth , pour les femmes. Voye^ Nom
DE BA PTÊME.
Le nom de famille eft le nom qui appartient à toute
la race, à toute la famille, qui fe continue de pere
en fils, 6c paff'e a toutes les branches ; tel eft le nom
de Bourbon. Il répond au patronymique des Grecs ;
par exemple les defeendans d’Eaque fe nommoient
Eacides. Les Romains .appelloient ces noms .généraux
qui fe donnent à toute la race , gentilitia.
Nous n’avons que des connoiffances incertaines
fur l’origine des noms & des furnoms; 6c l’ouvrage de
M. Gilles-André de la Roque, imprimé à Paris en
16 81 , in-12. n’a point débrouillé ce cahos par des
exemples précis tirésde rHiftoire. Son livre eft d’ailleurs
d’une fécherefle ennuyeufe.
Dans les titres au deffùs de l’an tooo, on ne trouve
guère les perfennes défignées autrement que par
leur nom propre ou de baptême ; c’eft de-Ià peut-
être que les prélats ont retenuTufage c!e ne figner
que leur nompropre avec celui de leur évêché, parce
que durant les fiecles précédens on ne voyoit point
d’autres fouferiptions dans les conciles. Le commun
peuple d’Angleterre n’avoit point de nom de famille
ou de furnom avant le régné d’Edouard I. qui monta
furie trône en 975. Plufieurs familles n’en ont pdinC
encore dans le Holftein & dans quelques autres
pa ys, où l’on n’eft diffingué que par le nom de baptême
& par celui de fon pere : Jacques, fils de Jean ;
Pierre , fils de Paul.
On croit que les Jurnoms ou noms de famille ont
commencé de n’être en ufage en France que vers
l’ an 987 , fur la fin delà lignée des Carlovingiens ,
où les nobles de France prirent des furnoms de leurs
principaux fiefs, ou bien impoferent leurs noms à
leurs fiefs, & même avec un ufage fort confus. Les
bourgeois & les fer fs qui n’étoient pas capables de
fief, prirent leurs furnoms du miniftere auquel ils
étoient employés, des lieu x, des métairies qu’ils
habiroient, des métiers qu’ils exerçoient, &ç.
Matthieu, hiftoriographe , prétend que les plus
grandes familles ont oublié leurs premiers noms 6c
furnoms, pour continuer ceux de leur partage , apa