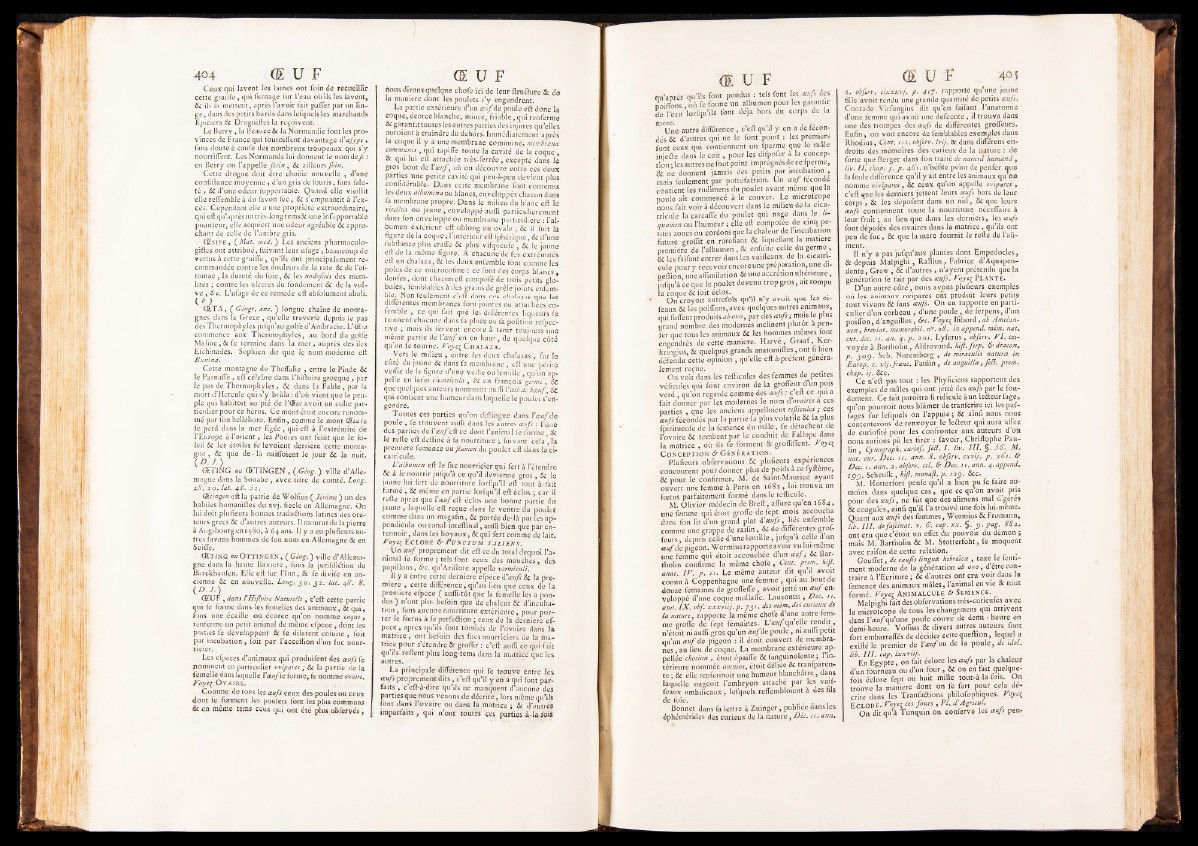
404 OEU F
Ceux qui lavent les laines ont foin de recueillir
cette graiffe, qui fumage lur l’eau oii ils les lavent,
8c ils la mettent, après l’avoir fait pafl’er par un ling
e , dans des petits barils dans lefquels les marchands
Epiciers 8c Droguiftes la reçoivent.
Le Berry, la Beauce & la Normandie font les provinces
de France qui fournilTent davantage d'oefype,
fans doute à caufe des nombreux troupeaux qui s’y
nourriffent. Les Normands lui donnent le nom défi :
en Berry on l’appelle fcrin, 8c ailleurs foin.
Cette drogue doit être choifie nouvelle , d’une
confiftance moyenne, d’un gris de fouris, fans fale-
té , 8c d’une odeur fupportabie. Quand elle vieillit
elle reffemble à du favon fec, 8c s’empuantit à l’excès.
Cependant elle a une propriété extraordinaire,
qui eft qu’après un très-long temsSc une infupporrable
puanteur, elle acquiert une odeur agréable & approchant
de celle de l’ambre gris.
CEsipe, ( Mat. med. ) Les anciens pharmacolo-
giftes ont attribué, fuivant leur ufage, beaucoup de
vertus à cette graiffe, qu’ils ont principalement recommandée
contre les douleurs de la rate 8c de l’ef-
tomac , la dureté du foie, 8c les nodojitcs des membres
; contre les ulcérés du fondement 8c de la vulv
e , &c. L’ufage de ce remede eft abfolument aboli.
( * > ■ )
(E T A , ( Geogr. anc. ) longue chaîne de montagnes
dans la Grèce , qu’elle traverfe depuis Je pas
des Thermophyles jufqu’au golfe d’Ambracie. L’(Eta
commence aux Thermophyles, au bord du golfe
Maliac, Sc fe termine dans la mer, auprès des îles
Efchinades. Sophien dit que le nom moderne eft
Bunina.
Cette montagne de Theffalie , entre le Pinde 8c
le Parnaffe , eft célébré dans l’hiftoire grecque , par
le pas de Thermophyles, 8c dans la Fable, par la
mort d’Hercule qui s’y brûla : d’oit vient que le peuple
qui habitoit au pié de 1 ’(Eta avoit un culte particulier
pour ce héros. Ce mont étoit encore renommé
par l'on hellébore. Enfin, comme le mont (Eta fe
fe perd dans la mer Égée, qui eft à l’extrémité de
l ’Europe à l’orient, les Poètes ont feint que le fo-
leil 8c les étoiles fe levoient derrière cette montagne
, 8c que de - là naifloient le jour 8c la nuit.
( D .J ..)
CETING ou GETINGEN * QGèog. ) ville d’Alle-
magne dans la Souabe , avec titre de comté. Long.
28. 2 0. lat. 48. 52.
OEiingen eft la patrie de "Wolfius ( Jérôme ) un des
habiles humaniftes du xvj. fiecle en Allemagne. On
lui doit plufieurs bonnes traduôions latines des orateurs
grecs 8c d’autres auteurs. Il mourut de la pierre
à Augsbourg en 1 580, à 64 ans. Il y a eu plufieurs autres
lavans hommes de fon nom en Allemagne & en
Suiffe.
CEting ou Ottingen , ( Géog. ) ville d’Allemagne
dans la haute Bavière, fous la jurifdiCtion de
Burçkhaufen. Elle eft fur l’Inn, 8c fe divife en ancienne
8c en nouvelle. Long. 3 o, j 2. lat. 48. 8.
OEUF , dans ÜHijloire Naturelle , c’eft cette partie
qui fe forme dans les femelles des animaux, 8c qui,
fous une écaille ou écorce qu’on nomme coque,
renferme un petit animal de même efpece , dont les
parties fe développent 8c fe dilatent enfuite , foit
par incubation , foit par l’acceffion d’un fuc nourricier.
Les efpeces d’animaux qui produifent des oeufs fe
nomment en particulier ovipares ; 8c la partie de la
femelle dans laquelle Yoeufie forme, fe nomme ovaire.
Voye{ Ovaire.
Comme de tous les oeufs ceux des poules ou ceux
^ont fe forment les poulets font les plus communs
& en meme teins ceux qui ont été plus obiervés, J
OEUF
b o u s d i r o n s q u e l q u e c h o f e i c i d e l e u r f t r t iC h i r e Sc d o
l a m a n i é r é d o n t l e s p o u l e t s s ’ y e n g e n d r e n t .
La partie extérieure d’un oeuf de poule eft donc la
coque, écorce blanche, mince, friable, qui renferme
8c garantit toutes les autres parties des injures qu’elleS
auroient à craindre du dehors. Immédiatement après
la coque il y a une membrane commune, membrana.
commuais , qui tapiffe toute la cavité de la coque ,
8c qui lui eft attachée très-ferrée, excepté dans le
gros bout de Y oeuf, où on découvre entre ces deux
parties une petite cavité qui peu-à-peu devient plus
confidérable. Dans cette membrane font contenus
les deux albumina ou blancs, enveloppés chacun dans
fa membrane propre. Dans le milieu du blanc eft le
vitellus ou jaune, enveloppé auffi particulièrement
dans fon enveloppe ou membrane paiticuliere .•l’albumen
extérieur eft ohlong ou ovale , 8c il fuit la
figure de la coque ; l’intérieur eft fphérique, 8c d’une
lubftance plus craffe 8c plus vifqueule , 8c le jaune
eft de la même figure. A chacune de fes extrémités
eft un chalaza, 8c les deux enfemble font comme les
pôles de ce microcofme : ce font des corps blancs ,
denfes, dont chacun eft compofé de trois petits globules,
femblables à des grains de grêle joints enfemble.
Non feulement c’eft dans ces chalazas que les
differentes membranes font jointes ou attachées enfemble
, ce qui fait que les différentes liqueurs fa
tiennent chacune dans fa place ou fa pofition refpec-
tive ; mais ils fervent encore à tenir toujours une
même partie de Y oeuf en en haut, de quelque côté
qu’on fe tourne. Foye{ Chalaza.
Vers le milieu , entre les deux chalazas , fur le
côté du jaune 8c dans fa membrane , eft une petite
veflîe de la figure d’une velfie ou lentille , qii’on appelle
en latin cicatriculà , 8c en françois germe, 8c
que quelques auteurs nomment aufti Yoeil-de boeuf, 8c
qui contient une humeur dans laquelle le poulet s’engendre.
Toutes ces parties qu’on diftingue dans Y oeuf de
poule , fe trouvent auffi dans les autres oeufs : l'une
des parties de Yoeuf eft ce dont l’animal fe forme , 8c
le refte eft deftiné à fa nourriture ; fuivartt cela , la
première femence ou flamen du poulet eft dans la ci-
cafric-ule.
Ualbumen eft le fuc nourricier qui fert à l’étendre
8c à le nourrir jufqu’à ce qu’il devienne gros , 8c le
jaune lui fert de nourriture Iorfqu’il eft tout à-fait
forme , 8c même en partie lorlqu’il eft éclos ; car il
refte après que Y oeuf eft éclos une bonne partie du
jaune , laquelle eft reçue dans le ventre du poulet
comme dans un magafin, 8c portéede-là parles ap-
pendicula ou canal inteftinal, aufti bien que par en-
tennoir, dans les boyaux, 8c qui fert comme de lait.
F o y e { Eclore & P u n c t u m S a l i e n s .
Un oeuf proprement dit eft ce du total dequoi l’animal
fe forme ; tels font ceux des mouches, des
papillons, &c. qu’Ariftote appelle vermicnli.
Il y a entre cette derniere efpece d'oeufs 8c la première
, cette différence, qu’au lieu que ceiix de la
première efpece ( auffi-tôt que la femelle lès a pondus
) n’ont plus befoin que de chaleur 8c d’incubation
, fans aucune nourriture extérieure , pour porter
le foetus à fa perfection ; ceux de la derniëré efpece
, après qu’ils font tombés de l’ovairè dans là
matrice , ont befoin des fucs nourriciers de la matrice
pour s’étendre & groflir : c’eft aufti cë qui fait
qu’ils reftent plus long-tems dans la matrice que les
autres.
La principale différence qui fe trouvé ëntre les
oeufs proprement dits, c’eft qu’il y en a qui font parfaits
, c’eft-à-dire qu’ils ne manquent d’aucune des
parties que nous venons de décrire, lors même qu’ils
font dans l ’ovaire ou dans lâ matrice ; & d’autres
imparfaits , qui n’ont toutés ces parties à-la-foü
OEU F
cm’après qnSb'font- pondus I tels font tes ctufs des
poiffons , où fe forme un albumen pour les garantir
de l’eau lorfqu’ils font déjà hors du corps de la
mere. H H . « 4-. j c
Une autre différence , c’eft qu il y en a de fécondés
8c d’autres qui ne le font point : les premiers
font ceux qui contiennent un fperme que le mâle
inje&e dans le c o ï t , pour les difpofer à ia.concepr
tion ; les autres ne font point imprégnés de ce fperme,
8c ne donnent jamais des petits par incubation ,
mais feulement par putréfaction. Un oeuf féconde
contient les rudimens du poulet avant meme que la
poule ait commencé à le couver. Le microfcope
nous fait voir à découvert dans le milieu de la cica-
tricule lacarcaffe du poulet qui nage dans le h-
quamen ou l’humeur ; elle eft compoiée de cinq pe- <
tites zones ou cordons que la chaleur de 1 incubation
future groflit en raréfiant 8c liquéfiant la matière
première de l’albumen , & enfuite celle du germe ,
8c les faifant entrer dans les vaiffeaux de la.cicatricule
pour y r e c e v o ir encore une préparation, une digeftion,
une aflïmilation & une accrétion ultérieure,
jufqu’à ce que le poulet devenu trop gros, ait rompu
la coque 8c foit éclos. ^ .
On croyoit autrefois qu’il n’y avoit que les 01-
feaux 8c les poiffons, avec quelques autres animaux,
qui fuffent produits ab ovo, par des oeufs; mais le plus
grand nombre des modernes inclinent plutôt à pen-
fer que tous les animaux 8c les hommes memes font
engendrés de cette maniéré. Harvé, G ra af, Ker-
kringius, & quelques grands anatomiftes, ont fi bien
défendu cette opinion , qu’elle eft à-prefent généralement
reçue.
On voit dans les tefticules des femmes de^ petites
véficules qui font environ de la groffeur d’un pois
verd , qu’on regarde comme des oeufs: c’eft ce quia
fait donner par les modernes le nom d'ovaires à ces
parties , que les anciens appelloient teflicules ; ces
oeufs fécondés par la partie la plus volatile 8c la plus
fpiritueufe de la femence du mâle, fe détachent de
l’ovaire 8c tombent par le conduit de Fallope dans
la matrice , où ils fe forment & groffiffent. Foye^
Conception £ G énération. ' v
Plufieurs obfervations Sc plufieurs expériences
concourent pour donner plus de poids à ce fyftème,
8c pour le confirmer. M. de Saint-Maurice ayant
ouvert une femme à Paris en 1682, lui trouva, un
foetus parfaitement formé dans le tefticule.
M. Olivier médecin de Breft, affure qu’en 1684,
une femme qui étoit groffe de fept mois accoucha
dans fon lit d’un grand plat d'oeufs, lies enfemble
comme une grappe de raifin, 8c de différentes grof-
feurs, depuis celle d’une lentille, jufqu’à celle d’un
oeuf de pigeon. Wormius rapporte avoir vu lui-même
une femme qui étoit accouchée d’un oeuf ; 8c Bartholin
confirme la même chofe, Cent. prtm. hiß.
anat. IF . p. //. Le même auteur dit qu’il avoit
connu à Coppenhague une femme , qui au bout de
douze femaines de groffeffe, avoit jette un oeuf enveloppé
d’une coque mollaffe. Lauzonus , Dec. 11.
ann. IX . obf. xxxviij. p. 731. 8es tnern, des curieux de
la nature, rapporte la même chofe d’une autre femme
groffe de fept femaines. L'oeuf qu’elle rendit,
n’étoit ni auffi gros qu’un oeuf de poule, ni auffi petit
qu’un oeuf de pigeon : il étoit couvert de membranes
, au lieu de coque. La membrane extérieure ap-
pellée chorion , étoit épaiffe 8c fanguinolente ; 1 intérieure
nommée arnnios, étoit deliee 8c tranfparen-
t e ; 8c elle renfermoit une humeur blanchâtre,, dans
laquelle nageoit l’embryon attache par les vaiffeaux
umbilicaux, lefquels reffembloient à des fils
de foie.
Bonnet dans fa lettre à Zuinger, publiée dans les
éphémérides des curieux de la nature, Déc. 11, ann.
OE U F 405
X. obf er v. clxxxvj. p. 41f . rapporte qu’une jeune
fille avoit rendu une grande quantité de petits oeufs»
Conrade Virfungius dit qu’en faifant l ’anatomie
d’une femme qui avoit une defeente , il trouva dans
une des trompes des oeufs de différentes groffeurs*
Enfin, on voit encore de femblables exemples dans
Rhodius, Cent. m . obferv. Lvij. 8c dans différens endroits
des mémoires des curieux de la nature : de
forte que Berger dans fon traité de naturâ hutnand ,
liv. II. chap. j . p. 4C1. n’héfite point de penfer que
la feule différence qu’il y ait entre les animaux qu’on
nomme vivipares, & ceux qu’on appelle ovipares ,
c’eft que les derniers jettent leurs oeufs hors de leur
corps, 8c les dépofent dans un nid, 8c que leürs
oeufs contiennent toute la nourriture néceffaire à
leur fruit ; au lieu que dans les derniers, les oeufs
font dépofés des ovaires dans la matrice, qu’ils ont
peu de fuc, 8c que la mere fournit le refte de l’aliment.
Il n’y a pas jufqu’aiix plantes dont Empedocles,'
8c depuis Malpighi, Rallius, Fabrice d’Aquapen-
dente, G rew , 8c d’autres , n’ayent prétendu que la
génération fe fait par des oeufs. Foyt{ Plante.
D ’un autre cô té , nous avons plufieurs exemples
où les animaux ovipares ont produit leurs petits
tout vivans 8c fans oeufs. On en rapporte en particulier
d’un corbeau, d’une poule, de ferpens, d’un
poiffon, d’anguilles, &c. Foye-{ Ifibord, ab Amelan-
xén, breviar. memorabil. n°. 28. in append. métn. nat„
cur. dec. //. an. 4. p, 201. Lyferus , obferv. FI. envoyée
à Bartholin, Aldrovand. hifi.ferp. & dracon.
p. g, OQ. Seb. Nuremberg , de miraculis naturoe in
Europ. c. xlj. franc. Paulin, de anguilla, fect. prem.
chap. i j . 8cc.
Ce n’eft pas tout : les Phyficiens rapportent des
exemples de mâles qui ont jette des oeufs par le fondement.
Ce fait paroîtra fi ridicule à un le&eurfage,
qu’on pourroit nous blâmer de tranferire ici les paf-
fages fur lefquels on l’appuie ; 8c ainfi nous nous
contenterons de renvoyer le lefteur qui aura affez
de curiofité pour les confronter aux auteurs d’où
nous aurions pu les tirer : favoir, Chriftophe Paulin
, Cynograph. curiof fecl. I. liv. I II. § . 6G. M.
nat. cur. Dec. //. ann. 8. obferv. cxvij. p. 2G1. &
Dec. 1. ann. 2. obferv. ccl. & Dec. it. ann. 4. append.
zcfÿ. Schculk, hiß. mönafl. p. 129. 8cc.
M. Hotterfort penfe qu’il a bien pu fe faire au-
moins dans quelque ca s , que ce qu’on avoit pris
pour des oeufs, ne fût que desalimens mal d;géres
8c coagulés, ainfi qu’il l’a trouvé une fois lui-même.
Quant aux oeufs des femmes, Wormius 8cFromann,
üb. I I I . de fafeinat. v. G. cap. x x . § . ß . pag. 882.
ont cru que c’étoit un effet du pouvoir du démon ;
mais M. Bartholin 8c M. Stotterfoht, fe moquent
avec raifon de cette relation.
Gouffet, de caufis linguoe hebrdicoe , taxe le fenti-
ment moderne de la génération ab ovo, d’être contraire
à l’Ecriture ; 8c d’autres ont cru voir dans la
femence des animaux mâles, l’animal en vie & tout
formé. Foyei Animalcule & Semence.
Malpighi fait des obfervations très-curieufes avec
le microfcope de tous les changemens qui arrivent
dans Y oeuf qu’une poule couve de demi • heure en
demi-heure. Voffius 8c divers autres auteurs font
fort embarraffés de décider cette queftion, lequel a
exifté le premier de Y oeuf ou de la poule, de idol.
lib. I I I . cap. Ixxviij.
En Egypte, on fait éclore les oeufs par la chaleur
d’un fourneau ou d’un fou r, 8c on en fait quelquefois
éclore fept ou huit mille tout-à-la-fois. On
trouve la maniéré dont on fe fert pour cela décrite
dans les Tranfaftions philofophiques. Foye^
Eclore. Foyei ces fours , Pl. d'Agricul,
On dit qu’à Tunquin on conferve les oeufs pçn