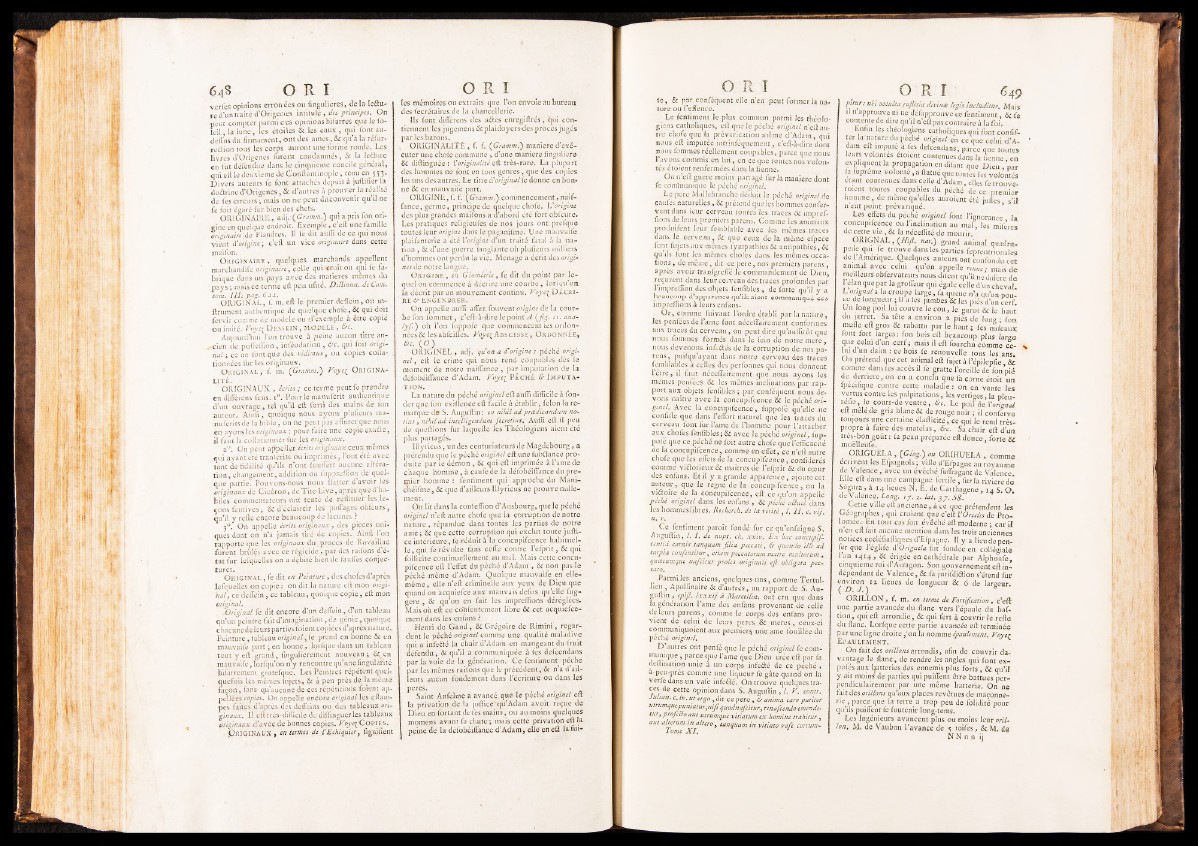
verfes opinions erron ées ou fingulieres, de la leôu-
re d’un traite d’Origer.ies intitulé , des principes. On
peut compter parmi ces opinions bicarrés que le fo-
Icil, la lune, les étoiles & les eaux , qui font au-
deffiis du firmament, ont des aines, & qu à la relur-
re&ion tous les corps auront une forme ronde. Les
livres d’Origenes fure-nt condamnés, & la leâure
en fut défendue dans le cinquième concile général,
qui eft le deuxieme de Conftantinople, tenu en 553.,
Divers auteurs fe font attachés depuis à juftifier la
doârine d’Origenes, & d’autres à prouver la réalité
de fes erreurs ; mais on rae peut dilconvenir qu’il ne
fe foit égaré fur bien des chefs. #
ORIGINAIRE, adj.(Gramm.) qui a pris fon origine
en quelque endroit. Exemple, c eft une famille
originaire îde Flandres. Il fe dit aufli de ce qui nous
vient à’origine ; c’eft un vice originaire dans cette
maifon.
Originaire, quelques marchands appellent
marchandife originaire, celle qui *ercût ou quife fabrique
dans un pays avec des matières mêmes du
pays ; mais ce terme eft peiu ufite. Diftionn. de Com.
coin. III; pag. (044.
ORIGINAL, f. m. eft le premier deflein, ou în-
ftrument authentique de quelque chofe, ÔÇ qui doit
fervir comme de modèle ou d exemple à etre copie
Ou imité. Foye^ DESSEIN , MaODELE, 6rc,
Aujourd’hui l'on trouve à peine aucun titre an-
..-cien de pofléflion, inféodation, &c. qui foit original
; ce ne font que des vidimus, ou copies colla- .
données fur les originaux.
Original, f. m. (Gramm.) Foye1 Originalité.
. >
ORIGINAUX , écrits; ce terme peutfe prendre
en différens fens. i° . Pour le manufçrit authentique
d’un ouvrage, tel qu’il eft forti des mains de ion
auteur. Ainfi, quoique nous ayons plufieurs ma-
nuferits de la b ible, on ne peut pas affurer que nous
en ayons les originaux : pour faire une copie exafte,
il faut la collationner fur les originaux. ^
20. On peut a t e l ie r écrits originaux ceux mêmes
qui ayant été tranferits ou imprimés, l’ont été avec
tant de fidélité qu’ils, n’ont fouffert ayicune altération,
changement,addition ou fuppreffion de quelque
partie. Pouvons-nous nous flatter d avoir les
originaux de Cicéron, d eTite-Live, après qued habiles
commentateurs ont tenté de reftituer les .leçons
fautives, & d’éclaircir les paffages obfcurs ,
qu’il y refte encore beaucoup de lacunes ?
30. On appelle écrits originaux, des pièces uniques
dont on n’a jamais tiré de copies. Ainfi l’on
rapporte que les originaux du., procès de Ravaillac
furent brûlés avec ce régicide, par des raifons d’e-
tat fur lefquelles on a dçbité bien de fauffes conjec-
tures.
ORIGINAL, fe dit en Peinture, des chofesd’après
lefeuelles on copie: on dit la nature eft mon original,
ce deffein, ce tableau, quoique copie, eft mon
original.
-■Original fe dit encore d’un deffein, d’un tableau
qu’un peintre fait d’imagination, de genie, quoique
chacune de leurs parties foient copiées d’après nature..
Peinture, tableau original, fe prend en bonne & en
mauvaife part ; en bonne, lorfque dans un tableau
tout y eft grand, fingulierement nouveau; & t en
mauvaife, lorfqu’on n’y rencontre qu’une fingularite
bifarrement grotefque. Les Peintres répètent quelquefois
les mêmes fujets, & à peu près de la même
façon, fans qu’aucune de ces répétitions foient ap-
pellées copies. On appelle encorqoriginal les eftam-
pes faites d’après des deffeins ou des tableaux originaux.
Il eft très-difficile de diftinguer les tableaux
originaux .d’avec de bonnes copies. Foyé{ COPIES.
ORIGINAUX . en termes de C Echiquier, lignifient
les mémoires ou extraits que l’on envoie au.bureau
desfecrétaires de la chancellerie.
Ils font différens des aftés enregiftrés, qui contiennent
les jugemens &plaidoyerS‘des procès jugés
par les barons.
, ORIGINALITÉ, f. f. (Gramm?) maniéré d’exécuter
une chofe commune , d’une maniéré finguliere
& diftinguée : l’originalité eft très-rare. La plupart
des hommes ne font en tous genres, que des copies
les uns des autres. Le titre à!original fe donne en bonne
& en mauvaife part.
ORIGINE,f. f. (Gramm.) commencement,naif-
fance, germe, principe de quelque chofe. U origine
des plus grandes maifons a d’abord été fort obfcure.
Les pratiques religieufes de nos jours ont prefque
toutès leur origine dans le paganifme. Une mauvaife .
plaifanterie a été Vorigine d’un traité fatal à la nation
, & d’ une guerre fanglante oîi plufieürs milliers
d’hommes ont perdu la vie. Ménagé a écrit des origines
de notre langue.
Origine , en Géométrie, fe dit du point par lequel
on commence à décrire une courbe, lorfqu’on
la décrit par un mouvement continu. Foye^ D écrire
& Engendrer.
On appelle aufli affez fouvent origine de la courbe
fon fommet, c’eft-à-dire le pointé (fig. / /. ana-
|yf. ) oii l’on fuppofe que commencent les ordonnées
& les abfciffes. FoyeiAbscisse, Ordonnée-, 9 ( o )
ORIGINEL , adj. qu’on a tTorigine : pèche originel
, eft le crime qui nous rend coupables dès le
moment de notre riaiffance , par imputation de la
défobéiffance d’Adam. Foye^ Péché & Imputation.
La nature du péché originel eft aufli difficile à fonder
que fon exiftence eff facile à établir, félon la remarque
de S. Auguftin: eo nihil ad pmdicandum no-
tius , nihil ad intelligendum fecretius. Aufli eft il peu
de queftions fur laquelle les Théologiens aient été
plus partagés.
Illyricus, un des centuriateurs de Magdebourg, a
prétendu que le péché originel eft une fubftance produite
par le démon , & qui eft imprimée à l’ame de
chaque homme, à caufe de la défobéiffance du premier
homme :. fentiment qui approche du Mani-
chéifme, Sc que d’ailleurs Illyricus ne prouve nullement.
On lit dans la conteffion d’Ausbourg, que le péché
originpl n’eft autre chofe que la corruption de notre
nature, répandue dans toutes les parties de notre
ame; & que cette corruption qui exclut toute jufti-
ceintérieure, fe.réduit à la concupifcence habituelle
, qui fe révolte fans ceffe contre l’efprit, & qui
follicite continuellèment au mal. Mais cette concupifcence
eft l’effet du péché d’Adam', & non pas le
péché même d’Adam. Quoique mauvaife en elle-
même , elle n’eft criminelle aux yeux 'de Dieu- que
quand on acquiefce aux mauvais defirs qu’elle fug-
gere , & qu’on en fuit les impreflxons déréglées.
Mais oii eft ce confentement libre & cet acquiefcement
dans les enfans .
Henri de Gand , & Grégoire de Rimini, regar-
. dent le péché originel comme une qualité maladive
qui a infeâé la chair d’Adam en mangeant du fruit
défendu, & qu’il a communiquée à fes defeendans
i par la voie de la génération. Ce fentiment pèche
par les mêmes raifons que le précédent, & n’a d’ailleurs
aucun fondement dans l’écriture ou dans les
peres.
Saint Anfelme a avancé que le péché originel eft
la privation de la juftice'qu’Adam avoit reçue de
Dieu en fortant de fes mains, ou au moins quelques
momens avant fa chute ; mais cette privation eft la
peine de la défobéiffance d’Adam, elle en eft la fuite
, & par conféquent elle n’en peut former la nature
ou l’effence.
Le fentiment le plus commun parmi les théologiens
catholiques, eft que le péché originel n’eft autre
chofe que la prévarication même d’Adam, qui
nous eft imputée intrinféquement, c’eft-â-dire dont
nous fommes réellement coupables, parce que rious
l’avons commis en lu i, en ce que toutes nos volontés
étoient renfermées dans la fienne.
On n eft guere moins partagé fur la maniéré dont
fe communique le péché originel.
Le pere Mailebranche déduit le péché originel de
caufes naturelles, & prétend que les hommes confer-
yent dans leur cerveau toutes les traces & împref-
fions de leurs premiers parens. Comme les animaux
produifent leur femblable avec les mêmes traces
dans le cerveau, & que ceux de la même efpece
font fujets aux mêmes fympathies & antipathies, &
qu ils font les mêmes chofes dans les mêmes occasions
, de même, dit ce pere, nos premiers parens,
après avoir tranfgreffé le commandement de Dieu,
reçurent dans leur cerveau des traces profondes par
l’impreffion des objets fenfibles , de forte qu’il y a
beaucoup d’apparence qu’ils aient communiqué ces
impreflions à leurs enfans.
O r , comme fuivant l ’ordre établi par la nature,
les penfées de l’ame font néceffairement conformes
aux traçes du cerveau, on peut dire qu’auflitôt que
nous fommes formés dans le fein de notre mere,
nous devenons infeétés de la corruption de nos pa-
rens, ,puifqu’ayant dans notre cerveau des traces
femblables à celles des perfonnes qui nous donnent
l.etre, il faut néceffairement que nous ayons les
memes penfées & les mêmes inclinations par rapport
aux objets fenfibles ; par. conféquent nous devons,
naître avec la concupifcence & le péché originel.
Avec la concupifcence, fuppofé qu’elle ne
confifte que dans l’effort naturel que les traces du
cerveau font fur l’ame de l’homme pour l ’attacher
aux chofes fenfibles ;& avec le péché originel, fup-
pole que ce peche ne foit autre chofe que l’efficacité
de la concupifcence, comme en effet, ce n’eft autre
chofe que les effets de la concupifcence, confiderés
comme viûorieux & maîtres de l ’efprit & du coeur
des enfans. Et il y a grande apparence, ajoute cet
auteur, que le régné de la concupifcence, ou la
victoire de la concupifcence, eft ce qu’on appelle
péché originel dans les enfans, & péché actuel dans
les hommes libres. Recherck. de La vérité, l. I I . c. vij.
n. v.
. Ce fentiment paroît fondé fur ce qu’enfeigne S.
Auguftin, l. 1. de nupt. ch. xxiv. E x hac concupif-
centid carnis tanquam filia peccati, & quando illi ad
turpia confentitur, etiam peccatorum matre multorum ,
quoecumque nafeitur proies originali ejl obligata pec-
car o.
Parmi les anciens, quelques-uns, comme Tertul-
lien , Apollinaire & d’autres, au rapport de S. Auguftin
, epijl. Ixxxij à Marcellin, ont cru que dans
la génération l’ame des enfans provenant de celle
de leurs parens, comme le corps des enfans provient
de celui de leurs peres & meres, ceux-ci
communiquoient aux premiers une ame fouillée du
péché originel.
D ’autres ont penfé que le péché originel fe communique
, parce que l’ame que Dieu crée eft par fa
deftination unie à un corps infeâé de ce péché ,
a-peu-près comme une liqueur fe gâte quand on la
verfe dans un vafe infeûé. On trouve quelques traces
de cette opinion dans S. Auguftin, l. V. contr.
Julian, c. iv. ut ergo , dit ce pere , & anima caro pariter
utrumquepuniatur^niji quodnafeitur, renafeendo emende-
tur, profecto aut utrumque vitiatum ex homine trahitur ,
aut alterum in altero, tanquam in yitiato vafe corrum-
Tonte X I .
pitur: iibt occulta juftitia divïnoe legis includaur. Mais
il n’approuve ni ne d'eftpprouve ce fentiment, & fe
contente de dire qu’il n’elt pas contraire à la foi.
Enfin les théologiens catholiques qui font confif.
ter la nature du péché origintl en ce que celui d ’A . '
dan, eft impute à les defeendans, parce que toutes
leurs volontés étoient contenues dans la fienne, en
expliquent la propagation en difant que Dieu , par
la lupreme volonté, a ftatué que toutes les volontés
étant contenues dans celle d’Adam, elles fe trouye-
roienr toutes coupables du péché de ce premier
homme, de même qu’elles auroient été iuftes s’il
n’eut point prévariqué.
Les effets du péché originel font l’ignorance la
concupifcence ou l’inclination au mal, les mifêres
de cette v ie . & la néceflité de mourir.
ORIGNAL n<u.) grand animal .quadrua
B B | 1 trouve dans les parties feptentrionales
de 1 Amérique. Quelques auteurs ont confondu cet
animal avep celui qu’on appelle r,nm; mais de
meilleurs obfervateurs nous difent qu’il ne différé de
l’élan que par la groffeur qui égale celle d’un cheval
L <P«£iW.a la croupe large, fa queue n’a qu’un pouce
de longueur ; il a les jambes & les piés d’un cerf.
Un long poil lui couvre le cou, le garot & le haut
du jarret. Sa tête a. environ a piés de long • fon
mufle eft gros & rabattu pa rle haut; fes nafeaux
font fort larges: fon bois eft beaucoup plus large
que celui d’un cerf; maisil.eft fourchu comme ce- ^
lui d’un daim : ce bois fe renouvelle tous les ans.
On prétend que cet animal eft fujet à l’épilepfie &
j comme dans fes accès il fe gratte l ’oreille de fon pié
p , 4®rr^ereî on en a conclu que fa corne étoit un
Ipécifique contre cette maladie : on en vante les
vertus contre les palpitations, les vertiges, la pleu-
réfie, le cours-deventre, &c. Le poil de V orignal
eft mêlé de gris blanc & de rouge noir ; il conferve
toujours une certaine élafticité, ce qui le rend très-
propre à faire des matelas, &G. Sa chair eft d’un
très-bon goût : la peau préparée eft douce, forte &c
moëlleufe.
^ ORIGUÉLA, (Géog.) ou ORIHUELA , comme
écrivent les Efpagnols; ville d’Efpagne au royaume
de Valence, avec un évêché fuffragant de Valence.
Elle eft dans une campagne fertile, fur la rivieredê
Ségura, à 14 lieues N. E. de Carthagene, 14 S. O .
de Valence. Long. iy. 2. lat. g j . J>8.
Cette ville eft ancienne, à ce c/ue prétendent les
Géographes , qui croient que c’eft VOrcehs de Pto-
lomée. En tour cas fon évêché eft moderne ; car il
n’en eft fait aucune mention dans les trois anciennes
notices eccléfiaftiques d’Efpagne. Il y a lieu de pen-
fer que l’églife cl'Origuela fut fondée en collégiale
l’an 14 14 , & érigée en cathédrale par Alphonfe,
cinquième roi d’Arragon. Son gouvernement eft indépendant
de Valence, & fa jurifdiélion s’étend fur
enviroei 12 lieues de longueur & 6 de largeur.
GRILLON, f. m. en terme de Fortification, c’eft
une partie avancée du flanc vers l’épaule du baf-
tion, qui eft arrondie, & qui fert à couvrir le refte
du flanc. Lorfque cette partie avancée eft terminée
par une ligne droite ,’ on la nomme épaulement. Foyer
Épaulement.
On fait des orillons arrondis, afin de couvrir davantage
le flanc, de rendre les angles qui font ex-
pofés aux hatteries des ennemis plus forts , & qu’il
y ait moins de parties qui puiffent être battues perpendiculairement
par une même batterie. On ne
fait des orillons qu’aux places revêtues de maçonnerie
, parce que la terre a trop peu de fblidité pour
qu’ils puiffent fe foutenir long-tems.
Les Ingénieurs avancent plus ou moins leur oril-
Ion, M. de Vauban l ’avance de 5 toifes, & M. de
N N n n ij