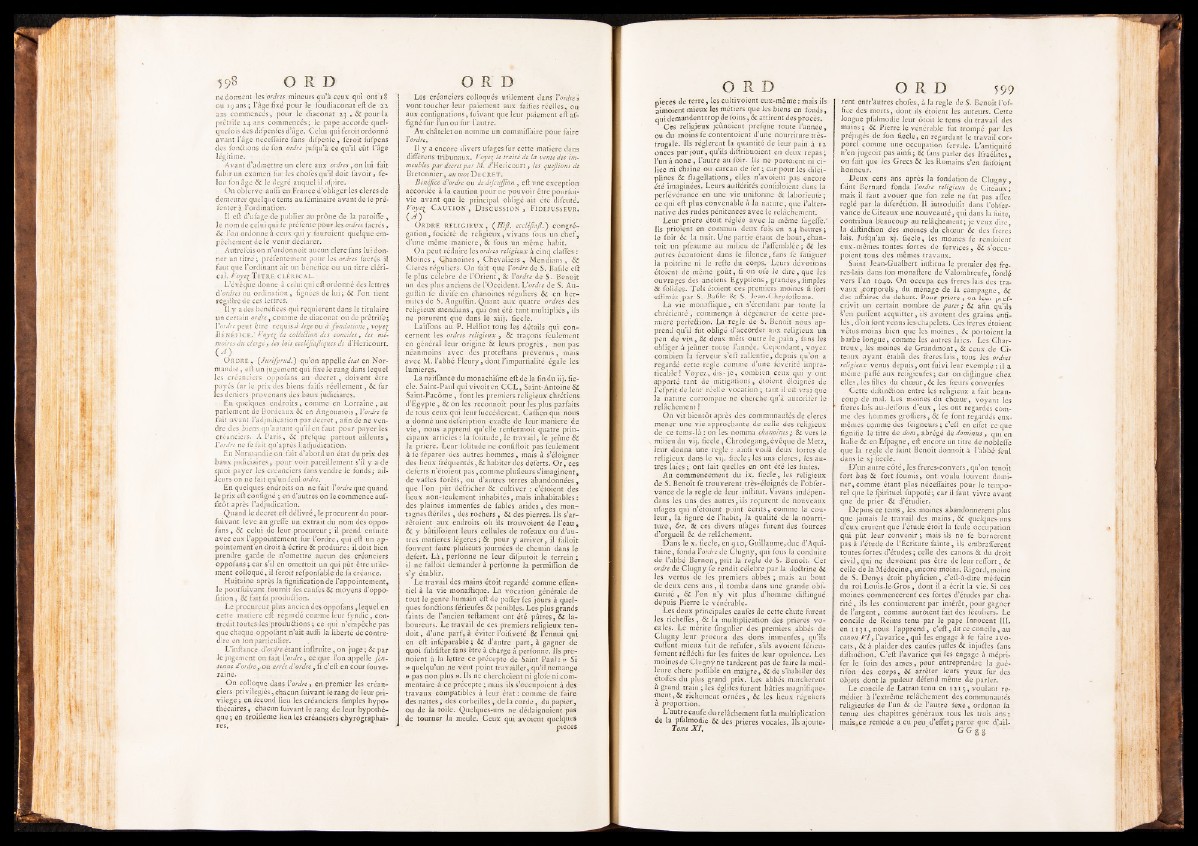
ne donnent les 'ordres mineurs qu’à ceux qui o n t 18
ou 19 ans ; l’âge fixé pour le foudiaconat eft de 22
ans commencés , pour le diaconat 23 , & pour la
prêtriié 24 ans commencés; le pape accorde quel-’
quefois des difpenfes d’âge. Celui qui feroit ordonné
avant l’âge néceflaire fans difpenle , feroit fufpens
des fondions de fon ordre jufqu’à ce qu’il eût l’âge
légitime; '
Avant d’admettre un clerc aux ordres, on lui fait
fubir un examen fur les chofesqu’il doit favoir, félon
fon âge & le degré auquel il afpire.
On oblerve aufli en France d’obliger les clercs de
demeurer quelque tems au féminaire avant de fe pré-
fenterà l’ordination.
Il eft d’ufage de publier au prône de la paroiffe ,
le nom de celui qui fe préfente pour les ordres facrés,
& l’on ordonne à ceux qui y fauroient quelque empêchement
de le venir déclarer.
, Autrefois on n’ordonnoit aucun clerc fans lui donner
un titre ; préfentement pour les ordres facrés il
faut que l’ordinant ait un bénéfice ou un titre clérical.
Voye^ T itre, c léric al.
L’év.êque donne à celui qui eft ordonné des lettres
d'ordres ou ordination, lignées de lui; & l’on tient
regiftre dé ces lettres.
Il y a des bénéfices qui requièrent dans le titulaire
un certain ordre, comme de diaconat ou de prêtrife;
Y ordre peut être requise lege ou à fondatione, voyeç
B É N É F IC E .' Voye^ ’La collection des conciles , les mémoires
du clergé, les lois eccléjîafiiques de d’Hericourt. on g I Ordre , \Jurifprud.) qu’on appelle état en Normandie
, eft un jugement qui fixe le rang dans lequel
les créanciers oppofans au decret, doivent être
payés fur le prix des biens faifis réellement, ôc fur
les deniers provenans des baux judiciares.
• En quelques eadroits, comme en Lorraine , au
parlement de Bordeaux & en Angoumois , Y ordre fe
fait -avant l’adjudicàtiori par decret, afin de ne vendre
des biens qu’autant qu’il en faut, pour payer les
créanciers. A Paris, & prefque partout ailleurs,
Y ordre ne fe fait qu’après l’adjudication.
En Normandie on fait d’abord un état du prix des
baux judiciaires, pour voir pareillement s’il y a de
quoi payer les créanciers fans vendre le fonds; ailleurs
on ne fait qu’un feul ordre.
En quelques endroits on ne fait Y ordre que quand
le prix eft configné ; en d’autres on le commence auf-
fitôt après l’adjudication.
Quand le decret eft délivré, le procureur du pour-
fuivant leve au greffe un extrait du nom des oppo^
fans, & celui de leur procureur ; il prend enfuite
avec eux l’appointement fur l’ordre, qui eft un appointements
droit à écrire & produire: il doit bien
prendre garde de n’omettre: aucun des créanciers
oppofans ; car s’il en omettoit un qui pût être utilement
colloqué, il feroit refponfable de fa créance.
Huitaine après la fignification de l’appointement,
.le pourfuivant fournit fes caufes & moyens d’oppo-
iition, & fait fa produ&ion. -
Le procureur plus ancien des oppofans, lequel en
cette matière eft regardé comme leur fyndic , contredit
toute.Stfos produétions; ce qui n’empêche pas
que chaque oppofant n’ait aufli la liberté de contredire
en fon particulier.
L’inftance-àéordre étant inftruite, on juge; & par
le jugement on fait- !'ordre, ce que,l’on appelle fen-
tenne d ordre y ou arrêt d'ordre, fi c’eft en cour fouve-
raine.
On colloque dans l’ordre, en premier les créanciers
privilégiés, chacun fuivant le rang de leur privilège;
en fécond lieu les créanciers Amples hypothécaires
, chacun fuivant le rang de leur hypothèque
; en troifieme lieu les créanciers chyrographai-
res.
Les créanciers colloqués utilement dans Yordre >
vont toucher leur paiement aux faifies réelles, ou
aux confignations, fuivant que leur paiement eft af-
figné fur l’un ou fur l’autre.
Au châtelet on nomme un commiflaire pour faire
Yordre.
II y a encore divers ufages fur cette matière dans
différens tribunaux. Voyelle traité de la vente des immeubles
par decret par M. Hericourt, les quejlions de
Bretonnier, au mot D ec r e t .
Bénéfice d'ordre ou de difcujfion, eft une exception
accordée à la caution pour ne pouvoir être pourfui-
vie avant que le principal obligé ait été difeuté.
Foyer CAUTION , DISCUSSION , FlDEJUSSEUR. on WÊÊKÊk Ordre rel igieu x , (Hifi. eccléfiafi.') congrégation,
fociété de religieux, vivans fous un chef,
d’une même maniéré, & fous un même habit.
On peut réduire les ordres religieux à cinq claffes :
Moines , Qhanoines , Chevaliers , Mendians , &
Clercs réguliers. On fait que Yordre de S. Bafile eft:
le plus célébré de l’Orient, & Yordre de S . Benoît
un des plus anciens de l’Occident. L'ordre de S. Au-
guflin fe divife en chanoines réguliers & en her-
mites de S. Auguftin. Quant aux quatre ordres des
religieux mendians, qui ont été tant multipliés, ils
ne parurent que dans le xiij. fiecle.
Laiflons au P. Helliot tous les détails qui concernent
les ordres religieux , & traçons feulement
en général leur origine & leurs progrès , non pas
néanmoins avec des proteftans prévenus, mais
avec M. l’abbé Fleury, dont l’impartialité égale les
lumières.
La naifl’ance du monachifme eft de la fin du iij. fiecle.
Saint-Paul qui vivoiten C C L , Saint-Antoine &
Saint-Pacôme, font les premiers religieux chrétiens
d’Egypte , & on les reconnoît pour les plus parfaits
de tous ceux qui leur fuccéderent. Caflien qui nous
a donné une defeription exafte de leur maniéré de
v ie , nous apprend qu’elle renfermoit quatre principaux
articles : la folitude, le travail, le jeûne &
la priere. Leur folitude ne confiftoit pas feulement
à fe féparer des autres hommes, mais à s’éloigner
des lieux fréquentés,& habiter des deferts. O r , ces
deferts n’étoient pas, comme plufieurs s’imaginent,
de vaftes forêts, ou d’autres terres abandonnées ,
que l’on pût défricher &c cultiver : c’étoient des
■ lieux non-feulement inhabités,,mais inhabitables:
des plaines immenfes de fables arides, des montagnes
ftériles , des rochers, & des pierres. Ils s’ar-
rêtoient aux endroits oii ils trouvoient de l’eau ,
& y bâtifloient leurs cellules de rofeaux ou d’autres
matières légères; & pour.y arriver, il falloit
fouvent faire plufieurs journées de chemin dans le
defert. L à , perfonne ne leur difputoit le terrein ;
il ne falloit demander à perfonne la permiflion de
s’y établir.
Le travail des mains étoit regardé comme effen-
tiel à la vie monaftique. La vocation générale de
tout le genre humain eft de palier fes jours à quelques
fondions férieufes & pénibles. Les plus grands
faints de l’ancien teftament ont été pâtres, & laboureurs.
Le travail de ces premiers religieux ten-
do it, d’une part', à éviter l’oifiveté & l’ennui qui
en eft inféparable; & d’autre part, à gagner de
quoi fubfifter fans être à charge à perfonne. Ils pre-
noient à la lettre ce précepte de Saint Paul: » Si
»quelqu’un ne veut point travailler, qu’ilnemange
» pas non plus ». Ils ne cherchoient ni glofe ni commentaire
à ce précepte ; mais ils s’occupoient à des
travaux compatibles à leur état : comme de faire
des nattes, des corbeilles, de la corde, du papier,
ou de la toile. Quelques-uns ne dédaignoient pas
de tourner la meule. Ceux qui avoient quelques
pièces
pièces de terré, les cultivoient eux-même: mais ils
aimoient mieux les métiers que les biens en fonds,
qui demandent trop de foins, & attirent des procès.
Ces religieux jeûnoient prefque toute l’année,
ou du moins fe contentoient d’une nourriture très-
frugale. Ils réglèrent la quantité de leur pain à 12
onces par jour, qu’ils diftribuoient en deux repas ;
l’un à none , l’autre au foir. Ils ne portoient ni ci-
lice ni chaîne ou carcan de fer ; car pour les d-ifei-
plines & flagellations, elles n’avoient pas encore
été imaginées. Leurs auftérités confiftoient dans la
perfévérance en une vie uniforme & laborieule ;
ce qui eft plus convenable à la nature, que l’alternative
des rudes pénitences avec le relâchement.
Leur priere étoit réglée avec la même fagefle.'
Ils prioient en commun deux fois en 24 heures ;
le foir &c la nuit. Une partie étant de bout, chan-
toit un pfeaume au milieu de l’aflemblée; & les
autres écoutoient dans le filence, fans fe fatiguer
la poitrine ni le refte du corps. Leurs dévotions
étoient de même goût, fi on ofe le dire, que les
ouvrages des anciens Egyptiens, grandes, Amples
& folides. Tels étoient ces premiers moines fi fort
eftimés par S. Bafile & S. Jean-Chryfoftome.
La vie monaftique, en s’étendant par toute la
chrétienté, commença à dégénérer de cette première
perfeâion. La réglé de S. Benoît nous apprend
qu’il fut obligé d’accorder aux religieux un
peu de v in , & deux mêts outre le^pain, fans les
obliger à jeûner toute l’année. Cependant, voyez
combien la ferveur s’eft rallentie, depuis qu’on a
regardé cette réglé comme d’une févérité impraticable
! Voyez, d is -je , combien ceux qui y ont
apporté tant de mitigations, étoient éloignés de
l ’efprit de leur réelle vocation ; tant il eft vrai que
la nature corrompue ne. cherche qu’à autorifer lé
relâchement !
On vit bientôt après des communautés de clercs
mener une vie approchante de celle des religieux
de ce tems-là.: on les nomma chanoines ; & vers le
milieu du vij. fiecle, Chrodegang, évêque de Metz,
leur donna une réglé : ainfi voilà deux fortes de
religieux dans le vij. fiecle; les uns clercs, les autres
laïcs ; ont fait quelles en ont été les fuites.
Au commencement du ix. fiecle, les religieux
de S. Benoît fe trouvèrent très-éloignés de l’obfer-
vance de la réglé de leur inftitut. Vivans indépen-
dans les uns des autres, ils reçurent de nouveaux
ufages qui n’étoient point écrits, comme la couleur,
la figure de l’habit, la qualité de la nourriture
, &c. & ces divers ufages furent des fources
d’orgueil Sc de relâchement.
Dans le x. fiecle, en 910, Guillaume, duc d’Aquitaine,
fonda Yordre de Clugny, qui fous la conduite
de l’abbé Bernon, prit la réglé de S. Benoît. Cet
ordre de Clugny fe rendit célébré par la doftrine &
les vertus de fes premiers abbés ; mais au bout
de deux cens ans, il tomba dans une grande obf-
curité , & l’on n’y vit plus d’homme diftingué
depuis Pierre le vénérable.
Les deux principales caufes de cette chute furent
les richeffes, & la multiplication des prières vocales.
Le mérite fingulier des premiers abbés de
Clugny leur procura des dons immenfes, qu’ils
euffent mieux fait de refufer, s’ils avoient férieu-
fement réfléchi fur les fuites de leur opulence. Les
moines de Clugny ne tardèrent pas de faire la meilleure
chere pofîible en maigre, 8c de s’habiller des
étoffes du plus grand prix. Les abbés marchèrent
à grand train ; les églifes furent bâties magnifiquement
, & richement ornées, 8c les lieux réguliers
à proportion.
L autre caufe du relâchement fut la multiplication
de la pfalmodie 8c des prières vocales. Ils ajoute-
Tome X I ,
rent entr’autres chofes, à la réglé de S. Benoît l ’office
des morts, dont ils étoient les auteurs. Cette
longue pfalmodie leur ôtoit le tems du travail des
mains ; 8c Pierre le vénérable fut trompé par les
préjuges de fon fiecle, en regardant le travail corporel
comme une occupation fervile. L’antiquité
n’en jugeoit pas ainfi; ôc fans parler des Ifraélires,
on fait que les Grecs 8c les Romains s’en faifoient
honneur.
Deux cens ans après la fondation de Clugny,
faint Bernard fonda Yordre religieux de Citeaux *
mais il faut avouer que fon zele ne fut pas affez
réglé par la diferétion. Il introduifit dans l’obfer-
vance de Citeaux une nouveauté, qui dans la fuite
contribua beaucoup au relâchement; je veux dire,
la diftinélion des moines du choeur & des freres
lais. Jufqu’au xj. fiecle, les moines fe rendoient
eux-mêmes toutes fortes de fervices, 8c s’occu-
poient tous des mêmes travaux.
Saint Jean-Gualbert inftitua le premier des freres
lais dans fon monaftere de Valombreufe, fondé
vers l’an 1040. On occupa ces freres-lais des travaux
.corporels, du ménage de la campagne, 8c
des affaires du dehors. Pour priere, on leur pref-
crivit un certain nombre de pater; 8c afin qu’ils
s’en puffent acquitter, ils avoient des grains enfilés
, d’où font venus les'chapelets. Ces freres étoient
vêtus moins bien que les moines , 8c portoient la
barbe longue, comme les autres laïcs. Les Chartreux
, les moines de Grandmo'nt, & ceux de Citeaux
ayant établi des freres-lais, tons les ordres
religieux venus depuis, ont fuivi leur exemple : il a
même paflé aux religieufes ; car on di^ingue chez
elles, les filles du choeur, 8c les foeurs converfes
Cette diftinâion entre les religieux a fait beaucoup
de mal. Les moines du choeur, voyant les
freres-lais au-deffons d’eux , les ont regardés comme
des hommes grofliers, & fe font regardés eux-
mêmes comme des feignéurs ; c’eft en effet ce que
fignifie le titre de domy abrégé de dominus, qui en
Italie & en Efpagne, eft encore un titre de nobleffe
que la réglé de faint Benoît donnoit à l’abbé feul
dans le xj fiecle.
D’un autre côté, les freres-convers, qu’on tenoit
fort bas & fort fournis, ont voulu fouvent dominer,
comme étant plus néceffaires pour le temporel
que le fpirituel fuppofé; car il faut vivre avant
que de prier & d’étudier.
Depuis ce tems, les moines abandonnèrent plus
que jamais le travail des mains, & quelques-uns
d’eux crurent que l’étude étoit la feulé occupation
qui put leur convenir ; mais ils ne fe bornèrent
pas à l’étude de l’Ecriture fainte, ils embrafferent
toutes fortes d’études ; celle des canons & du droit
c iv il, qui ne dévoient pas être de leur reffort, &
celle de la Médecine, encore moins. Rigord, moine
de S. Denys étoit phyficien, c’eft-à-dire médecin
du roi Louis-ie-Gros, dont il a écrit la vie. Si ces
moines commencerenf ces fortes d’études par charité,
ils les continuèrent par intérêt, pour gagner
de l’argent, comme auroient fait des féculiers. Le
concile de Reims tenu par le pape Innocent III.
en 1131 -, nous l’apprend, c’eft, dit ce concile, au
canon V I , l’avarice, qui les engage à fe faire avocats
, & à plaider des caufes juftes & injuftes fans
diftinétion. C ’eft l’avarice qui les engage à mépri-
fer le foin des âmes, pour entreprendre la gué-
rifon des corps, & arrêter leurs yeux fur des
objets dont la pudeur défend même de parler.
Le concile de Latran tenu en 12 15 , voulant remédier
à l’extrême relâchement des communautés
religieufes de l’un & de l’autre fexe, ordonna la
tenue des chapitres généraux tous les trois ans :
mais.ee remede a eu peu d’effet; parce que d’ail-
G G g g
l