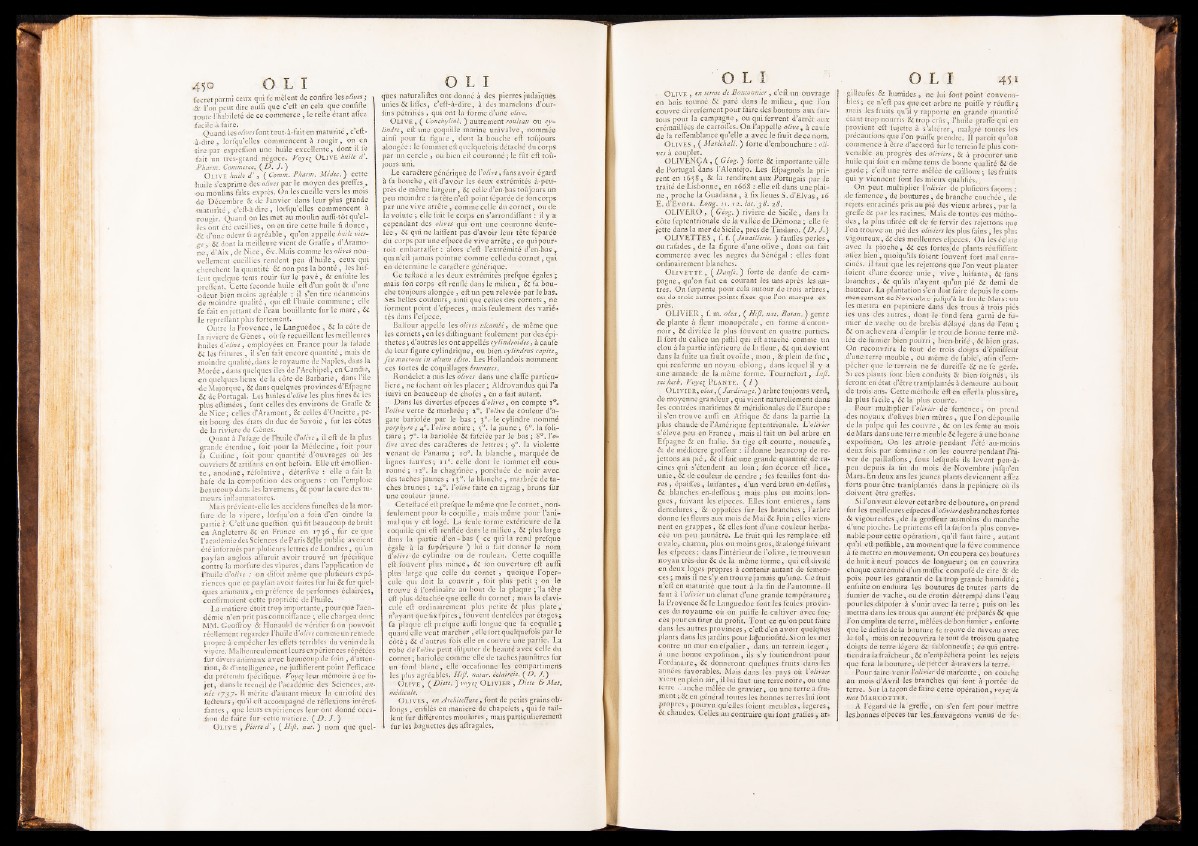
fecret parmi ceux qui fe mêlent de confire les o tiv e s ;
.& l’on peut dire aufii que c’eft en cela que confifte
toute l’habileté de ce commerce , le refte étant allez
/a ci le à faire. 5
Quand les ol'tvesfont tout-à-fait en maturité, c eft-
.à-dire , îorfqu’elles commencent à rougir, on en
tire par exprefiion une huile excellente, dont il le
fait un très-grand négoce. Voye^ Oliv e huile d\
JPharm. Commerce. (Z), ƒ. )
O live huile d' , ( Comm. Pharm. Médec.') cette
■ huile s’exprime des olives par le moyen des preffes ,
ou moulins faits exprès. On les cueille vers les mois
de Décembre & de Janvier dans leur plus grande
maturité, c’eft-àdire, lorfqu’elles commencent à
rougir. Quand on les met au moulin auffi-tôt qu’elles
ont été cueillies, on en tire cette huile fi douce,
& d’une odeur fi agréable, qu’on appelle huile vierge
, & dont la meilleure vient de Graffe, d’Aramo-
ne, d’Aix , de Nice, &c. Mais comme les olives nouvellement
cueillies rendent peu d’huile, ceux qui
cherchent la quantité & non pas la bonté , les laif-
fent quelque tems rouir fur le pa vé, & enfuite les
preffent. Cette fécondé huile eft d’un goût & d’une
odeur bien moins agréable : il s’en tire néanmoins
de moindre qualité, qui eft l’huile commune ; elle
fe fait en jettant de l’eau bouillante fur le marc, &
-le repreffant plus fortement.
Outre la Provence, le Languedoc , 8c la côte de
la riviere de Gènes , où fe recueillent les meilleures
huiles d’olive, employées en France pour la falade
6c les fritures, il s’en fait encore quantité, mais de
moindre qualité, dans le royaume de Naples, dans la
Morée , dans quelques îles de l’Archipel, en Candie,
«n quelques lieux de la côte de Barbarie, dans Pile
de Majorque, & dans quelques provinces d’Efpagne
6c de Portugal. Les huiles d’olive les plus fines 8c les
plus eftimées, font celles des environs de Graffe &
de Nice ; celles d’Aramont, 8c celles d’Oneitte, périt
bourg des états du duc de Savoie, fur les côtes
de la riviere de Gènes.
Quant à l’ufage de l’huile d’olive , il eft de la plus
grande étendue, foit pour la Médecine, foit pour
la Cuifine, foit pour quantité d’ouvrages oh les
ouvriers & artifans en ont befoin. Elle eft émolliente
, anodine, réfolutive , déterfive : elle a fait la
bafe de la compofition des onguens : on l’emploie
beaucoup dans les lavemens, 8c pour la cure des tumeurs
inflammatoires.
Mais prévient-elle les accidens funeftes delamor-
fure de la vipere, lorfqu’on a foin d’en oindre la
partie ? C ’eft une queftion qui fit beaucoup de bruit
en Angleterre 8c en France en 1736* fur ce que
l’académie desSciences de Paris &|le public avoient
été informés par plufieurs lettres de Londres , qu’un
payfan anglois afluroit avoir trouvé un fpécifique
contre la morfure des viperes, dans l’application de
l’huile d!olive : on difoit même que plufieurs expériences
que ce payfan avoir faites fur lui 8c fur quelques
animaux, en préfence de perfonnes éclairées,
confirmoient cette propriété de l’huile.
La matière étoit trop importante, pour que l’académie
n’en prit pas connoiffance ; elle chargea donc
MM. Geoffroy & Hunauld de vérifier fi on pouvoit
réellement regarder l’huile d’o/ive comme un remede
propre à empêcher les effets terribles du venin de la
vipere. Malheureufement leurs expériences répétées
fur divers animaux avec beaucoup de foin, d’attention,
& d’intelligence, ne juftifierent point l’efficace
du prétendu fpécifique. Poyt{ leur, mémoire à ce fu-
je t, dans le recueil de l’académie des Sciences, année
iJ3 7 ' 11 mérite d’autant mieux la curiofité des
leéfeurs, qu’il eft accompagné de réflexions intéref-
fantes , que leurs expériences leur ont donné occa-
.fion dé faire fur-cette matière. ( D . J. )
ÛLiyE , Pierre d ’ , ( Hifi. nat. ) nom que quelques
naturaliftes ont donné à des pierres judaïques
unies & liftés, c’eft-à-dire, à dés mamelons d’our-
fins pétrifiés , qui ont la forme d’une olive.
Ol iv e , ( Conchyliol. ) autrement rouleau ou cylindre
, eft une coquille marine uni v alve , nommée
ainfi pour fa figure , dent la bouche eft toûjours
alongée: le fommet eft quelquefois détaché du corps
par un ce rcle, ou bien eft couronné ; le fût eft -toujours
uni.
Le caraâere générique de Y olive, fans avoir égard
à fa bouche, eft d’avoir les deux extrémités à-peu-
près de même largeur, 8c celle d’en-bas toûjours un
peu moindre : fa tête n’eft point féparée de fon corps
par une vive arrête, comme celle du cornet, ou de
la volute ; elle fuit le corps en s’arrondiffant : il y a
cependant des olives qui ont une couronne dentelée
, 8c qui ne laiffent pas d’avoir leur tête féparéè
du corps par une efpece de vive arrête, ce qui pour-
roit embarraflêr : alors c’eft l’extrémité d’en-bas ,
qui n’eft jamais pointue Comme celle du cornet, qui
en détermine le caraélere générique.
Ce teftacé a les deux extrémités prefque égales’;
mais fon corps eft renflé dans le milieu, 8c fa bouche
toujours alongée, eft un peu relevée par le bas.
Ses belles couleurs, ainfi que celles des cornets, né
forment point d’efpeces, mais feulement des varié-»
tés dans l’efpeçe.
Balfour appelle les olives ulcombi, de même que
les cornets, en les diftinguant feulement par des épithètes
; d’autres les ont appellés cylindroïdes, à caufe
de leur figure cylindrique, ou bien cylindrus capite,
feu mucrone in altum édita. Les Hollandois nomment
ces fortes de coquillages brünettes.
Rondelet a mis les olives dans une claffe particulière
, ne fachant où les placer ; Aldrovandus qui l’a
fuivi en beaucoup de chofes , en a fait autant.
Dans les diverles efpeces d’olives, on compte i° .
Yolive verte 8c marbrée ; i ° . Y olive de couleur d’agate
bariolée par lè bas ; 3°.- le cylindre nommé
porphyre ; 40. Yolive noire ; 50. la jaune ; 6°. la foli-
taire ; 70. la bariolée & fafciée par le bas ; 8°. Yo-
live avec des caraéteres de lettres ; 90. la violette
venant de Panama ; io°. la blanche, marquéé dé
lignes fauves ; 1 1°. celle dont le fommet eft couronné
; 1 z°. la chagrinée, pon&uée de noir avec
des taches jaunes ; 13®. la blanche, marbrée de taches
brunes ; 140. Yolive faite en zigzag, bruns fur
une couleur jaune.
Ce teftacé eft prefque le même que le cornet, noti-
feulement pour la coquille, mais même pour l’animal
qui y eft logé. La feule forme extérieure de la
coquille qui eft renflée dans le milieu , & plus large
dans la partie d’en - bas ( ce qui la rend prefque
égale à la fupérieure ) lui a fait donner le nom
d’olive de cylindre ou de rouleau. Cette coquille
eft fouvent plus mince, 8c lôn ouverture eft auflï
plus large que celle du cornet , quoique l’opercule
qui doit la couvrir , foit plus petit ; on le
trouve à l’ordinaire au bout de la plaque ;'la tête
eft plus détachée que celle du cornet ; mais la clavicule
eft ordinairement plus peiite 8c plus plate ,'
n’ayant que fix fpires, fouvent dentelées par étages;
fa plaque eft prefque auffi longue que fa coquille;
quand elle veut marchér , elle lort quelquefois par le
côté ; 8c d’autres fois elle en couvre une partie. La
robe de l’olive peut difputer de beauté avec celle du
cornet ; bariolée comme elle de taches jaunâtres fur
un fond blanc, elle occafionne les compartiment
les plus agréables. Hiß. natur. éclaircie. (Z>. ƒ.)
O live , ( Diete. ) voye^ O livier , Dicte & Mat.
medicale.
Olives , en Architecture ont de petits grains ob-
lôngs , enfilés en maniéré de chapelets , qui fe taillent
fur différentes moulures, mais particulièrement
fur les baguettes des aftragales.
. Ö L IV E , en terme de Pontonnier, c’eft.un ouvrage
en bois tourné 8c paré dans le milieu, que l’on
couvre diverfement pour faire des boutons aux fur-
tous pour la campagne, ou qui fervent d’arrêt aux
crémaillées de carroffes. On l’appelle olive, à caufe
de la reffemblance qu’elle a avec le fruit de ce nom.
OliVes , ( Maréchall. ) forte d’embouchure : olives
à couplet.
OLIVENÇ A , ( Géog. ) forte & importante vil le
de Portugal dans l ’Alentéjo. Les Efpagnols la prirent
en 1658, & la rendirent aux Portugais par le
traité de Lisbonne, en 1668 : elle eft dans une plaine
, proche la Guadiana , à fix lieues S. d’Elvas, 16
E. d’Evora. Long. 11. 12. lat, 38. 28.
OLIVERO , ( Géog. ) riviere de Sicile, dans la
côte feptentrionale de la vallée de Démona ; elle fe
jette dans la mer de Sicile, près de Tindaro. (Z>. ƒ.)
OLIVETTES ', f. f. ( Jéuaillerie. ) fauffes perles,
ou rafades , de la figure d’une olive , dont on fait
commerce avec les negres du Sénégal : elles font
ordinairement blanches.
Olivette , ( Danfe. ) forte de danfe de campagne,
qu’on fait en courant les uns après les autres.
On ferpente pour cela autour de trois arbres,
ou de trois autres points fixes que l’on marque exprès.
OLIVIER, f. m. olea, ( Hiß. nat. Botan. ) genre
de plante à fleur monopétale, en forme d’entonnoir
, & divifée le plus fouvent en quatre parties.
Il fort du calice un piftil qui eft attaché comme un
clou à la partie inférieure de la fleur, &c qui devient
dans la fuite un fruit ovoïde, mou, & plein de fu c ,
qui renferme un noyau oblong, dans lequel il y a
une amande de la même forme. Tournefiort, Inft.
rei kerb. Voye[ P L A N T E . ( I )
Olivier, olea, ( Jardinage. ) arbre toujours verd,
de moyenne grandeur , qui vient naturellement dans
les contrées maritimes & méridionales de l’Europe :
il s’en trouve auffi en Afrique & dans la partie la
plus chaude de l’Amérique feptentrionale. L’olivier
s’élève peu en France, mais il fait un bel arbre en
Efpagne & en Italie. Sa tige eft courte, noueufe,
& de médiocre groffeur : il donne beaucoup de remettons
au pié, & il fait une grande quantité de racines
qui s’étendent au loin ; fon écorce eft lice ,
unie, & de couleur de cendre ; fes feuilles font dures
, épaiffes , luifantes, d’un verd brun en-deffus,
6c blanches en-deffous ; mais plus ou moins longues,
fuivant les efpeces. Elles font entières, fans
dentelures , & oppofées fur les branchés ; l’arbre
donne fes fleurs aux mois de.Mai & Juin ; elles viern
nent en grappes , & elles font d’une couleur herbacée
un peu jaunâtre. Le fruit qui les remplace eû
ovale, charnu, plus ou moins gros, & alongé fuivant
les efpeces : dans l’intérieur de l’o live, fe trouve un
noyau très-dur & de la même forme, qui eftdivifé
en deux loges propres à contenir autant de femen-
ces ; mais il ne s’y en trouve jamais qu’une. Ge fruit
n’eft en maturité que tout à la fin de l’automne.- Il
faut à Yolivier un climat d’une grande température ;
la Provence & le Languedoc font les feules provinces
du royaume où on puiffe le cultiver avec fuc-
cès pour en tirer du profit. Tout ce qu’on peut faire
dans les autres provinces, c’eft d’en avoir quelques
plants dans les jardins pour lajcuriofité. Sion les met
contre un mur en efpalier, dans un terrein leger,
à une bonne expofition, ils s’y foutiendront pour
l’ordinaire, &c donneront quelques' fruits dans les
années favorables. Mais dans les pays où Yolivier
Vient en plein air, il lui faut une terre noire, ouLune
terre ..anche mêlée de gravier, ou.une terre à froment
; & en général toutes les bonnes terres lui font
propres, pourvu qu’ellesfoient meubles, legeres j
& chaudes. Celles au contraire qui font graffés, ar»
gilleufés & humides, ne lui font point convenables
; ce n’eft pas que cet arbre ne puiffe y réuffir ;
mais les fruits qu’il y rapporte en grande quantité
étant trop nourris &trop crûs, l’huile graffe qui en
provient eft fujette à s ’altérer, malgré toutes les
précautions que l’on puiffe prendre. Il paroît qu’on
commence à etre d’accord fur le terrein le plus convenable
au progrès des oliviers, & à procurer une
huile qui foit en même tems de bonne qualité & de
garde; c’eft une terre mêlée de cailloux ; les fruits
qui y viennent font les mieux qualifiés.
On peut multiplier Yolivier de plufieurs façons :
.de femence, de boutures, de branche couchée , de
.rejets enracines pris au pié des vieux arbres, par la
greffe & par les racines. Mais de toutes Ces méthodes
, la plus ufitée eft de fe fèrvir des rejettons que
l’on trouve au pié des oliviers les plus fains, les plus
vigoureux, & des meilleures efpeces. On les éclate
avec la pioche, & ces fortes]de plants réuflîffent
affez bien, quoiqu’ils foient fouvent fort mal enracines.
Il faut que les rejettons que l’on veut planter
foient d’une écorce unie, v iv e , luifante, & fans
branches, & qu’ils n’ayent qu’un pié &c demi de
.hauteur. La plantation s’en doit faire depuis le commencement
cle Novembre jufqù’à la fin de Mars: on
les mettra en pepiniere dans dès trous à trois piés
les uns des autres, dont le fond fera garni de fumier
de vache ou de brebis délayé dans de l’eau ;
& on achèvera d’emplir le trou de bonne terre mêlée
deTùmier bien pourri, biembrifé, & bien gras.
On recouvrira le tout de trois doigts •d’épaiffèur
d’une terre meuble, où même de fable’,-afin d’em-
pecher que le'terrein ne fe !dürciffe & ne fe gerfe.
Si ces plants font bien conduits & bien-foignës, ils
feront eh état d’être tranfplantés à demeure au bout
de trois: ans. Cette méthode eft en effefla plussCire,
la plus facile , & la plus courte.
Pour '’multiplier Yolivier dé femence , on prend
•des noyaux d’olives bien mfmesy que l’on dépouille
de la pulpe qui les couvre , & on les femé àu mois
de Mars dans une terre meuble &£ legere à une bonne
expofition. On les airrofe pemdant l’été au-moins
deux fois par femaine .^on les couvre*pendant l’hiver
de .paillaflons, fous lefquels ils lèvent peu-à-
.peu depuis la fin du mois de Novembre jufqu’en
.Mars. En deux ans les jeunet; plants deviennent affez
forts pour être tranfplantés dans la pepiniere où ils
doivent’ être greffés.
Si l’on veut élever cet arbre de bouture, on prend
fur les meilleures efpeces d!'olivier des branches fortes
.& vigoureufes, de la groffeur au-moins du manche
d’une pioche. Le printems eft la faifon la plus convenable
pour cette opération, qu’il faut faire , autant
qu’il eû polfible, au moment que la fève Commence
à fie mettre en mouvement. On coupera ces boutures
de huit à neuf pouces de longueur; on en couvrira
.chaque:extrémité d’un mnftic Compofé de cire & de
poix pour les garantir de la trop grande humidité ;
enfuite on enduira les boutures de toutes parts de
fumier de vache, ou de crotin détrempé dans l’eau
pour les difpofer à s’unir avec la terre ; puis on les
mettra dans les trous qui auront'été préparés & que
l’on emplira de terre", mêlées dé’bon fumier, enforte
que le deffus de la bouture fe trouve de niveau avec
le lo i, mais on recouvrira lë tout de troisou quatre
doigts de terre légère ÔC fablonneufe ; ce qui entretiendra
la fraîcheur, 8c n’empêcnera point les rejets
que fera la‘bouture,- dé pe'rCer’ à-travers la terre.
Pour faire venir Yolivier de mafcotte, on couche
au mois d’Avril les branches qui font à portée de
terre. Sur la façon de faire cette opération y voyelle
mot Ma rco t t er.
A l’égard de la greffe, on s’en fert pour mettre
les bonnes efpeces lur lesJauvageons venus de fe