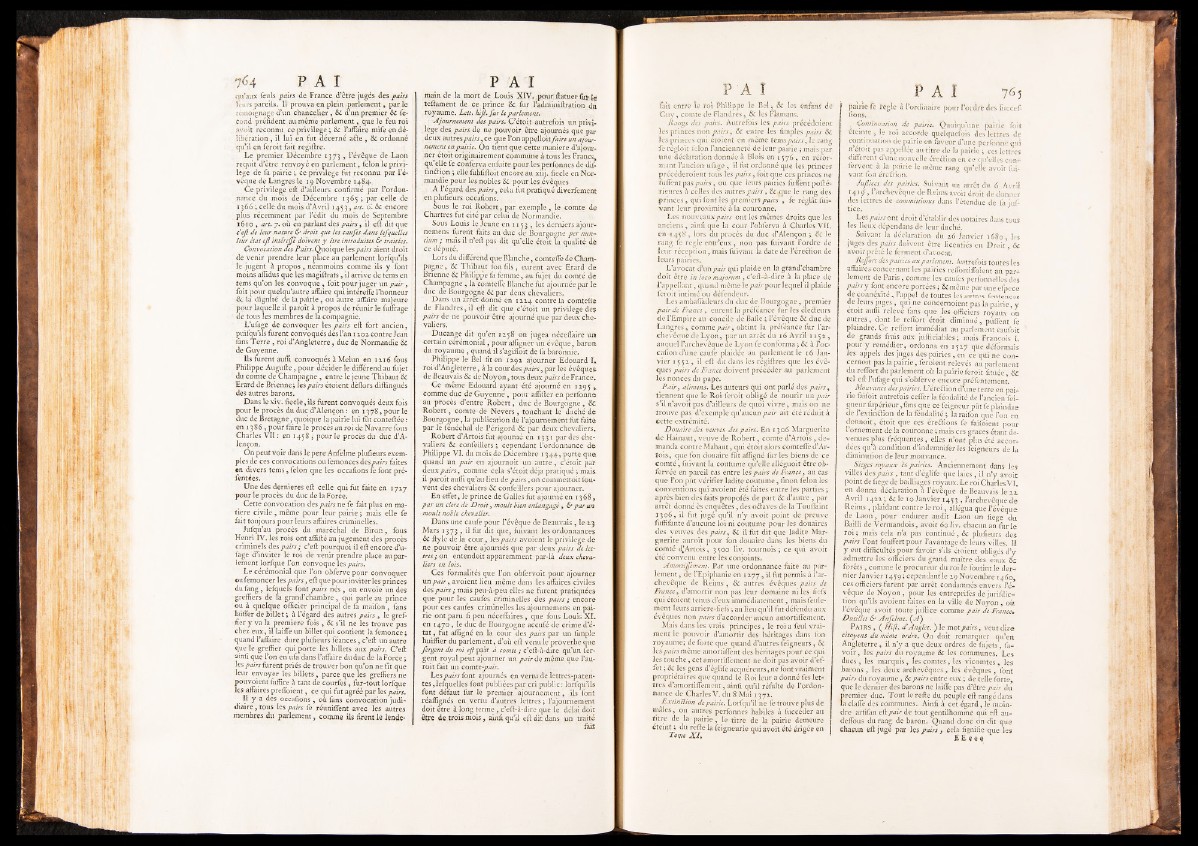
7<$4 P A I
qu’aux feuls pairs de France d’être jugés des pairs
leurs pareils. Il prouva en plein .parlement, par le
témoignage d’un chancelier , 6c d’un premier 6c fe-
cona prélident au même parlement, que le feu roi
. avoit reconnu ce privilège ; 6c l’affaire mife en délibération
, il lui en fut décerné afte , 6c ordonné
qu’il en feroit fait, regiftre.
Le premier Décembre 1373 , l’évêque de Laon
requit d’être renvoyé en parlement, félon le privilège
de fa pairie ; ce privilège fut reconnu par l’évêque
de Langres le 19 Novembre 1484.,
Ce privilège eft d’ailleurs confirmé par l’ordonnance
du mois de Décembre 1365 ; par celle de
1366 ; celle du mois d’Avril 145 3, art. 6 8c encore
plus récemment par l’édit du mois de Septembre
1610 , art. y. où en parlant des pairs , il eft dit que
cefl de leur nature & droit que les caufes dans lefquelles
leur état ejl intèreffé doivent y être introduites & traitées.
Convocation des Pairs. Quoique les pairs aient droit
de venir prendre leur place au parlement lorfqu’ils
le jugent à propos, neanmoins comme ils y font
moins afîidus que les magiftrats, il arrive de tems en
tems qu’on les convoque , foit pour juger un pair,
foit pour quelqu’autre affaire qui intéreffe l’honneur
8c la dignité de la pairie, ou autre affaire majeure
pour laquelle il paroît à propos de réunir le fuffrage
de tous les membres de la compagnie.
L’ufagè de convoquer les pairs eft fort ancien,
puifqu’ils furent convoqués dès l’an 1201 contre Jean
fans Terre , roi d’Angleterre, duc de Normandie 6c
de Guyenne.
Us furent aufli convoqués à Melun en 1216 fous
Philippe Augufte, pour décider le différend au fujet
du comte de Champagne , entre le jeune Thibaut 6c
Erard de Brienne; les pairs étoient dèflors diftingués
des autres barons.
Dans lexiv. fiecle,ils furent convoqués deux fois
pour le procès du duc d’Alençon : en 1378, pour le
duc de Bretagne, quoique la pairie lui fut conteftée :
en 13 86, pour faire le procès au roi de Nayarre fous
Charles V il : en 1458 ; pour le procès du duc d’Alençon.
On peut voir dans le pere Anfelme plufieurs exemples
de ces convocations ou femonces des pairs faites
en divers tems, félon que les occafionsle font pré-
fentées.
Une des dernieres eft celle qui fut faite en 1727
pour le procès du duc de la Force.
Cette convocation des pairs ne fe fait plus en matière
civile , même pour leur pairie ; mais elle fe
fait toujours pour leurs affaires criminelles.
Jufqu’au procès du maréchal de Biron, fous
Henri IV. les rois ont affilié au jugement des procès
criminels des pairs; c’eft pourquoi il eft encore d’u-
fage d’inviter le roi de venir prendre place au parlement
lorfque l’on convoque les pairs.
Le cérémonial que l’on obferve pour convoquer
©ufemoncer les pairs, eft que pour inviter les princes
du fang , lefquels font pairs nés, on envoie un des
greffiers de la grand’chambre , qui parle au prince
ou à quelque officier principal de fa maifon , fans
laiffer de billet ; à l’égard des autres pairs , le greffier
y va la première fois , & s’il ne les trouve pas
chez eux, il laiffe un billet qui contient la femonce ;
quand l’affaire dure plufieurs féances, c’eft un autre
que le greffier qui porte les billets aux pairs. C’eft
ainfi que l’on en ufa dans l’affaire du duc de la Force ;
les pairs furent priés de trouver bon qu’on ne fît que
leur envoyer les billets, parce que les greffiers ne
pouvoient fuffire à tant de courfes, fur-tout lorfque
les affaires preffoient, ce qui fut agréé par les pairs.
Il y a des occafions , où fans convocation judi-
diaire, tous les pairs fe réuniffent avec les autres
membres du parlement, comme ils firent le lende-
P A I
main de la mort de Louis XIV. pour ftatuer fuHe
teftament de ce prince 6c fur l’adminiftration dvi
; royaume. Leu. hiß. fur le parlement.
Ajournement des pairs. C’étoit autrefois un privilège
des pairs de ne pouvoir être ajournés que par
deux autres pairs, ce que l’on appelloit faire un ajournement
en pairie. On tient que cette maniéré d’ajourner
étoit originairement commune à tous les Francs,
qu’elle fe conferva enfuite pour les perfonnes de dif-
tinôion ; elle fubfiftoit encore au xiii. fiecle en Nor-
.mandie pour les nobles 6c pour les evêques
A l’egard. des pairs, c el a fut pratiqué d irerfement
en plufieurs occafions.
Sous le roi Robert,, par exemple, le comte de
Chartres fut cité par celui de Normandie.
Sous Louis le Jeune en 1 x 5 3 , les derniers ajour-
nemens furent faits au duc de Bourgogne per nun—
tiltm ; mais il n’eft pas dit qu’elle étoit, la qualité de
ce député.
Lors du différend que Blanche, comteffe de Champagne
, 6c Thibaut fon fils, eurent avec Erard de
Brienne 6c Philippé fa femme, au fujet du comté de
Champagne , la comteffe Blanche fut ajournée par le
duc dé Bourgogne 6c par deux chevaliers.
Dans un arrêt donné en 1224 contre la comteffe
de Flandres, il eft dit que c’étoit un privilège des
pairs de ne pouvoir être ajourné que par deux che-
• valiers.
Ducange dit qu’en 1258 on jugea néceflàire un
certain cérémonial, pour affigner un évêque, baron-
du royaume , quand il s’agiffoit de fa baronnie.
Philippe lé Bel fit en 1292 ajourner Edouard R
roi d’Angleterre, à la cour des pairs, parles évêques,
de Beauvais 6c de N oyon, tous deux pairs de France.
■ Ce même Edouard ayant été ajourné en 1295 ,
comme duc de G uyenne, pour affilier en perfonna
au procès d’entre Robert, duc de Bourgogne, 6c
Robert, comte de Nevers , touchant le duché de
Bourgogne, la publication de l’ajournement fut faite
par le fenéchal de Périgord 6c par deux chevaliers,
Robert d’Artois fut ajourné en 1331 par des chevaliers
6c confeillers ; cependant l’ordonnance de
Philippe VI. du mois de Décembre 13 44, porte que
quand un pair en ajournoit un autre, c’étoit par
deux pairs, comme cela s’étoit déjà pratiqué ; mais,
il paroît auffi qu’au lieu de pairs, on commettoit fou-
vent des chevaliers 6c confeillers pour ajourner.
En effet, le prince de Galles fut ajourné en 1368,
par un clerc de Droit, moult bien enlangagê , & par un
moult noble chevalier.
Dans une caufe pour l’évêque de Beauvais, le >25
Mars 1373 , il fut dit que, fuivant les ordonnances
. 6c ftyle de la cour., les pairs avoient le privilège de
ne.pouvoir être ajournés que par deux pairs de lettres;
On entendoit apparemment par-là deux chevaliers
en lois.
Ces formalités que l’on obfervoit pour ajourner
un pair, avoient lieu même dans les affaires civiles
des pairs ; mais peu-à-peu elles ne dirent pratiquées
que pour les caufes criminelles des pairs ; encore
pour ces caufes criminelles les ajournemens en pairie
ont paru fi peu néceffaires, que fous Louis XI.
en 1470, le duc de Bourgogne accufé de crime d’éta
t , dit affigné en la cour des pairs par un fimple
huiffier du parlement, d’où eft venu le proverbe que
fergent du roi efi pair à comte ; c’eft-à-dire qu’un fer-
gent royal peut ajourner un pair de même que l’au-
roit fait un comte-pair.
Les pairs font ajournés en vertu de lettres-pat entes
, lefquelles font publiées par cri public: lorfqu’ils
font défaut fur le premier ajournement, ils font
réaflignés en vertu d’autres lettres; l’ajournement
doit être à long terme , c’eft-à-dire que le délai doit
être de trois m ois, ainfi qu’il eft dit dans un traité
P A I
fait entré le foi Philippe le Bel j 6c les ènfans dé
G u y , comte de Flandres, 6c les Flàmansv,:\ %
Rangs des pairs. Autrefois les pairs précédôierit
les prinCes non pairs, 6c entre les fimples pairs ôc
les princes qui étoient en même tems pairs, le rang
fe régloit félon l’ancienneté de leur pairie ; mais par
une déclaration donnée à Blois en 1576 , en réformant
l’ancien ufage „ il dit ordonné que les princes
précéderoient tous les pairs, foit que ces princes ne
fùffent pas pairs, ou que leurs pairies fùffent pofté-
rieures à celles des autres pairs, 8c«que le rang des
princes , qui font les premiers pairs , fe réglât fui-
Vant leur proximité à la couronne-.
Les nouveaux pairs ont les mêmes droits que les
Anciens, ainfi que la cour l’obferva à Charles V il.
en 14s8 , lors du procès du duc d’Alençon ; 6c le
rang fe réglé entr’eu x, non pas fuivant l’ordre de
leur réception, mais fuivant la date de l’ére&ion de
leurs pairies.
L’avocat d’un pair qui plaide en la grand’chambre
doit être in loco majorant, c’eft-à-dire à la place de
l ’appellant, quand même le pair pour lequel il plaide
feroit intimé ou défendeur.
Les ambaffadeurs du duc de Bourgogne, premier
pair de France , eurent la préféance lùr les électeurs
de l’Empire au concile de Balle ; l’évêque 6c duc de
Langres, comme pair, obtint la préféance fur l’ar-
chevêqiiê de Lyon, par un arrêt du 16 Avril 1 15 2 ,
auquel l’archevêque de Lyon fe conforma ; 6c à l’oc-
cafion d’une caufe plaidee au parlement le 16 Janvier
1552 , il eft dit dans les régiftres que les évêques
pairs de France doivent précéder au parlement
les nonces du pape»
Pair, alimens. Les auteurs qui ont parlé des pairs,
tiennent que le Roi feroit obligé de nourir un pair
s’il n’avoit pas d’ailleurs de quoi v iv re , mais on ne
trouve- pas d’exemple qu’aucun pair ait été réduit à
Cette extrémité.
Douaite des veuves des pairs. Ën 1306 Marguerite
de Hainaut, veuve de Robert, comte d’Artois , demanda
contre Mahaut, qui étoit alors comteffe d’Artois,
que fon douaire fût affigné fur les biens de ce
comté, fuivant la coutume qu’elle alléguoit être ob-
fervée en pareil cas entre les pairs de France, au cas
que l’on pût vérifier ladite coutume, finon félon les
conventions qui-avoient été faites entre les parties ;
après bien des faits propofés de part 6c d’autre , par
arrêt donné ès enquêtes, des oétaves de la Touffaint
1 306, il fut jugé qu’il n’y avoit point de preuve
fuffifante d’aucüne loi ni coutume pour les douaires '
des veuves des pairs, 6c il fut dit que ladite Mar-*
guerite aiiroit poiir fon douaire dans les biens du
comté d’Artois, 3500 liv» tournois; ce qui avoit
été convenu entre les conjoints.
Amortifjèment. Par une ordonnance faite au par*
lement, de l’Epiphanie en i 27 7 , il fût permis à l’archevêque
de Reims, 6c autres évêques pairs de
France, d’amortir non pas leur domaine ni les fiefs
qui étoient tenus d’eux immédiatement, mais feulement
leurs arriere-fiefs ; au lieu qu’il fut défendu aux
évêques non pairs d’accorder aucun amortiffement.
Mais dans les vrais principes, le roi a feul vraiment
le pouvoir d’amortir des héritages dans fon
royaume; de forte que quand d’autres leigneurs, 6c
les pairs même amortiffent des héritages pour ce qui I
les touche, cet amortiffement rte doit pas avoir d’effet
; 6c les gens d’églife acquéreurs, ne font vraiment
propriétaires que quand le Roi leur a donné fes lettres
d’amortiffement, ainfi qu’il réfulte de l’ordonnance
de Charles V. du 8 Mai 1372.
Extinction de pairie. Lorfqu’il ne fe trouve plus de
mâles, ou autres perfonnes habiles à fucceder au
titre de la pairie, le titre de la pairie demeure
eteint.; du refte la feigneurie qui avoit été érigée en
Tome X I .
P A I 765
pairie ié régie à l’ordinaire pour l’ordre des fuccef-
fio n s i ,
•T f ont'inuatioh de pairie. Quoiqu’une pairie foit
"eteinte, Iè roi accorde quelquefois des lettres dé
continuation de pairie en faveur d’une perfonné qui
n’étoit pas appellée au titré de la pairie ; ces lettres
different d une nouvelle éreâion en ce qu’elles con-
fervent à^ la pairie le même rang qu’ellé avoit fuivant
fort éreôion.
Juflices des pairies. Suivant uh arrêt du g Avril
14 1$ , l’archevêque de Reims avoit droit de donner
des lettres de commïttimus dans l’étendue de fa juf-
tice. }
Les pain ont droit d’établir des notaires dans tous
les lieux dépendans de leur duché.
. Suivant la déclaration du 26 Janvier 1680, les
juges des pairs doivent être licentiés en D ro it, 8c
avoir prêté le ferment d’avocat.
Rejfort des pairies au parlement. Autrèfois toutes les
affaires concernant les pairies réflbrtiffoient aü parlement
de Paris, comme les caufes perfonnelles des
pairs y font encore portées ; 6c même par une èfpece
de connexité, l’appel de toutes les autres fentences
de leurs juges, qui ne côricernoiént pas la pairie, y
étoit auffi releve fans que les officiers royaux ou
autres, dont le reflbrt étoit diminué, piiffent fe
plaindre. Ce reffort immédiat au parlement eaufoit
de grands frais aux juftiéiables; mais François I.
pour y remédier, ordonna en 1527 qlie déformais
les appels des juges des pairies, en ce qui ne con-
cernoit pas la pairie, feroient relevés au parlement
du reflbrt du parlement où la pairie feroit fitiiée 8c
tel eft l’ufage qui s’obferve encore préfentement.
Mouvance des pairies. L’éreûion d’une terre en pai-‘
rie faifoit autrefois cefler la féodalité de l’ancien fei-
gneur fupérieur, fans que ce feigneur pût fe plaindre
de Pextin&ion de la féodalité ; la raifon que l’on en
donnoit, étoit que eçs ère étions fe faifoient pour
l’ornement de la couronne ; mais ces grâces étant devenues
plus fréquentes i elles n’ont plus été accordées
qu’à. Condition d’indemnifer les feigrteurs de la
diminution de leur moüvanee» :
Sieges royaux ès pairies. Anciennement dans les
Villes des pairs, tant d’églife que laïcs , il n’y avoit
point de fiege de bailliages royaux» Le roi Charles V I.
en donna déclaration à l’éveque de Beauvais le 22
Avril 1422 ; 6c le 10 Janvier 1453 , F archevêque dé
Reims , plaidant contre le r o i, allégua que l’évêque
de LaOn, pour endurer audit Laon un fiege du
Bailli de Vermandois, avoit 60 liv. chacun an fur le
roi ; mais cela n’a pas Continué, 6c plufieurs des
pairs l’ont fouffert pouf l’avantage de leurs villes. II
y eut difficultés pour favoir s’ils étoient obligés d’y
admettre les officiers du gfand maître des eaux 6c
forêts , comme le procureur du roi le foutint le dernier
Janvier 1459; cependant le 29 Novembre 1460*
ces officiers furent par arrêt condamnés envers l’évêque
de N oyon, polir les entfeprifes de jurifdic-
tion qu’ils avoient faites en la ville de Noyon , où
l’évêque avoit toute juftice comme pair de France»
Dutillet & Anfelme. (A j
Pairs , ( Hiß. d'Anglet. ) le mot pairs, veut dire
citoyens du thème ordre-. On doit remarquer qu’en
Angleterre, il n’y a que deiix ordres de fujets, fav
o ir , les pairs du royaume 8c les communes. Les
ducs , les marquis, les comtes, les vicomtes, les
barons , les deux archevêques , les évêques , font
pairs du royaume >, 6c pairs entre eiix ; de telle forte,
que le dernier des barons ne laiffe pas d’être pair du
premier duc. Tout le refte du peuple èft rangé dans
la claffe des communes. Ainfi à cet égard, le moindre
artifan eft pair de tout gentilhomme qui eft au-
deflbus du fang de baron. Quand donc On dit que
chacun eft juge par les pairs 3 cela fignifie que les