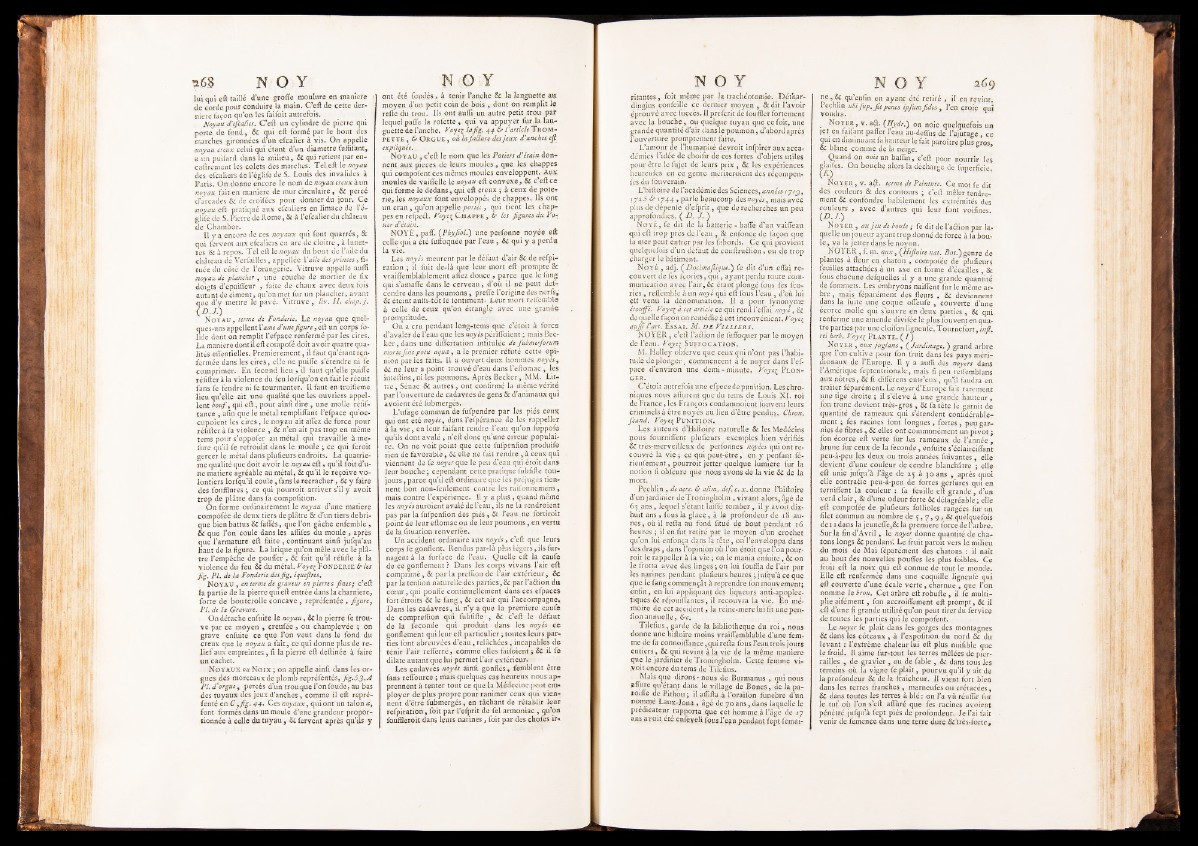
lui qui eft taillé d’une groffe moulure en maniéré »
de corde pour conduire la main. C ’elt de cette dernière
façon qu’on les faifoit autrefois.
Noyau d'efcafter. C’eft un cylindre de pierre qui
-porte de fond, & qui eft formé par le bout des
marches girpnnées d’un efcalier à vis. On appelle
noyau creux celui qui étant d’un diamètre fuffifant,
# un puifard dans le milieu, & qui rerient par encadrement
les colets des marches. Tel.eft le noyau
des. efcaliers de l’églife de S.. Louis des invalides à
Paris. On donne encore le nom de noyau creuxra un
noyau fait en maniéré de mur circulaire, & perce
d’arcades & de croifées pour donner du jour. Ce
noyau eft pratiqué aux elcaliers en limace de l e-
glife, de S. Pierre de Rome, & à l’efcalier du château
de Chambor.
ïl y% encore de ces noyaux qui font quarrés, &
qui fervent aux efcaliers en are de cloître , à lunettes
& à repos. Tel eft le noyau du bout de: l’aile du
château de Verfailles, appellée Yaîle des princes, fi-
tuée du côté de l’orangerie. Vitruve appelle aufli
noyau de plancher , une couche de mortier de fix
doigts d’épaiffeur ,« faite de chaux avec deux fois
autant de ciment, qu’on met fur un plancher, avant
que d’y mettre le pavé. V itru ve, liv. IL chap.j. gin N o y a u , terme de Fonderie. Le noyau que quelques
uns appellent Marne cT une figure , eft un corps fo-
liçle dont on remplit l’efpace renfermé par les cires.
La maniéré dontil eft compofé doit avoir quatre qualités
effentielles. Premièrement, il faut qu’étant renfermée
dans les cires, elle ne puiffe s’étendre ni fe
comprimer. En fécond lieu , il faut qu’elle puiffe
yéiifter à la violence du feu lorfqu’on en fait le récuit
fans fe fendre ni fe tourmenter. Il faut en troifieme
lieu qu’elle ait une qualité que les ouvriers appellent
bouf, qui eft, pour ainli dire , une molle rçfif-
tance , afin que le métal rempliffant l’efpace qu’oc-
cupoient les cires, le noyau ait affez de force pour
réfifter à fa violence , &c n’en ait pas trop en même
tems pour s’oppofer au métal qui travaille à me*
liire qu’il fe refroidit dans le moule ; ce qui feroit
gercer le métal dans plufieurs endroits. La quatrième
qualité que doit avoir le noyau eft, qu’il loit d’une
matière agréable au métal, & qu’il le reçoive vo lontiers
lorfqu’il coule, fans le recracher, & y faire
des fpufflures ; ce qui pourroit arriver s’il y avoit
trop de plâtre dans fa compofition.
On forme ordinairement le noyau d’une matière
compofée de deux tiers de plâtre & d’un tiers de brique
bien battus & faffés, que l’on gâche enfemble,
& que l’on coule dans les allifes du moule , après
que l’armature eft faite , continuant ainfi jufqu’au
haut de la figure. La brique qu’on mêle avec le plâtre
l’empêche de pouffer, & fait qu’il réfifte à la
violence du feu ôc du métal. Voye^ F o n d e r i e & les
fig. PI. de la Fonderie des fig. èquejlres.
N o.YAU , en terme de graveur en pierres fines; c’eft
la partie de la pierre qui eft entrée dans la charnière,
forte de houterolle concave, repréfentée, figure,
PI. de la Gravure.
On détache enfuite le noyau, & la pierre fe trouve
par ce moyen , creufée, ou champlevée ; on
grave enfuite ce que l’on veut dans le fond du
creux que le noyau a fait, ce qui donne plus de relief
aux empreintes, fi la pierre eft deftinée à faire
un cachet.
N o y a u x ou N o i x ; on appelle ainfi dans les orgues
des morceaux de plomb repréfentés, fig.5 3 .4
PI. d'orgue., percés d’un trou que l’onfoude, au bas
des tuyaux des jeux d’anches , comme il eft représenté
en G,fig. 44. Ces noyaux, qui ont un talon a,
font formés dans un moule d’une grandeur propor-;
-donnée à celle du tuyau, & fervent après qu’ils y
ont été fondés, à tenir l’anche & la languette aù
moyen d’un petit coin de bois , dont on remplit le
relie du trou. Ils ont aufli un autre petit tro.u paf
lequel paffe la rofette , qui va appuyer fur,la languette
de l’anche. Yoyeç lu fig. 44 & l'artiçle T romp
e t t e , 6* O R Q U E , OÙ la facture desjeux d’ançkes ejf
expliquée. .
N o y a u * ç’eft le nom que les Potiers d'étain donr
tient aux pièces, de leurs moples , que les çhappes
qui compofent ces mêmes moules enveloppent. Aux
moules de vaiffelle le noyau eft convexe, & c’eft ce
qui forme le dedans, qui eft creux ; à ceux de pote?
rie, les noyaux fout enveloppés de chappes. Ils ont
un cran , qu’pn appelle portée , qui tient les çhappes
en refpeû. Yoye^ Ç h a p p e , & les figures du Fa-
tier d'étain.
N O Y É , paff. ( Phyfiof) une perfonne noyée eft
celle qui a été fuuoquée par l’eau , & qui y a perdu
la vie.
Les noyés meurent par le défaut d’air & de refpi-
ration ; il fuit de-là que leur mort eft prompte &
vraiffemblablement affez douce , parce que le fang
qui s’amafl'e dans le cerveau, d’pù il ne peut del-r
cendre dans les poumons » preffe l’origine des nerfs,’
Si éteint auffi-tôt le fentiment? Leur mort refi’emble
à celle de ceux qu’on étrangle avec une grands
promptitude.
On a cru pendant Iong-ttenis que c’éioit à force
d’avaler de l’eau que les noyés périffoient ; mais Bec?
k e r , dans une differtation intitulée de fubmerfo/uin
morte fine potu aquce, a le premier réfuté cette opinion
par les faits.. Il a ouvert deux hommes noyés,
& ne leur a point trouvé d’eau dans Teftomac , les
inteftins, ni les poumons. Après Becker, MM. Lit-?
tre, Sénac & autres, ont confirmé la même vérité
par l ’ouverture de cadavres de gens & d’animaux qui
avoient été fubmergés.
L ’ufage commun de fufpendre par les piés ceux
qui ont été noyés, dans l’efpérance de les rappeller
à la v ie , en leur faifant rendre l’eau qu’on fuppofe
qu’ils dont avalé , n’eft donc qu’une erreur populaire.
On ne voit point que cette fufpçnfion produife
rien de favorable, §£ elle ne fait rendre , à ceux qui
viennent de fe noyer que le peu d’eau qui étoit dans
leur bouche; cependant cette pratique fubfifte toiv-
jours, parce qu’il eft Ordinaire que les, préjugés tiennent
bon non-feulement contre les raifonnemens,
mais contre l’expérience. Il y a plus, quand même
les noyés auroient avalé de l’eau, ils ne la rendroienî
pas par la fufpenfion des piés, & l’eau ne fortiroit
point de leur eftomac ou de leur poumons, en vertu
de la fituation renverfée.
Un accident ordinaire aux noyés, c’eft que leurs
corps fe gonflent. Rendus par?là plus légers, ils fur-
nagent à la furfaee de l’eau. Quelle eft la caufe
de ce gonflement ? Dans les corps vivans l’air eft
comprimé, & par la preffion de l’air extérieur, &
par la tenfion naturelle des parties, & par l’aûion du
coeur, qui pouffe continuellement dans ces efpaces
fort étroits $£ le fang , & cet air qui l’accompagne,
Dans les cadavres, il n’y a que la première caufe
de compreffion qui fubfifte , & c’eft le défaut
de la fécondé qui produit dans les noyés ce
gonflement qui leur eft particulier ; toutes leurs parties
font abreuvées d’eau, relâchées, incapables de
tenir l’air refferré, coipme elles faifoient ; & il fe
dilate autant que lui permet l’air extérieur.
Les .cadavres noyés ainfi gonflés, femblent être
fans reffource ; mais quelques cas heureux nous apprennent
à tenter tout ce que la Médecine peut era?
ployer de plus propre pour ranimer ceux qui vien-*
nent d’être fubmergés., en tâchant de rétablir leur
refpiration, foit par l’efprit de fel armOniac , qu’on
fauffleroit dans leurs narines, foit par des chofes u>
filantes, foit meme par la trachéotomie. Détqar-
dingius çonfeille ce dernier moÿeq , & dit l ’avoir
éprouvé avec fuçcès. 11 prefçrit de foufiler fortement
avec la bouche, op quelque tuyau que çe foit, une
grande quantité d’air çlans le poumon, d’qbüfd après
l’ouverture promptement faite,
L ’amour de l’humanité deyrqjf infpirer aux acca-
démies l’idée de choifir de ces fortes d’objet^ utile?
pour être je fifiet de leurs prix , & les expériences
heureufes en ce genre mériteraient des réçompen-
fes dp fouverain.
L’hiftqire de l’académie des Sciences, années 1719,
172.5 & 17 4 4 , parle beaucoup desnçyfs, mais avec
plus <}e dépenfe d’efprit, que de recherches un peu
approfondies. ( D.. j . )
No y é , fe dit de la batterie - baffe d’un vaiffeau
qui eft trop près 4g l’eau , edfonçg de façon que
la nier peut entfer par lçs fabords. Çe qui provient
quelquefois d’un défaut 4e- ÇQuftruftiouj Pu de trop
charger le bâtiment.
No yé , adj. ( Docimaflique?) fe dit d’un effai recouvert
de fes fçories, q ui, ayant perdu toute communication
ayeç l’air, êé étant plongé fous fes fçpr
ries , reffemjije à up noyé qui eft fous, i ’pap , d’oii lui
eft venu la dénomination. Il a pour fynonyme
étouffé. Voye^ à cet article ce qui rend Telia j noyé ,
de quçlle façon on.femédie à cet inçoiiyéniept. Voye^
qujji l'art. E s s a i . M. d e F il l ie r s .
N O Y ER , c’eft Taélion de fuffoquer par le moyen
de l’eau, Foye^ Su f fo c a t io n .
M. Halley pbferve que ceux qui n’ont pas l’habi?
fude de plonger s commencent à fe noyer dans l’ef?
pace d’environ une demi-miniite. Foyer Plonger.
Ç ’étoit autrefois une efpeçe de punition, Lesçhrpr
piques nous affurent que du tems de Louis XJ. roi
de France, les François condamnoient l'ouyent leurs
criminels à être noyés au lieu d’être pendus.: Chrort.
feand. Foyei P u n i t i o n .
Les auteurs d’Hiftqife naturelle & les Medécins
nous fourniflent plufieurs exemples bien vérifiés
& très-merveilleux de perfpnnes noyées qui ont recouvré
la vie ; ce qui peut-être,' en y penfant fé?
fieufement, pourroit jetter quelque lumière fur la
notion fi obfçqre que nous, ayons de la vie & de la
mort.
Pechlin , de acre. & alim. def. c. x . donne l’biftoire
d’ un jardinier deTroningholm , vivant alors, âgé de
65 ans, lequel s’étant laifle tomber, il y avoit dix-
huit ans, fous la glace, à la profondeur de 18 au-
pes, où il refta au fond fitué de bout pendant 1 £
heures ; il en fut retiré par le moyep d’un çrochet
qu’on lui enfonça dans la tête, pn l’enveloppa dans
des draps, dans Topinion oh Ton étoit que Ton pour-
roit le rappeller à la vie ; on le mania çnfuite, & on
Je frptta avec des lipgçs; 90 lui fouflla de l’qir pâlies
narines pendant plufieurs heures ; jufqu’à ce que
que le fang commençât à reprendre fon mouvement;
enfin, en lui appliquant des liqpeurs anri-apoplee-
tiques & réjouiflantes, il recouvra la vie. En mémoire
de cet accident, la reine-mere lui fit une pen-
fion annuelle, &c.
TUefius, garde de la hifiliotheqij£ du roi , nous
donne une hiftoire moins yrpiffemjîlable d’une femme
de fa çonnoiffance, qui refta fous l’eap trois jours
entiers, qui revint à la vie de la même maniéré
que le jardinier de Troninghplm. Cette femme vi-
.voit encore du teips de Tilefips.
Mai? qye dirons.-nous de Bprpianus , qui npus
pfTure qu’étant dans le village de Bpnes, de la pa-
yoiffe de Pithpp; il aflifta à foraifon funebre d’un
•ppipipe Laux-Jona, âgé de 70 ans, dans laquelle le
prédicateur rapporta que çèt homme à l’âge de 17
ans avoit. été enfe.Yeli fpp§ l’eap pendant fept femaine.,
& qu’enfin en ayant été retiré , il 6n reyint.
Pechlin ubi fup. fit penes ipfumfides, Ten croie qui
voudra. -1
§ No y e r , v - aél. fHydrY) on noie quelquefois un
jet en faifant paffer l’çau au-deffus 4^ l^ajutage , ce
qui en diminuant fa hauteur le fait paroître plus gros,
& blanc comme de la neige.
Quand pn noie un fiaffin^ c’eft pour nourrir les
^ touche alprs la décharge de'fiiperÉcie,
- Nq yçr , v* a£l. tçfrne je Peinture. Ce mot fe dit
des" couleurs & des contours ; ç’eft mêler tendre-
ment & confondre habilement jps extrémités des
couleurs , avec d’autres' qui leur font voifines.
' ..................
Nq yer , au jeu de boule ; fe dit de l’aflion par laquelle
un joueur qyapttrop donné de forçe à fa boule
, va la jetter dans le noyon.
NOYER , f. m. nux, (.Hifioire nat. Bot.') genre de
plantes à fleur en phaton , compofée de plufieurs
feuilles attachées à un axe en forme d’écailles , &
fous chapune dcfquelles il y a une grande quantité
dp fomipprs. Les embryons naiffpnt lur le même ar-
brp, mais feparepient des fleurs , & deviennent
dan§ la fuite une poque offeufe / couverte d’une
éçprçe piplle qui s’ouvre en deux p?rtjes , Sc qifi
renferipe une amende divifée le plusfouventen quar
tre parties par une cloifon ligneufe. Tournefort, infi,
rei herb. Fpyeç Plante. ( / )
Nqyer , nux jiiglans, ( Jardinage. ) grand arbre
qpe 1 on cultive pptjr fon truit dans les pays méridionaux
de l’Europe. Il y a aufli des noyers dans
T Amérique fpptentrionale, mais fi peu reffemblgns
^PX PPtrps, & f i différens entr’eux, qu’il faudra en
traitpr féparéfnent. Le noyer d’Europe fait rarpipent
une tige droite ; il s’élève à une grande hauteur ,
fpn trpn.c devient très?gros , & fa tête fe garnit de
quantité de rameaux qui s’étendent cpnfidérabler
ipçnt ; fes raçinps font longues, fortps, peu garnies
dç fibres, & elles ont communément un pivot ;
fon éporce efl: verte fur les rameaux dp Tannée,
brunp fur ceiix de la féconde, enfuite s’éçlairciffant
peu-à-ppu les deux ou trois année? fuivantes , elle
deyienç d’une couleur de cendre blanchâtre ; elle
eft unie j.ufqu’à l’âge de 25 à 30 ans , après quoi
elle cpntraûe peu-à-peu de fortes gprfures qui en
terniflent la çpuleur : fa feuille eft grande, d’un
verd clair, & d’une odeur forte & défagréable ; elle
eft compofée de plufieurs fpliioles rangées fur un
filet commun au nombre de 5 , 7 , 9 , & qqelquefois
dei 1 dans la jeuneffe,&la première force de l’arbre.
Sur la fin d’A v r il, le noyer donne quantité de char
tons longs ôç pendans'. Le fruit paroît vers le milieu
du mois de Mai féparément des chatons : il naît
au bout des nouvelles pouffes les plus foiblps. Ce
fruit eft la noix qui eft connue de tout le monde.
Elle eft renfermée dans une coquille ligneufe qui
,eft couverte d’upe écale verte, charnue , que Ton
nomme le brqu. Çet arbre eft robufte, il fe multiplie
aifépient, fon accroiffement eft prompt, &c il
eft d’une fi grande utilité qu’on peut tirer du fervicp
de toutes les parties qui le compofent.
Le noyer fe plaît dans les gorges ,cjes montagnes
dan? les coteaux , à Texpofition du nord <Sc du
levant : l’extrême chaleur lui eft plus nuifible que
le froid. Il aime fur-tout les terres mêlées de pierrailles
, de gravier , qu, de fable , & dans tous les
terrains pii la vigne fe plaît, pourvu qu’il y ait de
la profondeur & de la fraîcheur. Il vient fort bien
dans les terres franches , marneufes ou crétacées,
& dans toutes les terres à blé : on Ta yû réuffir fur
le tuf où l’on s’eft afluré que fes racines avoient
pénétré jufqu’à fept piés de profondeur. Je l’ai fait
venir de fe.mençe dans une terre dure &.'très.-ferte,