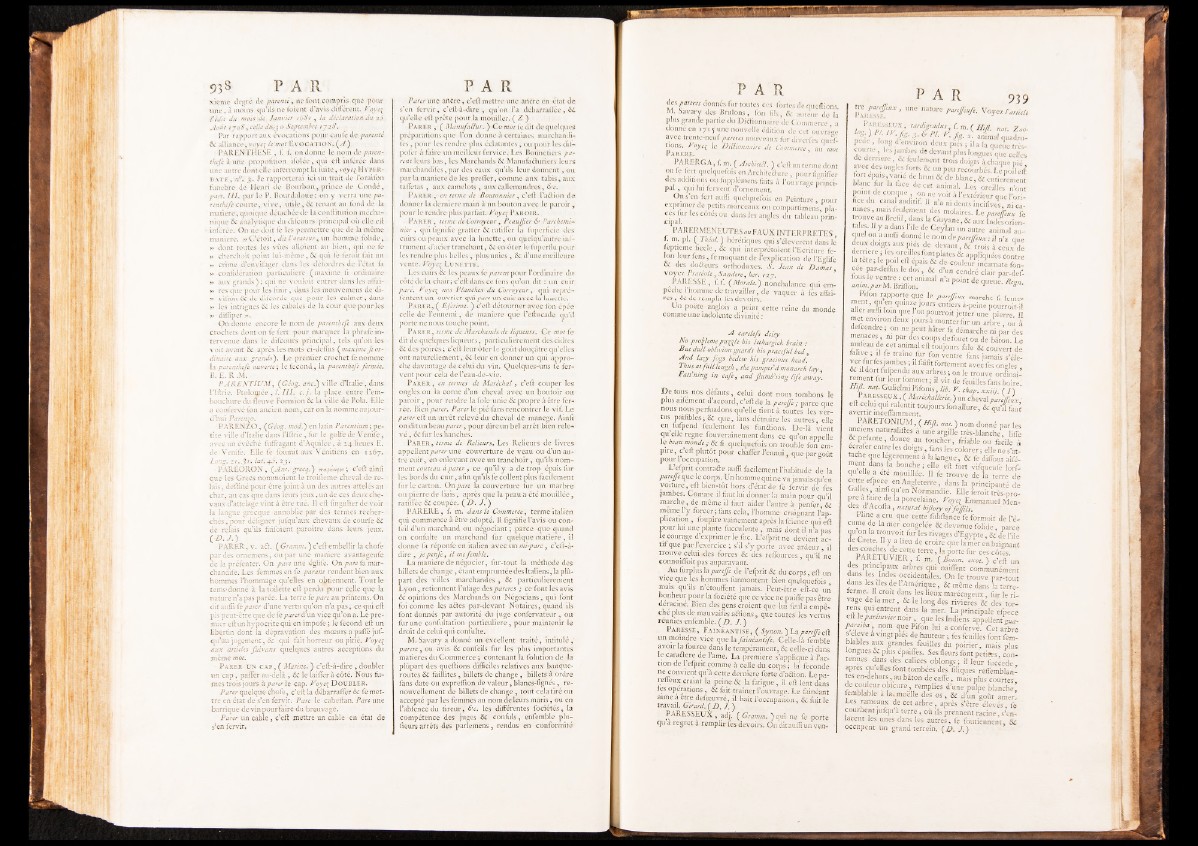
xieme degré de parenté^ ne font, compris que pôur
\me, il moins qu’ils ne foient d’avis different. Voye[
l'tJic du mois uU Janvier lô'Si , la déclaration du zJ
Août 1708, celle du\'^ o Septembre tyz8.
Par rapport aux évocations pour caul'e de parenté
& alliance, eeyc; U oeucÉv O CATION. (--/ )
PARENTHESE , f. 1'. on donne le nom de paren-
the/e à une proportion ifolée, qui eft inlérée dans
une autre dont elle interrompt la luite, voye^ Hyper-
b a t e , n°. 3. Je rapporterai ici un trait de l’orailbn
funebrè dé Henri de Bourbon, prince de Condé,
pare. III. par le P. Bourdaloue ; on y verra une pa-
renthefe courte, v iv e , utile, & tenant au tond de la
matière, quoique détachée de la conftitution média-
nique 8c analytique du diieouts principal oii elle eft
inférée. On ne doit le les permettre que de la même
maniéré. » C’étoit dit l'orateur, un homme folulc,
» dont toutes les vues alloient au bien, qui ne le
» cherchoit point lui-même, 8c qui le leroit fait un
» crime cl’envilager dans les délordres de l’état la
» conlidération particulière (maxime fi ordinaire
» aux grands ) ; qui ne vouloit entrer dans les affai-
» res que pour les finir, dans les mouvemens de cli-
» vilion 8c de dilcorde que pour les calmer, dans
» les intrigues 8c les cabales de la cour que pour les
On donne encore le nom de parenthefe aux deux
crochets dont on fe fert pour marquer la phrafe intervenue
dans le dilcours principal, tels qu’on les
voit avant 8c après les mots ci-delTus (maxime f i ordinaire
aux grands'). Le premier crochet fe nomme
la parenthefe ouverte ; le fécond, la parenthefe fermée.
B. E. R.M.
P A R E NTIUM, ( Gèog. anc.') ville d’Italie, dans
Plffrie. PtoloQiée , /. III. c .j. la place entre l’embouchure
du fleuve Formion 8c la ville de Pola. Elle
a confervé fon ancien nom, car on la nomme aujourd’hui
Paren^o.
PARENZO, (Gèog. mod.') en latin Parentium ; petite
ville d’Italie dans f lf lr ie , fur le golfe de Venil'e,
avec un évêché fuffragant d’Aquilée, à 24 lieues E.
de Venil'e. Elle fe fournit aux Vénitiens en 1267.
Long. 2 /. 3 1 • éat. 43. 23 •
•PARÉORON, (Ant. grecq.) 7rap»upov; c’efl: ainfi
que les Grecs nommoient le troifieme chevaL de relais
, deftiné pour être joint à un des autres attelés au
char, au cas que dans leurs jeux, un de ces deux chevaux
d’attelage vint à être tué. Il eft fingulier de voir
la langue grecque annoblie par des termes rècher-
chés, pour défigner jufqu’aux chevaux de courfe 8c
de relais qu’ils faifoient paroitre dans leurs jeux.
( -D .J .)
PARER, v. a£h ( Gramm. ) c’eft embellir la chofe
par des ornemens, ou par une maniéré avantageufe
de la préfenter. On pare une églile. On pare fa mar-
chandife. Les femmes en fe parant rendent bien aux
hommes l’hommage qu’elles en obtiennent. Tout le
tems* donné à la toilette eft perdu pour celle que la
nature n’a pas parée. La terre fe pare au printems. On
dit suffi fe parer d’une vertu qu’on n’a pas, ce qui eft
pis peut-être que de fe parer d’un vice qu’on a. Le premier
eft un hypocrite qui en impofe ; le fécond eft un
libertin dont la dépravation des moeurs a pafl’é juf-
qu’au jugement, 8c qui fait horreur ou pitié. Voye[
aux articles fuivarts quelques autres acceptions du
même mot.
■ P a r e r u n c a p , ( Marine. ) c’eft-à-dire , doubler
un cap, pafler au-delà , & le laitier à côté. Nous fumes
trois jours à parer le cap. Voye^ D o u b l e r .
Parer quelque chofe, c’eft la débarrafîer 8c fe mettre
en état de s’en fervir. Pare le cabeftan. Pare une
barrique de vin pour faire du breuvagè.
Parer un cable, c’eft mettre un cable en état de
s’en fervir.
Parer une aflfcre, c’ eft mettre une ancre en état de
s’en fervir, c’eft-à-dire , qu’on l’a débarrafl’é e , 8c
qu’elle eft prête pour la mouiller.. ( Z )
P a r e r , ( Manufactura ) Ce mot 1e dit de quelques
préparations que l’on donne à certaines marchandé
les, pour les rendre plus éclatantes, ou pour les dil-,
poler à .faire un meilleur l’ervice.'Les Bonnetiers parent
leurs bas, les Marchands 8c Manufa&uners leurs
marchandifes, par des eaux qu’ils leur donnent, ou
par la maniéré de les preffer, comme aux tabis, aux
taffetas , aux camelots , aux callemandres, &c.
P a r e r en terme de Boutonnier, c ’ e f t l ’ a é l i o n d e
d o n n e r l a d e r n i c r e m a i n à u n b o u t o n a v e c l e p a r o i r ,
p o u r l e r e n d r e p l u s p a r f a i t . Voye{ P a r o i r .
Parer , terme de Corroyeur, Peauffîer & Parcliemi-
nier , qui lignifie gratter 8c ratifier la fuperficie des
cuirs ou peaux avec la lunette, ou quelqu’autre inf-
trument d’acier tranchant, 8c en ôter le fuperflu pour
les rendre plus belles , plus unies, 8c d’une meilleure
vente. Voye£ Lunette.
Les cuirs 8c les peaux fe parent pour l’ordinaire du
côté de la chair; c’eft dans ce fens qu’on dit : un cuir
paré. Pbyffî nos Planches du Corroyeur, qui repré-
fentent un ouvrier qui pare un cuir avec la lunette.
P a r e r , ( EJ'crime. ) c’eft détourner avec fon épée
celle de l’ennemi, de maniéré que l’eftocade qu’il
porte ne nous touche point.
P a r e r , terme de Marchands de liqueurs. Ce mot fe
dit de quelques liqueurs, particulièrement des cidres
8c des poires ; c’eft: leur ôter le goût douçâtre qu’elles
ont naturellement, 8c leur en' donner un qui approche
davantage de celui du vin. Quelques-uns fe fervent
pour cela de l’eau-de-vie.
P a r e r , en termes de Maréchal, c’eft couper les
ongles ou la corne d’un cheval avec un boutoir ou
paroir, pour rendre la foie imie 8c propre à être ferrée.
Bien parer. Parer le pié fans rencontrer le vif. L e
parer eft un 'arrêt relevé du cheval de manege. Ainft
on dit un beau parer, pour dire un bel arrêt bien relev
é , & fur les hanches.
P a r e r , terme de Relieurs. Les Relieurs de livres
appellent parer une couverture de veau ou d’un autre
cuir, en enlevant avec un tranchoir, qu’ils nomment
couteau à parer y ce qu’il y a de trop épais fur
les bords du cuir, afin qu’ils fe collent plus facilement
fur le carton. On pare la couverture fur un marbre
ou pierre de liais, après que la peau a été mouillée,
ratifiée 8c coupée. (D . J.')
PARERE, f. m. dans le Commerce, terme italien
qui commence à être adopté. Il fignifie l’avis ou con-
feil d’im marchand ou négociant ; parce que quand
on confulte un marchand fur quelque m atière, il
donne fa réponfe en italien avec un mi-pare , c’eft-à-
dire , je penfe, il me femble.
La maniéré de négocier, fur-tout la méthode des
billets de change, étant empruntée des Italiens, la plupart
des villes marchandes , 8c particulièrement
Lyon, retiennent l’ufage des parères ; ce font les avis
8c opinions des Marchands ou Négocians, qui font
foi comme les a êtes par-devant Notaires, quand ils
font donnés par autorité du juge confervateur, ou
fur une confultation particulière, pour maintenir le
droit de celui qui confulte.
M.Savary a donné un excellent traité, intitulé
parère, ou avis 8c confeils fur les plus importantes
matières du Commerce ; contenant la folution de la
plupart des queftions difficiles relatives aux banqueroutes
8c faillites , billets de change , billets à ordre
fans date ou expreffion de valeur, blancs-fignés , renouvellement
de billets de change , tout cela tiré ou
accepté par les femmes au nom de leurs maris, ou en
l’abfence du tireur, &c. les différentes fociétés, la
compétence des juges 8c confuls, enfemble plusieurs
arrêts des parlemens, rendus en conformité
îles parères donnés fur toutes ces fortes de queftions,
M. bavary des Brûlons, fon fils, 8c auteur de la
plus grande partie du Diflionnairc de Commerce a
donne en 1715 une nouvelle édition de cet ouvrage
avec trente-neuf parères nouveaux fur diverfes quef-
tions. Voy^ le Dictionnaire de Commerce, aul mot
P A R E R E .
PARERGA, f. m. ( Jrchitecl. ) c’eft un terme dont
on lç le et quelquefois en Architefture , pour fignifier
des additions ou fupplcmens faits à l’ouvrage princi-
p a l, qui lui lcrvent d’ornement.
On s en fert auffi quelquefois en Peinture, pour
exprimer de petits morceaux ou compartimens, places
fur les cotés ou dans les angles du tableau principal.
. 1
PARERMENEUTES ou FAUX INTERPRETES,
f. m. pl. ( Théol. ) hérétiques qui s’élevèrent dans le
leptieme fiecle, 8c qui interprétaient l’Ecriture félon
leur fens, fe moquant de l’explication de l’Eglife
& des dodeurs orthodoxes. S. Jean de Damas
voyez P ratio le, Sandere, her.'tzy.
PARESSE , f. f. (Morale.) nonchalance qui empêche
l’homme de travailler, de vaquer à fes affaires
, 8c de remplir fes devoirs.
Un poète anglois a peint cette reine du monde
comme une indolente divinité :
A carelefs deity
No problème pu^le his Lethargick brain ;
But dull oblivion guards his peaceful bed
And la\y fogs bedew his gracions head.
7%/« at fu ll length, the pamptrd monarch Lay,
Faiïning in café, and fumb'ring Life away.
D e tous nos defauts, celui dont nous tombons le
plus aifément d’accord, c’eft de la pareffe ; parce que
nous nous perfuadons qu’elle tient à toutes les vertus
paifibles; & que, fans détruire les autres, elle
en fiifpend feulement les fondions. De-là vient
qu’elle régné fouverainement dans ce qu’on appelle
le beau monde ; 8c fi quelquefois on trouble fon empire
, c eft plutôt pour chafler l’ennui, que par goût
pour l’occupation.
L’efprit contrade auffi facilement l’habitude de la
pareffe que le corps. Un homme qui ne va jamais qu’en -
yoiture, eft bien-tôt hors d’état de fe fervir de fes
jambes. Comme il faut lui donner la main pour qu’il
marche^, de meme il faut aider l’autre à penfer, 8c
meme 1 y forcer ; fans cela, l’homme craignant l’application
, foupire vainement après lafcience qui eft
pour lui une plante fucculente , mais dont il n’a pas
le courage d’exprimer le fuc. L’efprit ne devient act
if que par l’exercice ; s’il s’y porte avec ardeur , il
trouve celui ides forces & des refiources , qu’il ne
connoifloit pas auparavant.
Au furplus la pareffe de l’elprit 8c du corps, eft un
vice que les hommes furmontent bien quelquefois
mais qu’ils n’étouffent jamais. Peut-être eft-ce un
bonheur pour la fociété que ce vice ne puifle pas être
déraciné. Bien des gens croient que lui feul a empêché
plus de mauvaifes adions, que toutes' les vertus
reunies enfemble. (D . J .)
P a r e s s e , F a i n é a n t i s e , ( Synon. ) La pareffe eft
un moindre vice que la fainéantife. Celle-là femble
avoir la fource dans le tempérament, 8c celle-ci dans
le caradere de l’ame. La première s’applique à l’action
de 1 efprit comme à celle du corps ; la fécondé
ne convient qu’à cette derniere forte d’adion. Le pa-
refîeux craint la peine & la fatigue , il eft lent dans
les opérations , 8c fait traîner l’ouvrage. Le fainéant
aime a etre defoeuvré, il hait l’occupation, 8c fuit le
travail. Girard. (D . J .)
PARESSEUX, adj. ( Gramm. ) qui ne fe porte
qu à regret à remplir fes devoirs. On dit auffi un ven-
P a r e s se ’ U" e " atUre ^ H | V oy z iC a n id ,
P a r e s s e u x , tardigradus. f. m. f Ni fl v „
log. ) PL IV. fil. o £ pl % T Z °0‘
M m Ü 0 A b 3 Y * m W® animal quadruco
Y S T courte les jambesT de dfeevuaxn tp prlu s; lioUngUue sp V iee c terlèles-s
de dernere & feulement trois doigts 4 chaqTte pii
avec des ongles forts & un peu recourbés. LepoSeif
fort épais varré de brun & de blanc, & entièrement
blanc fur la face de cet animal. Les oreilles n’ont
po.n de conque on ne voit à l’extérieur que l W
ficedu canal audit,f. H n’a ni dents incifives, ni canines
, mais feulement des molaires. Le pareteux fe
trouve auBrefil dans la Guyane, & aux fndraorîenonel
O y a I r 'u K p Cey lan un autre animal auquel
on a auffi donné. le nom de parefeux ■. il n’a que
deux doigts aux pies de devant, & trois à ceuxde
t X ’ V fes. ° Y esfon‘ P'ates & appliquées contre
la tête, le poil eft épais & de- couleur incarnate foncée
par-deffus le dos, & d’un cendré clair par-def-
fous le ventre : cet animal n’a point de queue Reen
amm. par M. Brifîon. * ‘ 8 •
Pifon rapporte que le parefeux marche f, lente-
X ’ WM W M ,OUrS entlers à-Peine pourroit-il
allei auffi loin que Ion pourrait jetter. une^foierre. Il
met environ deux jours à monter fur un arbre , ou à
defeendre; on ne peut hâter fa démarche ni par des
menaces , m par des coups de fouet ou de bâton Le
mufeau de cet animal eft toujours fale & couvert de
fahve ; il fe traîne fur fon ventre fans jamais s’élever
fui fes jambes ; ,1 fa,fit fortement avec fes ongles ,
& il dort fufpendu aux arbres ; on le trouve ordinai-
rement fur leur fommet ; il vit de feuilles fans boire.
Hlft. nat. Guhelmi Pifonis , lib. V. chap. xxiii: ( n
P a r e s s e u x ( Maréckallerie. ) un cheval parcffiux -
elt celui qui ralentit toujours fon allure, & qu’il feut
avertir inceflamment. ”
.• .PARETONIUM, ( Hijl.nat. ) nom donné par les
mciens naturaliftes à M e argille très-blanche, liffe
oc pelante, douce, au toucher, friable ou facile à
ecrafer entre les doigts, fans les colorer; elle ne s’at-
teche que legerement à la Umgue, & fe diffout aifé-
ment dans la bouche ; elle eft fort vifqueufe lorf-
que fiea été mouillée. II fe trouve de la terre de
cette efpece en Angleterre, dans la principauté de
Galles, ainfi qu en Normandie. Elle ferait irès-pro-
Sdefz djM Aicroeift!a,l anpa0turrcaell ahiinfloer- yH offofj iElsm. manuel Men-
Pline a cru que cette fubftance fe formoit de l’écume
de la mer congelée & devenue folide, parce
qu on la trouvoit fur les rivages d’Egypte, & de lfile'
de Crete. Il v a lieu de croire que la mer en baignant
terre>la porte fur ces côtés.
PARÉTUVIER f. m. ( Botan. exot. ) c’eft un
des principaux arbres qui naiffent communément
dans les Indes occidentales. On le trouve par-tout
dans les fies de l’Amérique, & même dans la terre-
terme. Il croit dans les lieux marécageux fur le ri-
vage de la mer, & le long des rivières & des tor-
rens qui entrent dans la mer; La principale efpece
elt le parctuvicr noir , que les Indiens appellent gua-
paraiba, nom que Pifon lui a confervé. Cet arbre
W M vmSt pics de hauteur ; fes feuilles font fem-
blables aux grandes feuilles du poirier, mais plus
longues & plus épaiffes. Ses fleurs font petites, contenues
dans des calices oblongs ; fi leur fuccede
apres qu’eUés font tombées des filiques reffemblan-
tes en-dehors, au bâton de cafte , mais plus courtes,
de couleur obfcure, remplies d’une pulpe blanche,
femblable à la. moelle des os , & d’un goût amer’
Les rameaux de cet arbre, après s’être élevés fe
courbent jufqu’à terre , oii ils prennent racine, s’enlacent
les unes dans les autres, fe foutiennent &
occupent u n grand terrain. ( D . J.)