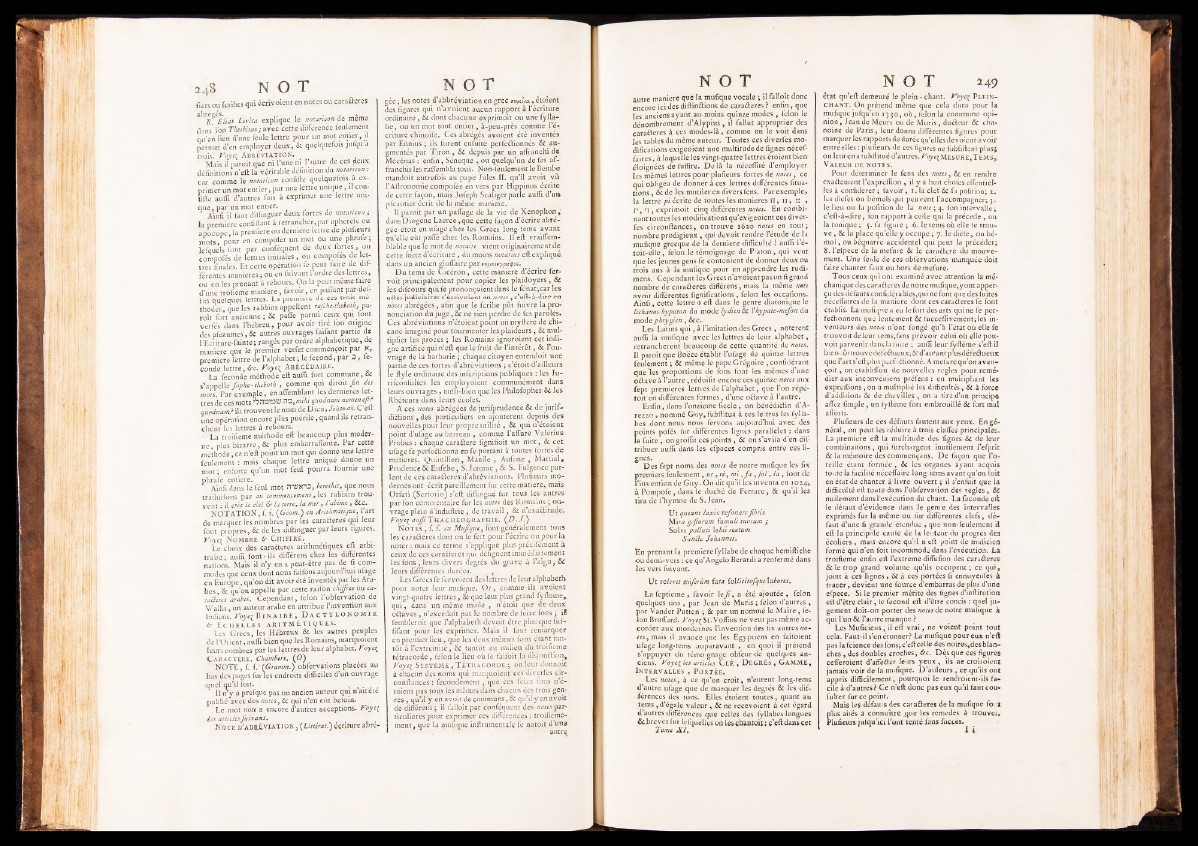
fiers pu fciibes qui écrivoient en notes ou caraâeres
Elias Ltvita explique le nolancon de même
dans ïcm TlusHtas; avec cette différence feulement
qu’ aff lieu d’une feule lettre pour un mot entier, il
pèrnjèt d’en employer deux, & quelquefois jufqu a :
trois. Voye{ ABREVIATION. ^
Mais il paroît que ni l’une ni l’autre de ces .deux
définitions n’eft la véritable définition du nauncoi,:
cai- comme le nolancon conliite q.ielqumois a exprimer
un mot entier, par une lettre unique, il con-
lille aufli d’autres fois à exprimer une lettre uni-
qu e , par un mot entier.
Ainfi il faut diftinguer deux fortes de nuançons
la première confiftant à retrancher, par apherdf pu
apocope, la première ou derniere lettre de plufieurs
mots 1 pour en compofer un mot ou une phrafe ;
lefquels font par conféquent de deux fortes, ou
compofés de lettres initiales , ou compotes de lettres
finales. Et cette opération fe peut faire de différentes
maniérés ; ou en fuivant l’ordre des lettres,
ou en les prenant à rebours. On la peur même faire
d’une trofienie maniéré, lavoir, en panant par-det-
1 quelques lettres. La première de ces trois méthodes,.
que les rabbins appellent rafiht-ihcboth,™-
ï-oît for: ancienne ; & paffe parmi ceux qui font
verfés dans l’hébreu, pour avoir tire fon origine
dés pfeaumes, & autres ouvrages faifant partie de
l ’Ecriturë-fainte; rangés par ordre alphabétique, de
manière mie le premier verfet commençoit par K,
première lettre de l’alphabet; lefecond,par S , féconde
lettre, fi-c. Voy‘ \ Abk ck im ik k .
La fécondé méthode eft auiïi fort commune, K
s’appelle Tophi-thiboth , comme qui diroit,/« dis
mots Par exemple, enaffemblant lesdermeres let-
tresdecesmbts biWieV na.mihi,juodnam nominf?
quednamk'às trouvent le nom de Dieu, Jckoyah.l^ eit
une opération encore plus puérile, quand us retranchent
les lettres à rebours. N f ;
* La troifieme méthode eft beaucoup plus moderne
, plus bizarre, St plus embarraflante. Par cette
méthode, ce n’eft point un mot qui donne une lettre
feulement : mais chaque lettre unique donne un
mot ; enforte qu’un mot feul pourra fournir une
phrafe entière.
Ainfi dans le feul mot 7V m ^ , bereshu, que nous
traduifons par au commencement, les rabbins trouvent
: il créa le ciel & la terre, la mer , l'abîme , Stc.
NOTATION , f. f. {Géom.) en Arithmétique, l’art
de marquer les nombres par les caractères qui leur
font propres, St de les diftinguer par leurs figures.
y o y e i Nombre & C hiffre.
Le choix des caraâeres arithmétiques eft arbitraire
; aufli font - ils différens chez les différentes
nations. Mais il n’y en a peut-être pas de fi commodes
que ceux dont nous faifons aujourd hui ufage
en Europe, qu’on dit avoir été inventés par les Arabes
& qu’on appelle par cette raifon chiffres ou caractères
arabes. Cependant, félon l ’obfervation de
Wallis, un auteur arabe en attribue l’invention aux
Indièns. Foye^ B i n a i r e , D a c t y l o n o m i e
& E c h e l l e s a r i t m é t i q u e s . ,
Les Gre cs, les Hébreux St les autres peuples
de l’Orient, aufli bien que les Romains, marquoient
leurs, n ombres par les lettres de leur alphabet. Voye.1
C arac tère. Chambtrs. (O)
I N O T E , L i:(Grammy obfervations placées au
bas des pages fur les endroits difficiles d’un ouvrage
«quel qu’il lbit. . . , . , ,
Il n’y a prefque.pas.un ancien auteur qui n ait ete
publié avec des notes, & qui n’en eut beloin.
Le mot note a encore d’autres acceptions. Voye^
.les articles fuivans.
N o t e d’a b&év iat io n , {Littéral.) écriture abrégée
; les notes d’abbréviation en grec tY/Aut, étoient
des figures qui n’avoient aucun rapport à l’écriture
ordinaire, St dont chacune exprimoit ou une fylla-
b e , ou un mot tout entier, à-peu-près comme l’écriture
chinoife. Ces abrégés a voient été inventés
par Ennius ; ils furent enfuite perfeâionnés & augmentés
par T iro n , St depuis par un affranchi de
Mécénas : enfin, Séneque , ou quelqu’un de fes affranchis
les raffembla tous. Non-feulement le Bembe
mandoit autrefois au pape Jules II. qu’il avoit vu
l’Aftronomie compofée en vers par Hippinus écrite
de cette façon, mais Jofeph Scaîiger parle aufli d’un
pféautier écrit de la même maniéré.
Il paroît par un paffage de la vie de Xenophon
dans Diogene Laerce ,que cette façon d’écrire abrégée
étoit en ufage chez les Grecs long-tems avant
qu’elle eût pafle chez les Romains. Il eft vraiflem-
blable que le mot de notaire vient originairement de
cette forte d’écriture, du moins notarius eft expliqué
dans un ancien gloffaire par M/Autypctçoç.
D u tems de Cicéron, cette maniéré d’écrire fer-
voit principalement pour copier les plaidoyers, St
les difeours qui fe prononçoientdans le fénat;car les
aâes judiciaires s’écrivoient en notes, c’eft-à-dire en
notes abrégées, afin que le feribe pût fuivre la prononciation
du juge, & ne rien perdre de fes paroles.
Ces abréviations n’étoierit point un myftere de chicane
imaginé pour tourmenter les plaideurs , St multiplier
les procès ; les Romains ignoroient cet indigne
artifice qui n’eft que le fruit de l’intérêt, & l’ouvrage
de la barbarie ; chaque citoyen entendoit une
partie de ces fortes d’abréviations ; c’étoit d’ailleurs
lé ftyle ordinaire des infcriptio'ns publiques : les Ju-
rifconfultes les employoient communément dans
1 leurs ouvrages , aufli-bien que les Philofophes Si les
Rhéteurs dans leurs écoles.
A ces notes abrégées de jurifprudence St de jurif-
diâions, des particuliers en ajoutèrent depuis des
nouvelles pour leur propre utilité , St qui n’étoient
point d’ufage au barreau , comme l’affure Valerins
Probus : chaque caraâere fignifioit un mot, & cet
ufage fe perfectionna en fe portant à toutes fortes de
matières. Quintilien, Manile , Aufone , Martial,
Prudence St Eufebe, S. Jerome, & S. Fulgence parlent
de ces caraâeres d’abréviations. Plufieurs modernes
ont écrit pareillement fur cette matière, mais
Orfati (Sertorio) s’eft diftingué fur tous les autres
par fon commentaire fur les notes des Romains ; ouvrage
plein d’induftrie , de tra vail, St d’exaâitude.
Voyt^ û«^£Th a ch é o g r a ph ie . {D .J .)
N o t e s , f, f. en Mujîque, font généralemênt tous
les caraûeres dont on fe fert pour l’écrire ou pour la
noter : mais ce terme s’applique plus précisément à
ceux de ces caraCteres qui délignent immédiatement
les fons , leurs divers degrés du grave à l’aigu, St
leurs différentes durées. \
Les Grecs fe fervoient des lettres de leur alphabeth
pour noter leur mufique. O r , comme ils avoient
vingt-quatre lettres, &• que leur plus grand fyfteme,
qui, dans un même mode , n’étoit que de deux
oCtaves, n’excédoit pas le nombre de feize fons ; iB
fembleroit que l’alphabeth devoit être plus que fuf-
fifant pour les exprimer. Mais il faut remarquer
en premier lieu, que les deux mêmes fons étant tan-,
tôt à l’extrémité, St tantôt au milieu du troifieme
tétracorde, félon le lieu où fe faifoit la disjonction*
Voye£ S y s t è m e , T é t r a c o r d e ; on leur donnoit
à chacun des noms qui marquoient ces diverfes cir-
conftances : fecondement, que ces feize fons n’é-
tôient pas tous les mêmes dans chacun des trois gen?
r e s , qu’il y en avoit de communs, & qu’il y en avoit
de différens ; il' falloit par conféquent des notes particulières
p'our exprimer ces différences ; troifieme«
ment, que la mufique infiniment ale fe notpit d’une
autre
autre maniéré que la mufique vocale ; il falloit donc
encore ici des diftinâions de caraCteres ? enfin y que
les anciens ayant au-moins quinze modes , félon le
dénombrement d’Alypius, il fallut approprier des
caraCteres à ces modes-là, comme on le voit dans
les tables du même auteur. Toutes ces diverfes modifications
exigeoient une multitude de fignes nécef-
faires, à laquelle les vingt-quatre lettres étoient bien
éloignées de fuffire. De là la néceflîté d’employer
les mêmes lettres pour plufieurs fortes de notes, ce
qui obligea de donner à ces lettres différentes fitua-
tions, St de les mutiler en divers fens. Par exemple»
la lettre pi écrite de toutes les maniérés n , u , G ,
r , H, exprimoit cinq différentes notes. En combinant
toutes les modifications qu’exigeoient ces diverfes
circonftances, on trouve 1620 notes en tout;
nombre prodigieux , qui devoit rendre l’étude de la
mufique grecque de la derniere difficulté ! aufli l’é-
toit-elle, félon le.témoignage de Piaton, qui veut
que les jeunes gens fe contentent de donner deux ou
trois ans à la mufique pour en apprendre les rudi-
mens. Cependant les Grecs n’avoient pas un fi grand
nombre de caraâeres différens, mais la même note
avoit différentes fignifications, félon les occafions.
Ainfi, cette lettre d> eft dans le genre diatonique le
lichanos hypaton du mode lydien St l’hypate-mefon du
mode phrygien, & c .
Les Latins q u i, à l’imitation des Grecs , notèrent
aufli la mufique avec les lettres de leur alphabet,
retranchèrent beaucoup de cette quantité de notes.
Il paroît que Boëce établit l’ufage de quinze lettres
feulement ; & même le pape Grégoire , confidérant
que le s proportions de fons font les mêmes d’une
o â a v e à l’autre, réduifit encore ces quinze notes aux
fept premières lettres de l’alphabet, que l’on répé-
toit en différentes formes, d’une oCtave à l’autre.
Enfin, dans l’onzieme fiec le, un bénédictin d’ A-
rezzo , nommé Guy, fubftitua à ces lettres les fylla-
bes dont nous nous fervons aujourd’hui avec des
points pofés fur différentes lignes parallèles : dans
la fuite , on groflit ces points , & on s’avifa d’en dif-
tribuer aufli dans les efpaces compris entre ces lignes.
Des fept noms des notes de notre mufique les fix
premiers feulement, u t , ré, mi %fa ,fo l , la , font de
l’invention de Guy. On dit qu’il les inventa en 1024,
à Pompofe, dans le duché de Ferrare, & qu’il les
tira de l’hymne de S. Jean.
Ut queant Iaxis refonare fibris
Mira gejlorum farnuli tuorurn ;
Solve polluti labii reatum
Sancle Johannes.
En prenant la première fyllabe de chaque hemiftiche
ou demi-vers : ce qu’Angelo Berardi a renfermé dans
les vers fuivant.
Ut relevet miferûm (ata (oUicitofque \abores.
La feptieme, fa voir a été ajoutée, félon
quelques uns , par Jean de Mûris ; félon d’autres ,
par Vander Putten ; & par un nommé le Maire, félon
Broflard. Voyc^Si. Voffius ne veut pas même accorder
aux mordernes l’invention des lix autres no~
tes, mais il avance que le,s Egyptiens en failoient
ufage long-tems auparavant , en quoi il prétend
s’appuyer du témo gnage obfcur de quelques anciens.
Foye[ les articles C l É , D E G R É S , G A M M E ,
I n t e r v a l l e s , P o r t é e .
Les notes, à ce qu’on croit, n’eurent long-tems
d’autre ufage que de marquer les degrés & les différences
des tons. Elles étoient toutes, quant au
tems , d’égale valeur , & ne recevoient à cet égard
d’autres différences que celles des fyllabes longues
de brèves iur lelqueUes on les chantoit ; ç’eft dans cet
Tome K l ,
état qtfieft demeuré le plein - chant. Voye^ Plein-
chant. On prétend même que cela dura pour la
mufique jufqu’en 1330, où , félon la commune opinion,
Jean de Meurs ou de Mûris, dofteur & chanoine
de Paris, leur donna différentes figures pour
marquer les rapports de durée qu’elles dévoient avoir
entre elles : plufieurs de ces figures ne fubfiftent plus;
on leurena lubftitué d’autres. ^oye^MESURE,TEMS,
Valeur de notes.
Pour déterminer le fens des notes, & en rendre
exactement l’expreffion , il y a huit choies eflentiel-
les à confiderer ; favoir , 1. la clef & fa pofition; 2.
les dièfes ou bémols qui peuvent l’accompagner; 3.
le lieu ou la pofition de la note ; 4. Ion intervalle ;
c’eft-à-dire, ion rapport à celle qui la précédé , ou
la tonique ; 5. fa figure ; 6. le tems où elle le trouve
, & la place qu’elle y occupe ; 7. le dièfe, ou bémol
, ou béquarre accidentel qui peut la précéder;
8. l’efpece de la mefure & le caraftere du mouvement.
Une feule de ces obfervations manquée doit
faire chanter faux ou hors de mefure.
Tous ceux qui ont examiné avec attention la me-
chanique des caraCteres de-notre mufique,y ont apper-
çu des défauts conficlérables,qui ne font que des fuites
néceflaires de la maniéré dont ces caraCteres fe font
établis. La mufiqne a eu le fort des arts qui ne fe perfectionnent
que lentement & iucceflîvement;Ies inventeurs
des notes n’ont longé qu’à l’état où ellefe
trou voit de leur tems,fans prévoir celui où elle pou-
voit parvenir dans la fuite ; aufîï leur fyftème s’eft il
bien-:ôrtrouvédéfeCtueux;&d’autantp’usdéfeClueux
que l’art s’eft plus perfectionné. A melure qu’on a va n-
ço it , on établiflbit de nouvelles régies pour remédier
aux inconvéoiens préfens : en multipliant les
expreflions, on a multiplié les difficultés, & à force
d’additions & de chevilles , on a tiré d’un principe
affez fimple, un lyftème fort embrouillé & fort mal
aflorti.
Plufieurs de ces défauts fautent aux yeux. En général,
on peut les réduire à trois clafles principales.
La première eft la multitude des fignes St de leur
combinailons, qui furchargent inutilement l’efprit
St la mémoire des commença ns. De façon que l’oreille
étant formée, St les organes ayant acquis
toute la facilité néceflaire long-tems avant qu’on foit
en état de chanter à livre ouvert ; il s’enfuit que la
difficulté eft toute dans l’obfervation des réglés, St
nullement dans l’exécution du chant. La fécondé eft
le défaut d’évidence dans le genre des intervalles
exprimés fur la même ou fur différentes clefs, défaut
d’une fi grande étendue , que non-feulement il
eft la principale caule de la lenteur du progrès des
écoliers , mais encore qu’il n’eft point de muficien
formé qui n’en foit incommodé dans l’exécution. La
troifieme enfin eft l’extrême diffufion des caraâeres
St le trop grand volume qu’ils occupent ; ce qui,
joint à ces lignes, St à ces portées fi ennuyeufes à
tracer, devient une fource d’embarras de plus d’une
efpece. Si le premier mérite des fignes d’inftitution
eft d’être clair, le fécond eft d’être concis : quel jugement
doit-on porter des notes de noire mufique à
qui l ’un St l’autre manque ?
Les Muficiens, il eft v ra i, ne voient point tout
cela. Faut-il s’en étonner? La mufique pour eux n’eft
pas la Icience des fons; c’eft celle des noires,des blanches
, des doubles croches, &c. Dès que ces figures
cefleroient d’affeâer leurs y e u x , ils ne croiroient
jamais voir de la mufique. D ’ailleurs , ce qu’ils ont
appris difficilement, pourquoi le rendroient-ils facile
à d’autres 1 C e n’eft donc pas eux qu’il faut cou-
fulter fur ce point.
Mais les défauis des caraâeres de la mufique fo t
plus ailes à connoître .que les remedes à trouver,
Plufieurs julqu’ici l’ont tenté fans fuccès.Ii